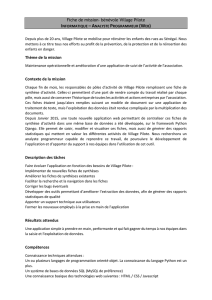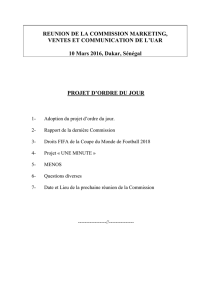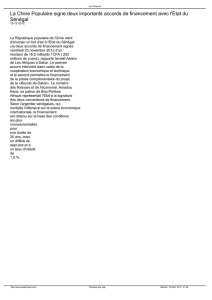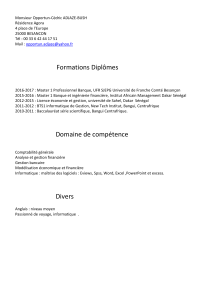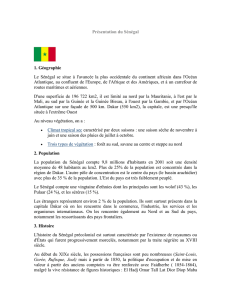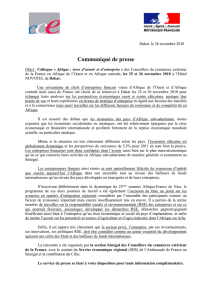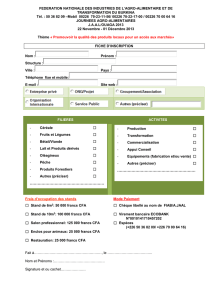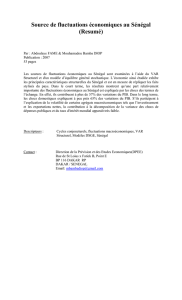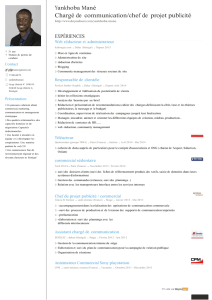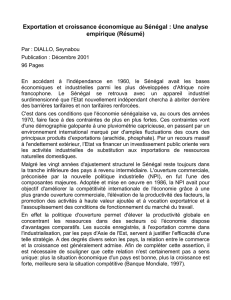Économie populaire et marchande sur le marché des TIC

Économie populaire et marchande
sur le marché des TIC au Sénégal :
entre concurrence, complémentarité et collaboration
Olivier SAGA
EBAD, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Depuis le début des années 2000, le Sénégal connaît une forte
pénétration de la téléphonie mobile accompagnée d’une lente, inégale
mais sûre diffusion des Technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les différentes sphères de la société.
L’importance de cette tendance est telle que le secteur des
télécommunications contribue à hauteur de 8 % à la constitution du
Produit intérieur brut (PIB). Pour apprécier correctement ce phénomène,
il faut cependant prendre en compte les grandes caractéristiques de
l’économie sénégalaise, à savoir un secteur primaire qui emploie 60 %
des actifs et un secteur tertiaire qui génère quant à lui 60 % du PIB
(Afrikeco, 2003) sans oublier un secteur dit « informel » qui participe
pour 60 % au PIB. Dès lors, il est utile de s’interroger sur le rôle joué par
ce dernier dans le processus de vulgarisation des TIC dans la société
sénégalaise dans la mesure où économistes, anthropologues et
sociologues ont l’habitude d’opposer, dans leurs analyses des pays en
voie de développement, un « secteur informel », considéré comme
« archaïque » et un « secteur formel » présenté comme étant le « secteur
moderne » de l’économie.
L’observation de la réalité quotidienne fournit moult illustrations
de la présence, sur le marché des biens et services TIC, symbole par
excellence de la modernité, des acteurs du secteur dit « informel » que
nous préférons caractériser par le vocable « économie populaire ». Il
existe en effet un large spectre d’activités, liées à la société de
l’information, dans lesquelles les acteurs de l’économie populaire
interviennent à un titre quel qu’il soit avec une ampleur plus ou moins
grande. Parmi celles-ci, nous citerons la revente de services de téléphonie
dans les télécentres et de services d’accès à Internet dans les
cybercentres, la vente, la réparation et le décodage de téléphones
portables, la revente de cartes SIM et de recharges téléphoniques, la vente
de matériel informatique, la récupération de déchets électroniques, etc. À
celles-ci s’ajoutent des activités plus ou moins légales telles que

Économies populaire et marchande sur le marché des TIC au Sénégal
154
l’installation de dispositifs de réception de bouquets télévisés cryptés ou
encore la vente de copies pirates de logiciels, de clips vidéo sou de films,
etc.
Nous basant essentiellement sur l’analyse de travaux de recherche,
de rapports d’experts, d’articles de presse et de nos propres observations,
nous délimiterons d’abord le périmètre de l’économie populaire au sein
du marché des produits et des services TIC. Dans un second temps, nous
nous attacherons à expliquer la nature des relations existant entre
l’économie populaire et le secteur moderne de l’économie, de même que
l’influence réciproque qu’ils peuvent exercer l’un sur l’autre.
1. Économie populaire : bien plus que le secteur informel
Le concept de secteur informel a fait son apparition dans la
littérature économique des années 1970 suite aux travaux entrepris dans
le cadre du Programme mondial de l’emploi par le Bureau international
du travail (BIT) (Charmes, 1990). Il a été découvert au Ghana et au
Kenya où ont été identifiées les notions d’emploi et d’entreprises
informels avant que cette notion de « secteur informel » ne soit adoptée
sur le plan international en 1993. La 15
e
Conférence internationale sur les
statistiques du travail (CIST) l’a décrit « comme un ensemble d’unités de
production des biens ou des services en vue principalement de créer des
emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités ayant
un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle de manière
spécifique, avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant
que facteurs de production. Les unités de production du secteur informel
présentent les caractéristiques particulières des entreprises
individuelles. » (ACS, 2007).
Échappant généralement à tout contrôle étatique et n’ayant aucun
caractère officiel, les activités du secteur informel ne sont cependant ni
clandestines ni criminelles même si elles se développent souvent en
marge de la légalité (CONESA, 2001). Cela étant, si dans les pays
développés, évoluer dans le secteur informel signifie être marginal par
rapport à un système économique et social très formalisé (Fall et al.,
2003), il en est tout autrement dans les pays dits en voie de
développement. En effet, compte tenu de l’importance du secteur
informel en termes d’emplois et de contribution à l’économie, c’est plutôt
le secteur formel qui serait marginal. De longue date, la préoccupation
des États et des bailleurs de fonds a été de faire disparaître le secteur
informel en tentant de l’intégrer progressivement au secteur formel. Force
est de constater que loin d’avoir régressé, il s’est plutôt développé au

Des réseaux et des hommes. Les Suds à l’heure des TIC
155
point de dominer l’économie de nombre de pays africains (Verick, 2006).
Cette économie populaire, différente du secteur marchand capitaliste et
du secteur étatique, se caractérise non par des investissements en
capitaux, mais par l’investissement de la force de travail dans de petites
entreprises ou des activités individuelles (Castel, 2007). Dans un pays
comme le Sénégal, si elle a pendant longtemps échappé à toute forme de
fiscalité, elle est, depuis la réforme du Code général des impôts de 2004,
soumise à la Contribution globale unique (CGU) et contribue dès lors au
tiers des recettes fiscales (Ndiaye et al., 2008). Se nourrissant de
l’excédent structurel de main-d’œuvre résultant de divers phénomènes
tels que l’urbanisation, l’exode rural, le chômage urbain, la faible densité
industrielle, etc., cette économie populaire constitue une véritable
« armée de réserve » (Ikonicoff et al., 1980) sur laquelle s’appuie le
secteur moderne afin de confiner l’emploi formel dans des limites
minimales et peser ainsi sur les salaires, les avantages sociaux et la
protection sociale. Elle a fortement progressé suite aux Politiques
d’ajustement structurel (PAS) imposées par les institutions de Bretton
Woods dans les années 1980 qui ont eu pour conséquences la fermeture
de nombreuses entreprises publiques, parapubliques et privées ainsi que
la diminution des effectifs de la Fonction publique dans le cadre du
programme des « départs volontaires » (Fall, 1993). Pendant des années,
les activités de l’économie populaire se sont partagées entre le commerce,
la production, le transport et le bâtiment. Cependant, forte de ses
capacités d’adaptation, elle a évolué en fonction de la conjoncture
économique et des orientations des politiques publiques ce qui lui a
permis de tirer profit des nouvelles opportunités offertes par la
libéralisation de l’économie, la globalisation des échanges ainsi que le
développement des TIC (Gaufryau et al., 1997).
1.1. Le catalyseur : l’autorisation de la revente de services
téléphoniques
Jusqu’au début des années 1990, l’économie populaire était quasi
absente du secteur des TIC au Sénégal. Il faut dire qu’à l’époque, le
niveau d’informatisation de la société était relativement faible, la
téléphonie mobile inexistante et le marché des télécommunications
n’avait pas encore été libéralisé. Les choses changèrent en 1993. La
Société nationale de télécommunications du Sénégal (Sonatel) autorisa la
revente de services téléphoniques dans des « télécentres privés » afin de
démocratiser l’accès au téléphone dans le cadre de sa politique de service
universel (Sagna, 2008). Il s’agissait d’un agrément la liant à une
personne physique ou morale en vue de l’exploitation d’un local d’une
superficie minimale de 12 m
2
, comprenant un dispositif de taxation et

Économies populaire et marchande sur le marché des TIC au Sénégal
156
spécialement aménagé pour la vente de services de téléphonie ou de
télécopie. L’exploitant devait s’acquitter d’une caution d’un montant de
250 000 francs CFA
1
par ligne à Dakar et de 150 000 francs CFA dans les
régions, payer des frais de raccordement de 67 200 francs CFA par ligne
et acheter un compteur de taxes téléphoniques coûtant 100 000 francs
CFA soit un investissement minimum allant de 417 200 francs CFA à
Dakar et à 317 200 francs CFA dans le reste du pays, sans parler des
coûts d’aménagement et d’équipement du télécentre auxquels venaient
s’ajouter les factures d’électricité et éventuellement les frais de loyer et
les salaires des employés. En contrepartie, l’exploitant pouvait revendre
des unités téléphoniques dans une limite maximale de 75 % du tarif de
base qui était de 60 francs CFA, soit un prix plafond de 105 francs CFA.
1.2. Au début étaient les télécentres
Préfigurant la privatisation de la Sonatel, qui interviendra en 1996,
cette opération qui s’inscrit dans la perspective de la libéralisation du
marché des télécommunications (Sagna, 2010), ouvre aux acteurs de
l’économie populaire les portes d’un secteur qui lui étaient jusqu’alors
fermées. Dans le Sénégal du milieu des années 1990, confronté à une
grave crise économique et dans lequel 67,9 % de la population vit en
situation de pauvreté, les télécentres privés constituent une formidable
opportunité pour les jeunes sans emploi, les agents de l’État ayant quitté
volontairement la Fonction publique ou encore les retraités vivant
difficilement de leurs pensions. Ces groupes investissent massivement le
créneau et dès 1995 le nombre de télécentres s’élève à 2 042 et totalise
4 084 emplois, soit plus que le double de l’effectif du personnel de la
Sonatel. L’opération s’avère également être une aubaine pour l’opérateur
historique puisque les télécentres réalisent 5,5 % de son chiffre d’affaires
alors qu’ils ne représentent que 2,5 % du parc de lignes téléphoniques.
Devant un tel succès, les règles d’établissement des télécentres sont
assouplies et l’obligation de respecter une distance minimale entre deux
installations est supprimée. Cette mesure provoque une explosion des
demandes d’agrément et fin 1997, on dénombre 6 796 télécentres dans
l’ensemble du pays. Au fil des années, leur nombre ne cesse d’augmenter
et un bilan établi en 2006 faisait état de 18 500 télécentres totalisant
23 000 lignes téléphoniques, employant 30 000 personnes et générant un
chiffre d’affaires de 50 milliards de francs CFA (représentant 33 % du
chiffre d’affaires de la Sonatel), ajouté à cela l’important bénéfice social
apporté à des milliers de citoyens qui ont désormais accès au téléphone
(Petit-Pzsenny, 2004).
1
Un euro vaut 655,957 francs CFA (1 franc = 100 francs CFA).

Des réseaux et des hommes. Les Suds à l’heure des TIC
157
La création des télécentres privés peut être considérée comme la
première illustration de l’alliance entre l’économie populaire et
l’économie marchande en vue de dynamiser la diffusion des TIC dans la
société sénégalaise. Elle permit à la Sonatel d’accroître la pénétration de
la téléphonie et d’augmenter par la même la demande en matière de
services de communication, sans pour autant devoir recruter du personnel
supplémentaire ni mettre en place des infrastructures d’accueil avec tous
les frais inhérents. Nombre de gérants de télécentres se considéreront de
facto comme des « employés » de la Sonatel, n’hésitant pas à utiliser,
illégalement, mais avec la bienveillante complicité de l’entreprise
publique, sa marque et son logo sur les murs de leurs locaux. Cette
structure, dans laquelle l’économie marchande avait eu recours à
l’économie populaire pour étendre son emprise sans pour autant en
supporter les coûts qui avaient été transférés sur ses « partenaires », sera
par la suite réutilisée. L’exploitation de cette logique d'équipement
collectif, externalisé par la Sonatel vers l’économie populaire, rendit le
téléphone accessible à un grand nombre de citoyens, mais permit dès lors
à l’opérateur de remplir ses obligations en matière d’accès universel. La
Sonatel fera considérablement progresser l’accès universel, et les
télécentres sénégalais seront pendant longtemps cités en exemple et
présentés comme un modèle pouvant servir dans la lutte contre la fracture
numérique dans les villes comme dans les campagnes. Cependant, du fait
de la forte concurrence découlant du développement de la téléphonie
mobile, leur nombre diminuera à partir de 2007 pour n’être plus que
quantité négligeable quelques années plus tard (Sagna, 2009).
2. Quand l’économie populaire contribue au développement de la
téléphonie mobile
La téléphonie mobile est justement le marché sur lequel
l’économie populaire est désormais paradoxalement fortement présente.
Introduite en septembre 1996 avec le lancement du réseau Alizé, la
téléphonie mobile a constitué un monopole de l’opérateur historique
pendant plus de deux ans et demi. Durant cette période, la Sonatel offrait
uniquement une formule post-payée qui limitait son accès aux plus nantis,
compte tenu des tarifs pratiqués. À partir de juin 1998, dans la
perspective de l’arrivée sur le marché d’un opérateur concurrentiel, elle
cibla le grand public en investissant le créneau du prépayé qui rencontra
rapidement un vif succès. Un an après son lancement, cette formule
comptait près de 22 000 abonnés, dépassant la formule post-payée qui
n’en totalisait que 16 000 après six années d’existence. Suite au
lancement d’un appel d’offres international, le groupe Millicom
International Cellular (MIC) démarra ses activités sous la marque Sentel
en avril 1999. Le lancement du prépayé, l’arrivée de Sentel puis celle
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%