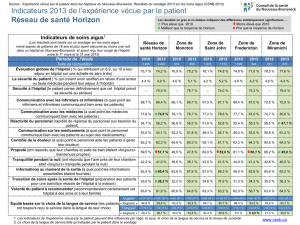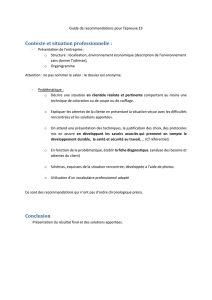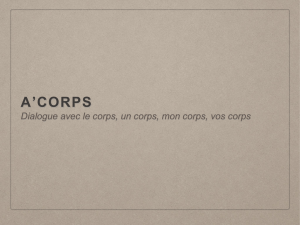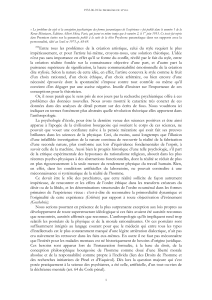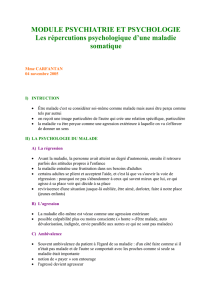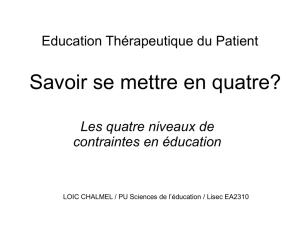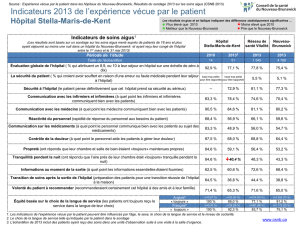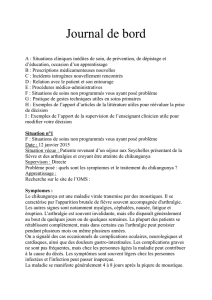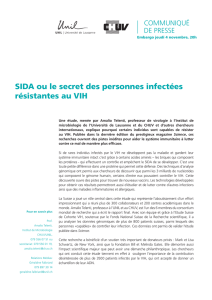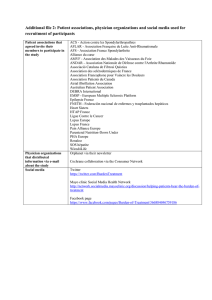Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

WWWREVMEDCH
février
293
psychiatrie
de liaison
Le médecin au centre
pour une approche de l’expérience
vécue
Depuis de nombreuses années, une grande attention est portée à
la figure du patient, dans le contexte d’une société en mouvement
et de pratiques médicales toujours plus complexes. Nous propo-
sons de déplacer le projecteur sur la figure du médecin, non moins
prise dans les évolutions en cours mais de manière probablement
moins évidente. Nous nous intéressons dans ces trois articles,
successivement, à l’expérience vécue du médecin contemporain,
à l’éthos qui rassemblerait la communauté médicale et à la for-
mation du futur médecin, en nous appuyant sur divers projets de
recherche réalisés dans le cadre du Service de psychiatrie de liai-
son du CHUV. Dans ce premier article, nous posons notamment la
question de savoir ce qu’est l’expérience vécue du médecin et
dessinons les contours d’une recherche scientifique « centrée sur
le médecin ».
Toward the lived experience
of the physician
For many years, a major focus of interest has been the patient, in
the context of a constantly changing society and increasingly com-
plex medical practices. We propose to shift this focus on the phy-
sician, who is entangled in a similar, but less evident way. In these
three articles, we explore, in succession, the lived experience of
the contemporary physician, the ethos which brings together the
medical community, and the education of the future physician,
using research projects currently under way within the Service of
Liaison Psychiatry at Lausanne University Hospital. In this first article,
we particularly raise the question of what is the lived experience of
the physician and sketch the outline of « physician-centered » re-
search.
INTRODUCTION
Un nouveau paradigme émerge aujourd’hui dans le domaine
de la santé, dans un contexte où sont observées une standar-
disation des soins, une multiplication des guidelines et des re-
commandations tout comme une emprise de l’Evaluation,1 une
tension entre rationalités sanitaire et économique, une promo-
tion de la médecine fondée sur les données probantes (EBM)
ainsi qu’une technologisation de la pratique diagnostique et
de la prise en charge thérapeutique. Dans ce paradigme, le pa-
tient est placé au «centre» (patient-centeredness) et il s’agit de
l’approcher comme une personne à part entière (whole person)
au travers de la pratique de soins médicaux montrant de la
compassion et de l’empathie et de partager avec lui pouvoir et
responsabilité.2 Il semble dès lors que la place du patient dans
la relation et la décision thérapeutiques se trouve définie par
un double mouvement qui va de la non-prise en compte (voire
de l’«effacement») à la prise en compte de sa subjectivité et
de la singularité de son expérience vécue.
Ces développements, quelle que soit leur direction, modifient
les manières de penser, de pratiquer ainsi que de vivre la cli-
nique du point de vue non seulement du patient, mais encore
du médecin. De fait, on tend à oublier que le médecin est éga-
lement impliqué comme personne à part entière (whole person)
dans les soins prodigués et qu’il en est par là même un élément
essentiel. Cette faible attention portée au médecin, car c’est
de cela dont il s’agit, se retrouve dans la recherche scientifi-
que; certaines dimensions étant davantage décrites que d’autres,
ainsi que nous allons le voir plus loin.
Une récente revue de littérature portant sur la question, lar-
gement étudiée, de la communication clinique en oncologie
peut être évoquée en préambule. Celle-ci montre qu’une
vingtaine d’études seulement traitent des caractéristiques du
clinicien susceptibles d’influer sur la communication ou sur
le patient.3 On aurait pu penser que du fait de la place qu’occupe
le cancer dans les discours, savants ou non, la figure du méde-
cin oncologue émerge davantage.4,5
Partant d’observations empiriques et cliniques, nous voulons
parcourir ici ce champ de recherche, encore largement inex-
ploré, où le médecin se trouve être à la fois sujet et objet d’in-
térêt scientifique.
LE MÉDECIN ET SON MONDE INTERNE
Une part des études, sans doute la plus grande, est spécifique-
ment centrée sur le «monde interne» des médecins. Y sont
rapportées des expériences de crises (de sens, de valeurs ou
encore d’identité),6 face notamment aux contraintes budgé-
taires, à la pénurie de relève, à la surcharge de travail ou à la
judiciarisation des soins, ainsi que de souffrance individuelle,
se manifestant chez le médecin par des états d’angoisse, de
dépression ou d’épuisement professionnel et par des abus de
substances; la tendance à l’augmentation de la prévalence de
ces abus apparaît par ailleurs plutôt inquiétante.
Drs CÉLINE BOURQUIN a, MICHAEL SARAGA a, RÉGIS MARION-VEYRON b et Pr FRIEDRICH STIEFELa
Rev Med Suisse 2016 ; 12 : 293-5
a Service de psychiatrie de liaison, CHUV, b Unité de psychiatrie de liaison, PMU,
1011 Lausanne
celine.bourquin@chuv.ch | [email protected]
regis.marion-veyron@chuv.ch | frederic.stiefel@chuv.ch
05_07_39027.indd 293 04.02.16 08:49

REVUE MÉDICALE SUISSE
WWW.REVMED.CH
10 février 2016
294
D’autres études, dirigées vers les praticiens, traitent de l’iden-
tité du médecin (physicianhood) ou de la formation de l’iden-
tité professionnelle (professional identity formation, PIF),7,8 soit
le processus fondateur par lequel celui qui n’est pas initié de-
vient une «personne qui guérit» (healer). L’attention est por-
tée principalement ici sur la construction/production identi-
taire tant individuelle que collective (la culture de la méde-
cine): sont interrogés la nature de l’identité professionnelle
des médecins et les facteurs qui influencent son développe-
ment.
D’autres études enfin examinent la structure psychologique
du médecin. Il s’agit en particulier des travaux sur les mouve-
ments défensifs liés à la menace que représentent certaines
situations cliniques, à l’instar de la fin de vie d’un patient ou
de certains aspects de l’interaction médecin-patient, et l’émo-
tionnalité qui leur est associée.9 Si ces travaux sont particuliè-
rement intéressants dans une perspective d’amélioration de
l’interaction clinique, voire de prévention de l’épuisement du
médecin, ils ne touchent qu’en partie à la question de l’expé-
rience vécue. En outre, c’est seulement au travers de la mesure
de la satisfaction au travail – utilisée aujourd’hui de manière
courante dans les hôpitaux, dans une optique plutôt managé-
riale – que paraît être investigué un semblant d’expérience
vécue, alors qu’elle intègre des dimensions bien plus vastes.
En effet, si l'expérience vécue est relative à ce qui fait le quo-
tidien du médecin et à sa «manière d’être au monde» médi-
cal, elle apparaît aussi dans un rapport que l’on pourrait qua-
lifier de dialogique avec son «monde externe», son contexte.
Vécu et contexte sont en outre souvent placés en opposition
hiérarchique – du type «englobant/englobé» – alors même
qu’ils devraient idéalement être approchés ensemble.
Nous allons, dans la suite de cet article, essayer de préciser
notre définition de l’expérience vécue, réfléchir aux manières
dont le contexte affecte le vécu du médecin et dessiner les
contours d’une recherche scientifique «centrée sur le méde-
cin».
L’EXPÉRIENCE VÉCUE
L’expérience vécue du médecin, comme celle de tout un cha-
cun, ne se réduit pas à ses réflexions à propos de son identité
professionnelle: elle n’est ni le produit de représentations ni
produite par des processus cognitifs. Elle n’est pas non plus
définie seulement par un équilibre psychique, un état psycho-
pathologique ou un sentiment de plénitude ou d’épuisement;
ces états peuvent, à la limite, être considérés comme se rap-
portant à un certain vécu dans la durée. Elle n’est pas non plus
assimilable à l’organisation psychologique, laquelle peut par
contre refléter un aspect du vécu (par exemple, l’angoisse qui
pousse le médecin à agir).
Dès lors, qu’est-ce que l’expérience vécue du médecin? C’est
sa «manière d’être au monde», en l’occurrence médical, et de
l’habiter. C’est son inscription subjective dans le quotidien
clinique, une expérience qui intègre les dimensions corporelle,
spatiale, temporelle, affective et cognitive. Les différents as-
pects du vécu du médecin forment, en dernière analyse, un
tout indissociable dont la représentation n’est que partielle-
ment accessible à la réflexion.
Vignette clinique
Une médecin assistante travaillant dans un centre de
référence tertiaire rapporte se sentir «agressée» dès le
moment où elle arrive sur son lieu de travail. Invitée à
élaborer davantage, elle décrit la sensation d’avoir un
corps rétréci et l’impression d’être de taille minuscule,
tandis qu’elle doit se mouvoir dans un univers de géants.
Ce sentiment ne la quitte pas (ou que peu) au cours de
la journée, voire se renforce quand elle se trouve dans
des endroits où les appareils médico-techniques sont
prédominants. Il lui semble que sa journée s’écoule de
manière paradoxale: à la fois interminable et trop courte
car elle a l’impression de «courir après le temps» et d’être
constamment interrompue, comme si le temps n’était plus
linéaire et continu. Hypervigilante et très préoccupée de
«rater quelque chose», elle est souvent fatiguée et a très
envie de quitter les lieux pour se retrouver dans un ail-
leurs qui est la nature; il lui est même arrivé d’envier les
patients qui, eux, n’ont à «se soucier de rien». Quand
bien même elle n’exprime que peu d’émotions, elle admet
vivre parfois des mouvements agressifs, avec le fantasme
de repousser ses collègues, voire des patients; elle vit leurs
corps comme «envahissants».
Ce compte rendu narratif donne une idée de l’expérience vécue
de cette jeune collègue qui, dans un premier temps, est étonnée
de la description qu’elle livre et peine à identifier les éléments
susceptibles de contribuer à son expérience quotidienne. La
difficulté à «saisir» l’expérience vécue observée chez les mé-
decins – souvent guidés par la rationalité et orientés vers les
faits – est, selon nous, à mettre en lien avec les exigences d’un
métier qui appelle à être «opérant» et laisse peu de place à la
réflexivité, qu’il s’agisse d’un retour sur soi, sa pratique ou le
contexte de soins.
CONTEXTE LE MONDE DE LA MÉDECINE
Certains des facteurs contextuels participant au vécu du
médecin sont connus et leurs effets ont pu être étudiés. C’est
notamment le cas des processus de socialisation et du «curri-
culum caché» (hidden curriculum) qui constituent la matrice
même de la formation de l’identité chez les étudiants en mé-
decine.10 Par le jeu des contraintes institutionnelles comme
des discours et contre-discours auxquels le futur médecin est
soumis, s’opère une transformation de l’individu et de son at-
titude; la transformation se poursuit certainement au niveau
postgradué, mais on manque d’études pour le confirmer.
Nombre de facteurs contextuels restent néanmoins peu étu-
diés. On peut citer à titre d’exemples les contraintes variées
et souvent contradictoires auxquelles sont soumis les méde-
cins: les pressions sur les coûts et l’exigence d’une communi-
cation empathique, la standardisation des soins et l’incitation
à exercer une médecine centrée sur le patient, la triple exi-
gence de performances clinique, académique et managériale,
etc. Ces influences contraignantes n’émanent à l’évidence pas
uniquement de l’administration et de la hiérarchie médicales,
mais aussi de l’environnement hospitalier qui est régi tant par
des normes et règles sociales que par un certain corporatisme –
05_07_39027.indd 294 04.02.16 08:49

WWWREVMEDCH
février
295
psychiatrie
de liaison
qui agit sur l’individu médecin – et mimétisme – à un niveau
plus fondamental du fonctionnement humain –, qui ne s’arrête
à l’évidence pas aux portes de l’hôpital.11
Les sociologues et anthropologues se sont intéressés à la figure
du patient et à ses évolutions, en tant qu’elle est objet de dis-
cours dominants. Nous avons déjà discuté de l’émergence de
la figure paradoxale du «survivant» s’agissant des patients at-
teints de cancer, qui contribue aux représentations du patient
cancéreux comme sujet sain en devenir ou renforcé par la ma-
ladie.12 Cette figure a le potentiel d’influencer la prise en charge
pour le meilleur et pour le pire.13 La figure du médecin, elle,
n’est guère investie scientifiquement. Elle se colore pourtant
des discours ambiants qui, au travers des médias en particulier,
inscrivent le médecin dans une dimension antagonique entre
confiance (en sa (toute)-puissance) et méfiance, et ce dans un
contexte de judiciarisation de la médecine où l’on demande
de plus en plus des comptes au praticien.14
Pour le dire une fois de plus: tandis que nombre d’éléments
intrapsychiques, biologiques, contextuels et sociaux, aux sens
strict et large, ont été étudiés dans divers groupes de patients,
l’expérience vécue du médecin a reçu peu d’attention; quand
bien même il se trouve pareillement impliqué dans les soins
et qu’il nous paraît y jouer un rôle majeur.
PERSPECTIVES LE MONDE DES MÉDECINS
Nous avons observé, dans une étude récente, que quand les
médecins sont invités à s’exprimer sur des questions relatives
aux soins en fin de vie – un sujet particulièrement sensible et
soulevant toutes sortes d’enjeux intrapsychiques, intersubjec-
tifs et contextuels –, ils ne font pas spontanément mention de
leur vécu propre et des facteurs contextuels (contenu mani-
feste des discours).
Consécutivement à cette observation et partant de la question
de savoir si ces facteurs sont perçus, mais qu’ils restent tus ou
s’ils sont scotomisés, nous avons décidé d’examiner de manière
systématique et empirique les facteurs d’influence agissant
sur l’expérience vécue de médecins. Pratiquement, l’étude
menée cherche à faire produire par les médecins des discours
centrés sur différents aspects spécifiques de leur vécu, allant
de leur vie interne aux discours dominants sur la médecine, la
maladie, le médecin ou encore sur le patient, en passant par
les facteurs contextuels liés au dispositif médical et les pro-
cessus d’apprentissage du métier de médecin.15 Selon une mé-
thodologie inspirée tout à la fois de la sociologie visuelle (la
photo-elicitation) et de la psychologie clinique (méthodes pro-
jectives), il s’est agi en particulier de développer des «stimu-
lateurs» de la narration, qui se présentent sous une forme tant
écrite (press-book et extraits tirés de (auto)biographies de
médecins) que visuelle (récit photographique et images vidéo
floues). Dans une prochaine étape, seront conduits les entre-
tiens de recherche, lesquels devraient permettre d’approcher
de plus près l’expérience vécue de médecins d’aujourd’hui.
Il nous paraît indispensable de s’intéresser au médecin et à
son expérience vécue en se centrant sur l’(agent-)acteur plu-
tôt que sur ses productions, comme c’est traditionnellement
le cas dans le monde de la médecine.
Remerciements : Cette réflexion s’inscrit dans la suite des travaux menés dans le
cadre du Programme national de recherche (PNR) 67 du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, subsides n° 139248 et 139248 / 2.
Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation
avec cet article.
1 Abelhauser A Gori R Sauret MJ La
folie Évaluation Les nouvelles fabriques
de la servitude Paris Ed Mille et une nuits
2 Hutchinson TA ed Whole person care
A new paradigm for the st century New
York Springer
3 De Vries AMM de Roten Y Meystre C
et al Clinician characteristics communi
cation and patient outcome in oncology
A systematic review Psychoooncology
4 Bell K The breastcancerization of
cancer survivorship Implications for
experiences of disease Soc Sci Med
5 Stiefel F Bourquin C Saraga M Instances
d’aliénation Portrait du patient tiraillé/
Dispositif médical et discours dominants
Rev Med Suisse
6 Yasunaga H The catastrophic collapse
of morale among hospital physicians in
Japan Risk Manag Healthc Policy
7 Mc Namara H Boudreau JD Teaching
whole person care in medical school In
Hutchinson TA ed Whole person care
A new paradigm for the st century New
York Springer
8 Sharpless J Baldwin N Cook R et al
The becoming Students’ reflections on
the process of professional identity for
mation in medical education Acad Med
9 Bernard M de Roten Y Despland JN
Stiefel F Communication skills training
and clinicians’ defenses in oncology An
exploratory controlled study Psychoon
cology
10 Hafferty FW Franks R The hidden
curriculum ethics teaching and the
structure of medical education Acad Med
11 Girard R La route antique des
hommes pervers Paris Grasset
12 Bell K Remaking the self Trauma
teachable moments and the biopolitics
of cancer survivorship Cult Med Psychiatry
13 Stiefel F Bourquin C Good cancers
bad cancers good patients bad patients?
J Thorac Oncol
14 Schaad B Bourquin C Bornet F et al
Dissatisfaction of hospital patients their
relatives and friends Analysis of accounts
collected in a complaints center Patient
Educ Couns
15 Stiefel F Communication skills in
endoflife care Swiss National Science
Foundation Bonus of excellence Project
number / and
* à lire
** à lire absolument
05_07_39027.indd 295 04.02.16 08:49
1
/
3
100%