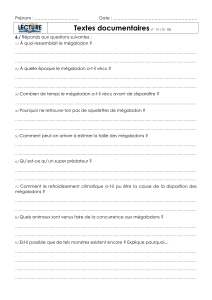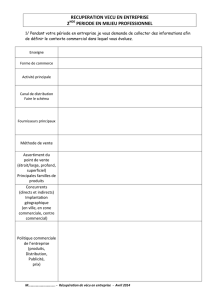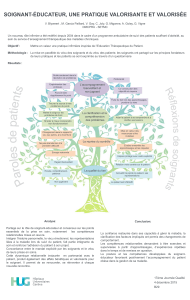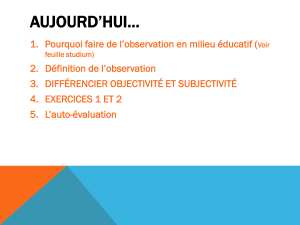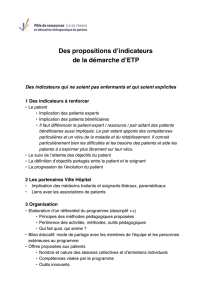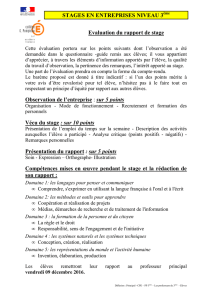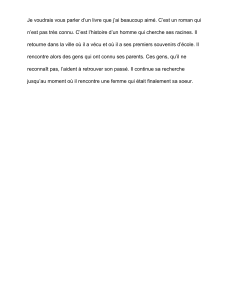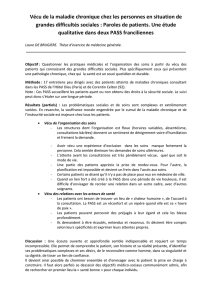La médecine et la mort - Société neuchâteloise de médecine

Noémi D. de Stoutz, Oncologie FMH
Aeschstrasse 3 – 8127 Forch
Survol historique
Dans une perspective historique, on
peut dire que la mort a toujours posé
des problèmes à la médecine. Hip-
pocrate n’a pas seulement décrit les
signes prémonitoires de la mort. Il a
en outre recommandé à ses disciples
d’éviter le contact des personnes
présentant ces signes, de peur de
faire une mauvaise réputation à la
médecine. Le cliché du médecin qui
abandonne le patient en fin de vie
n’est donc pas nouveau.
Ce qui est relativement nouveau, ce
sont les immenses possibilités qui
sont à notre disposition actuelle-
ment pour repousser la mort, pour
guérir et prolonger la vie.
Pour développer ces possibilités, de
gros efforts ont été nécessaires. Il y
a eu beaucoup d’observation cli-
nique ou de recherche fondamen-
tale, suivies de réflexions et déduc-
tions logiques, suivies de travaux de
recherche pour en vérifier la valeur
clinique, avant l’intégration dans la
pratique courante.
Des méthodes de recherche ont été
conçues pour rendre possible cette
vérification systématique. Entre
autres elles ont exigé une très
grande discipline de la part des
médecins impliqués dans la
recherche clinique : l’effort de faire
abstraction de leur propre subjecti-
vité et de celle du patient.
Le vécu du médecin constituait un
risque d’interprétation déséquilibrée
des résultats. Le vécu du patient
devait être filtré pour obtenir des
résultats reproduisibles. C’est dans
le but de supprimer l’influence de
toute subjectivité que les méthodes
en double aveugle ont été dévelop-
pées.
Plus récemment, il est devenu
important de documenter le vécu du
patient. Bien des protocoles de
recherche posent la question de la
qualité de vie. On a cherché des
manières de mesurer la qualité de
vie, avec l’ambition paradoxale
d’objectiver la subjectivité pour la
« statistifier ».
Trois générations
de médecins
Les plus agés parmi les médecins qui
pratiquent actuellement ont vécu les
grandes découvertes et les grandes
percées, qui étaient inimaginables
dans leur jeunesse. Des maladies
sont devenues guérissables,
d’autres ont perdu leur aspect mena-
çant en devenant chroniques, et bien
des maladies ont tout bonnement
disparu.
Ces médecins ont développé un
enthousiasme immense, parfaite-
ment légitime et compréhensible,
pour un métier qui dépassait ses
limites les unes après les autres.
Il est important aussi de se rappeler
que ces médecins avaient tous une
large culture humaniste, qui n’existe
plus dans la même mesure depuis
que l’accès aux études de médecine
est possible avec divers types de
maturité. Leur culture atténuait dans
le contact avec les patients, l’effet de
leur effort d’objectivité.
La deuxième génération (la mienne)
a été formée par ces grands enthou-
siastes. En plus de leur optimisme,
nos maîtres nous ont transmis leur
discipline dans l’effort constant
d’objectivité, qu’ils avaient perçu
comme une condition de succès.
Sans le vouloir, ils nous ont aussi
transmis un certain mépris du traite-
ment « symptomatique » qui se pré-
occupe du vécu subjectif du malade.
Or nous avons commencé à parler
d’une « déshumanisation » de la
médecine.
Il faut bien dire que nous n’avons pas
vécu de percées comparables à
celles qui ont marqué nos maîtres. Si
des choses sont devenues possibles
qui étaient encore impensables
récemment, si des techniques spec-
taculaires sont devenues courantes,
leur effet n’a par contre souvent pas
été spectaculaire. Cela fait long-
temps qu’on n’a plus transformé de
maladie mortelle à 100 % en maladie
guérissable dans 95 % des cas sans
séquelles (c’est ce qui s’est passé
pour le cancer du testicule au début
des années 1970).
La troisième génération, nous
sommes encore en train de la for-
mer. Ces jeunes médecins ont grandi
dans une société qui oubliait déjà les
grands fléaux que les anciens
avaient contribué à faire disparaître
– une société qui se méfie des vac-
cins et des antibiotiques parce-
qu’elle ne croit plus aux infections.
La discipline de l’objectivité conti-
nue à être transmise, la médecine
“evidence based” est mise en valeur,
surtout les degrés d’évidence maxi-
male, soit les grandes études contrô-
lées et les métaanalyses. La méde-
cine leur est présentée comme une
science naturelle précise, la vie
comme un ensemble de fonctions
mesurables qui ont lieu dans un
temps mesurable.
Pourtant, il est inévitable que cette
génération ressente nos contradic-
tions.
Nous avons transformé beaucoup de
maladies mortelles en maladies
chroniques, mais nous ne savons
trop que faire des personnes qui
continuent de vivre grâce à nos
efforts. Les personnes agées sont
perçues comme superflues et coû-
teuses. Les malades qui gèrent
depuis des années leur diabète, leur
dialyse, leur maladie rhumatismale,
leur cancer sont un peu trop indé-
pendants pour être des patients
agréables. Les personnes sauvées
dans la petite enfance par l’opéra-
tion de malformations congénitales
sont devenues des adultes auxquels
on ne s’attendait pas. Bien des sur-
vivants de crises aiguës portent des
séquelles et génèrent de gros coûts
à très long terme.
La médecine et la mort

Un dilemme supplémentaire est que
ces groupes de patients créés par
nos efforts sont trop hétérogènes
pour faire sur eux de belles études
contrôlées méta-analysables. Les
modes d’emploi basés sur l’évidence
nous font pour le moment cruelle-
ment défaut.
Et malgré tout, la mort
L’investissement dans la prolonga-
tion de la survie a donc été énorme
durant les cent ou cent cinquante
dernières années. Mais nous
n’avons toujours pas vaincu la mort.
Il est évidemment illusoire de vouloir
rendre l’homme immortel, l’ambi-
tion avouable est plutôt « mourir,
oui, mais pas de ça ».
A défaut de pouvoir prolonger indé-
finiment la vie de nos patients, la
stratégie est souvent de passer d’un
traitement au suivant, de regarder
chaque crise aiguë de manière iso-
lée et de laisser croire le patient et
ses proches qu’on est revenu à la
case départ.
Je voudrais esquisser une alternative
à cette stratégie. On pourrait l’appe-
ler « faire la nique à la mort » puisqu’il
s’agit de vivre pleinement, au mépris
de la mort. D’ajouter de la vie aux
jours, non pas des jours à la vie.
Il y a trop de ces publications qui
donnent des pourcentages de survie
à cinq ou dix ans, sans se préoccu-
per de ce qui arrive au reste des
patients. Mais qu’est-ce qui arrive à
ceux qui ne survivent pas ? Leur mort
est l’aboutissement d’un processus
marqué généralement de complica-
tions successives, dont chacune est
rendue plus pénible par celles qui
l’ont précédée.
Lorsque la mort est devenue inévi-
table, les défis lancés au médecin
sont complexes et mettent en jeu
tout son savoir physiopathologique
et pharmacologique, son habileté
clinique, son bon sens, ses compé-
tences sociales, son humilité, un peu
de philosophie, pas mal de psycho-
logie, beaucoup d’humour. Il s’agit
de prévoir les complications pro-
bables, pour s’y préparer ou même
les prévenir. La médecine palliative,
c’est de la médecine préventive.
Il s’agit de poser des diagnostics pré-
cis avec le moins de moyens para-
cliniques possible, pour choisir
ensuite le traitement optimal. En
médecine palliative il faut être excel-
lent clinicien.
Il s’agit de définir clairement le but
des traitements, et d’être très cohé-
rent dans sa poursuite. On cherche à
obtenir un état non pas de fonction
la plus proche possible de la nor-
male, mais qui permette le mieux
possible au patient de réaliser ce qui
est important maintenant pour lui.
Pour cela on peut profiter de tous les
progrès de la médecine, aussi long-
temps qu’on les met au service de ce
but.
Il s’agit de reconnaître et d’adopter
les priorités du patient, pour lui per-
mettre d’écrire le dernier chapitre de
sa biographie en cohérence avec qui
il a été. Cela signifie qu’on se tient à
l’arrière-plan, que tout l’engage-
ment du médecin sert à empêcher
l’organisme malade d’interférer
avec les choses essentielles qui doi-
vent se passer aux niveaux psycho-
social et spirituel. En médecine pal-
liative, on n’est jamais qu’un figu-
rant dans l’histoire d’un autre. Avec
beaucoup d’autres figurants profes-
sionnels on est responsable d’aider
le mourant à intégrer son dernier
reste de vie dans la logique de sa vie.
Il s’agit de redéfinir le succès : On
peut parler de succès lorsqu’une
personne est restée elle même, ou
est (enfin!) devenue elle-même
durant la dernière période de sa vie.
On peut parler de succès lorsque les
proches repartent dans la vie riches
d’une expérience qui contribue à les
faire vivre.
Il s’agit aussi de redéfinir la vie. La
vie n’est pas un ensemble de données
mesurables, mais un ensemble de
relations : avec soi-même, avec les
autres, avec le Tout Autre. La mort a
sa place là-dedans et ne réussit plus
à nous mettre en échec.
1
/
2
100%