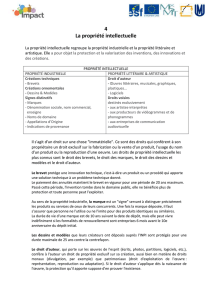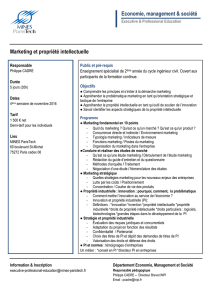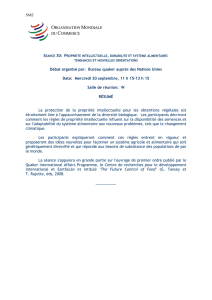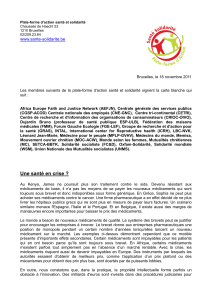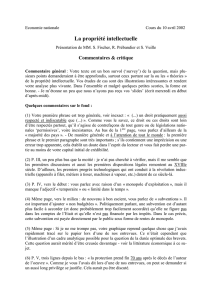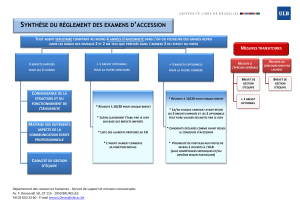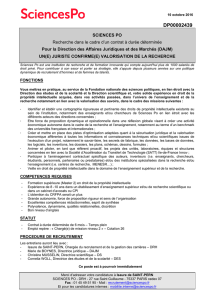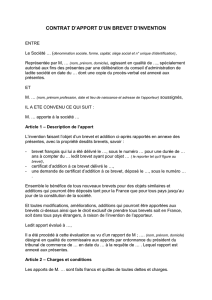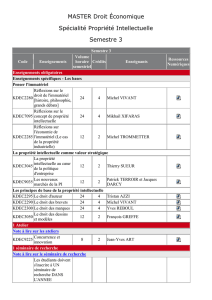Télécharger l`ensemble des contributions au

192 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE •AVRIL/JUIN 2007 •N011 Droit IÉconomie I Régulation
Cycle de conférences de la Cour de cassation
DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE :
APPROCHES JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE
Jeudi 9 novembre 2006
Le 9 novembre 2006, s’est tenu à la Cour de cassation, dans le cadre du cycle de conférences « Droit et
Économie de la Concurrence », un colloque intitulé « Droits de Propriété Intellectuelle : approches juridique
et économique », sous la direction scientifique de M. Frédéric Jenny, conseiller en service extraordinaire à la Cour
de cassation.
Dix intervenants (magistrats, avocats, professeurs, économistes, professionnels) ont traité de la contribution de
l’innovation au progrès économique et de la place de plus en plus éminente du secteur des services dans nos
économies, combinées au souci de promouvoir une concurrence loyale et efficace entre les offreurs de biens et
services, phénomènes qui ont pour conséquence que le régime de la protection de la propriété intellectuelle
(droit des brevets, droits d’auteurs, droit des marques, etc.) constitue un enjeu crucial pour la croissance
économique dans le monde moderne. Mais, en raison même de leur importance, les droits de propriété
intellectuelle sont aussi l’objet de nombreuses interrogations concernant leur légitimité, leurs contours et leurs
limites au regard d’autres droits, ainsi que la façon dont certains d’entre eux doivent être adaptés aux évolutions
technologiques du monde moderne.
Quatre questions ont tout particulièrement retenu l’attention des participants à cette demi-journée d’étude :
– un vif débat s’est engagé dans nombre de pays, sur ce que devrait être le champ du domaine brevetable
et l’importance de la protection que les brevets devraient offrir pour favoriser l’innovation.
– qu’est-ce qui mérite d’être breveté et quel degré de protection les brevets doivent-ils offrir ?
– comment concilier équité, proportionnalité et recherche du dynamisme économique dans la
rémunération de la propriété intellectuelle ?
– en quoi les nouvelles technologies de communication et de diffusion des oeuvres audio-visuelles
bouleversent-elles l’équilibre du régime des droits d’auteur ?
Enfin, à l’heure où le champ du droit de la concurrence connaît un essor sans précédent, certaines autorités
antitrust ont explicitement ou implicitement pris, au nom du respect de la concurrence, des décisions allant dans
le sens d’une expropriation totale ou partielle des détenteurs de droits de propriété intellectuelle. Que peut-on
dire alors de la cohabitation parfois difficile entre droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle ?
Les acteurs du marché sont-ils les malheureux otages des incohérences résultant d’une insuffisante coordination
entre ces deux instruments juridiques ?
Intervenants
Claude CRAMPES, Université de Toulouse I (Gremaq et IDEI)
Philippe SÉMÉRIVA, Conseiller référendaire à la Cour
de Cassation
Claude CRAMPES
D’après l’article L. 611-02 du Code de la propriété intellec-
tuelle, le brevet est un titre de propriété industrielle protégeant
les inventions, délivré pour une durée de vingt ans. Dans l’ar-
ticle L. 611-10, le Code énonce les caractéristiques des inven-
tions susceptibles d’être brevetées : elles doivent être nou-
velles, impliquant une activité inventive et susceptibles d’ap-
plication industrielle. Il évoque aussi des cas de non breveta-
bilité : les découvertes, théories scientifiques, méthodes ma-
thématiques, créations esthétiques, plans, principes et méthodes
dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou
dans le domaine des activités économiques, programmes d’or-
dinateurs, présentations d’informations.
Le Code donne donc quelques orientations pour distinguer
parmi les créations intellectuelles celles qui méritent une pro-
tection légale et celles qui n’en méritent pas et, à l’intérieur
du premier ensemble, celles qui peuvent recevoir un brevet
et celles qui doivent être protégées différemment. Mais la ra-
tionalité économique de ces orientations ne saute pas aux
811
RLC
L’objet et le champ des brevets : qu’est-ce qui
mérite d’être breveté ?

Droit IÉconomie I Régulation N0 11 • AVRIL/JUIN 2007 • REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE 193
PERSPECTIVES COLLOQUE
yeux. Une recherche sur les bases de données des offices de
délivrance des brevets, couplée à un exercice de statistique
jurisprudentielle, permettrait de donner des indications qua-
litatives et quantitatives débouchant sur une taxonomie des
inventions brevetées. Mais cette observation du passé nous
renseignerait essentiellement sur les pratiques des offices et
des tribunaux et non sur l’objectif du système des brevets,
alors que l’intitulé de cette session nous invite plutôt à une
réflexion normative.
Pour apporter une réponse économique à la question posée,
je vais expliquer pourquoi il faut en appeler à la théorie des
mécanismes incitatifs, et plus particulièrement à l’une de ses
applications qui traite des contrats de délégation de services.
Je vais d’abord rappeler la rationalité économique du brevet
et le situer par rapport aux autres instruments publics de sti-
mulation de la recherche. Ensuite, j’expliquerai en quoi il est
semblable à un contrat de délégation de service public « à re-
venu-plafond », c’est-à-dire un contrat entre, d’une part, les
autorités publiques représentant les citoyens et, d’autre part,
une personne privée ou publique chargée d’entreprendre des
tâches (ici des programmes de R & D) sur lesquelles elle pos-
sède une information de meilleure qualité que celle des au-
torités. Pour répondre à la question de l’intitulé de cette ses-
sion, il restera donc à se demander quelles activités de recherche
méritent de faire l’objet d’un tel contrat, avec les gains et les
risques qui lui sont attachés.
I. – LA RATIONALITÉ ÉCONOMIQUE DU BREVET
Le brevet donne à son titulaire le droit d’exploiter une inno-
vation de façon exclusive. Il fait partie de la panoplie des ins-
truments utilisés par les pouvoirs publics pour stimuler l’ac-
tivité innovatrice et créative. Pourquoi faut-il stimuler cette
activité? Et pourquoi par des brevets?
L’essence du problème à résoudre peut se résumer ainsi :
i) l’activité inventive est bénéfique pour la société car elle
conduit généralement à des créations de produits ou de pro-
cédés dont le gain collectif est supérieur au coût collectif,
mais…;
ii) ces créations ont une nature essentiellement informa-
tionnelle dans la mesure où elles produisent de la connais-
sance. Elles appartiennent à la catégorie des biens publics,
c’est-à-dire des biens non détruits par l’usage. Comme, par
ailleurs, l’information est peu coûteuse à copier et à trans-
mettre, les gains appropriables par les agents capables d’in-
nover sont inférieurs aux coûts qu’ils doivent supporter pour
aller au bout de leurs programmes de R & D. Leur intérêt
égoïste les conduit alors naturellement à ne pas chercher à in-
nover.
On connaît deux familles de solutions à cette divergence entre
intérêt privé et intérêt public (
pour une analyse plus détaillée, cf. Tirole
(2003)
). D’une part, la collectivisation des coûts : puisque l’en-
semble de la collectivité profitera des innovations, tout le
monde doit participer à leur financement par l’impôt dont les
recettes serviront à construire des laboratoires publics, à ver-
ser des subventions ou accorder des crédits d’impôts aux en-
treprises privées, voire à organiser des concours. D’autre part,
et à l’opposé, on trouve les méthodes de privatisation des
gains : les agents qui engagent des dépenses de recherche se
voient reconnaître le droit d’en tirer les bénéfices au travers
d’une exploitation monopolistique qui peut être soit oppor-
tuniste (le secret), soit reconnue par un titre légal de propriété
intellectuelle (le brevet).
Le brevet apparaît donc comme un moyen parmi d’autres d’at-
tirer les candidats à l’innovation. Sa particularité est de ga-
rantir à l’innovateur l’aide des tribunaux si des braconniers
cherchent à chasser sur le territoire décrit par les revendica-
tions inscrites dans le titre délivré par l’organisme respon-
sable de l’allocation. Les effets négatifs de ce monopole de
fait (perte de bien-être due au pouvoir de marché) sont com-
pensés par l’obligation de description qui assure la diffusion
publique de l’information sur l’innovation. On espère que
cette diffusion permettra d’innover « autour du brevet » pen-
dant sa durée de validité et de provoquer une concurrence
immédiatement après son expiration, comme le font les gé-
nériques dans le secteur du médicament.
II. – UN CONTRAT À REVENU PLAFOND
La théorie des incitations fournit un cadre de réflexion ap-
proprié pour comprendre la place qu’occupent les brevets
dans la panoplie des outils de promotion de la recherche
(
pour une présentation détaillée des principes généraux et de la modélisation économique
de la théorie des mécanismes incitatifs, cf. Laffont et Martimort (2002)
). Le pro-
blème analysé consiste à déterminer le cadre contractuel qui
permettra à un « principal » (supérieur hiérarchique, em-
ployeur, gouvernement, etc.) d’obtenir que ses agents (su-
bordonnés, employés, entreprises privées, etc.)œvrent dans
le sens de son intérêt sans avoir à leur abandonner une part
trop importante des gains collectés. Toute la difficulté de
l’exercice vient de ce que les agents, par leur qualification
ou par leur situation privilégiée dans le processus de prise
de décision, possèdent généralement de meilleures informa-
tions que leur supérieur. Il peut s’agir d’informations concer-
nant certaines des caractéristiques exogènes du problème à
résoudre (état de la technologie, état de la demande, etc.)
qui sont identifiées comme « variables de sélection adverse ».
Il peut aussi s’agir d’informations sur des décisions non ob-
servables de l’extérieur, telles que l’effort de maintenance
ou l’effort de R & D; on parle alors de « variables de hasard
moral ».
La rationalité économique commande que le contrat base la
rémunération versée aux agents au moins partiellement sur
certaines variables de performance, à condition qu’elles soient
observables : la récolte, le chiffre d’affaires, les coûts (s’il existe
une comptabilité fiable). Avec un contrat mal calibré, on risque
de rémunérer de la même façon le surdoué paresseux et le
maladroit hyperactif, alors que l’efficacité voudrait qu’on in-
cite le surdoué à se montrer plus vaillant, quitte à le payer
très cher, et à susciter moins d’activité de la part du maladroit
pour réduire sa rémunération. La théorie des mécanismes in-
citatifs montre que le contrat optimum est flexible, c’est-à-
dire qu’il pousse les agents à réaliser des efforts qui ne soient
pas trop éloignés de ce que le principal exigerait d’eux en in-
formation parfaite, au moyen d’une rémunération discrimi-
nante. Concrètement, on propose aux agents un « menu de
contrats » allant du moins exigeant et faiblement rémunéré
(juste assez pour couvrir les coûts de fourniture du service)
au plus exigeant et bien rémunéré (suffisamment pour ne pas
donner aux agents efficaces l’envie de choisir l’autre contrat).
Par son choix, chaque agent révèle son information privée.
Plus le nombre de contrats dans le menu est grand, mieux le
principal peut extraire de chaque agent l’information et l’ef-
fort correspondant à sa vraie nature. Ainsi, dans un contrat
de délégation de service public, l’éventail des contrats pour
un service de qualité donnée va du contrat à « marge fixe »,
bien adapté au cas d’entreprises peu susceptibles de réduire
leurs coûts de production, au contrat à « prix fixe » qui sera
plutôt choisi par celles qui sont capables d’améliorer leur pro-
ductivité. Entre les deux, les contrats offerts doivent combi- >

194 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE •AVRIL/JUIN 2007 •N011 Droit IÉconomie I Régulation
CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA COUR DE CASSATION — DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : APPROCHES JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE
ner une marge fixe (faiblement incitative mais apportant une
assurance de faibles gains) et un prix fixe (fortement incita-
tif mais risqué).
Dans son souci de promouvoir les efforts de R & D, l’État ap-
paraît comme un principal face à une multitude d’agents, cer-
tains identifiés et dont les caractéristiques technico-écono-
miques sont partiellement connues, d’autres totalement
inconnus jusqu’au jour où ils innovent. En lançant des pro-
grammes de recherche subventionnés, la puissance publique
propose l’équivalent d’un contrat de R & D à marge fixe. En
effet, les laboratoires publics ou privés qui répondent aux ap-
pels d’offre verront leurs coûts contrôlés et recevront des
sommes garantissant leur remboursement. Les ressources fi-
nancières vont de la poche des ménages/contribuables au
compte bancaire des centres de recherche, souvent ex ante et
sans réelle obligation de résultat, ce qui en fait un mécanisme
faiblement incitatif. Au contraire, par le système des brevets
dont l’étendue est limitée dans le temps (20 ans maximum)
et dans l’espace (champ des revendications défini explicite-
ment au moment du dépôt), les pouvoirs publics offrent à
l’ensemble des agents la possibilité de révéler leurs qualités
de chercheurs et de développeurs dans le cadre d’un contrat
à revenu plafond. L’absence de référence aux coûts s’explique
par le fait que beaucoup de caractéristiques techniques
et comptables du processus de recherche sont (et resteront)
non observables par le principal. Le financement de la re-
cherche se fait alors ex post en mettant à contribution les mé-
nages/consommateurs et non pas les ménages/contribuables.
Il y a donc une forte incitation à réussir à innover.
L’éventail des outils de promotion de la recherche reflète ainsi
à la fois la multiplicité des projets à entreprendre, la multipli-
cité des agents susceptibles de les réaliser, et le déficit infor-
mationnel sur la nature des projets et l’identité et les qualités
des innovateurs potentiels.
III. – À QUELLES INVENTIONS ACCORDER UN BREVET?
En utilisant le filtre de la théorie des incitations résumées ci-
dessus, nous pouvons maintenant apporter quelques éléments
de réponse à la question posée que nous reformulerons de la
façon suivante : pour quels types d’innovations les inventeurs
devraient-ils être incités à choisir un contrat de financement
à revenu plafond?
i) Le brevet est le contrat bien adapté quand les pouvoirs
publics (représentés par l’Office de la propriété intellectuelle)
souffrent d’un fort déficit informationnel sur les débouchés
potentiels de l’innovation. C’est évidemment le cas pour les
«innovations de marché », celles qui sont tirées par la de-
mande privée. Parce que les entreprises ont généralement une
meilleure connaissance de l’état des techniques que les res-
ponsables politiques, c’est également vrai pour beaucoup d’in-
novations « poussées » par la technologie, sauf s’il s’agit d’in-
novations fondamentales dont seuls les pouvoirs publics sont
en mesure d’internaliser la totalité des effets. Ces innovations
fondamentales ne verront le jour que grâce à des programmes
publics de recherche, c’est à dire des contrats à marge fixe. Je
pense que c’est ce que fait explicitement la loi quand elle ex-
clut du champ de la brevetabilité les théories scientifiques et
les méthodes mathématiques, dont la plupart sont de fait pro-
duites par des employés de l’État.
ii) Tout contrat à rémunération fixe (ou plafonnée) est ris-
qué puisque les fluctuations de coût sont entièrement à la
charge de l’agent : la marge est variable et peut devenir né-
gative quand surviennent des évènements non prévus. Il en
va ainsi du brevet qui plafonne les revenus sans les garantir.
Donc, il ne devrait attirer que les agents prêts à assumer cer-
tains risques industriels et commerciaux maîtrisables statis-
tiquement. C’est par exemple, le cas en pharmacie où la de-
mande potentielle peut être calculée et où les procédés de
recherche sont assez bien identifiés. C’est le savoir-faire ac-
cumulé, combiné à une part de chance, qui va faire la diffé-
rence. Le brevet donne alors l’occasion de réaliser une péré-
quation entre les rares réussites qui rapportent beaucoup et
les nombreux échecs au bilan financier négatif. En revanche,
pour les projets industriels très risqués (par exemple la fusion
nucléaire contrôlée dont la date de réalisation est impossible
à déterminer), seuls des consortiums de recherche associant
firmes privées et publiques et garantissant une marge aux in-
vestisseurs privés sont capables de fournir un cadre contrac-
tuel à la mesure des risques encourus.
iii) Les pouvoirs publics ne doivent pas accorder leur pro-
tection à des innovations dont la valeur sociale nette est né-
gative ou pour lesquelles l’octroi d’un brevet conduirait à une
perte d’efficacité collective. C’est ce qui se produit quand une
innovation faussement nouvelle est revendiquée et brevetée.
On connaît les exemples du « one-click » d’Amazon (
«Patent wars »,
The Economist, 6 avr. 2000
) et du « lien hypertexte » de British Tele-
com
(« More Rembrandts in the attic », The Economist, 17 janv. 2002
). Accorder un
brevet à ces fausses innovations, c’est accorder une aubaine
au déposant opportuniste. Ce type d’erreur peut être réduit
en recourant à un examen collectif de la validité des demandes
de brevets, c’est-à-dire en étendant le champ des investiga-
tions sur l’antériorité au-delà des bases de données et des
compétences des offices de délivrance des brevets. On connaît
la procédure d’opposition de l’Office Européen des Brevets
(
cf. les conditions d’application sur le site de l’OEB : <http://www.european-patent-office.org/le-
gal/epc/e/apv.html>
) qui court sur neuf mois après publication de
la notification de délivrance. Certains mouvements qui mili-
tent contre la brevetabilité des logiciels souhaiteraient, à dé-
faut d’interdiction, que les demandes de brevet soient publiées
sur Internet avant que le brevet soit octroyé pour être passées
au crible des recherches d’antériorité par l’ensemble de la
communauté des internautes.
iv) Les logiciels, tout comme les innovations biotechno-
logiques, posent un problème additionnel qui vient de leur
nature séquentielle. Dans ces domaines, les innovations uti-
lisent des fragments de programmes qui, s’ils font l’objet
d’une appropriation privée exclusive, peuvent bloquer toute
recherche ultérieure. Cela ne signifie pas que les innovations
doivent être interdites de brevet dans ces domaines mais que
le champ des revendications ne devrait pas empêcher l’effort
de recherche. Au contraire, le système des brevets, par l’obli-
gation de divulgation, cherche à encourager les utilisations
induites. Pour les innovations séquentielles, il faudrait donc
compléter le brevet par un mécanisme de licence obligatoire
à un prix fixé après négociation avec l’autorité chargée de
l’allocation des droits. Ce prix peut même faire partie du
menu offert au choix de l’innovateur : le choix d’un brevet
comprenant un prix de cession élevé devrait se payer par de
fortes redevances d’obtention et de maintien du brevet (
pour
une revue de la littérature sue ce thème, cf. Encaoua et alii (2005)
). Une variante
consiste à exiger que ces innovations soient placées dans une
banque de dépôt dont l’accès est contrôlé par une instance
privée ou publique chargée de vérifier que les utilisateurs ont
un objectif de recherche qui n’enfreint pas les droits des dé-
posants.

Droit IÉconomie I Régulation N0 11 • AVRIL/JUIN 2007 • REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE 195
PERSPECTIVES COLLOQUE
Conclusions
La théorie des incitations permet de montrer que le brevet
est une forme de contrat liant la société et des innovateurs
privés, dont les caractéristiques s’expliquent par l’impossi-
bilité d’identifier a priori l’ensemble des projets de recherche
et des meilleurs candidats à leur réalisation, et d’observer
leurs efforts de R & D. Le brevet confère une position mono-
polistique aux innovateurs, ce qui est néfaste pour l’effica-
cité; mais il déclenche une concurrence pour le marché et
accélère ainsi le rythme des innovations. Autre point positif,
la privatisation des gains collectifs est partiellement compen-
sée par la diffusion de l’information dans l’ensemble de la
société.
En allant au-delà du point de vue normatif qui permet de ré-
fléchir à la légitimité de certains brevets, nous souhaitons
conclure en nous posant la question de l’adéquation du sys-
tème lui-même. Le système des brevets est-il adapté à une so-
ciété dont la richesse est basée sur la connaissance? Conçu
pour des innovations industrielles, c’est-à-dire matérielles,
dont les retombées économiques sont mal prévisibles mais
restent contrôlables, mesurables et vérifiables ex post, on ima-
gine bien qu’il présente des faiblesses dans l’environnement
économique actuel et qu’il soit utilisé de façon stratégique par
certains pour bloquer l’accès au-delà des revendications légi-
times (
cf., par exemple, Noel M. et Schankerman M. (2006) pour une étude sur les com-
portements stratégiques dans le secteur du logiciel
). Aux yeux des économistes,
la principale faiblesse du système est son manque de flexibi-
lité, c’est-à-dire la pauvreté du menu offert aux innovateurs.
La flexibilité actuelle vient surtout de l’adaptabilité de la du-
rée et du champ des revendications. Mais, il manque des op-
tions suffisamment différentes les unes des autres par les droits
conférés et le prix à payer pour les obtenir de façon à former
un vrai menu dans lequel les innovateurs trouveraient un
contrat adapté à leur innovation (
«… economic theory pleads for a mecha-
nism design approach to the patent system, where an optimal patent system could be based
on a menu of different degrees of patent protection with stronger protection corresponding to
higher fees » Encaoua et alii (2005)
).
Bibliographie
•Encaoua D., Guellec D. et Martinez C. (2005), « Patent systems for encouraging innova-
tion : Lessons from economic analysis », WP Eureqa, Université Paris I, à paraitre dans Re-
search Policy.
• Laffont J.-J. et Martimort D. (2002) « The theory of incentives. The principal-agent model »,
Princeton University Press.
• Noel M. et Schankerman M. (2006) « Strategic Patenting and Software Innovation », Lon-
don School of Economics WP, Juin, <http://sticerd.lse.ac.uk/dps/ei/EI43.pdf>.
• Tirole J. (2003) « Protection de la propriété intellectuelle : une introduction et quelques
pistes de réflexion » p. 9 à 47 in «Propriété intellectuelle », Rapport du Conseil d’Analyse
Économique, La documentation française, Paris, <http://lesrapports.ladocumentationfran-
caise.fr/BRP/034000448/0000.pdf>.
Philippe SÉMÉRIVA
C’est un honneur d’avoir été invité à vous présenter quelques
réflexions sur une question, qui n’a que le tort d’être un peu
ardue, relative à ce qui « mérite » d’être breveté.
C’est, en outre, une chance d’intervenir à la suite de M. Crampes,
qui a dessiné le vaste périmètre dans lequel s’insère cette ques-
tion.
Il y aura des redites entre lui et moi; tant pis? Non, tant mieux,
puisque cela démontrera, au besoin, qu’entre adeptes de spé-
cialités différentes, on parle des mêmes choses – ce qui est le
moins – mais qu’en outre on y décèle les mêmes difficultés.
Le droit des brevets, qui est bien vieux, confronte en perma-
nence l’idée d’invention à la marche de la technologie.
La règle du jeu n’a pas varié, qui consiste à échanger une pro-
tection monopolistique temporaire contre la divulgation d’un
enrichissement de l’art antérieur; c’est l’idée de contrat qu’évo-
quait tout à l’heure M. Crampes, celle d’un échange, c’est-à-
dire d’un accord, qui suppose un certain équilibre entre le
droit que consent la collectivité et l’avantage qu’elle en retire
(
car, s’il n’est pas de lésion en matière d’échange, un trop grand déséquilibre peut remettre
en cause la qualification même d’un tel accord, cf. Cass. 3eciv., 15 mars 1977, n° 75-14.664,
Bull. civ. III, n° 120
).
Il reste généralement enseigné, sinon unanimement admis –
car la controverse sur le bien fondé de cette analyse n’est pas
en voie de s’éteindre –, que l’arrière-plan économique justi-
fiant la constitution de ce droit exorbitant tient à ce que « le
rôle du brevet est de restreindre la concurrence pour encoura-
ger la recherche et le développement » (
Stiglitz J. et Walsh C., Principes
d’économie moderne, De Boeck éditeur, p. 451
), ce qui se traduit, dans une
version plus entrepreneuriale, par l’idée que « l’objectif n’est
pas de faire plaisir aux entreprises, mais de reconnaître que
les industriels génèrent une activité économique qui accroît le
bien-être de tous en procurant à la collectivité les moyens dont
elle a besoin pour satisfaire ses besoins présents et futurs »
(
Sueur T. et Combeau J. Un monument en péril : le système des brevets en Europe, Droit
et économie de la propriété intellectuelle, LGDJ, 2005
), et se prolonge, dans une
vision compétitrice, par l’affirmation selon laquelle « la mise
en place d’un système efficace visant à protéger les brevets cou-
vrant des innovations technologiques constitue une arme cru-
ciale dans un environnement économique compétitif » (
Maloney Th.,
La défense des droits de la propriété industrielle en Europe, aux États-Unis et au Japon, Mé-
langes Stauder, Presses universitaires de Strasbourg, 2001
).
Ajoutons à cela un principe de rémunération, parfois même
seulement morale, manifestant la reconnaissance publique
envers l’inventeur.
Et soulignons enfin que cette permanence des mobiles se pro-
longe par la permanence de l’objet du brevet, conçu comme
consistant en une « invention », encore que l’expression soit
en elle-même polysémique.
L’adéquation de ces principes de base aux différentes activi-
tés de recherche et de développement est variable.
Car, si l’on constate que, comme bien d’autres institutions ju-
ridiques, le droit du brevet connaît des difficultés, parfois
graves, il faut tout de même commencer par signaler que le
système fonctionne sans problème existentiel dans nombre
de secteurs d’activités, quel qu’en soit le degré de sophistica-
tion, notamment parce qu’il en est l’un des fruits, et qu’il s’y
trouve encore naturellement adapté.
Mais c’est un truisme de souligner que les choses se compli-
quent beaucoup lorsqu’on envisage des technologies assez
nouvelles pour n’être nées, ou ne s’être largement dévelop-
pées qu’après l’élaboration des règles fondamentales de la
matière.
Il faut se risquer à relever diverses circonstances pouvant in-
fluer sur l’idée que l’on peut se faire, dans ces conditions, de
«ce qui mérite d’être breveté »:
– on craint, d’abord, de devoir remarquer que, notamment
en ce qu’ils concernent les technologies nouvelles, les droits
de propriété intellectuelle – et point seulement les droits de
brevet – sont généralement abhorrés du public;
– par une meilleure connaissance du droit comparé, voire
de notre droit unifié (
Pollaud-Dullian, La brevetabilité des inventions, Litec, IRPI,
n° 16
), on s’est aperçu que le droit européen diffère sensible-
ment des principes reçus au Japon et aux États-Unis, qui ad-
mettent comme brevetable tout ce qui est utile, et cela ne peut
être indifférent, en termes de compétitivité ou d’emplois, ni
sans effets juridiques; >

196 REVUE LAMY DE LA CONCURRENCE •AVRIL/JUIN 2007 •N011 Droit IÉconomie I Régulation
CYCLE DE CONFÉRENCES DE LA COUR DE CASSATION — DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : APPROCHES JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE
– on n’a pas manqué de souligner qu’il n’est pas forcé-
ment sain que les offices de délivrance aient précisément
quelque intérêt à la délivrance de brevets (
cf. Tirole J., Rapport au
Conseil d’analyse économique sur la propriété intellectuelle
);
– enfin, l’émergence constante de nouvelles pratiques,
bien différentes des techniques primitives, tels les remparts
de brevets visant à cadenasser le marché par multiplication
des barrières juridiques à l’entrée de nouveaux opérateurs,
posent, telles les pools de brevets, des questions difficiles à
évaluer au regard du bien commun.
De façon plus générale encore, le prestige du brevet n’est plus
ce qu’il était, notamment parce que les opérateurs écono-
miques peuvent lui préférer d’autres stratégies, par exemple
le secret, voire le bénéfice de la première présence sur le mar-
ché (
Lévêque F. et Ménière Y., Économie de la propriété intellectuelle, éd. La Découverte
),
et parce que les interventions des autorités de concurrence
ont recadré l’exercice des droits qu’il confère dans le respect
des principes généraux.
Il existe une relativisation du brevet.
Mais, c’est en tant que juge que je parle ici, et il ne peut être
question, tant au regard de cette fonction, que de mon ab-
sence de compétence à ce propos, d’aller plus loin dans ces
observations, voire de me lancer dans des projets ridicule-
ment ambitieux, tel que celui d’évoquer les questions éthiques
qui nourrissent la crise de la brevetabilité, en interpellant, par
exemple, les brevets de médicaments, au regard de l’équilibre
entre les investissements qu’il supposent et le poids des ca-
tastrophes humaines que ce coût même peut impliquer, ou
en examinant le respect des limites des choses devant rester
hors du commerce.
Ces débats ont place à cette tribune, mais d’autres les explo-
reront; je ne veux que centrer mon propos sur la confronta-
tion du juge avec la question précisément posée.
Un juge rend des jugements, et plus précisément, des « dis-
positifs ».
La théorisation des questions ne vaut donc qu’en ce qu’elle
éclaire cette décision finale; en résumé : le brevet est-il va-
lable? D’où suivra,… et donc, est-il contrefait? Puis répara-
tions, interdictions, etc.
Et de ce point de vue, je voudrais faire part de quelques dif-
ficultés, en suggérant que, peut-être, l’influence des divers fac-
teurs que j’ai cru devoir citer, et de bien d’autres que j’ai ou-
bliés ou dont j’ignore tout, crée des tensions sur « l’outil
juridique brevet ».
En somme, la question de la brevetabilité, si elle n’a jamais
été simple, débouche à présent, au moins dans certains cas,
sur d’importants aléas dans la décision finale.
I. – DE LA DIFFICILE APPRÉCIATION
DE LA BREVETABILITÉ...
La Convention de 1883 dessine un monument harmonieux,
sauf cette curieuse observation qu’elle ne définit clairement
que ce qui n’est pas brevetable, et non point ce qui l’est.
On en retient cependant, de manière positive, et pour parler
comme les directives de l’OEB, que l’objet du brevet est une
invention nouvelle, inventive, et susceptible d’application in-
dustrielle.
Cette définition n’a cependant pas réussi à héberger certaines
des nouvelles technologies, et on a pu, dès les années 1980,
déplorer cette « érosion du droit des brevets » (
Colloque IRPI sur la
conférence de Nairobi
).
Il en est résulté un vaste mouvement de contournement du
droit primaire, soit par définition, au cas par cas, d’un cadre
juridique propre à certains secteurs (
obtentions végétales, topographies
de semi-conducteurs, logiciels, bases de données; la Commission européenne ne semble
pas se résoudre à déposer son évaluation de la pertinence de cette dernière protection spé-
cifique; on envisagerait même d’en constater l’inefficacité économique; cf. Benabou V.-L.,
Propr. intell., n° 18, p. 106
), soit par délimitation d’un sous-ensemble
de règles particulières supposées adapter le droit général à
certains types d’avancées techniques (bio-technologies).
On peut se demander si la perspective commune de ces dé-
marches n’est pas en définitive de malaxer l’institution-bre-
vet pour la rétrécir ou la dilater à la mesure des nouveaux dé-
fis, faisant du « sur mesure » pour certains types de technologies,
et laissant les autres aux bons soins du prêt-à-porter général,
au risque de faire de ce dernier une sorte de cadre par défaut,
voir un lit de Procuste, qui ne va jamais à qui s’y allonge.
Quoi qu’il en soit, ce phénomène de reclassement spécifique
a profondément remis en cause les principes habituels de bre-
vetabilité.
Avec le droit des obtentions végétales, c’est la notion de dé-
couverte, supposant l’élaboration de quelque chose qui n’était
pas dans l’état du monde, qui est remise en cause, la loi ad-
mettant la protection de « toute variété nouvelle, créée ou dé-
couverte » (
C. propr. intell., art. L. 623-1
).
Dans le cas des semi-conducteurs, c’est la notion de nouveauté
qui est convoquée, puisque « la topographie finale ou inter-
médiaire d’un produit semi-conducteur traduisant un effort
intellectuel du créateur peut, à moins qu’elle ne soit courante,
faire l’objet d’un dépôt conférant la protection » (
C. propr. intell.,
art. L. 622-1
).
Quant aux logiciels, on a opté pour un système dérivé du droit
d’auteur (du copyright?), qui suppose que la création pour-
tant apparemment de nature technique, consiste en sa phase
«d’écriture »; c’est cette fois la distinction entre l’œuvre et
l’invention qui s’estompe.
Accessoirement, cette prolifération d’objets juridiques a créé
quelques risques d’abordages, que l’on n’évite que par de
subtiles distinctions, telle, s’agissant de l’articulation entre
brevet et certificat d’obtention végétale, la règle selon laquelle
«la loi française, dans sa rédaction actuelle, reconnaît la bre-
vetabilité d’une invention portant sur des végétaux, à condi-
tion que la mise enœuvre de l’invention ne soit pas limitée à
une variété végétale telle que définie à l’article 5 du règlement
2100/94 » (
Peuscet J., Brevetabilité de la biologie en France, CEIPI n° 54, p. 60
).
À ce stade, nous sommes en présence de difficultés bien
connues du juge, de la nature de celles que pose la mise en
œuvre de bien d’autres règles, par exemple celle excluant la
protection par le droit des dessins et modèles d’un objet fonc-
tionnel, encore que la jurisprudence a mis du temps à se fixer,
et que la question donne encore lieu à de vifs débats (
Guerre et
paix aux frontières du design, RLDA 2006/5, n° 287
), ce qui montre qu’il faut
bien du temps pour prendre la mesure d’une telle règle, alors
pourtant qu’on mesure facilement les motifs de l’ostracisme
ainsi dicté par la loi.
Le juge s’attend encore à ce que les textes puissent donner
lieu à des interprétations divergentes et à voir, par exemple,
la Cour de cassation dire que le droit français, pourtant en
mêmes termes que la CBE, ne permet pas, quoi qu’en dise la
Grande chambre de recours de l’OEB, la protection de la se-
conde application thérapeutique (
Cass. com., 26 oct. 1993, Rapp. annuel
de la Cour de cassation 1993, p. 314, étant précisé que l’article 54 CBE a été révisé en 2000,
sans incidence pour l’instant, dans cette période transitoire, sur l’article L. 611-11 du Code
de la propriété intellectuelle; le feuilleton n’est d’ailleurs pas terminé, car il ne semble pas
que la décision de la GRC fasse l’unanimité à l’OEB : OEB, CRT, 29 oct. 2004, T.1002/03
).
Et, enfin, on ne pouvait perdre de vue la controverse fonda-
mentale entre découverte et invention (
Azéma J. et Galloux J.-C., D.,
§ 173; Vivant M. et Bruguière J.-M. Réinventer l’invention?, Propr. intell., 2003, n° 8, p. 286
).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%