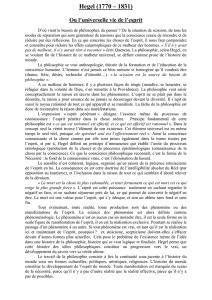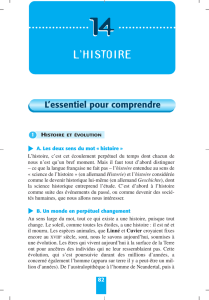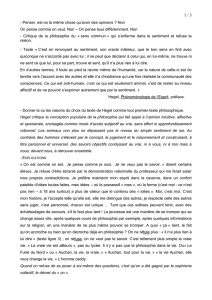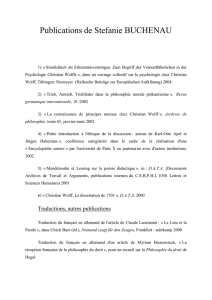Résumé de thèse

Élodie DJORDJEVIC – Résumé de thèse – page 1/4
Élodie DJORDJEVIC
Doctorante en philosophie à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne
ATER en philosophie à l’Université Paris II Panthéon-Assas
Résumé de thèse
La thèse que j’achève sous la direction du Professeur Jean-François Kervégan, intitulée
« Rationalité et normativité. Hegel et la question du jugement politique », se situe au croisement
de l’histoire de la philosophie, de la philosophie pratique et de l’ontologie. Partant d’une
interrogation sur la conception de l’action et le statut de la normativité dans la pensée de Hegel et
de sa confrontation avec des développements de la philosophie contemporaine de l’action et des
institutions qui lui semblent — à bien des égards — opposés, mon travail de recherche porte sur
le jugement politique en tant qu’il met en jeu, de manière problématique, le rapport entre
rationalité et normativité. Il s’agit de déterminer plus avant la nature et le statut des normes
éthiques et politiques, poser la question de leur spécificité et de la rationalité qu’il faut leur
accorder : dégager la nature, la possibilité et les conditions d’un véritable jugement politique, d’une
évaluation qui peut se prévaloir légitimement du qualificatif de politique — par distinction, tout à
la fois du jugement moral et du jugement technique. De la sorte, c’est la possibilité d’une
détermination non exclusivement morale du devoir-être et qui ressortirait en propre à la politique
que ce travail de recherche s’efforce de dégager.
La première partie, qui tient en quelque sorte lieu de prolégomènes, tend à situer l’essai de
théorie du jugement de politique dont cette thèse est l’objet relativement à la conception
arendtienne de celui-ci, à la conception du jugement politique qu’elle prétend mettre au jour chez
Kant à partir de sa détermination du jugement réfléchissant dans sa modalité esthétique et contre la
philosophie de l’histoire dont la pensée de Hegel se présente comme le paradigme.
Particulièrement, il s’agit dans cette partie préliminaire de mettre à mal l’alternative, posée par H.
Arendt, à laquelle nous serions selon elle nécessairement voués dès lors qu’il s’agit de penser le
modus operandi propre du jugement comme faculté politique par excellence : pour Arendt en effet,
face aux difficultés auxquelles nous sommes alors confrontés et, plus généralement, dès lors qu’il
s’agit de concevoir le problématique rapport de la théorie à la pratique qui hante la pensée
moderne, « [n]ous nous retrouvons, en dernier ressort, placés devant la seule alternative possible
dans ce domaine — ou bien l’on affirme, avec Hegel, que Die Weltgeschichte ist das Weltgericht et l’on
confie à la Réussite ce jugement ultime, ou bien l’on pose, avec Kant, l’autonomie de l’esprit
humain et son indépendance possible vis-à-vis des choses telles qu’elles sont ou telles qu’elles
sont advenues »
1
. Si cette formule condense certains éléments décisifs de la position arendtienne
de la question du jugement politique qui, pour dégager la possibilité d’une théorie de celui-ci,
donne la faveur à Kant (précisons, de plus, que ce n’est pas dans la philosophie proprement
pratique de Kant qu’Arendt trouve un appui pour sa théorie mais, presque exclusivement, dans la
première partie de la Troisième Critique) contre Hegel, il s’agit, afin de déterminer plus précisément
le sol de notre perspective et la pertinence du recours à la pensée hégélienne sur ce plan, de
réfuter la triple affirmation qu’elle contient, à savoir : 1) Kant et Hegel s’opposent radicalement et
frontalement quant à la possibilité même de la normativité en général et de l’évaluation politique
en particulier ; 2) Parce que Kant conçoit la possibilité de la détermination de normes
1
La Vie de l’esprit, Première partie : La Pensée, IV : « Où est-on quand on pense ? », 21 « Post-scriptum », trad. fr. L.
Lotringer, PUF, Quadrige, Paris, rééd. 2005, pp. 276-277.

Élodie DJORDJEVIC – Résumé de thèse – page 2/4
indépendantes de ce qui est, sa pensée maintient la possibilité d’un jugement véritable ; 3) Parce
qu’il donne dans une philosophie de l’histoire — laquelle revient pour Arendt à placer la sanction
et le jugement dans la pure factualité (et donc à l’éliminer comme tel) — la position hégélienne,
au contraire, rend impossible toute évaluation véritable ou plutôt nous condamne à approuver à
tout ce qui est pour cette seule raison qu’il est factuellement advenu (chapitre I).
Si, cependant, c’est bien en raison des caractéristiques propres de l’action décelées par
Arendt que la pensée hégélienne, qui fonctionne alors comme représentante des théories
politiques fondées sur une philosophie de l’histoire, est considérée comme inopportune pour
penser le jugement politique, la deuxième partie, vise, à travers l’analyse conjointe de la doctrine
hégélienne de l’esprit objectif et de la Logique, à mettre au jour le statut et la conception
hégélienne de la normativité plus particulièrement, précisément, par le biais d’une analyse
attentive de la détermination hégélienne de l’action en général, et de l’action politique en
particulier (chapitre II). En effet, s’il ne s’agit pas de montrer que l’on puisse immédiatement
trouver, dans la philosophie de Hegel, une théorie du jugement politique en tant que telle, nous
visons à établir qu’il y a, en revanche, dans cette philosophie, une pensée de la normativité
particulièrement féconde à cet égard, dans la mesure où elle permet de concevoir une
détermination non exclusivement morale du devoir-être. Mettant en œuvre une étude de
l’élaboration hégélienne d’une « philosophie de l’histoire », sa place dans l’économie du système et
les déterminités logiques qu’elle mobilise, la confrontation de la conception hégélienne de
l’histoire à l’appréhension positive du droit par la jeune l’École historique du droit (qu’incarne au
premier chef Savigny dont Hegel est le contemporain et le collègue à Berlin) doit d’abord
précisément permettre de réfuter la thèse selon laquelle Hegel donnerait dans un historicisme –
fut-il larvé -, pour lequel la réussite, voire le simple fait, se présenterait effectivement ipso facto
comme bon et juste pour cela seul qu’il est (chapitre III). Pour autant, la « normativité
rationnelle » que ces analyses doivent permettre de mettre au jour n’est pas une normativité morale,
dont l’aune serait un idéal abstrait et indépendant de ce qui est. Le dernier chapitre de cette
deuxième partie s’efforce de dégager la possibilité et les caractéristiques d’une normativité
proprement politique, par distinction de la normativité morale par, notamment, une
confrontation de la philosophie pratique hégélienne à des pensées contemporaines qui, tout en
l’« actualisant », en refusent les “présupposés” en général et, en particulier, sa conception de la
rationalité et de l’histoire, et tentent de penser une « normativité immanente » en en “traquant”
les manifestations et les preuves à travers des phénomènes tels que le sentiment d’injustice ou les
expériences du mépris : il s’agit d’analyser en particulier, s’agissant de la question du jugement
politique et de la détermination du politique, le rapport de la position hégélienne à la « théorie de
la reconnaissance » telle que l’élabore, à partir d’une certaine lecture de Hegel, la pensée de ce que
l’on peut désigner comme le “premier Honneth” (celui de La Lutte pour la reconnaissance et des
Pathologies de la liberté, dans l’anti-institutionnalisme qu’elle contient) (chapitre IV).
S’interroger sur le jugement politique suppose à l’évidence de déterminer l’objet même d’un
tel jugement et c’est précisément à une tentative de circonscription du champ de la politique, tout
autant qu’à la détermination du sujet qui lui est corrélé, qu’est consacrée la troisième partie de mon
travail. Ici encore, les analyses hégéliennes de l’esprit objectif et plus particulièrement le concept
d’institution qui s’y déploie dans le rapport qu’il entretient à l’action et au « sens pratique » sont le
support de la réflexion. À cet égard, si la deuxième partie de la thèse s’efforce de dégager,
relativement à une normativité simplement « morale », quelque chose comme une normativité
proprement politique, il s’agit sous cet aspect et par une confrontation entre les conceptions
hégélienne et bourdieusienne du « sens pratique » relativement à l’institution, tel qu’Aristote en
est aussi bien entendu le médiateur, de montrer que ce dont il est ici question est bien une
normativité “véritable”, une normativité en un sens fort et qui ne saurait être comprise et réduite
à une simple « normalisation » (chapitre V). Il s’agit également dans cette troisième partie de
tenter, à travers le prisme de la normativité politique ainsi conçue, de faire leur part et de penser

Élodie DJORDJEVIC – Résumé de thèse – page 3/4
les rapports qu’entretiennent entre eux les champs du social et du politique, d’un côté, du moral,
de l’éthique et du politique à proprement parler de l’autre, ainsi que les déterminations du sujet
qui y sont chaque fois impliquées. Il s’agit alors, avec mais aussi contre Hegel et sa pensée de la
souveraineté de l’État, de s’efforcer de penser le “lieu” du politique et de sa normativité propre,
mais aussi la question de l’identité du sujet politique dans son rapport aux normes, face à des
transformations du monde qui se laissent grossièrement énoncer comme un mouvement
d’autonomisation du social et l’érosion de la souveraineté de l’État ainsi que celle, peut-être de la
prééminence et de l’exclusivité étatique pour ce qui concerne les normes et les droits. Ces
analyses sont menées sur un double front problématique : d’une part, selon un pôle plus
“subjectif”, celui de la confrontation de la conception hégélienne de l’État dans son rapport à la
société civile et à la famille en tant que cette dernière est déterminée, avec l’institution sociale de
la « corporation », comme « racine éthique » de l’État, à la détermination bourdieusienne de l’État
comme « détenteur du monopole du capital symbolique » (chapitre VI) ; d’autre part, selon un
pôle plus “objectif”, par l’étude de la détermination hégélienne de la souveraineté de l’État et la
théorie de la représentation qu’elle contient, à la lumière du réquisit de distinction arendtienne
entre le traitement de la « question sociale » et le champ proprement politique, ainsi que la
critique, par celle-ci, de l’appréhension du politique par le prisme de la souveraineté et
l’identification de l’étatique et du politique que sous-tend une telle conception (chapitre VII).
La difficulté d’une détermination définitive et fixe du champ politique lui-même, ainsi que
les problèmes propres posés par le jugement politique dans ce qu’il a de normatif et dans son
rapport à la rationalité, conduisent, dans la quatrième et dernière partie de cette étude, à analyser
plus avant et frontalement la question de la détermination de la rationalité politique, dans la relation
qu’entretient ici la raison avec la contingence et la difficile question de l’évaluation que supporte
celle du jugement de l’action et de savoir ce qui doit être fait. Il s’agit ainsi de revenir à l’ontologie
hégélienne et, singulièrement, aux catégories de la modalité : pouvoir déterminer quelque chose
comme une rationalité politique, dont le jugement politique serait le fruit, suppose en effet
d’éclairer les rapports entre nécessité, possibilité et devoir-être, tels que ces concepts sont
mobilisés dans le champ politique, où leur assignation même, leur champ de pertinence respectif,
fait elle-même l’objet d’un enjeu politique. Certains travaux de Vincent Descombes et une
attention plus particulière portée aux rapports qu’entretiennent, dans la Logique de Hegel,
contingence, nécessité et devoir-être s’agissant de la détermination de la finité, devront alors être
mobilisés (chapitre VIII). Enfin, puisque la question du jugement politique implique également
d’élucider le statut du dire qu’est la philosophie elle-même en tant qu’elle se donne le monde et la
pratique pour objet, c’est ici une distinction entre l’appréhension que l’on peut dire “positive” de
la pratique (que ce soit par les sciences sociales ou la “théorie politique”) et la “philosophie
politique”, tel que le pivot de cette distinction nous semble précisément se tenir dans le rapport
qu’entretiennent ces deux types de discours rationnels sur la politique (ou encore sur ce que l’on
peut désigner de manière hégélienne comme « monde objectif ») et la conception de la
normativité qui les sous-tend dans le même temps qu’elle y est à l’œuvre, que nous voudrions
proposer, élaborer et fonder. En dernière instance, du point de vue de l’appréhension rationnelle
du monde pratique, la conception et position du rapport entre théorie et pratique nous semble
être ce qui détermine ultimement le statut possiblement normatif du discours rationnel – que ce
dernier pose et assume – et, surtout, ses nature et modalité. De nouveau, sur ce point, l’étude la
confrontation de la pensée hégélienne de ce rapport et de la modalité normative du discours qu’il
implique relativement à celle de la sociologie critique bourdieusienne, qui se présente
précisément, contre une tradition de la sociologie et de l’ethnologie mais aussi – et peut-être,
surtout – contre l’appréhension philosophique de la pratique et la posture qu’elles supposent et
avec laquelle elle prétend rompre, comme la véritable théorie pratique de la pratique et seule à
même de saisir la logique de l’action sans la réduire à la « logique logique » permettra de mener
l’analyse. Ce sont alors les conséquences que l’on peut tirer de ce qui précède relativement au
rapport entre philosophie et politique, rationalité et normativité et, en dernière instance, sur ce

Élodie DJORDJEVIC – Résumé de thèse – page 4/4
que peut être le caractère critique de la philosophie dans le refus qu’elle doit entretenir à ses
tendances à l’édification comme, sans doute, à la dénonciation et à la résignation. À cet égard, il
s’agit aussi de mesurer, s’agissant de la question du rapport entre normativité et rationalité et celle
du jugement politique, dans quelle mesure la pensée hégélienne, qui peut à l’occasion s’affirmer
comme la « véritable critique », engage et ce dans son versant le plus ontologique. Ou encore,
pour le dire avec le Foucault de la Leçon inaugurale, le même qui désigne l’humeur généalogique
comme « positivisme heureux » : « échapper à Hegel suppose d’apprécier exactement ce qu’il en
coûte de se détacher de lui ; cela suppose de savoir jusqu’où Hegel, insidieusement peut-être s’est
approché de nous ; cela suppose de savoir, dans ce qui nous permet de penser contre Hegel, ce
qui est encore hégélien ; et de mesurer en quoi notre recours contre lui est encore peut-être une
ruse qu’il nous oppose et au terme de laquelle il nous attend, immobile et ailleurs »
2
(chapitre IX).
2
M. Foucault, L’Ordre du discours, Gallimard, 1971, p. 72 et pp. 74-75.
1
/
4
100%




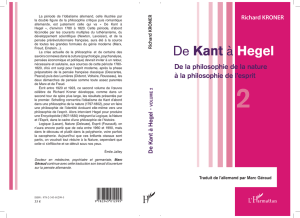
![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)