Le philosophe et psychanalyste Slavoj Žižek à l`Université

Quel regard portez-vous sur la
jeunesse actuelle ?
Le dernier grand mouvement
mobilisateur, où il y a eu différentes
demandes (par rapport à l’éduca-
tion, à la famille, aux conditions de
travail, etc.) a été 1968. Le système
capitaliste a intégré ces demandes
à tel point que toutes les anciennes
normes ont explosé, mais aucun pro-
gramme d’identité n’a été proposé.
La jeunesse actuelle est donc dans
une situation diffi cile, où ni elle ni les
aînés ne savent comment formuler
une alternative. La désorientation
de la jeunesse n’est ainsi que le
signe d’une désorientation générale.
On voit juste émerger, d’un côté, du
cynisme, de l’autre, des deman-
des contradictoires qui pourtant
se rejoignent dans leur volonté
d’attirer l’attention : violence
dans les banlieues, grands ras-
semblements de foule où l’ob-
jectif est de faire un geste ano-
din (tout le monde lève le pied en
même temps par exemple), etc.
La jeunesse se retrouve donc
entre violence ou conformisme,
c’est une situation assez triste.
Selon vous, quels sont
les éléments essentiels à
apprendre aux étudiants en
philosophie ?
Le rôle de l’université est de
corriger les questions plutôt que
d’apprendre à donner les répon-
ses. L’université doit inciter l’étu-
diant à se retirer du monde, et à
se demander si la façon d’appro-
cher le problème est pertinente. Il
y a beaucoup de fausses batailles
dans les débats de société actuels.
Par exemple, on pose mal la ques-
tion du racisme, réduite à celle de
la tolérance, alors que cette équi-
valence ne va pas de soi. De même
pour celle de la libération sexuelle :
TRANSDISCIPLINARITÉ
Slavoj Žižek ou l’autre
regard sur le monde
Le philosophe et psychanalyste Slavoj Žižek, profes-
seur à l’Université de Ljubljana (Slovénie), est un des
principaux animateurs de la philosophie contempo-
raine. Il se partage entre conférences spécialisées,
tenues dans des universités d’Europe et des États-
Unis, et participation au débat de société, grâce à son
analyse de la politique et du cinéma en particulier. En
mars, il était l’invité du cycle de conférences « Penser
la condition anthropologique aujourd’hui », organisé
par le Département de philosophie. Libre cours l’a
rencontré à cette occasion.
Antoine Masson (à gauche) et Sébastien Laoureux (à droite), chargés de cours au Département de philosophie, ont invité le philosophe et psychanalyste slovène Slavoj Žižek (au centre), Université de Ljubljana, à
enrichir de sa pensée originale leur réfl exion sur la condition humaine. Un événement qui a réuni plus d’une centaine de chercheurs, d’étudiants et de cliniciens.
Philosophie et psychanalyse, sœurs siamoises
Slavoj Žižek exerce sa philosophie avec des éléments de notre monde : la politi-
que, le cinéma et les neurosciences en particulier. Il le fait avec des références
qui appartiennent à la fois à la philosophie fondamentale (Hegel, Schelling, etc.)
et à la psychanalyse lacanienne, elle-même réputée, a priori, antiphilosophique. Il
propose donc une pensée très originale, et est un bel exemple de transdisciplina-
rité dont se réclame le cycle organisé par Antoine Masson et Sébastien Laoureux
autour du thème « Penser la condition anthropologique aujourd’hui ».
Outre l’animation d’une journée d’études consacrée à l’analyse de ses travaux,
le professeur slovène a tenu une conférence pour répondre à la question « est-il
possible d’être hégélien aujourd’hui ? ». Il relit la dialectique hégélienne à travers
l’enseignement de Lacan et renouvelle ainsi la théorie du savoir absolu, et éclaire
en retour les enjeux de la psychanalyse à partir de la dialectique hégélienne. Il pro-
pose de concevoir le retournement qu’Hegel opère vers la « chose inatteignable »,
comme ce qui ouvre un écart traumatique qui est la « chose » même. Cet « écart »
ou « impossible » n’est rien d’autre que la réalité traumatique déployée dans le
cadre de la psychanalyse : celle qui fait de la chose inatteignable la cause du désir.
Il faut donc l’apport de la psychanalyse pour lire Hegel de cette façon, mais aussi,
c’est Hegel qui a permis à la psychanalyse d’avoir ce regard. Les deux disciplines
s’intriquent l’une à l’autre. Tout comme la psychanalyse fait un aller-retour incessant
entre pratique clinique et théorie, la pensée de Slavoj Žižek vaut par son application à des choses concrètes (le cinéma par exemple). Et
comme elle, la philosophie du professeur Žižek apporte un décalage qui permet de voir le monde autrement pour faire avancer la réfl exion.
Un changement de point de vue sans que l’objectif soit de fournir une solution clef sur porte.
il ne s’agit pas de savoir s’il faut
revenir à davantage d’interdits en
la matière, mais pourquoi cette
libération s’accompagne de l’émer-
gence de problèmes tels que
l’impuissance, etc. Il faut être
innovant et interroger la forme
même du questionnement.
Pensez-vous que les
universités européennes
sont en phase avec la
société contemporaine ?
Le problème pour l’univer-
sité n’est pas d’être en phase
avec la société, c’est notre
société qui n’est pas en phase avec
elle-même. Je ne veux pas vivre dans
un monde où il n’y aurait que deux
modèles possibles : le libéralisme
anglo-saxon et le nouvel autorita-
risme asiatique. Les universités ont
un rôle à jouer dans ce renouvelle-
ment, mais elles ne risquent pas de
le faire, si elles-mêmes sont acquises
au principe d’utilitarisme. C’est pour
cela que j’estime que la Réforme de
Bologne est catastrophique. Elle
demande aux universités de répon-
dre aux attentes de la société, mais
qui va défi nir ce que sont ces atten-
tes ? Ce ne sont que des décisions
idéologiques et politiques. L’histoire
nous montre que toutes les grandes
idées ou inventions sont nées par
« surcroît1 ». Le productivisme est
une erreur. Si les universités pren-
nent cette voie, c’est désastreux
pour la société elle-même. L’univer-
sité doit s’affranchir de la société,
afi n de laisser un espace de liberté
pour ce « surplus » créatif.
Propos recueillis par E.D.
1 Voir Antoine Masson et Bernard Chouvier (eds),
Les fabriques du surcroît, Presses universitai-
res de Namur, 2007
Le rôle de l’université est
de corriger les questions
plutôt que d’apprendre à
donner les réponses
MAGAZINE DE L’UNIVERSITÉ DE NAMUR
4
CONNEXION
1
/
1
100%


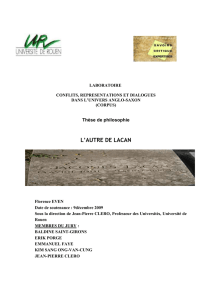
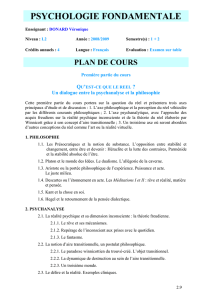




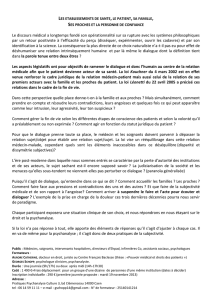
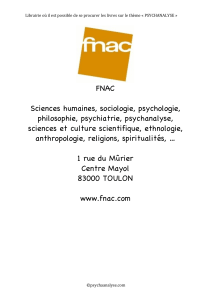
![Hegel « Le 14 Novembre [1831] mourut à Berlin le célèbre](http://s1.studylibfr.com/store/data/001023432_1-a9b6716e401d92cc3aee9aa9973a15fa-300x300.png)
