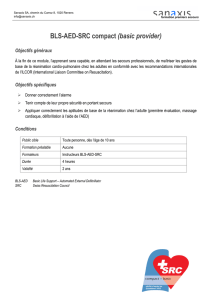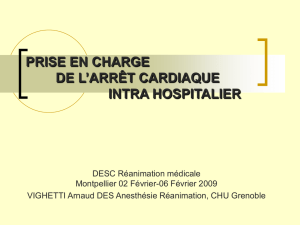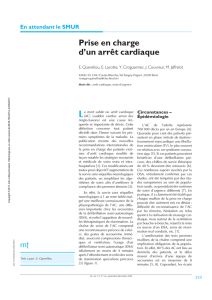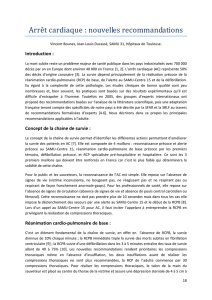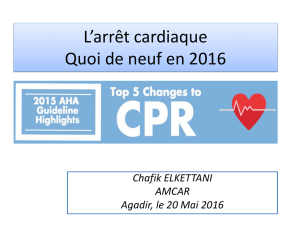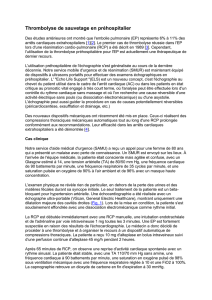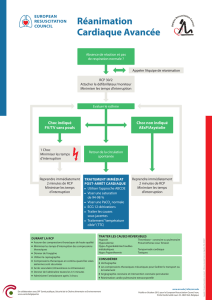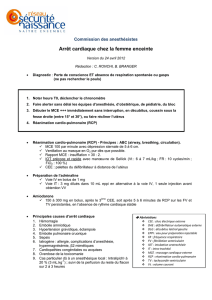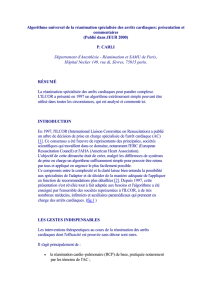Mise au point sur la réanimation cardio-pulmonaire initiale

MISE AU POINT
Mise au point sur la réanimation cardio-pulmonaire
initiale
P.Y. Gueugniaud*, J.S. David
Service d’anesthésie-réanimation, centre hospitalier universitaire Lyon-Sud, 165, chemin du Grand-Revoyet,
69495 Pierre-Bénite cedex, France
(Reçu le 24 décembre 2000 ; accepté le 20 août 2001)
Résumé
L’American Heart Association en collaboration avec l’International Liaison Committee On Resuscitation vient de
proposer une actualisation des recommandations pour la réanimation cardio-pulmonaire. C’est l’occasion de faire le
point sur les travaux récents et les principaux progrès dans le traitement de l’arrêt cardiaque, concernant en particulier
le massage cardiaque, la ventilation, la défibrillation ou le traitement pharmacologique. Pour terminer, nous résumons
ce qui paraît essentiel et novateur dans les nouveaux concepts de la réanimation cardio-pulmonaire. © 2001 Éditions
scientifiques et médicales Elsevier SAS
arrêt cardiaque / réanimation cardio-pulmonaire
Summary – Update in cardiopulmonary resuscitation.
Actualisation of the guidelines for cardiopulmonary resuscitation have been recently proposed by the American Heart
Association in collaboration with the International Liaison Committee On Resuscitation. It is the opportunity to take stock
of the current studies and the main recent improvements achieved in cardiac arrest treatment, in particular for cardiac
massage, airway control and ventilation, defibrillation, or use of pharmacologic agents. In the last section of the review,
we summarize what we consider to be significant revisions and innovations in resuscitation concepts. © 2001
Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS
cardiac arrest / cardiopulmonary resuscitation
La mort subite concerne au moins 250 000 personnes
par an à travers le monde industrialisé [1] et en France
environ 50 000 personnes [2]. La grande majorité de
ces arrêts cardiaques ou arrêts circulatoires (AC) inopi-
nés, sont initialement des fibrillations ventriculaires
(FV). La défibrillation immédiate permet une survie
dans jusqu’à 90 % des cas [3], alors que les chances de
survie finale diminuent de 10 % par minute de retard
dans la mise en place des gestes élémentaires de survie
ou réanimation cardio-pulmonaire (RCP) de base : la
RCP est devenue un véritable problème de santé publi-
que justifiant, depuis les balbutiements du bouche-à-
bouche et du premier massage cardiaque externe (MCE)
dans les années 1960, une énorme débauche d’énergie à
travers de très nombreuses études, expérimentales ou
cliniques, sur l’AC ainsi que la mise au point de recom-
mandations internationales régulièrement remises à
jour. La dernière actualisation a été éditée par l’Ameri-
can Heart Association (AHA) en collaboration avec
l’International Liaison Committee on Resuscitation
(ILCOR) en 2000 [4]. Une courte énumération des
éléments nouveaux les plus marquants proposés dans ce
*Correspondance et tirés à part.
Adresse e-mail : [email protected] (P.Y. Gueugniaud).
Réanimation 2001 ; 10 : 623-32
© 2001 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés
S1164675601001797/SSU

consensus international, ainsi que l’algorithme de trai-
tement médical sont proposésàla fin de cette mise au
point. Préalablement, nous développerons les princi-
paux axes de recherche, expérimentaux et cliniques,
pouvant être sources de progrès dans la RCP, de base ou
spécialisée, àsavoir : le MCE, la ventilation, la défi-
brillation et les agents pharmacologiques de la RCP.
Le massage cardiaque externe
Le MCE est désormais bien codifié. Il est indiquéde
réaliser une dépression du sternum de 4 à5 cm, avec
une durée de compression égale à50 % du cycle
compression-relaxation passive, et àune fréquence de
compression actuellement de 100/min. [4]. Cepen-
dant, même réalisécorrectement, le MCE ne permet
d’obtenir un débit cardiaque égal qu’à environ 25–30 %
du débit avant arrêt cardiaque, entraînant ainsi une
diminution importante des circulations coronaire et
cérébrale qui compromet les possibilités de reprise
d’activitécardiaque et le pronostic neurologique. De ce
fait, plusieurs méthodes ont étéproposées pour amélio-
rer l’efficacitédu MCE. Certaines ont consistéàmodi-
fier la technique du MCE, soit en associant de manière
simultanée compression thoracique et ventilation arti-
ficielle (technique de la compression-ventilation syn-
chrone), soit en comprimant alternativement thorax et
abdomen (technique de la compression abdominale
intermittente). Si des résultats prometteurs ont pu être
observés expérimentalement ou sur de petites séries de
patients en intrahospitalier, ils n’ont pas étéconfirmés
sur des séries suffisantes [5, 6]. Outre les tentatives
d’amélioration de la technique de MCE, des techniques
instrumentales ont étéélaborées. La compression du
thorax peut ainsi être obtenue soit par un piston pneu-
matique (Thumpert, Michigan Instruments, États-
Unis), soit par une veste pneumatique circonférentielle
àgonflage séquentiel (VEST-CPRt, Cardiologic Sys-
tems Inc, États-Unis). Malgréla régularitédu MCE et
la bonne reproductibilitédes mesures hémodynami-
ques qu’il procure, le Thumpertn’adémontréd’intérêt
qu’en expérimentation animale ou dans des situations
cliniques particulières comme le MCE prolongélors
d’une hypothermie profonde. Les seules données
concernant la VEST-CPRtémanent d’une petite série
de patients pour lesquels cette technique a amélioré
significativement la pression de perfusion coronaire [7].
Aucune étude suffisante n’a pu aboutir depuis. D’autres
techniques récentes pourraient s’avérer plus intéressan-
tes.
La compression-décompression active (CDA) : elle
consiste àappliquer, sur le thorax des patients en AC,
une «ventouse »(Cardio Pump Ambut) pour le com-
primer et le décomprimer activement. Le but de cette
méthode de massage est de générer en diastole, grâce àla
décompression active, une pression intrathoracique
négative capable d’améliorer le retour veineux intratho-
racique et donc le remplissage du cœur. La conséquence
en est une élévation du débit cardiaque et de la pression
artérielle. La décompression active est également res-
ponsable d’effets autres que circulatoires, en particulier
ventilatoires. Ainsi, chez le chien, en ventilation spon-
tanée ou en ventilation artificielle, une augmentation
importante du volume courant a étéobservée [8].
Après plusieurs études animales ayant montréque la
CDA améliorait le débit cardiaque, le débit sanguin
cérébral, la pression artérielle et le CO
2
expiré, plusieurs
études humaines ont étépubliées. Si certaines d’entre
elles n’ont pas retrouvéde bénéfice clinique [9-14],
d’autres ont montréune amélioration de la survie, à
court [15, 16], comme àlong terme [17]. La plupart de
ces études présentent des limites méthodologiques
importantes (études rétrospectives, absence de rando-
misation, populations insuffisantes, etc.), seule une
étude française prospective et randomisée [17] propose
une méthodologie correcte avec une population suffi-
sante : elle met en évidence une amélioration lors de
l’utilisation de la CDA du nombre de patients sortant
de l’hôpital sans séquelle neurologique (6 % contre
2%,p= 0,01) et une amélioration du taux de survie à
un an (5 % contre 2 %, p= 0,03). Cette méthode,
traumatisante si elle est mal réalisée (apprentissage
nécessaire), admet quelques contre-indications comme
le traumatisme thoracique. Elle est également inappli-
cable face àcertaines particularités anatomiques comme
un pectus excavatum, une hypertrophie mammaire ou
une pilositéimportante.
La valve d’impédance inspiratoire (inspiratory impe-
dance threshold valve) : la phase de décompression pas-
sive du thorax durant la RCP standard s’accompagne
d’une négativation de la pression intrathoracique.
Celle-ci est responsable d’un effet soufflet avec afflux
d’air et augmentation du retour veineux sanguin dans le
thorax. Cependant, la pression négative ainsi créée reste
modeste, conduisant àun faible niveau de retour vei-
neux. L’utilisation d’une technique de compression-
décompression active pour le MCE permet d’augmenter
sensiblement la pression négative intrathoracique. Mais
un niveau de pression négative avec augmentation signi-
ficative du remplissage myocardique ne pourra être
obtenu que si les voies aériennes sont occluses lors de la
phase de décompression thoracique. Cela se rapproche
de la manœuvre de Müller dans laquelle les patients
(éveillés) doivent produire un effort inspiratoire àglotte
fermée pour augmenter le remplissage du cœur afinde
faciliter le diagnostic de certains souffles cardiaques.
Lors de la RCP, l’occlusion des voies respiratoires est
obtenue àl’aide d’une valve unidirectionnelle (Resusci-
624 P.Y. Gueugniaud, J.S. David

valve ITV™CPRxLLC, Minneapolis, États-Unis)
conçue pour se fermer lorsque la pression intrathoraci-
que devient inférieure àla pression atmosphérique (à
chaque décompression thoracique active) [18]. Cette
valve, montée sur l’extrémitédistale de la sonde d’intu-
bation, est dotéed’une soupape de sécuritéconçue pour
s’ouvrir si la pression intrathoracique devient inférieure
à–22 cm d’eau afin de limiter le risque de barotrauma-
tisme, d’œdème pulmonaire, mais également pour per-
mettre au patient de respirer en cas de reprise d’activité
cardio-respiratoire spontanée [19]. Àchaque compres-
sion, l’air est éjectédu thorax : la quantitéd’air dans le
thorax diminue ainsi régulièrement et la pression néga-
tive intrathoracique s’élève progressivement jusqu’à
l’insufflation suivante. Il est probable que lors de la
RCP avec la valve d’occlusion, plus la fréquence respi-
ratoire est basse, meilleur est le remplissage ventricu-
laire. Cependant, le ratio compression-ventilation
optimal reste àdéfinir précisément. Sur un modèle de
porc en FV, l’utilisation de la valve d’occlusion lors du
MCE avec CDA a permis d’augmenter de manière
significative la pression de perfusion coronaire, le débit
sanguin du ventricule gauche et le débit sanguin céré-
bral. Des résultats similaires avaient étédécrits en utili-
sant une technique de MCE standard. La première
évaluation prospective chez l’homme a étéréalisée par
Plaisance sur un faible collectif d’AC non traumatiques
(n= 21) [20]. Il a montréqu’avec la valve d’impédance,
le CO
2
expiré, la pression de perfusion coronaire, et la
pression artérielle diastolique sont significativement
optimisés. La reprise d’une activitécirculatoire sponta-
née (RACS) est également plus rapide.
Le ballon d’occlusion intra-aortique : pour augmen-
ter les pressions de perfusions coronaire et cérébrale,
une sonde àballon est positionnéeetgonflée dans
l’aorte thoracique descendante. Sur différents modèles
expérimentaux d’AC, il a étémis en évidence une
élévation des débits sanguins cérébral et coronaire [21],
et une élévation du nombre de RACS [22]. Chez
l’homme, l’utilisation de cette technique n’aétérappor-
tée que chez deux patients en AC pour lesquels une
élévation de la pression artérielle et de la pression de
perfusion coronaire a ététrouvée [23].
Massage cardiaque interne mini-invasif (technique
du «parapluie »ou Thera cœurt) : il s’agit d’une tech-
nique récemment décrite de massage cardiaque interne
sans thoracotomie chirurgicale. Après repérage du qua-
trième espace intercostal gauche, une incision, débu-
tant à3 cm du sternum et d’environ 5 cm, est effectuée
puis élargie au doigt jusqu’à la pointe du ventricule
droit. Un trocart est ensuite introduit par l’orifice ainsi
crée jusqu’au contact du ventricule droit, puis, àl’inté-
rieur du thorax, un dispositif de compression ressem-
blant àun parapluie déployéàl’envers est ouvert. Dès
lors le parapluie, prenant appui sur le ventricule droit,
permet de comprimer de manière séquentielle le ven-
tricule gauche àl’aide d’un dispositif ressemblant àune
pompe àvélo. Sur un modèle de FV chez le cochon,
cette technique s’est avérée aussi efficace que le massage
interne àthorax ouvert pour les pressions artérielle,
pulmonaire, coronaire et cérébrale [24]. Une étude
multicentrique de faisabilitéest actuellement en cours
en médecine préhospitalière.
La ventilation artificielle
La ventilation artificielle constitue un des aspects fon-
damentaux lors de la prise en charge d’un AC. Classi-
quement, la RCP de base devait alterner une insufflation
toutes les cinq compressions thoraciques s’il y a deux
sauveteurs, ou deux insufflations toutes les 15 compres-
sions thoraciques si le sauveteur est seul. Aujourd’hui
les recommandations proposent de simplifier la
séquence en maintenant une alternance de 15/2 quel
que soit le nombre de sauveteurs [4]. De plus, la néces-
sitéd’une ventilation artificielle réalisée sans équipe-
ment (bouche à-bouche) par un sauveteur isoléest
parfois remise en cause [25, 26]. Dans un travail récent
comparant l’effet sur le pronostic des AC de la ventila-
tion artificielle par bouche-à-bouche, il n’a pas étémis
en évidence de différence selon que la RCP de base était
entreprise avec ou sans ventilation [27]. Mais cette
étude prospective et randomisée nord-américaine a sim-
plement comparéle résultat sur la RACS et la survie de
deux instructions téléphoniques proposées par le stan-
dardiste des urgences aux appelants non formésàla
RCP : description du massage cardiaque seul ou du
massage cardiaque plus bouche-à-bouche alternés. La
survie est de 10 % dans le groupe MCE + bouche à
bouche et de 14,5 % dans le groupe MCE seul
(p= 0,09). Ces résultats ne peuvent donc pas s’extra-
poler au concept général de l’association
MCE + ventilation artificielle au cours de la RCP et
remettre en cause la ventilation d’autant plus que
d’importants biais méthodologiques rendent les conclu-
sions discutables. Il n’empêche que la tendance actuelle
en matière d’éducation du grand public est àla simpli-
fication de la technique de la RCP pour la rendre
accessible au plus grand nombre, espérant ainsi amélio-
rer le pronostic des AC. Il est proposépar l’American
College of Cardiology, qu’en présence d’un AC non
asphyxique (noyade, inhalation), il soit pratiquéune
RCP par compression thoracique seule [28]. Différents
aspects de la ventilation artificielle sont par ailleurs
remis en cause.
En ce qui concerne la ventilation de base
La ventilation au masque présente certains inconvé-
nients parmi lesquels celui d’augmenter la fréquence
Réanimation cardio-pulmonaire initiale 625

des régurgitations et vomissements. Le masque laryngé
ou le Combitubetont donc étéproposés pour réduire
leur incidence et augmenter l’efficacitéde la ventilation.
Dans un travail rétrospectif, portant sur 713 patients,
Stone a montréque la fréquence des régurgitations était
inférieure avec l’utilisation du masque laryngé[29].
Dans un travail prospectif portant sur 470 patients, le
Combitubets’est montrésupérieur au masque laryngé
en terme de rapiditéd’insertion alors qu’en terme d’effi-
cacitéventilatoire, il n’y avait pas de différence avec le
masque facial [30]. Ces deux techniques sont proposées
par l’ILCOR comme des alternatives lors d’une intuba-
tion impossible. Cependant, bien que séduisantes, elles
nécessitent un apprentissage particulier [31].
Il était initialement recommandépar l’AHA, lors de
chaque ventilation d’insuffler un volume de 800 à
1 200 mL [32], alors que l’European Resuscitation
Council (ERC) a préconiséen premier des volumes
moindres de l’ordre de 500 mL [33]. L’insufflation de
grands volumes tels que recommandée par l’AHA est
responsable rapidement de distension gastrique avec
une augmentation du risque de vomissements. Le
meilleur compromis pour être efficace sans être délétère
semble être obtenu pour des volumes de l’ordre de 400
à500 mL [34]. Wenzel a montréqu’il est possible de
réaliser une ventilation efficace au masque avec des
ballons autoremplisseurs pédiatriques par comparaison
avec une ventilation réalisée avec du matériel adulte.
Bien qu’avec le matériel pédiatrique les volumes mesu-
rés et les pressions dans les voies aériennes aient étéplus
faibles, la saturation en oxygène a étécomparable dans
les deux groupes [35]. Cependant, lorsque la même
étude a étéfaite avec une ventilation en air au lieu d’un
mélange air–oxygène à50 %, les auteurs montrent que
la ventilation avec le ballon autoremplisseur pédiatri-
que n’est plus suffisante pour maintenir l’oxygénation
[36] et qu’il faut alors un ballon autoremplisseur de
taille intermédiaire pour maintenir l’oxygénation [37].
Quoi qu’il en soit, les recommandations 2000 de
l’ILCOR préconisent des volumes de 10 mL/kg en air
et de 6 à7 mL/kg en oxygène par insufflation [4].
En ce qui concerne le mode de ventilation
L’intubation de la trachée apparaît comme une recom-
mandation de classe 1 [31]. Quand l’intubation est
réalisée, la ventilation artificielle se fait classiquement
sur un mode en volume contrôlé.Récemment, diffé-
rents modes ventilatoires ont étéproposés comme alter-
native àla ventilation contrôlée, parmi lesquelles la
continuous positive airway pressure (CPAP) [38] ou
l’insufflation continue d’oxygène (ICO) intratrachéale
[39]. Ces nouveaux modes ventilatoires ont étédéve-
loppés pour augmenter l’efficacitédu MCE (suppres-
sion de l’arrêt du MCE pour l’insufflation et
accentuation de son effet «pompe thoracique ») et pour
simplifier la prise en charge ventilatoire des patients en
AC. Dans l’ICO, l’intubation de la trachée se fait avec
une sonde d’intubation modifiée (sonde de Boussignac,
Vygon, Paris). Il s’agit d’une sonde d’un diamètre
interne de 7,5 mm dont la paroi renferme huit capillai-
res d’un diamètre de moins de 700 µm. Ceux-ci
s’ouvrent juste au-dessus de l’extrémitédistale de la
sonde. Dès que le patient est intubé,l’insufflation conti-
nue d’oxygène (débit de 15 L/min. d’O
2
) par l’extré-
mitéproximale des capillaires débute. Ceci va générer
une pression endotrachéale continue d’environ 10 cm
d’H
2
O. L’orifice proximale de la sonde est laissée ouvert
àl’atmosphère sans autre mode de ventilation et servira
en cas de RACS àbrancher un ventilateur de transport.
Pendant la RCP, la ventilation ne sera entretenue que
par les mouvements thoraciques générés par le MCE et
l’ICO. Sur un modèle de porc en FV [40], l’utilisation
de l’ICO, en tant que seul mode ventilatoire, a étéaussi
efficace que la ventilation mécanique (PaO
2
et PaCO
2
non différentes pendant la RCP) et s’est accompagné
d’une amélioration de certains paramètres hémodyna-
miques (pression artérielle systolique et débit sanguin
carotidien). Chez l’homme, Saïssy a montrérécem-
ment, sur une série d’AC non traumatiques par asys-
tole, que l’ICO était aussi efficace que la ventilation
contrôlée lors de la RCP spécialisée [39]. Il n’y a pas eu
de différence significative pendant la RCP entre les
deux groupes en ce qui concerne la survie et la gazomé-
trie initiale alors qu’à l’entréeenréanimation il existait
une différence significative entre les deux groupes en
faveur du groupe ICO pour la PaO
2
, la PaCO
2
,etle
pH artériel. Cette différence pourrait être en relation
avec une protection mécanique de l’état pulmonaire au
cours du MCE par le maintien de cette pression positive
en continu (réduction des atélectasies et contusions).
Ainsi, l’application d’une pression positive continue de
l’ordre de 10 à15 cm d’H
2
O dans les voies aériennes
pourrait être une solution ventilatoire simple et une
alternative àla ventilation contrôlée classique lors de la
RCP spécialisée, mais le résultat des études de survie en
cours de réalisation sera nécessaire avant d’envisager
une application clinique.
La défibrillation
Elle représente l’un des quatre maillons de la «chaîne
de survie », concept défini simultanément par l’AHA et
l’ERC en 1992 [41]. Ces quatre maillons sont consti-
tués par : l’alerte, la RCP de base, la défibrillation et la
RCP spécialisée. Pour espérer un pronostic favorable,
les quatre maillons sont indispensables, et ils doivent
être mis en place le plus précocement possible. La FV
étant le rythme cardiaque rencontrédans 90 % des AC
d’origine médicale, la défibrillation et la précocitéde sa
626 P.Y. Gueugniaud, J.S. David

mise en place sont donc un élément clépour le succèsde
la RCP. L’optimisation de la défibrillation est logique-
ment au cœur de la recherche sur l’AC. Trois thèmes
dans ce domaine doivent être abordés : le choix entre
défibrillation première ou RCP de base préalable, l’éner-
gie et le choix de l’onde de défibrillation, et la place de
la défibrillation semi-automatique (DSA).
Défibrillation première ou réanimation
cardio-pulmonaire de base préalable ?
La défibrillation immédiate est le traitement de choix
d’un épisode de FV venant de débuter. Plus le délai
entre le début de la FV et sa conversion en rythme
efficace est long, plus les chances de survie diminuent
[42]. Si la défibrillation reste toujours constituéede
salves de trois chocs successifs (si nécessaire, c’est-à-
dire, si persistance de la FV entre chaque choc de la
même salve), et si chacune des séries de trois chocs doit
être espacée de 1 minute de RCP, la question est
actuellement poséedel’intérêtd’une brève période de
RCP, avant même le premier choc électrique, en cas de
FV prolongée [28]. En effet, des études expérimentales
ont montréqu’une RCP préalable au choc électrique en
cas de FV prolongée pouvait faciliter la défibrillation et
augmenter le nombre de RACS [43]. Une étude clini-
que prospective récente a par ailleurs suggéréque 90 s
de RCP avant un choc électrique améliorait la survie :
lorsque l’analyse du rythme et l’éventuel choc réalisés
par un DSA sont précédés de RCP préalable, la survie
passe de 24 à30 % (p= 0,04) [44]. Dans cette étude, le
bénéfice devient surtout évident quand le choc électri-
que a lieu pour des FV prolongées d’au moins quatre-
minutes (17 % contre 27 %, p= 0,01).
Énergie du choc et choix de l’onde
pour la défibrillation
Les défibrillateurs externes classiques délivrent habi-
tuellement une onde électrique monophasique en forme
de demi-sinusoïde de brève durée. L’énergie réellement
délivréeàpartir de l’énergie stockée dans un condensa-
teur est fonction du niveau d’impédance transthoraci-
que rencontréau cours de la défibrillation. Les valeurs
affichées sur les défibrillateurs modernes correspondent
àla quantitéd’énergie qui serait administréeàun
patient dont l’impédance thoracique serait de 50 Ω.En
réalitécette impédance varie chez l’adulte moyen de 60
à100 Ω. Cette impédance thoracique joue un rôle
important pour l’efficacitéde la défibrillation : malheu-
reusement, peu de défibrillateurs indiquent l’énergie
réellement administrée au patient [45]. L’énergie habi-
tuelle pour les défibrillateurs traditionnels àondes
monophasiques est pour le premier choc de la première
série de 200 joules. L’énergie préconisée pour le troisiè-
me choc d’une série est toujours de 360 joules. En
revanche, l’énergie du choc intermédiaire (le deuxiè-
me choc) de la première série peut être, soit d’une
énergie équivalente au premier choc (200 joules), soit
d’une énergie intermédiaire de 300 joules. Les recom-
mandations actuelles laissent le choix entre ces deux
possibilités pour le deuxième choc de la première salve
[4]. En cas d’échec de trois chocs successifs et aprèsla
réalisation de une minute de RCP, la tentative de défi-
brillation doit être poursuivie avec de nouvelles séries de
trois chocs maintenus àla valeur maximale de 360 jou-
les. La récidive secondaire d’une FV, quant àelle, doit
faire réutiliser l’énergie initialement efficace pour la
première défibrillation.
Outre les classiques défibrillateurs àondes électriques
monophasiques, il existe actuellement sur le marchéde
nombreux défibrillateurs délivrant des ondes biphasi-
ques tronquées. Ils seraient susceptibles de diminuer le
seuil de défibrillation, d’entraîner moins de dysfonc-
tionnements post-défibrillation et de prolonger la
période réfractaire protectrice [45]. L’énergie délivrée
par ces appareils est inférieure àcelle délivrée pour le
premier choc sur les défibrillateurs traditionnels (150 à
175 joules). Dans une étude récente sur l’utilisation de
ces défibrillateurs d’ondes biphasiques d’énergie basse
non croissante (≤200 joules), les auteurs concluent que
ce mode de défibrillation donne des résultats meilleurs,
ou au moins équivalents àceux d’un défibrillateur
traditionnel [46, 47]. Il reste maintenant àdéterminer
l’énergie optimale pour la défibrillation biphasique.
L’augmentation des énergies pour ce type de techniques
n’a pas étéévaluée en cas de résistance àde multiples
chocs àbasse énergie. Un ajustement en fonction de
l’impédance thoracique doit également être évalué[4].
La défibrillation par ondes biphasiques tronquées per-
met également de proposer des appareils plus maniables
et d’utilisation simplifiée. Le bénéficie paraît probable,
mais il reste àdémontrer une amélioration de l’efficacité
en terme de survie des patients.
Défibrillation semi-automatique
Le développement de la DSA représente certainement
le progrèsrécent le plus important pour la RCP. Ces
appareils sont munis d’un microprocesseur permettant
d’analyser pendant dix secondes l’activitéélectrique
cardiaque captée par de larges électrodes autocollantes
qui servent également àdélivrer des chocs électriques. À
partir de cette interprétation automatique, ils
conseillent, en cas de FV, une défibrillation (par indica-
tions visuelles et/ou sonores utilisant le plus souvent
une voix artificielle). Les plus évolués des appareils se
mettent automatiquement en charge (avec des valeurs
préétablies en fonction des recommandations en vi-
gueur) et ils «suggèrent »àl’utilisateur de délivrer le
choc électrique (défibrillation «semi »-automatique).
La diffusion de ces appareils a permis de réduire signifi-
cativement le délai d’accèsàla défibrillation. En France,
Réanimation cardio-pulmonaire initiale 627
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%