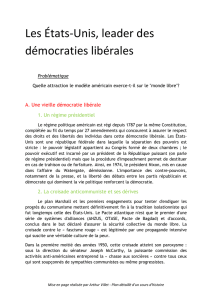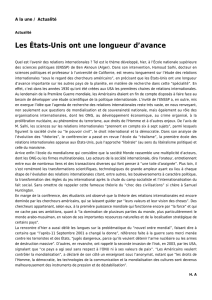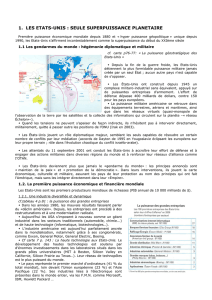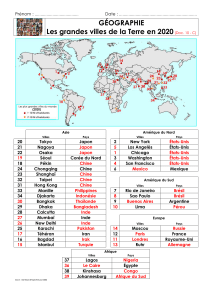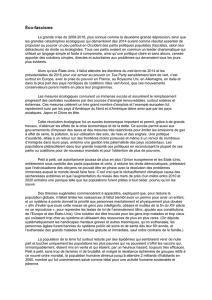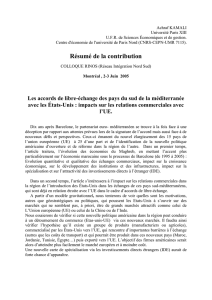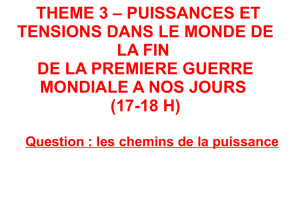Les États-Unis d`Amérique: les institutions politiques

Dmbvef!Dpscp
MFT!UBUT.VOJT!!
EÖBNSJRVF
Mft!jotujuvujpot!qpmjujrvft
tfqufousjpo
Extrait de la publication


MFT!UBUT.VOJT!EÖBNSJRVF
Mft!jotujuvujpot!qpmjujrvft
Extrait de la publication

ouvrages de claude corbo
Mon appartenance. Essais sur la condition québécoise, Montréal, VLB Éditeur, « Études
québécoises », 1992, 121 p. Ouvrage récipiendaire du prix Richard-Arès.
Matériaux fragmentaires pour une histoire de l’UQAM, Montréal, Éditions Logiques,
« Théories et pratiques dans l’enseignement », 1994, 367 p.
Lettre fraternelle, raisonnée et urgente à mes concitoyens immigrants, Outremont, Lanctôt
Éditeur, 1996, 137 p.
À la recherche d’un système de déontologie policière juste, efficient et frugal (avec la colla bo-
ration de Michel Patenaude), Québec, Gouvernement du Québec, 1997, xxiii+208 p.
Vers un système intégré de formation policière (avec la collaboration de Robert Laplante
et Michel Patenaude), Québec, Gouvernement du Québec, 1998, viii+342 p.
La mémoire du cours classique. Les années aigres-douces des récits autobiographiques,
Montréal, Éditions Logiques, « Théories et pratiques dans l’enseignement », 2000,
446 p.
Repenser l’école. Une anthologie des débats sur l’éducation au Québec de 1945 au rapport
Parent (avec la collaboration de Jean-Pierre Couture), Montréal, Presses de l’Université
de Montréal, « PUM-Corpus », 2000, 667 p.
Pour rendre plus sécuritaire un risque nécessaire (avec la collaboration de Ygal Leibu),
Québec, Gouvernement du Québec, 2001, vi+326 p.
L’idée d’université. Une anthologie des débats sur l’enseignement supérieur au Québec de
1770 à 1970 (avec la collaboration de Marie Ouellon), Montréal, Presses de l’Université
de Montréal, « PUM-Corpus », 2001, 377 p.
L’éducation pour tous. Une anthologie du rapport Parent, Montréal, Presses de l’Univer-
sité de Montréal, « PUM-Corpus », 2002, 432 p.
Les Jésuites québécois et le cours classique après 1945, Sillery, Éditions du Septentrion,
« Cahiers des Amériques », 2004, 404 p.
(Conception et direction) Monuments intellectuels québécois du xxe siècle. Grands livres
d’érudition, de science et de sagesse, Sillery, Éditions du Septentrion, 2006, 290 p.
Art, éducation et société post-industrielle. Le rapport Rioux et l’enseignement des arts au
Québec 1966-1968, Sillery, Éditions du Septentrion, 2006, 363 p.
En collaboration :
BÉLAND, Claude, Inquiétude et espoir. Valeurs et pièges du nouveau pouvoir économique.
Extraits de conférences choisis et ordonnés par Claude Corbo, Montréal, Québec
Amérique, 1998, 401 p.
LAMONDE, Yvan, et Claude CORBO, Le rouge et le bleu. Anthologie de la pensée
politique au Québec de la Conquête à la Révolution tranquille, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, « PUM-Corpus », 1999, 581 p.
TOCQUEVILLE, Alexis de, Regards sur le Bas-Canada. Choix de textes et présentation
de Claude Corbo, Montréal, Typo, 2003, 323 p.
Extrait de la publication

Dmbvef!Dpscp
MFT!UBUT.VOJT!EÖBNSJRVF
Mft!jotujuvujpot!qpmjujrvft
TFDPOEF!EJUJPO!NJTF!Ì!KPVS
tfqufousjpo
Extrait de la publication
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%