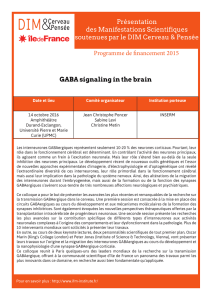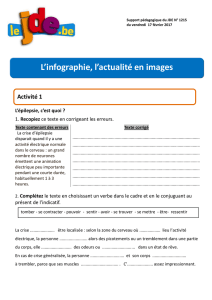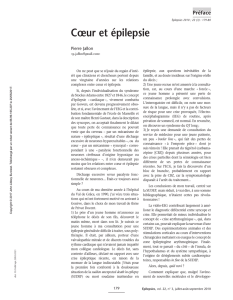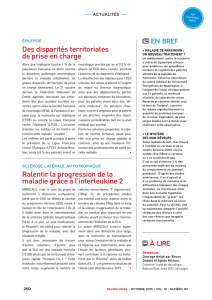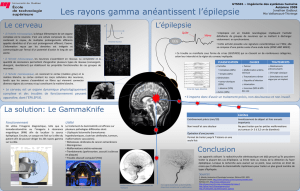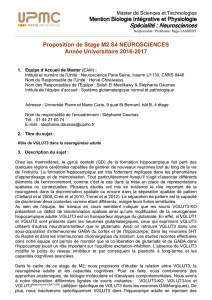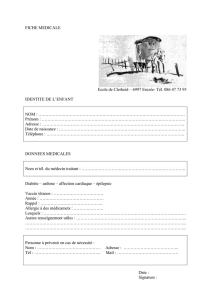Dre Lisa TopoLnik - Université Laval

DRE LISA TOPOLNIK
Faculté des sciences et de génie
Rencontre annuelle IRSC - ULAVAL
ÉPILEPSIE : LES NEURONES PERDENT LE CONTRÔLE
L’épilepsie en bref
Chez l’humain, les épilepsies affectent près de 50 millions de
personnes autour du monde, sans égard au sexe ou à la race.
La forme la plus fréquente de la maladie est l’épilepsie du lobe
temporal. Elle résulte d’une décharge neuronale excessive dans
le système nerveux central.
Pour la majorité des patients, l’origine de l’épilepsie se trouve dans
l’hippocampe, une structure qui joue un rôle important dans la
mémoire et l’apprentissage. Dans cette structure, toutes les étapes
de traitement de l’information sont contrôlées par une population
de cellules inhibitrices. Il existe aussi une sous- population unique
d’interneurones inhibiteurs qui sont spécialisés dans l’innervation
d’autres cellules inhibitrices. Ces interneurones sont comme des
chefs d’orchestre : ils synchronisent les ensembles neuronaux
et contrôlent tout le circuit hippocampique.
Or, chez les patients atteints d’épilepsie du lobe temporal, ces
interneurones se trouvent en plus petites quantités. Comprendre
en détail leur organisation fonctionnelle et comment ils exercent
leur contrôle inhibiteur à l’intérieur de l’hippocampe est donc une
clé pour comprendre la maladie.
Résumé du projet de recherche
Notre objectif est de comprendre les mécanismes du contrôle inhi-
biteur des circuits de neurones. Vu le rôle central des interneurones
inhibiteurs, c’est sur eux que portent nos efforts. Nous explorons
leur organisation et leur fonctionnement au sein de la hiérarchie
de neurones et quels changements ils opèrent quand le cerveau
devient malade.
Pour cette étude, nous comptons sur des animaux modifiés gé-
nétiquement dans lesquels ces interneurones sont associés à un
marqueur fluorescent. En utilisant une combinaison de microscopie
biphotonique, d’électrophysiologie et d’outils optogénétiques, nous
pouvons suivre à la trace et de façon précise les interneurones dans
ces animaux vivants. Nous verrons comment ils sont activés dans
l’hippocampe et pourrons comparer leur rôle de chef d’orchestre
dans un cerveau sain et un autre malade.
Retombées
Les résultats de cette recherche vont
éclaircir les règles de communication
entre les cellules inhibitrices. Ils permet-
tront donc de mieux cerner le traitement de l’information dans les
réseaux de neurones. Plus précisément, ils assureront une meilleure
compréhension du fonctionnement du réseau de neurones dans
l’hippocampe sain et des changements qui s’y déroulent chez les
animaux souffrant d’épilepsie du lobe temporal.
Ultimement, ils permettront la détermination de mécanismes sous-
jacents à l’expression de l’épilepsie chez l’humain et conduiront
à des traitements de qualité supérieure.
À plus long terme, l’objectif est de découvrir de nouvelles cibles
cellulaires jouant un rôle dans le contrôle de l’inhibition.
En ce sens, cette recherche est importante pour le développement
de nouvelles thérapies pour soigner l’épilepsie et la schizophrénie.
Par exemple, nous pourrions développer des sondes optogéné-
tiques qui aideront les patients atteints à contrôler l’activité de
certaines régions du cerveau.
Collaboration et équipe
L’équipe de recherche de la Dre Lisa Topolnik comprend quatre
étudiants des cycles supérieurs et deux professionnels de recher-
che qui travaillent en collaboration avec les groupes du D
r
Simon
Thibault (COPL, Université Laval) et du D
r
Karl Deisseroth (Stanford
University, États-Unis) en conception optique et en application
des outils optogénétiques.
Biographie
Dre Lisa Topolnik a obtenu son doctorat de l’Institut Bogomoletz
de Physiologie d’Ukraine en 2000. Elle a ensuite fait des études
postdoctorales à l’Université Laval avec le groupe du Dr Mircea
Steriade, et à l’Université de Montréal avec le Dr Jean-Claude
Lacaille. En 2007, elle est revenue à l’Université Laval en tant que
professeure adjointe et a reçu la subvention du Programme d’appui
aux professeurs universitaires (APU) du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), qui lui
permet de se concentrer sur la recherche.
1
/
1
100%