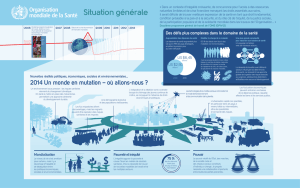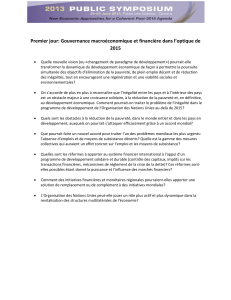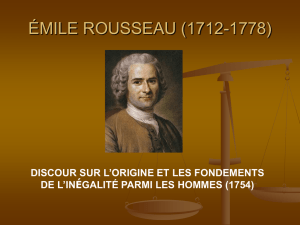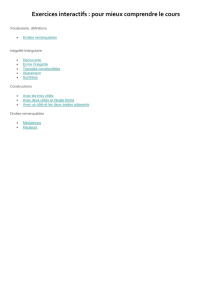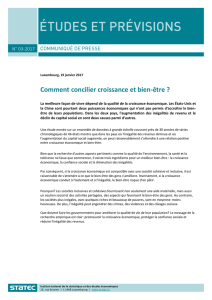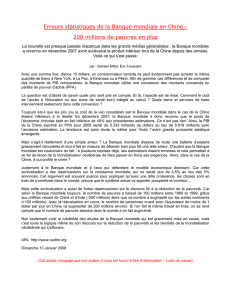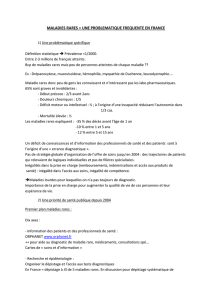Le talon d`Achille

28 Finances & Développement Décembre 2013
28 Finances & Développement Décembre 2013
L’inégalité
menace
le miracle
asiatique
D
EPUIS vingt-cinq ans, l’Asie connaît
une croissance plus rapide que toutes
les autres régions du monde, au
point que certains ont baptisé les
années à venir le «Siècle de l’Asie». Étant donné
l’intégration réussie de cette région dans le
marché mondial et le dynamisme de sa classe
moyenne, on peut penser que l’axe de la crois-
sance mondiale se déplacera de plus en plus vers
l’Asie dans les prochaines décennies.
Cette réussite est toutefois menacée par la
montée de l’inégalité qui a accompagné la crois-
sance des vingt-cinq dernières années. Chose
paradoxale, la croissance qui a diminué la pauvreté
absolue a en même temps creusé l’écart entre les
riches et les pauvres. Cette polarisation a non
seulement terni l’image de la réussite économique,
mais elle risque, si l’on ne s’y attaque pas, d’em-
pêcher les promesses de l’Asie de se concrétiser.
Par conséquent, les responsables politiques de la
région cherchent les moyens d’arrêter l’aggravation
de l’inégalité et de mieux partager la croissance.
Nous allons montrer pourquoi la distribution
du revenu se dégrade, en quoi cela est dangereux,
et ce que l’on peut faire pour mieux partager la
croissance économique de l’Asie.
Il faut une croissance solidaire
Si la société doit s’attaquer aux inégalités de re-
venu et de richesse, ce n’est pas seulement pour
des raisons morales, mais parce que ce phéno-
mène a aussi des conséquences plus pratiques.
Pour un taux de croissance donné, l’augmen-
tation de l’inégalité implique que le pays réduit
moins la pauvreté. Un nombre croissant de
recherches montre également que les disparités
de revenu vont de pair avec une dégradation
des résultats économiques, y compris la dimi-
nution de la croissance et l’augmentation de la
volatilité. Au niveau fondamental, on considère
en général aujourd’hui que l’inégalité retarde la
croissance et le développement pour plusieurs
raisons, notamment en freinant l’accumulation
du capital humain (voir «Plus ou moins», dans
le numéro de septembre 2011). Selon les travaux
récents de Berg et Ostry (2011), les sociétés iné-
galitaires sont moins susceptibles de maintenir
la croissance à long terme.
La mesure de distribution du revenu la plus
utilisée est l’indice de Gini. Il va de zéro, qui
signifie l’égalité parfaite parce que tout le monde
a le même revenu, à 100, où l’inégalité est totale
parce qu’une seule personne a tout. Donc, plus
l’indice de Gini est bas, plus la répartition du
revenu dans la société est équitable. Les sociétés
relativement égalitaires comme la Suède et le
Canada ont des indices compris entre 25 et
35, alors que la plupart des pays développés se
situent autour de 40. Beaucoup de pays en dé-
veloppement ont des indices encore plus élevés.
L’évolution de l’indice d’un pays peut montrer
si la croissance économique a été «solidaire»,
à savoir si ses bienfaits sont de plus en plus
partagés par les habitants à tous les niveaux
Le talon d’Achille
Ravi Balakrishnan, Chad Steinberg et Murtaza Syed
Tours d’habitation et baraquements
d’ouvriers à Mumbai, en Inde.

Finances & Développement Décembre 2013 29
de revenu. La baisse de l’indice signifie que la distribution du
revenu devient plus égale.
Nous pourrions plus spécifiquement nous concentrer sur les
plus vulnérables (les 20% les plus pauvres) et voir combien ils
bénéficient de la croissance. Nous pourrions, par exemple, nous
demander comment une hausse de 1% du revenu national les
affecte. Si leur revenu augmente d’au moins 1%, on peut dire que
la croissance est solidaire. En revanche, si le revenu des pauvres
augmente de moins de 1%, la croissance n’est pas solidaire, parce
qu’ils sont relativement désavantagés.
Les mauvais résultats de l’Asie
Depuis vingt-cinq ans, la croissance a été en moyenne plus forte
dans la plupart des pays d’Asie que dans les autres pays émergents.
Elle a permis des réductions notables de la pauvreté absolue: le
nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté (moins de
1,25 dollar par jour) a été presque réduit de moitié, passant de
plus de 1,5 milliard en 1990 à un peu plus de 850 millions en
2008. Malgré ce résultat impressionnant, l’Asie renferme toujours
les deux tiers des pauvres du monde, la Chine et l’Inde comptant
pour près de la moitié (voir encadré).
De plus, l’inégalité a augmenté dans l’ensemble de l’Asie.
Ce phénomène nouveau pour la région contraste fortement
avec la période spectaculaire de décollage économique des
trois décennies précédant 1990. «Croissance équitable» était le
slogan de cette période, pendant laquelle le Japon et les tigres
asiatiques ont pu conjuguer une croissance rapide et une iné-
galité relativement faible et qui, dans bien des cas, diminuait.
Les mauvais chiffres récents constituent donc un retournement
spectaculaire.
À l’échelle internationale, l’inégalité a augmenté plus vite en Asie
depuis vingt-cinq ans que dans les autres régions (graphique1).
La hausse a été particulièrement marquée en Chine et en Asie
de l’Est, avec un indice de Gini compris entre 35 et 45 dans
beaucoup de pays. C’est un chiffre encore inférieur à celui de la
plupart des pays d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine,
dont l’indice se situe généralement autour de 50. Toutefois, les
pays d’Amérique latine et d’Afrique subsaharienne (ainsi que
ceux du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord) ont en moyenne
résisté à la tendance mondiale et réduit l’inégalité pendant les
vingt-cinq dernières années, resserrant l’écart entre eux et l’Asie.
En particulier, alors que le pouvoir d’achat des citoyens d’Asie
augmentait, le revenu des 20% les plus pauvres n’a pas progressé
autant que celui du reste de la population (graphique2). C’est vrai
à la fois pour les pays relativement moins développés, notamment
la Chine et la plus grande partie de l’Asie du Sud, et dans des pays
plus avancés comme la Corée, la RAS de Hong Kong, Singapour
et la province chinoise de Taiwan. L’évolution de l’Asie contraste
fortement avec celle des pays émergents dans les autres régions,
en particulier en Amérique latine, où les revenus des 20% les
plus pauvres ont augmenté davantage depuis 1990 que ceux des
autres catégories de la population. Si l’Asie a été sans aucun doute
la championne en termes de taux de croissance depuis vingt-
cinq ans, la nature de cette croissance a vraisemblablement été
la moins solidaire de toutes les régions émergentes.
Une croissance moins solidaire
La hausse de l’inégalité a pratiquement touché l’ensemble du monde
depuis vingt-cinq ans, l’indice de Gini augmentant dans les pays
avancés comme en développement. Beaucoup d’analystes attribuent
Balakrishnan, corrected 11/4/13
Graphique 1
Aggravation de l’inégalité
Ces vingt-cinq dernières années, l’inégalité a augmenté plus vite
en Asie que dans les autres régions, même si elle reste plus
faible qu’en Amérique latine et en Afrique subsaharienne.
Sources : données CEIC; autorités nationales; base de données WIDER sur l’inégalité de revenu;
Banque mondiale, base de données PovcalNet; calculs des services du FMI.
Note : L’évolution de l’inégalité reète le changement de l’indice Gini pondéré pour la population.
L’indice de Gini va de 0, égalité totale où tout le monde a le même revenu, à 100, inégalité totale
où une seule personne a tout le revenu. NEI = Corée, RAS de Hong Kong, Singapour et province
chinoise de Taiwan. ASEAN-5 = Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam. L’indice
de Gini le plus récent est entre parenthèses.
Évolution de l’inégalité en points de pourcentage
–4 –2 0 2 4 6 8 10
Asie de l’Est (42,1)
Asie du Sud (32,2)
Pays avancés d’Asie (29,4)
NEI (36,7)
ASEAN-5 (37,9)
Afrique subsaharienne (45,2)
Moyen-Orient et Afrique du Nord (36,5)
Amérique latine et Caraïbes (52,0)
Europe centrale et orientale (38,3)
Pauvreté et inégalité en Inde et en Chine
La pauvreté a beaucoup diminué en Chine et en Inde depuis que
ces deux pays ont connu leur décollage économique, il y a trente
ans en Chine et vingt en Inde.
C’est au début des années 80 et au milieu des années 90 que la
pauvreté a diminué le plus vite en Chine, sous l’effet des réformes de
l’économie rurale, du faible niveau d’inégalité au départ et de l’accès
à la santé et à l’éducation. En 1981, la Chine était l’un des pays les
plus pauvres du monde, 84% de la population vivant avec moins de
1,25 dollar par jour, soit à l’époque le cinquième rang sur l’échelle de
la pauvreté mondiale. En 2008, les pauvres n’étaient plus que 13%,
soit beaucoup moins que la moyenne des pays en développement.
L’Inde a aussi réduit la pauvreté, mais plus lentement que la Chine.
En 1981, 60% des Indiens vivaient avec moins de 1,25 dollar par
jour, moins qu’en Chine. En 2010, la part était tombée à 33%, mais
restait deux fois et demie plus élevée qu’en Chine.
Toutefois, l’inégalité a augmenté dans les deux pays. Selon les
estimations officielles, l’indice de Gini pour la Chine (où 0 repré-
sente la distribution la plus égale et 100 la plus inégale) est passé
de 37 au milieu des années 90 à 49 en 2008. L’indice de l’Inde a
légèrement augmenté, de 33 en 1993 à 37 en 2010 selon la Banque
asiatique de développement (2012). Il existe aussi dans ce pays des
inégalités importantes fondées sur le sexe, la caste et la possibilité
d’accès aux services sociaux.
L’aggravation des disparités entre zones rurales et urbaines, ainsi
qu’entre régions, compte pour une part comprise entre un tiers et
deux tiers dans l’inégalité en Chine et en Inde.

30 Finances & Développement Décembre 2013
cette montée au moins en partie à des forces internationales qui
échappent au contrôle des pays, comme la mondialisation et le pro
-
grès technologique qui désavantagent les travailleurs non qualifiés.
La différence entre l’évolution en Asie et dans le reste du monde
laisse entendre qu’il existe, en plus de ces facteurs généraux, des
caractéristiques de la croissance en Asie qui ont aggravé la hausse
de l’inégalité dans la région. En s’attaquant à ces facteurs, qui, selon
notre analyse, comprennent la politique budgétaire, la structure
du marché du travail et l’accès à la banque et aux autres services
financiers, on pourrait élargir les bienfaits de la croissance de l’Asie,
et donc la rendre plus durable. En particulier, l’accroissement des
dépenses d’éducation, des années de scolarisation et de la part du
travail dans le revenu, avec les politiques qui développent l’accès aux
services financiers, augmente beaucoup le caractère solidaire de la
croissance. Or, l’Asie a pris du retard dans beaucoup de ces domaines.
Les dépenses publiques consacrées au secteur social sont basses
en raison de choix des pouvoirs publics. Les sommes relativement
faibles consacrées aux dépenses de santé et d’éducation en Asie
montrent que la politique budgétaire (impôts et dépenses) a un rôle
important à jouer pour mieux partager les bienfaits de la croissance
(graphique3). Dans les pays avancés, les impôts et les transferts
(comme ceux concernant le bien-être et le chômage) réduiraient
l’inégalité de 25% en moyenne, sur la base des indices de Gini. En
revanche, l’effet redistributif de la politique budgétaire en Asie est
fortement freiné par des faibles ratios impôts/PIB, en moyenne la
moitié de ceux des pays avancés et parmi les plus bas des régions
en développement (Bastagli, Coady et Gupta, 2012). Il en résulte
des dépenses sociales nettement plus faibles. La préférence donnée
à un système de prélèvements et de dépenses moins progressif
aggrave encore l’inégalité. En Asie, les impôts indirects, frappant
la consommation de biens et de services, représentent la moitié
des recettes fiscales, contre moins du tiers dans les pays avancés.
Or, ces impôts frappent les pauvres de façon disproportionnée.
La part du travail dans le revenu a diminué énormément. Au
cours des deux dernières décennies, on a assisté dans toute l’Asie
à un déclin marqué de la part du travail dans le revenu total et à
un accroissement de la part du capital, qui représente en moyenne
quelque 15 points de pourcentage selon la Banque asiatique de déve-
loppement (2012). Cette évolution contribue à l’inégalité parce que
le revenu du capital va généralement à des personnes relativement
riches, alors que celui des pauvres qui travaillent dans le secteur
officiel est principalement constitué de salaires. Les progrès tech-
nologiques sont l’une des raisons pour lesquelles la part du capital
dans le revenu national a augmenté, et expliquent aussi en partie
pourquoi la croissance économique ne crée pas une demande de
main-d’œuvre aussi forte qu’auparavant. Pourtant, on peut aussi
attribuer l’évolution de la part du capital et du travail dans le revenu
à la préférence que certaines parties d’Asie donnent à des secteurs
ayant un ratio capital/travail élevé. Cette tendance se manifeste par
des politiques axées sur l’industrie et l’exportation, une progression
relativement faible de l’emploi comparée à la vitesse de la croissance
et une concentration de la richesse entre les mains des sociétés, et
non des ménages. De plus, la hausse de l’inégalité est liée à un faible
pouvoir de négociation des travailleurs. Beaucoup d’ouvriers en Asie
travaillent dans le secteur informel, généralement non réglementé,
ce qui pèse sur les salaires. De plus, même dans le secteur officiel,
les travailleurs peu qualifiés n’ont pratiquement aucun pouvoir de
négociation pour faire monter leur salaire relatif.
L’accès au financement est difficile. Le manque d’accès au finan-
cement constitue un grave obstacle dans de nombreuses parties
d’Asie, où plus de la moitié de la population et une proportion
importante des petites et moyennes entreprises n’ont aucun lien
avec le système officiel de banque, d’assurance ou de négoce de
titres. Les recherches ont montré que le développement financier
non seulement facilite la croissance économique, mais contribue
à la répartir plus équitablement. Cela tient au fait que le manque
Balakrishnan, corrected 11/4/13
Graphique 3
Les dépenses qui réduisent l’inégalité
La hausse des dépenses d’éducation et de santé contribue
à augmenter le revenu relatif des plus pauvres.
(dépenses d’éducation (dépenses de santé
en pourcentage du PIB) en pourcentage du PIB)
Sources : Banque mondiale, base de données des Indicateurs sur le développement dans le
monde; calculs des services du FMI.
Note : AEP =Asie de l’Est et Pacique. ALC = Amérique latine et Caraïbes. AS = Asie du Sud.
Autres = pays émergents et en développement du reste du monde. NEI = Corée, RAS de Hong Kong,
Singapour et province chinoise de Taiwan. Le degré d’inclusion reète l’augmentation du revenu des
20 % les plus pauvres de la population consécutive à une variation de 1 % du revenu total par
habitant.
Degré d’inclusion Degré d’inclusion
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
0
1
2
3
4
5
0,3 0,6 0,9 1,2 1,5
0
2
4
6
8
ALC (sauf Brésil)
ALC (sauf Brésil)
AS (sauf Inde) AS (sauf Inde)
Brésil Brésil
Autres
Autres
NEI
NEI
Inde
Inde
AEP
AEP
Indonésie
Indonésie
Chine
Chine
Balakrishnan, corrected 11/4/13
Graphique 2
Pas d’amélioration relative
Bien que la croissance de l’Asie ait amené une forte réduction
de la pauvreté absolue, elle est moins efcace pour améliorer
la position relative des pauvres.
(réduction de la pauvreté depuis 1990) (degré d’inclusion)
Sources : Penn World Tables 7.0; Banque mondiale, base de données PovcalNet; calculs des
services du FMI.
Note : Les barres rouges mesurent combien la croissance est favorable aux pauvres, c’est-à-dire
combien la pauvreté absolue (revenu par habitant inférieur à 2 dollars par jour) est réduite par une
augmentation de 1 % du revenu total par habitant. On ne dispose pas de données pour les NEI.
Les barres bleues mesurent le caractère inclusif de la croissance, à savoir combien le revenu
des 20 % les plus pauvres change en réaction à une augmentation de 1 % du revenu total par
habitant. Asie de l’Est = Cambodge, Malaisie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam. ALC = Amérique
latine et Caraïbes. NEI = Corée, RAS de Hong Kong, Singapour et province chinoise de Taiwan.
Plus solidaire
Plus favorable aux pauvres
Variation en pourcentage
–4 –3 –2 –1 0 1 2
Asie du Sud (sauf Inde)
Tous les autres pays
émergents
Chine
Brésil
Asie de l’Est
ALC (sauf Brésil)
Inde
Indonésie
NEI

Finances & Développement Décembre 2013 31
d’accès aux services financiers et les coûts liés aux transactions
et à l’exécution des contrats frappent surtout les pauvres et les
petits entrepreneurs, qui n’ont généralement ni garanties, ni
réputation de solvabilité, ni relations d’affaires. À cause de ces
lacunes, il est pratiquement impossible aux pauvres d’obtenir un
financement, même s’ils ont un projet prometteur. En facilitant
le développement des marchés et instruments financiers, comme
les produits d’assurance qui permettent aux entreprises et aux
individus de faire face à des chocs tels qu’un accident ou un décès,
les gouvernements peuvent à la fois stimuler la croissance et faire
en sorte qu’elle soit répartie plus équitablement.
Améliorer les résultats
À partir de cette base, quels types de politiques peuvent aider
les pays d’Asie à inverser la tendance récente à une croissance
moins solidaire?
Politique budgétaire. Les gouvernements asiatiques doivent
augmenter les dépenses d’éducation, de santé et de protection so-
ciale, tout en gérant prudemment les finances publiques. Ils pour-
raient y arriver en augmentant le ratio impôts/PIB, notamment
en adoptant un système fiscal plus progressif ou en élargissant la
base d’imposition directe pour accroître l’effet redistributif de la
politique. Parallèlement, ils pourraient développer les dépenses
sociales en faveur des ménages vulnérables. Les programmes de
transferts monétaires sous conditions, qui exigent une action à
valeur sociale de la part des ménages, comme l’augmentation de
la fréquentation scolaire ou la vaccination, se développent dans
les pays émergents à faible revenu. La Bolsa Familia au Brésil et
les Opportunidades au Mexique sont deux grands programmes
de ce genre qui ont réussi à augmenter le revenu des pauvres.
Politiques du marché de travail. Les politiques qui améliorent les
programmes d’emploi dans les zones rurales, augmentent le nombre
de travailleurs dans le secteur officiel et réduisent l’importance du
secteur informel, suppriment les obstacles à la mobilité et insistent
sur la formation pourraient aider de façon disproportionnée les
travailleurs peu qualifiés. De plus, on a plaidé dans certains pays
pour la création d’un salaire minimum, ou son augmentation,
pour soutenir le revenu des travailleurs à bas salaire. Par exemple,
l’annonce en février 2013 par la Chine d’un plan en 35 points pour
lutter contre l’inégalité de revenus comprend une disposition visant
à porter le salaire minimum à au moins 40% du salaire moyen
dans la plupart des régions d’ici 2015. En général, nous notons
que l’inclusion est positivement corrélée au degré de protection de
l’emploi et au niveau du salaire minimum (graphique4).
Accès au financement. Les recommandations que l’on peut
faire à partir de l’expérience internationale comprennent
l’expansion de l’accès au crédit par la promotion de la finance
rurale, le développement du microcrédit (prêts modiques aux
petites entreprises), la subvention des prêts aux pauvres, le par-
tage des informations sur le crédit et la création de marchés de
capital-risque pour les jeunes entreprises.
Poursuivre l’action
Si les pays d’Asie prennent des mesures pour étendre les bien-
faits de la croissance, notamment en augmentant les dépenses
consacrées à la santé, à l’enseignement primaire et secondaire, en
renforçant des filets de sécurité, en intervenant sur le marché du
travail en faveur des travailleurs à faible revenu et en développant
l’accès aux services financiers, ils pourraient inverser la tendance
à la montée de l’inégalité.
Beaucoup de ces politiques sont en plus susceptibles de réduire
la préférence donnée au capital et aux grandes entreprises, et
d’étendre les bienfaits de la croissance en augmentant le revenu
et la consommation des ménages. Elles pourraient ainsi faciliter
le changement nécessaire du modèle économique asiatique pour
le déplacer des exportations vers la demande intérieure, ce qui
prolongerait la croissance miraculeuse de la région et contribue-
rait au rééquilibrage mondial. L’enjeu est de taille. Si l’Asie n’agit
pas pour corriger l’inégalité, il lui sera difficile de maintenir ses
taux rapides de croissance et de se placer au centre de l’économie
mondiale dans les années à venir. ■
Ravi Balakrishnan est chef de division adjoint au Département
Hémisphère occidental du FMI; Chad Steinberg est économiste
principal au Département de la stratégie, des politiques et de
l’évaluation du FMI; et Murtaza Syed est représentant résident
adjoint du FMI en Chine.
Cet article se fonde sur un document de travail du FMI de 2013, «e Elusive
Quest for Inclusive Growth: Growth, Poverty, and Inequality in Asia».
Bibliographie:
Banque asiatique de développement, 2012, “Outlook 2012: Confronting
Rising Inequality in Asia” (Manila). www.adb.org/publications/asian-
development-outlook-2012-confronting-rising-inequality-asia.
Bastagli, Francesca, David Coady, and Sanjeev Gupta, 2012, “Income
Inequality and Fiscal Policy,” IMF Sta Discussion Note 12/08 (Washington:
International Monetary Fund). www.imf.org/external/pubs//sdn/2012/
sdn1208.pdf.
Berg, Andrew, and Jonathan Ostry, 2011, “Inequality and Unsustainable
Growth: Two Sides of the Same Coin?” IMF Sta Discussion Note 11/08
(Washington: International Monetary Fund). www.imf.org/external/pubs/
/sdn/2011/sdn1108.pdf.
Balakrishnan, corrected 10/22/13
Graphique 4
La législation du travail joue un rôle
Avec un emploi mieux protégé et un salaire minimum
plus élevé, les pauvres s’en sortent relativement mieux.
(salaire minimum en pourcentage
(niveau de protection de l’emploi, indice) de la valeur ajoutée par travailleur)
Source : Banque mondiale, indicateurs Doing Business.
Note : L’indice de protection de l’emploi mesure la protection de la législation du travail
comme la moyenne des autres contrats d’emploi possibles, du coût de l’augmentation des
heures de travail, du coût du licenciement et des procédures de licenciement. AEP = Asie de l’Est
et Pacique. ALC = Amérique latine et Caraïbes.
AS = Asie du Sud. Autres = pays en développement ou émergents du reste du monde. NEI =
Corée, RAS de Hong Kong, Singapour et province chinoise de Taiwan.
Le degré d’inclusion reète l’augmentation du revenu des 20 % les plus pauvres de la
population consécutive à un changement de 1 % du revenu total par habitant.
Degré d’inclusion Degré d’inclusion
AS (sauf Inde)
Brésil
Brésil
Autres
Autres
NEI Inde
AEP
Indonésie Indonésie
0 0,5 1,0 1,5
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Chine
Chine
AS (sauf Inde)
ALC (sauf Brésil)
0 0,5 1,0 1,5
0
0,1
0,2
0,3
0,4
NEI
AEP
ALC (sauf Brésil)
Inde
1
/
4
100%