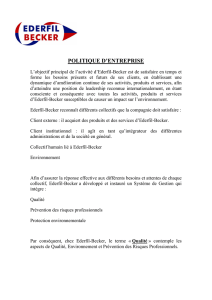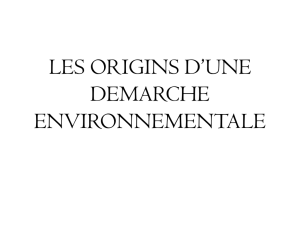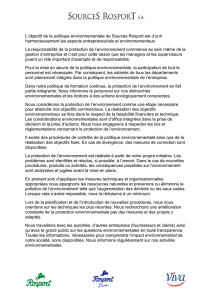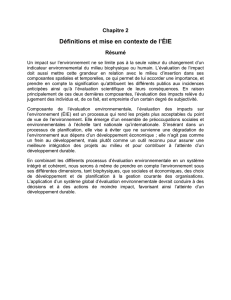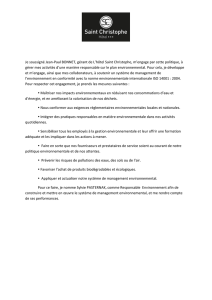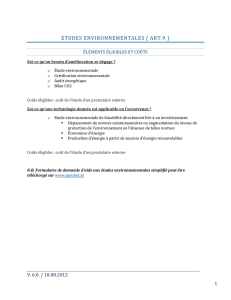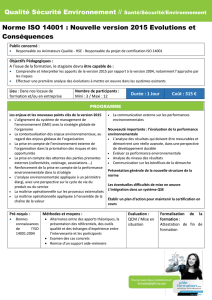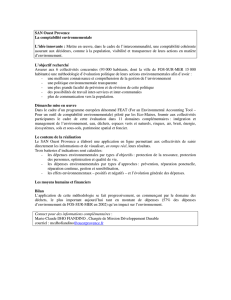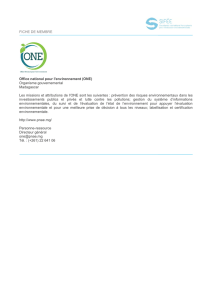innovation environnementale et profitabilité

BIOGRAPHIE
Stefan Ambec
Directeur de recherche INRA au LERNA
(Laboratoire d’Économie des
Ressources Naturelles), chercheur
à la Toulouse School of Economics
et membre de l’Institut d’Économie
Industrielle (IDEI) de Toulouse, Stefan
Ambec est aussi professeur invité à
l’Université de Göteborg. Il a obtenu
un Ph. D. en sciences économiques à
l’Université de Montréal. Ses travaux
portent sur l’économie des ressources
naturelles et de l’environnement et
l’économie industrielle, en particulier
sur l’impact des politiques
environnementales et sur le partage
de l’eau.
Innovation environnementale
et profitabilité
LES GAINS COMPENSENT-ILS LES COÛTS
ASSOCIÉS ?
LES CAHIERS DE L’ILB
A RETENIR
■D’après l’hypothèse de Porter, les gains de productivité ou de parts
de marché dépasseraient souvent les coûts supportés par les
pollueurs pour se conformer à la réglementation environnementale.
■Les opportunités d’améliorer à la fois la performance environnementale
et la performance économique des firmes sont nombreuses.
■Mais tant les analyses théoriques que les travaux empiriques semblent
indiquer que les innovations dues à des politiques environnementales
plus exigeantes, si elles favorisent l’innovation et améliorent la
performance environnementale des entreprises, ne compensent pas
systématiquement l’ensemble des coûts liés au respect de ces politiques.
En s’appuyant sur une enquête unique, Stefan Ambec et ses coauteurs
apportent un éclairage nouveau sur l’hypothèse de Porter, selon laquelle
des réglementations environnementales strictes peuvent favoriser les
innovations et ainsi améliorer le profit des industries qui y sont soumises
grâce à des gains de productivité. Ils confirment cependant que celle-ci
relève plutôt de l’exception que de la règle ! Les investisseurs sociale-
ment responsables ont donc un rôle difficile mais important à jouer dans
la sélection des entreprises pour lesquelles innovation environnementale
rime avec profitabilité.
D’après un entretien avec Stefan Ambec et son article “Environmental
Policy, Innovation and Performance: New Insights on the Porter Hypothesis”
(Journal of Economics and management Strategy, Volume 20, n° 3,
Automne 2011) coécrit avec Paul Lanoie(1), Jérémy Laurent-Lucchetti(2)
et Nick Johnstone(3).
La protection de l’environnement se
fait-elle au détriment de la performance
économique pour les entreprises ? Cette
question est pertinente en matière d’in-
vestissement socialement responsable
(ISR). Si la réponse s’avère positive, alors
une bonne performance environnemen-
tale est un signe de faible rendement
pour les actifs de l’entreprise. Si elle est
négative, alors performances environne-
mentale et financière sont complémen-
taires. La responsabilité environnementale
mène ainsi à une meilleure valorisation
de l’entreprise. En identifiant ces com-
plémentarités, les fonds ISR n’ont pas
à sacrifier le rendement pour contribuer
à améliorer l’environnement mais, au
contraire, développent une stratégie
“gagnante-gagnante” !
(1) HEC Montréal
(2) Université de Berne et Oeschger Center for Climate Change
(3) OCDE
http://www.idei.fr/fdir/
CAHIER ILB-FR N4-HD_Mise en page 1 01/09/11 14:04 Page4

Recommandations
pour les pouvoirs publics
■Favoriser l’innovation comme réponse
à la contrainte environnementale par
des réglementations environnementales
plus exigeantes mais flexibles pour les
entreprises, c'est-à-dire reposant sur
des instruments économiques comme
les taxes ou les permis échangeables.
■Favoriser l’investissement dans les
nouvelles technologies vertes notam-
ment par le biais du développement de
l’ISR et du transfert de technologies
liées à l’environnement.
LES CAHIERS DE L’ILB
Une manière d’aborder la question est
de tester ce qu’il est commun d’appeler
l’hypothèse de Porter. Selon cette hypo-
thèse, mise en avant par Michael Porter,
professeur de management stratégique
à l’Université d’Harvard, des régulations
environnementales plus strictes mais
flexibles, en favorisant l’innovation, peu-
vent amener à des gains de productivité
qui font plus que compenser le coût ini-
tial de l’investissement dans la nouvelle
technologie. “L’hypothèse de Porter a
connu un grand succès dans le débat
politique, notamment aux Etats-Unis, car
elle réfute l’idée selon laquelle la protec-
tion de l’environnement ne peut se faire
qu’au détriment de la croissance écono-
mique, explique Stefan Ambec. Mais elle
a aussi été fortement contestée par les
économistes dans la mesure où elle
remet en cause le paradigme de maximi-
sation des profits sur lequel repose la
rationalité des entreprises.” En effet, s’il
est possible d’accroître les profits des
entreprises réglementées, cela signifie
qu’il existerait systématiquement des
opportunités de profits ignorées en
l’absence de cette réglementation.
Un sujet qui prête à débat
Cette controverse a donné naissance à
une abondante littérature économique
sur les fondements théoriques qui pour-
raient sous-tendre l’hypothèse de Porter.
Stefan Ambec et Philippe Barla en ont
d’ailleurs proposé une revue critique en
2007 et concluent que l’hypothèse n’est
compatible avec l’hypothèse de rationalité
des firmes qu’en présence d’une imper-
fection de marché (en plus du problème
d’externalité négative que constitue la
pollution). Parmi les imperfections de
marché qui mènent à une situation com-
patible avec l'hypothèse de Porter, men-
tionnons les asymétries d'information
au sein de la firme (ou sur ses marchés)
ou encore le fait qu’une innovation a un
caractère de bien public. La réglementa-
tion environnementale peut avoir pour
effet de réduire l'inefficacité due à l'im-
perfection de marché considérée (en plus
de celle liée à la pollution) au bénéfice de
tous, y compris les firmes qui y sont sou-
mises.
Il existe ainsi plusieurs circonstances
dans lesquelles une meilleure performance
environnementale, suscitée ou non par
la réglementation, peut être bénéfique à
l’entreprise. Dans un article publié en
2008 avec Paul Lanoie, Stefan Ambec
suggérait, par exemple, sept canaux par
lesquels une meilleure performance envi-
ronnementale peut accroître les bénéfices
ou réduire les coûts : l’accès à de nouveaux
marchés, une meilleure différenciation
des produits, la diversification des acti-
vités à la vente de technologies liées à
l’environnement, la baisse des coûts
réglementaires, la diminution des entrants
de production tel que l’énergie, une plus
grande attractivité sur le marché du
travail et un meilleur accès au capital via
notamment l’ISR.
Une approche plus globale
De nombreux travaux ont également
consisté à tester empiriquement l’hypo-
thèse de Porter. De cette littérature ana-
lysée par Stefan Ambec et Paul Lanoie
en 2008, ressortent deux approches : la
première conclut à un lien positif, mais
parfois faible ou nul, entre l’intensité de
la réglementation environnementale et
l’innovation ; la deuxième montre un lien
négatif entre l’intensité de la réglemen-
tation environnementale et la producti-
vité, ce qui tend à rejeter l’hypothèse de
Porter. “Le travail exposé dans ce nouvel
article combine ces deux approches, ce
qui permet d’estimer, pour la première
fois, les quatre éléments principaux de
la chaîne de causalité de Porter, explique
Stefan Ambec. Cet exercice nous permet
d’obtenir un meilleur éclairage sur les
circonstances et mécanismes en jeu,
et sur le bien-fondé de l’hypothèse de
Porter.”
Pas de miracle global
Les auteurs montrent notamment que,
si la sévérité des politiques en faveur de
la protection de l’environnement contribue
à augmenter la performance environne-
mentale des entreprises, ce sont les
politiques flexibles qui semblent les plus
efficaces. Les normes de performance
souples apparaissent plus à même de
favoriser l’innovation que des normes
technologiques dirigistes (comme impo-
ser des convertisseurs catalytiques par
exemple). Ils montrent aussi que la
réglementation environnementale conduit
les entreprises à accroître leurs investis-
sements dans le processus de R&D, ce
qui a un effet positif sur leur performance
économique globale. Mais malheureuse-
ment, cet effet positif indirect est contre-
balancé par l’effet négatif direct de la
réglementation environnementale. “Pour
reprendre les mots de Porter lui-même,
les gains économiques liés à l’innovation
environnementale ne compensent pas
les coûts engendrés par la réglementa-
tion, regrette Stefan Ambec. La régle-
mentation environnementale se traduit
donc par un coût net à l’économie et il
n’y a pas de “miracle global”…
Pour aller plus loin
■ Ambec S., Lanoie P. (2009), “Performance
environnementale et économique de
l’entreprise”, Economie & Prévision, 190-
191: 71-94
■ Ambec S., Lanoie P. (2008), “Does it pay
to be green? A Systematic Overview”,
Academy of Management Perspectives,
23: 45-62
■ Ambec S., Lanoie P. (2008), “L’innovation
au service de l’environnement et de la
performance économique”, INRA Sciences
Sociales, n.6
■ Ambec S., Barla P. (2007), “Quand la
réglementation environnementale profite
aux pollueurs : survol des fondements
théoriques de l’hypothèse de Porter”,
L’Actualité Economique, 83 (3) : 399-414
METHODOLOGIE
Les auteurs ont testé la validité de l’hypo-
thèse de Porter en utilisant des données
relevant de l’ensemble de la chaîne de
causalité de Porter : politique environne-
mentale, recherche et développement,
performance environnementale et perfor-
mance commerciale.
Cette analyse empirique s’appuie sur une
base de données qui comporte des obser-
vations sur environ 4 200 établissements
de plus de 50 employés représentant
24 secteurs manufacturiers, situés dans
sept pays industrialisés (Allemagne,
Canada, Etats-Unis, France, Hongrie,
Japon, Norvège), issues d’une enquête
menée par l’OCDE.
CAHIER ILB-FR N4-HD_Mise en page 1 01/09/11 14:04 Page5
1
/
2
100%