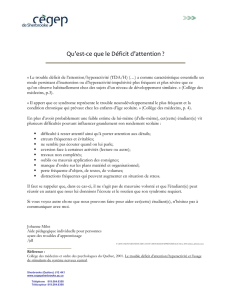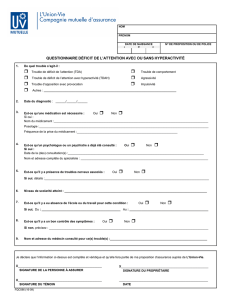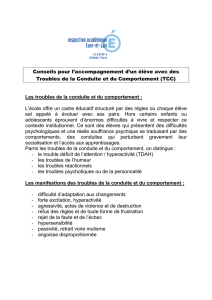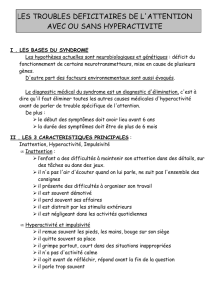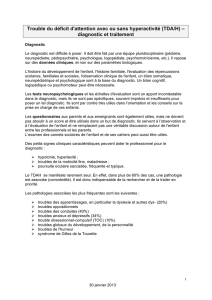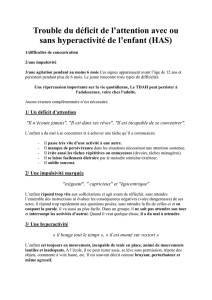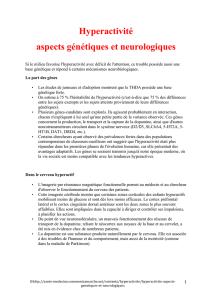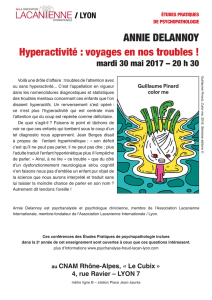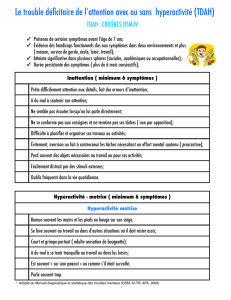L`HYPERACTIVITÉ À L`ÉCOLE : UNE SORTE DE

L'HYPERACTIVITÉ À L'ÉCOLE : UNE SORTE DE FIÈVRE DU COMPORTEMENT
(Honorez, J.M. (1)
Dans le cadre du séminaire du 25 mars 2004 portant sur l'hyperactivité à l'école organisé par
le Groupe Lire, groupe de recherche du Département d'Éducation et de Formation Spécialisées de
l'Université du Québec à Montréal, cette présentation propose de faire état des aspects principaux de
la notion d'hyperactivité à l'école en visant à préciser si elle est un trouble primaire ou secondaire :
l'hyperactivité est-elle la cause ou la conséquence d'une ou d'autres difficultés ou troubles ?
Pour atteindre cet objectif et lorsqu'il s'agira d'utiliser des données quantitatives,
l'hyperactivité sera traitée d'un point de vue macroscopique, soit celui qui correspond le plus
souvent à celui de l'épidémiologie (Honorez, 2000a).
Ainsi, après avoir constaté la difficulté à trouver une définition scolaire de l'hyperactivité, il
sera fait successivement état de la définition catégorielle de l'hyperactivité, des résultats d'études
épidémiologiques concernant sa prévalence, sa comorbidité et ses sous-types diagnostiques.
Les données rapportées devraient permettre de vérifier la thèse selon laquelle l'hyperactivité
serait le plus souvent un trouble secondaire associé à un autre trouble plus fondamental. Par
analogie avec la nosologie, ceci ferait alors de l'hyperactivité une sorte de fièvre du comportement.
Pour des motifs de concision dans la communication, la question du traitement de
l'hyperactivité bien qu'important (Honorez, 2002b) ne sera que sous-jacent aux propos. Pour le
même motif, le terme hyperactivité aura préséance sur d'autres dénominations du trouble.
1.0 HYPERACTIVITÉ ET INADAPTATIONS SCOLAIRES
Depuis plusieurs années, les intervenants auprès des jeunes ont été confrontés à une
augmentation apparemment exponentielle de demandes de services pour des élèves réputés
hyperactifs à l'école.
Il est toutefois au moins paradoxal de constater qu'il n'existe aucune définition ou diagnostic
officiel de l'hyperactivité dans, par et pour la plupart des administrations scolaires dont relèvent ces
élèves (MEQ, 2000c).
C'est ainsi que dans la plus récente version des Définitions des É.H.D.A.A., ou Élèves
Handicapés ou en Difficulté d'Adaptation ou d'Apprentissage, le Ministère de l'Éducation du
Québec n'a consacré aucune de sa douzaine de définitions aux élèves hyperactifs (MEQ, 2000c). Il
en était déjà de même dans ses précédentes définitions de 1992 (MEQ, 1992).

2.0 LA DÉFINITION CATÉGORIELLE DE L'HYPERACTIVITÉ
2.1 Mesure dimensionnelle et catégorielle de l'hyperactivité
Dans le langage quotidien, il existe diverses acceptions du terme hyperactivité auxquelles
les intervenants peuvent personnellement souscrire.
Pour les intervenants scolaires toutefois, les définitions opérationnelles se ramènent le plus
souvent à deux types : la définition médicale, dite catégorielle, et celle psychologique, dite
dimensionnelle.
La définition psychologique est plutôt en réalité liée à une mesure obtenue par un score issu
d'une épreuve psychométrique dimensionnelle telle le test de Conners. Comme beaucoup
d'épreuves psychométriques et malgré l'aura conférée par l'apparat statistique, une telle épreuve
n'est pas à l'abri d'un problème de validité. Vu ce type de réserve, la mesure dimensionnelle de
l'hyperactivité ne pourra être abordée ici puisque nécessitant un développement et des nuances par
trop complexes (Honorez, 2002d).
2.2 Terminologie anglo-saxonne
Tant pour les praticiens que les chercheurs en milieu scolaire, la définition opérationnelle de
l'hyperactivité est avant tout médicale. On la retrouve donc tant dans la Classification Internationale
des Maladies de l'Organisation Mondiale de la Santé, la CIM-10 de l'O.M.S. (O.M.S, 1993), que
dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'Association Américaine de
Psychiatrie, le D.S.M.-IV de l'A.P.A. (A.P.A., 1994).
D'un usage plus répandu en Amérique du Nord, la définition du D.S.M. correspond
fondamentalement et historiquement à une conception neuropédiatrique organiciste (Micouin et
Boucris, 1988).
Dans ce trouble de l'enfance proposé en 1902 par le pédiatre Still comme une anomalie du
sens moral, le corps médical cru retrouver finalement la symptomatologie de séquelles observées
chez les jeunes ayant survécus à une épidémie d'encéphalite de Von Economo. Cette étiologie
organiciste ayant été ainsi associée définitivement au trouble, celui-ci passa par diverses
appellations à consonance définitivement aussi organiciste l'une que l'autre : réaction hyperkinétique
de l'enfance, syndrome hyperkinétique, syndrome de l'enfant hyperkinétique, atteinte cérébrale
minime, dysfonction cérébrale minime, dommage cérébral minime, dysfonction cérébrale mineure
Dans la foulée de travaux de la psychologue montréalaise Virginia Douglas, le D.S.M.-III
de 1980 rebaptisa et redéfinit son Syndrome Hyperkinétique de l'Enfance et de l'Adolescence en
Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité (Honorez, 2002e).
2.3 L'hyperactivité dans le D.S.M.

Ainsi depuis 1980, l'hyperactivité correspond dans le D.S.M. aux critères diagnostiques
du Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité. Il s'agit donc d'un trouble mental
figurant dans la première section du D.S.M. dite des troubles habituellement diagnostiqués dans la
première enfance, la deuxième enfance ou l'adolescence. Il y est précisément défini dans la sous-
section dite Trouble déficitaire de l'attention et comportement perturbateur (A.P.A., 1994)
2.4 Dimensions du T.D.A./H. selon le D.S.M.
Depuis déjà 1968, le D.S.M. articule sa définition diagnostique de l'hyperactivité autour de
trois (3) dimensions comportementales : l'inattention ou déficit d'attention, l'hyperactivité et
l'impulsivité.
Pour obtenir actuellement un diagnostic positif parmi les 18 critères symptomatiques, il faut
notamment avoir au moins six (6) des neuf (9) manifestations de la dimension inattention dite aussi
du déficit d'attention.
Un autre diagnostic positif est obtenu lorsqu'il y a au moins six (6) des neuf (9)
manifestations dans le regroupement des deux (2) dimensions d'hyperactivité et d'impulsivité
(A.P.A., 1994).
2.5 Le diagnostic de l'hyperactivité dans le D.S.M.
Dans sa plus récente version, le diagnostic positif d'hyperactivité doit répondre à cinq (5)
conditions (A.P.A, 1994).
La première condition veut que les manifestations comportementales se retrouvent dans l'un
des volets de l'alternative suivante : (a) soit présence de six des symptômes suivants d'inattention
(ou plus) qui ont persisté pendant au moins 6 mois, à un degré qui est inadapté et ne correspond pas
au niveau de développement de l'enfant (voir les neuf (9) critères (a) à (i)); (b) soit présence de six
des symptômes suivants d'hyperactivité-impulsivité (ou plus) qui ont persisté pendant au moins six
(6) mois, à un degré qui est inadapté et ne correspond pas au niveau de développement de l'enfant
(voir pour l'hyperactivité, les six (6) critères (a) à (f); pour l'impulsivité, les trois (3) critères (g) à (i).
La deuxième condition exige que certains des symptômes d'hyperactivité-impulsivité ou
d'inattention ayant provoqué une gêne fonctionnelle étaient présents avant l'âge de 7 ans.
La troisième condition nécessite la présence d'un certain degré de gêne fonctionnelle liée
aux symptômes dans deux ou plus de deux types d'environnement différents (p.ex. à l'école ou au
travail et à la maison).
La quatrième condition requiert qu'on mette clairement en évidence une altération
cliniquement significative du fonctionnement social ou professionnel.

La cinquième condition commande que les symptômes ne surviennent pas exclusivement au
cours d'un Trouble envahissant du développement, d'une Schizophrénie, ou d'un autre Trouble
psychotique, et ils ne sont pas mieux expliqués par un autre trouble mental (p. ex. Trouble
thymique, Trouble anxieux, Trouble dissociatif ou Trouble de la personnalité).
2.6 Symptômes d'inattention
Les symptômes de la dimension inattention sont au nombre de neuf (9) (A.P.A., 1994) :
a) souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails, ou fait des fautes d'étourderie dans
les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités;
b) a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux;
c) semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement;
d) souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs
scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles (cela n'est pas dû à un
comportement d'opposition, ni à une incapacité à comprendre les consignes);
e) a souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités;
f) souvent, évite, a en aversion, ou fait à contrecoeur les tâches qui nécessitent un effort
mental soutenu (comme le travail scolaire ou les devoirs à la maison);
g) perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités (p.ex. jouets, cahiers de
devoirs, crayons, livres ou outils);
h) souvent, se laisse facilement distraire par des stimulus externes;
i) a des oublis fréquents dans la vie quotidienne.
2.7 Symptômes d'hyperactivité-impulsivité
Les symptômes pour les dimensions hyperactivité et impulsivité sont au nombre de neuf (9)
(A.P.A., 1994).
Les symptômes couvrant spécifiquement l'hyperactivité sont au nombre de six (6) (A.P.A.,
1994) :
(a) remue souvent les mains ou les pieds, ou se tortille sur son siège;
(b) se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis;
(c) souvent, court ou grimpe partout, dans des situations où cela est inapproprié (chez les
adolescents ou les adultes, ce symptôme peut se limiter à un sentiment subjectif d'impatience
motrice);
(d) a souvent du mal à se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisir;
(e) est souvent sur la brèche ou agit souvent comme s'il était monté sur ressorts;
(f) parle souvent trop.
Les symptômes de la dimension impulsivité sont au nombre de trois (3) (A.P.A., 1994) :
(g) laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas entièrement posée;
(h) a souvent du mal à attendre son tour;

(i) interrompt souvent les autres ou impose sa présence (p.ex. fait irruption dans les
conversations ou dans les jeux).
2.8 Types diagnostics d'hyperactivité
Diverses combinaisons ou algorithmes de l'hyperactivité ou T.D.A./H. sont possibles : le
type à dominance inattention (code D.S.M. : 314.01) avec six (6) critères parmi les neuf (9) signes
d'inattention; le type à dominance hyperactivité-impulsivité (314.00) avec six (6) signes
d'hyperactivité et/ou d'impulsivité; le type combiné ou mixte (314.01) avec chaque fois au moins
six (6) critères positifs du déficit de l'attention et de l'hyperactivité-impulsivité.
L'hyperactivité peut être diagnostiquée d'une quatrième façon, soit à partir du diagnostic
Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité, non spécifié qui est réservé aux troubles avec
symptômes évidents d'inattention ou d'hyperactivité/impulsivité, qui ne remplissent pas tous les
critères du Trouble: déficit de l'attention/hyperactivité.
3.0 L'HYPERACTIVITÉ SELON LES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES
Le D.S.M. estime que de trois (3) à cinq (5) pour cent des jeunes pâtiraient d'hyperactivité
telle que définie par le diagnostic de Trouble Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité
(A.P.A., 1994). Les enquêtes épidémiologiques soutiennent jusqu'à un certain point ces prévalences.
3.1 Prévalence des troubles mentaux des 6 a 14 ans
L'hyperactivité est le trouble mental le plus fréquent de l'E.Q.S.M.J., l'Enquête québécoise
sur la santé mentale des jeunes de 6 à 14 ans (Valla et coll., 1994). Elle reste le trouble mental le
plus fréquent que soit prise en compte (4.9%) ou non (5.4%) la mesure de l'adaptation, soit selon le
D.S.M., un certain degré de gêne fonctionnelle liée aux symptômes dans deux ou plus de deux
types d'environnement différents (par exemple à l'école ou au travail et à la maison) (tableau 1).
En tenant compte de cette mesure, les autres trouble mentaux se rangent ensuite ainsi :
Hyperanxiété (2.2%), Trouble d'Opposition (2.1%), Phobie Simple (2.0%), Dépression Majeure
(1.5%), Anxiété Généralisée (1.3%), Angoisse de Séparation (.9%), Trouble des Conduites (.7%) et
Dysthymie (.8%).
T. 1 : PRÉVALENCE DES TROUBLES MENTAUX DES 6 à 14 ANS
(Valla et coll., 1994)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%