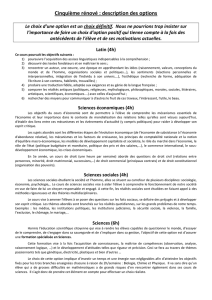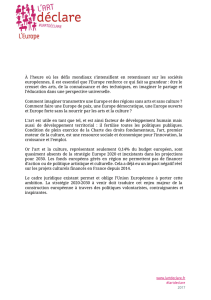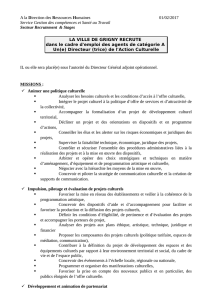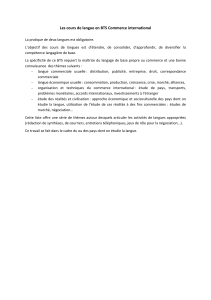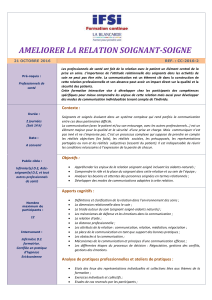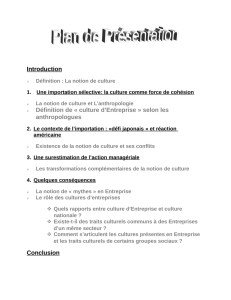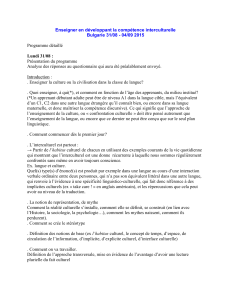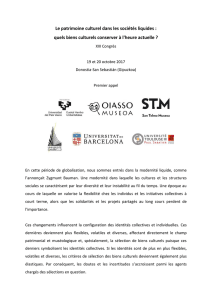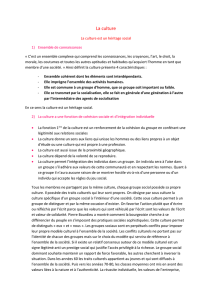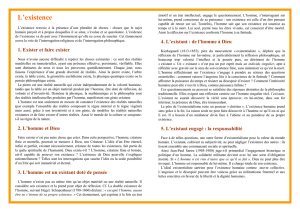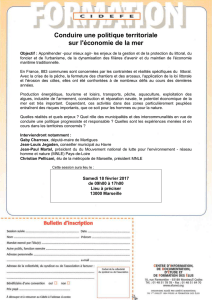Culture - Médiation de culture... scientifique

Culture et complexité ou du bon usage
de la culture
Albert Doutreloux
Culture ?
Interculturel ?
La culture : un construit
Une communication problématique
Le projet et la pratique interculturels
Références bibliographiques
Culture ?
La notion philosophique de « culture » se développe au XIXe siècle en même
temps que l'ethnologie et l'anthropologie contemporaines, et avec des corrélations
idéologiques évidentes entre ces deux approches des sciences humaines au
moment où l'Occident achève d'explorer le monde et de s'en emparer. Mais pour
avoir, depuis, été reprise de toutes les manières, ne fût-ce que par les
anthropologues, la notion de « culture » continue d'évoquer des représentations fort
diverses et ne semble pas plus aisée à conceptualiser. Elle offre à cet égard des
analogies avec les notions de « santé » ou de « vie », entre autres. Si l'on est
certain de désigner par ces termes des réalités, on a en même temps la plus
grande peine à en préciser objectivement la nature et le contour.
C'est au point que parfois certains se méfieront du terme et de ce qu'il entendrait
désigner et préféreront contourner l'obstacle. Méfiance ou non, une conception du
fait culturel se trouve fort bien explicitée sous le couvert de la notion d'« idéologie »
par Marc-Adélard Tremblay :
L'idéologie, on le sait, constitue une prise de position qui découle d'une
conscience formelle de soi, d'une définition et d'une compréhension d'une
situation globale. Elle représente un modèle ou un principe d'action qui
veut justifier d'une manière explicite et systématique la signification d'une
série de conduites. Elle cherche ainsi à introduire, dans le vécu quotidien
des membres d'une collectivité, un système à long terme, clos et

des membres d'une collectivité, un système à long terme, clos et
cohérent. (Tremblay, 1973 : 213)
Pareille élucidation dépasse bien des « définitions » classiques par sa complexité,
par l'articulation de plusieurs niveaux de réalité en quoi consisterait non la chose
mais le processus en cause, idéologie ou aussi bien culture, conscience de soi et
compréhension d'une situation globale, action et signification, quotidien et historicité,
cohérence et fermeture. On peut, entre autres élaborations, voir s'esquisser ici
autant le constructivisme que la systémique actuels.
On ne peut, par ailleurs, parler de culture que dans le cadre d'une culture. Or, on le
sait, il est fort difficile, sinon impossible, de parler du système à l'intérieur du
système... Aussi est-ce pour cela que l'anthropologie se spécifie comme démarche
scientifique en cherchant dans le détour par l'autre et le différent l'objectivation de
nos propres réalités. Ce processus héroïque (!) d'objectivation de l'inéluctable
subjectivité, à la fois, désigne l'anthropologie comme ressource nécessaire pour les
interventions sociétales de tous ordres, dans nos propres sociétés aussi bien que
dans les autres, et en marque les risques et les limites. En d'autres termes encore,
les questions, et les réponses, des anthropologues, de leurs commanditaires et des
collectivités intéressées ne sont pas forcément identiques, ni même compatibles. S'il
peut être nécessaire objectivement de déranger, il est en même temps inévitable de
décevoir parfois et aussi objectivement ! Marc-Adélard Tremblay exprime avec
beaucoup de lucidité et de franchise les ambiguïtés et les ambivalences de
l'anthropologie et de ses « applications ». (Tremblay, 1983 : 378-380)
Interculturel ?
Ainsi en va-t-il dans le champ récemment mis en valeur de l'« interculturel ». Pour
des raisons qu'il serait certainement intéressant d'élucider, l'anthropologie sans en
être absente n'y tient pas, tant s'en faut, la place prépondérante que s'y est taillée la
psychologie notamment. Peut-être l'interculturel recadre-t-il les questions et les
problèmes de telle façon qu'il faille revoir aussi approches méthodologiques,
conceptualisations et théories, sans oublier les interventions de l'anthropologie ou,
plutôt, des anthropologies. Des remarques de Marc-Adélard Tremblay peuvent très
bien être reprises ici :
« [...] n'avons-nous pas été indûment influencés, dans nos modes de
pensée, par notre conservatisme disciplinaire ? N'avons-nous pas
considéré les diverses dynamiques du changement externe et interne
comme des facteurs isolés agissant indépendamment sur le " tissu » de la
culture plutôt que comme deux ensembles de facteurs réagissant l'un sur
l'autre et sur les divers éléments d'un modèle culturel, lequel à son tour
déclenche une série de réactions en chaîne débouchant sur des
configurations totalement différentes ". (Tremblay, 1983 : 380-381)
Cette analyse comme d'autres encore n'introduit-elle pas, de nouveau, à une mise
en perspective complexe des phénomènes et à l'approche systémique en découlant

en perspective complexe des phénomènes et à l'approche systémique en découlant
!
C'est cette complexification de nos problématiques qu'on voudrait explorer à propos
de la notion de « culture » imposée par ce champ d'observation et surtout
d'intervention, l'« interculturel ». L'interculturel n'est pas la rencontre d'autres
cultures ou, plutôt, de ressortissants d'autres ensembles socioculturels. Les
anthropologues se sont fait précisément une spécialité de pareilles démarches.
Celles-ci jusqu'à récemment consistaient à pénétrer dans le contexte des autres...
en restant appuyé sur le sien propre et en gardant à toutes fins utiles le pouvoir de
mesurer l'intensité et la durée de l'engagement. Avec l'interculturel, c'est-à-dire avec
les situations créées désormais à peu près partout en Occident par les immigrations
et surtout avec les immigrants de ce « monde » qu'on appelait « tiers » il y a peu
encore... ! Nos « communautés clientes » désormais ont perdu leur naïveté et « [...]
ont appris à s'organiser et à contre-attaquer » (Tremblay, 1983 : 379). Il ne s'agit
plus, en effet, du flirt d'un soir, mais d'une vie commune et d'une vie commune à
laquelle les nouveaux venus entendent participer pleinement... sans, pour autant,
perdre leurs identités spécifiques. La complexité n'est plus seulement celle qui est
inhérente à tout processus culturel, mais encore celle qui résulte des emboîtements
plus ou moins imaginables et effectifs, heureux ou non, de systèmes culturels
différents, voire incompatibles.
La culture : un construit
Ces précautions épistémologiques prises et quoi qu'il en soit des heurs et malheurs
de la recherche et de l'intervention anthropologiques, la culture s'impose comme un
fait certain et essentiel à la compréhension comme à l'action dès qu'il s'agit de
groupes humains. Ce n'est plus, officiellement du moins, une manière, mise en
valeur dans la philosophie d'un Spengler, par exemple, de désigner l'« esprit » qui
sépare ceux qui le possèdent du commun de leur propre société et davantage
encore des sauvages et barbares extérieurs. Telle qu'elle est conçue de manière
générale par l'anthropologie, la réalité culturelle concerne tout groupe humain et a à
voir avec tout ce que vit l'individu et le groupe puisqu'elle les constitue précisément
comme... humains en suppléant ainsi aux dynamismes instinctuels devenus
déficients dans notre espèce. Ce serait pour le groupe et ses membres la manière
de construire dans l'imaginaire toute réalité les concernant à partir de l'expérience
historique concrète et en mettant en relations tous les niveaux de réalités
constituant cette expérience dans leurs contextes propres. Dans le même
mouvement prennent cohérence, et donc sens, l'ensemble de ces réalités de tous
niveaux intéressant la collectivité en cause à la suite de son histoire et au moment
où elle se perçoit. En ce sens on pourrait encore concevoir la culture comme
l'organisation de la complexité des relations aux réalités qui affectent les individus et
les groupes par sélections, classifications, accentuations et hiérarchisations. Enfin,
et d'un point de vue délibérément subjectif, les processus culturels ont comme objet
et comme effet essentiels de nous construire tout simplement nos identités
collectives et singulières. Dans toute cette élaboration, et pour reprendre une
perspective d'A. Wilden, si le singulier est en dépendance du collectif qui, de fait, lui

perspective d'A. Wilden, si le singulier est en dépendance du collectif qui, de fait, lui
survit, il le détermine néanmoins en raison de sa complexité supérieure (Wilden,
1983 : xxviii-xxix). Ceci n'est pas un des moindres problèmes auxquels les
processus culturels doivent répondre, soit la mise en relations fonctionnelles des
collectivités et de leurs membres.
Les processus culturels reprennent donc la plus grande partie des fonctions
qu'assume l'espèce pour les autres vivants, formation et information. Mais on passe
alors du niveau « espèce » au niveau « collectivité » avec les changements de
logiques nécessaires. C'est dire que chaque collectivité doit s'inventer elle-même et
pour elle-même dans ses environnements particuliers. Elle se distingue de la sorte
de ces environnements et en même temps des autres groupes analogues en se
construisant comme elle s'imagine. L. Wittgenstein le remarque avec humour :
S'il était loisible à un homme de venir au monde dans un arbre d'une
forêt, il y aurait des hommes qui chercheraient l'arbre le plus beau et le
plus élevé, d'autres qui choisiraient le plus petit, et d'autres encore qui
choisiraient un arbre médiocre, certes pas, veux-je dire, par esprit
philosophique, mais précisément pour cette raison, ou cette espèce de
raison, qui a fait que l'autre a choisi le plus haut. (1982 : 24)
Sans doute trouve-t-on dans ce processus culturel une racine capitale des
tribalismes, nationalismes et autres « ismes » de tous ordres avec tous les types de
« purifications ethniques » à leurs horizons...
En d'autres termes encore, les collectivités humaines ainsi structurées et organisées
par leurs processus culturels peuvent se concevoir comme autant de systèmes
autonomes ou, mieux, autopoiétiques. Si, en effet, le processus culturel assure la
stabilité et la cohérence à long terme d'une société, ethnique ou autre, l'autopoièse
développe cette idée d'homéostasie, si chère, et à juste titre, aux approches
fonctionnalistes et structuralistes, de deux façons : « D'une part, en transformant
toutes les références de l'homéostasie en références internes au système lui-même.
D'autre part, en affirmant que l'identité du système, que nous appréhendons comme
une unité concrète, provient de l'interdépendance des processus » (Varela, 1989 :
45). On pourrait concevoir que d'une certaine manière les ensembles culturels,
construits et concrets, se constituent selon des références internes propres et
s'identifient dès lors par des manières originales d'articuler les processus
constituants et d'actualiser ainsi par eux-mêmes et pour eux-mêmes les lois des
systèmes.
Une communication problématique
Selon pareille mise en perspective, les relations interculturelles qui affectent à tous
niveaux les contacts entre collectivités rendent ces contacts problématiques,
souvent conflictuels, voire parfois impossibles, au moins à court terme. Ce ne sont
donc pas tellement les réalités objectives qui feront difficulté dans les relations en
cause que les images culturelles que se sont formées de ces réalités chaque

cause que les images culturelles que se sont formées de ces réalités chaque
groupe et chacun dans son groupe. Ceci n'exclut pas toutes les causes bien plus
pragmatiques des difficultés et des conflits entre groupes humains mais signifie que
ces causes n'ont d'existence effective que travaillées pour chaque groupe impliqué
par son imaginaire culturel. Les dynamiques pratiques de la vie collective
actualisent les construits culturels sur le plan des contingences concrètes. Les
processus culturels de leur côté actualisent de manière préalable et continue ces
causalités objectives sur le plan, incontournable dans l'espèce humaine, de
l'imaginaire social et individuel.
Un paradoxe s'impose ici : ces images et les dynamiques qu'elles engendrent
demeurent pour leur grande part et la plupart du temps inconscientes pour la
majorité des membres d'une collectivité. N'était-il pas réservé au niveau suprême de
l'initiation, et ne l'est-ce pas encore dans maintes organisations, de saisir pour ce
qu'ils sont ces « on-disait-que » qui fondent les ordres sociaux ! Cette inconscience
favorise l'efficacité des processus culturels. Elle facilite, au moins, l'oblitération de
l'inéluctable part d'arbitraire de l'imaginaire culturel et son inscription, en ce qui
concerne non pas une opinion discutable, mais une croyance littéralement
indiscutable (Wittgenstein, 1982 : 25). Cette condition d'efficacité du construit
culturel, et dans sa logique même, peut entraîner des rigidités et des aveuglements
qui rendent difficiles les changements ou les ajustements nécessaires. Enfin, si elles
rendent possible la communication à l'intérieur de la collectivité en la structurant et
en l'organisant, les organisations culturelles inconscientes ou quasi inconscientes
compliquent les communications hors groupe, entre collectivités autonomes (Hall,
1979 : 209-210).
Le projet et la pratique interculturels
Ce sont précisément ces aléas des relations entre ensembles culturellement
différenciés et parce que culturellement différenciés qui constituent le champ propre
des observations et des pratiques dites désormais « interculturelles ». Ce champ de
recherche et d'intervention s'articule alors autour de la question formulée par C.
Camilleri : « comment instituer du commun à travers l'altérité, la différence, de façon
à les surmonter sans les évacuer ? » (1989 : 363). Ceci suppose des
conceptualisations et des réflexions théoriques adéquates en relations réciproques
avec des pratiques en la matière constamment revues. Sur le plan pratique, non
seulement il est d'ordinaire fort difficile d'objectiver la construction culturelle de nos
réalités comme telle, à commencer par celle de nos identités collectives et
individuelles, mais, selon les enjeux et les contextes, il peut être aussi risqué d'en
prendre conscience que d'en rester inconscient.
À cet égard, l'avertissement prodigué par les xénophobies et les racismes
individuels et collectifs ou tout simplement par les craintes des gens ordinaires n'est
pas dénué de tout fondement objectif. Ainsi se manifeste concrètement ce que fait
remarquer Varela, et en définissant les ensembles collectifs et culturels comme des
« systèmes autopoiétiques de niveau supérieur » :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%