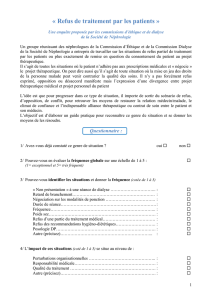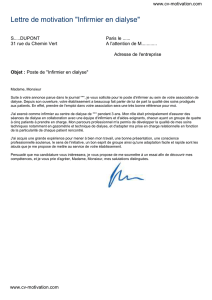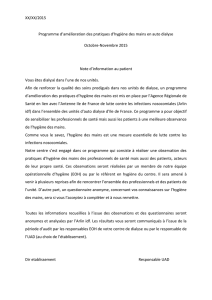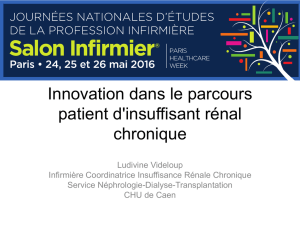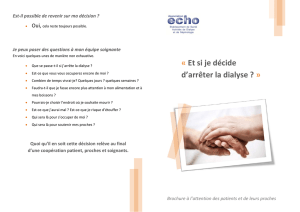nov. 2008 - Rein-échos.org l`IRC

LA REVUE SEMESTRIELLE GRATUITE DE LA LIGUE REIN ET SANTÉ
//// Education thérapeutique
en néphrologie
par C. Isnard Bagnis page 36
PRÉVENIR
n°5
NOV. 2008 – MARS 2009
//// La dialyse à vélo
par A. Kolko-Labadens page 38
INITIATIVES
IRCT
PERSONNES
ÂGÉES
p. 4 à 33
DOSSIER
//// Hémdialyse,
le cinquième élément
par B. Perrone page 40
LA DIALYSE


>>ÉDITORIAL
////
DOSSIER IRCT SUJETS ÂGÉS
04 DOSSIER IRCT
SUJETS ÂGÉS
04 Introduction
05 Vieillissement des IR néphrologie
11 Abord vasculaire
18 De la dialyse à la transplantation
22 Table ronde
29 Témoignages IDE
34 SUIVI DES MALADIES
RÉNALES
36 Education thérapeutique
38 Dialyses
48 INITIATIVES LOCALES
54 Recherche
57 Portrait
FRANÇOISE MIGNON
SERVICE DE NÉPHROLOGIE
HÔPITAL BICHAT —CLAUDE
BERNARD —PARIS
lya50 anslespremiers trai-
tements substitutifs de l’in-
suffisance rénale chronique
terminale (IRCT) sont deve-
nuspossibles.Faute de moyens et aussi
d’expertises, ils furent initialement
réservés à un très petit nombre de
patients jeunes, sans co-morbidité.
Quelques équipes pionnières ont livré
un combat quotidien pour que cesse,
au plus vite, l’intolérable « choix » des
malades pouvant être traités.
Que de progrès réalisés depuis cette
époque, résultats des travaux de tous :
chercheurs,soignants,industriels,mala-
des eux-mêmes et aussi organismes
payeurs!Leperfectionnementdestech-
niques, la prise en charge des compli-
cationsy comprisdesnouvellespatho-
logies induites par les traitements
eux-mêmes,lamiseaupoint demédi-
caments, tels que l’Erythropoïétine,les
chélateurs non aluminiques du phos-
phore,lesimmunosuppresseurs(deve-
nusplusefficacesetmoinstoxiques)et
bien d’autres, ont abouti à une réduc-
tion considérable de la morbi-morta-
litédesmaladestraitéset,danslespays
industrialisés, permis l’accès au pro-
gramme dialyse / transplantation de
tous les patients, même les plus âgés.
Actuellement, enFrance,plus de50000
malades vivent avec un traitement
substitutif de l’IRCT : 30 000 environ
sont dialysés, les autres transplantés.
Cinquante cinq pour cent des malades
dialysés sont âgés de plus de 60 ans et
33 % decespatientsont plus de75ans.
La transplantation est proposée aux
jeunesseniors, y compris avecdespro-
grammes spécifiques pour eux. La
Néphro-Gériatrie a ainsi progressive-
ment envahi notre spécialité, donnant
lieu à moultpublications,colloquessur
ce sujet qui avait néanmoins retenu
l’attention de quelquesuns depuisbien
des années.
La Néphro-Gériatrie occupe mainte-
nant une grande partie du temps des
équipes qui découvrent la nécessité
d’adapter les pratiquesauxspécificités
des personnes âgées. Pour chaque
patient, il faut prendre le temps néces-
sairepourévaluerles processus physio-
logiques et psychologiques propres au
vieillissement, très différentsd’unindi-
vidu à l’autre, d’où la grande hétéro-
généité des malades, y compris d’un
même millésime. Il faut apprendre à
connaîtrelessymptomatologies,volon-
tiers trompeuses dans le grand âge, et
tenircompte danstoutesdécisions des
nombreuses co-morbidités associées,
des handicaps moteurs et sensoriels
quasi-constants, sans oublier l’impact
du contexte socio-familial. D’où l’im-
portancepourlesNéphrologues,d’une
collaboration déjà largement entamée
avec beaucoup de spécialistes, au pre-
mier rang desquels les Gériatres.
Dans le même temps, il faut poursui-
vre les efforts pour que nos concito-
yens et, enparticulier,lesseniorsaient
un large accès au dépistage de l’insuf-
fisance rénale chronique, première
étape de la mise en place des traite-
ments capables de ralentir l’évolution
et donc d’espérer voir diminuer l’inci-
dence puislaprévalence del’IRCTdans
les annéesàvenir.C’estl’undesenjeux
majeursactuels dela Néphrologie. Son
importance n’a pas échappé à Mon-
sieurRAOULT, initiateuretrédacteuren
chef de Rein Echos, qui a conçu le con-
tenu de ce numéro où le lecteur trou-
vera une synthèse des principaux pro-
blèmes dont débattent les
professionnels qui s’intéressent main-
tenant à la Néphro-Gériatrie.
SOMMAIRE
I
• Nos partenaires ayant assuré la gratuité de cette
revue : Les différents auteurs (bénévoles)
• Nos sponsors : Amgen, B. Braun Avitum,
Genzyme, Fresenius Medicale Care France, Groupe
Francheville, Gérard Pons Voyages
• Crédit photos : Fresenius Medicale Care France -
Nephrocare (dont couverture), M. Raoult, les
auteurs pour leur article.
“
“
octobre 2008 - Reins-Échos n°5
///
3
ACTUELLEMENT,
EN FRANCE,PLUS
DE 50 000 MALADES
vivent avec un
traitement substitutif de
l’IRCT : 30 000 environ
sont dialysés,
les autres transplantés.

4
///
Reins-Échos n°5 - www.rein-echos.com
////
DOSSIER IRCT SUJETS ÂGÉS >>INTRODUCTION
L’augmentation continue
de l’espérance de vie est
le phénomène démo-
graphique le plus mar-
quant du XXesiècle. Actuel-
lement, le taux de mortalité globale
en France (1,84 pour 1000) est un des
plus faibles d’Europe et l’espérance
de vie à la naissance est l’une des plus
élevées : 84 ans pour les femmes et
77,1 ans pour les hommes. En 2005,
l’espérance de vie à l’âge de 65 ans
était de 22 ans pour les femmes et de
17,7 ans pour les hommes. A 85 ans, il
reste encore 8 ans à vivre pour les
femmes et 5 ans pour les hommes, à
90 ans 3ans pour les deux sexes (1).
Le vieillissement de la population pro-
gresse en dépit d’une augmentation
soutenue de la natalité : en 2010 les
plus de 75 ans représenteront 8,7% de
la population contre 7,9% en 1998 (2).
L’amélioration continue de l’état de
santé de la population française a per-
mis d’échapper aux conséquences
dramatiques d’un vieillissement vu par
certains, dans les années 80, comme
obligatoirement et mécaniquement
pourvoyeur d’une « pandémie » de
maladies chroniques invalidantes (3)
pour évoluer vers un phénomène de
compression de la morbidité dans les
dernières années de la vie (4,5). De
plus, l’espérance de vie sans incapa-
cité progresse plus vite que l’espé-
rance de vie à la naissance (6), limi-
tant la progression des incapacités,
même si celles-ci surviennent toujours
plus fréquemment chez les personnes
âgées. Le nombre de centenaires, dont
on considère qu’ils représentent un
modèle de vieillissement réussi,
augmente régulièrement. Les projec-
tions de l’INSEE montrent qu’il va dou-
bler entre 2006 et 2040 et plus que tri-
pler en 2050 (7).
Les maladies aiguës étant de mieux
en mieux guéries par des thérapeuti-
ques efficaces, ce sont les maladies
chroniques qui altèrent le plus l’état
de santé des français les plus âgés : le
diabète, l’hypertension artérielle (HTA),
la maladie d’Alzheimer et les cancers.
Le diabète et l’HTA représentent les
principales causes d’insuffisance
rénale terminale des sujets âgés dont
le taux d’incidence annuel moyen,
après 75 ans, est estimé à 139 par
million d’habitants, stable depuis 2003
(1). En 2006, les dialysés de plus de
75 ans représentaient 36% de l’en-
semble des dialysés soit 9280 et l’âge
médian des nouveaux patients pris en
charge en dialyse était de 71 ans en
2006 (8).
La réflexion à mener sur les patients
âgés atteints d’insuffisance rénale
chronique (IRC) doit porter sur deux
aspects très différents :
- La prise en charge optimale de l’IRC
âgé qui est, du fait de son terrain vas-
culaire, menacé de complications
telles que les accidents vasculaires
cérébraux, l’insuffisance cardiaque,
les pathologies démentielles, les évè-
nements iatrogènes, les troubles
nutritionnels et une perte d’autono-
mie altérant sa qualité de vie.
- Les mesures préventives de l’IRC
terminale devant prendre en compte
quelques points encore obscurs :
- la diminution de la fonction rénale
observée chez la plupart des sujets de
plus de 75 ans a-t-elle la même signi-
fication que chez les adultes en ter-
mes de complications métaboliques,
auto-aggravation des lésions intra-
rénales, vitesse d’évolution, mortalité ?
- les schémas de prévention qui ont
montré leur efficacité chez les adultes
jeunes n’ont pas été validés après
75 ans et le rapport bénéfice/risque
des différentes interventions doit être
apprécié sur une large population de
sujets âgés dépassant celle qui est habi-
tuellement adressée en néphrologie.
-C’est donc la collaboration des néphro-
logues, des gériatres, des épidémiolo-
gistes et des médecins généralistes
qui est nécessaire pour que l’ensemble
de la population âgée bénéficie d’une
prise en charge néphrologique
justement nécessaire et la plus effi-
cace possible. \\\
RÉFÉRENCES
1.S.Danet,E.Salines.L’étatdesantédela
populationenFrance.Donnéesdurapport
2007desuividesobjectifsdelaloidesanté
publique.Drees.EtudesetRésultatsn°623;
février 2008
2.F.Daguet.Unsièclededémographiefran-
çaise.Projectionsdepopulation2005-2050,
pour la France métropolitaine. Insee ré-
sultats, 2006
3.KramerM.Therisingpandemicofmen-
tal disorders and associatedchronic dise-
ases and disabilities. Acta Psychiatrscan.
1980;62 (suppl 285):282-97
4. Fried J-F. Aging, natural death and the
compression of morbidity. N Engl J Med
1980;303:130-35
5.D.Polton,C.Sermet.Levieillissement de
lapopulationva-t-ilsubmergerlesystème
de santé ? BEH n° 5-6, 2006 p.49-52
6.RobineJM,MornicheP,SermetC.Exa-
mination of the causes and mechanisms
oftheincreaseindisability-freelifeexpec-
tancy. J Aging Health 1988;10:171-91
7.Rapport 2006 du Réseau Epidémiologie
et Information en Néphrologie (REIN)
http://www.soc-nephrol.org/REIN/index.htm
PPRROOFFEESSSSEEUURR MMUURRIIEELL
RRAAIINNFFRRAAYY
Présidente de la Société
Française de Gériatrie et
Gérontologie, et est
également gérontologue,
au CHU de Bordeaux.
>> INTRODUCTION
DOSSIER

>>ETHIQUE
////
DOSSIER IRCT SUJETS ÂGÉS
Le grand âge a longtemps
soulevé la question des
limites thérapeutiques.Cela
était particulièrement frappant dans le
contexte de l’insuffisance rénale
chronique durant les premières années
de développement des traitements de
suppléance. L’hémodialyse se présen-
tait comme une technique périlleuse
et non justifiée chez le grand vieillard
et l’inscription en transplantation ne
se discutait plus au-delà d’un âge
adulte avancé.
Mais avec les avancées techniques, en
dialyse comme en transplantation, et
les progrès constants dans l’efficacité
et la tolérance des immunosuppres-
seurs, l’accès aux thérapeutiques de
suppléance s’est largement ouvert aux
sujets âgés. Ces derniers sont parallè-
lement devenus de plus en plus nom-
breux dans les populations d’insuffi-
sants rénaux chroniques.
Le vieillissement observé dans cette
pathologie correspond à une majora-
tion de la longévité dans la population
générale. Il apporte avec l’âge les dif-
ficultés inhérentes aux nombreuses
pathologies associées à l’insuffisance
rénale.
Les choix thérapeutiques
pour l’insuffisant rénal âgé :
du possible au souhaitable...
Aujourd’hui le défi est de choisir dans
les possibilités thérapeutiques le pro-
jet le mieux adapté. Ce choix doit inté-
grer plusieurs composantes : l’analyse
médicale fondée sur le contexte clini-
que, la possibilité technique, la volonté
du patient en tant que personne dans
le projet de vie qui lui est propre.
Le progrès technique se présente en
effet à la fois comme la promesse de
prolonger la vie malgré la défaillance
rénale et comme la menace d’une
contrainte pouvant altérer inexora -
blement le confort personnel et familial.
De nombreuses pathologies peuvent
être associées à l’insuffisance rénale
du sujet âgé. Ce sont le plus fré-
quemment des maladies cardiaques
ou vasculaires alourdissant les théra-
peutiques et altérant la tolérance de
la dialyse. Il s’agit aussi d’affections
compromettant de manière significa-
tive non seulement la durée mais aussi
la qualité de vie. L’indication théra-
peutique est alors rapportée au béné-
fice escompté pour le patient.
La possibilité technique a vu reculer
ses limites grâce à un progrès constant
dans les possibilités thérapeutiques
et la tolérance du traitement. Il n’y a
pas de limite d’âge en dialyse qu’il
s’agisse d’hémodialyse ou de dialyse
péritonéale. La perspective de trans-
plantation rénale dépend de l’état vas-
culaire et des pathologies associées
et non d’un âge donné. Cela est vrai en
ce qui concerne la transplantation à
partir de donneur en état de mort encé-
phalique ou de donneur vivant.
Le projet d’hémodialyse dépend de la
possibilité de créer ou de conserver
l’abord vasculaire en raison de l’état
vasculaire ou des surinfections de
cathé ters. Le confort thérapeutique
est influencé par la proximité du lieu
du traitement, par l’horaire et la durée
des séances et par leur tolérance.
La dépendance à la technique de sup-
pléance, les contraintes imposées au
patient et à son entourage, le nouveau
rythme de vie organisé au gré de la
périodicité des séances thérapeuti-
ques sont encore moins bien ac ceptés
par la personne âgée, attachée à son
autonomie, et préférant la qualité d’une
fin de vie paisible à sa durée.
Une loi sur les droits des
malades et la fin de vie
La crainte d’ « une médecine techni-
que toute-puissante », poussée par
« le techniquement possible au-delà
de l’humainement souhaitable » selon
l’expression du philosophe Jacques
Ricot a été entendue par le législateur.
La « loi relative aux droits des ma lades
et à la fin de vie », adoptée en 2005, a
renforcé le respect de l’autonomie des
personnes malades en asservissant
toute décision thérapeutique au consen -
tement de personnes conscientes
ou à la confrontation d’une décision
collégiale.
Cette loi énonce clairement l’interdic-
tion de toute obstination thérapeuti-
que déraisonnable et autorise le méde-
cin à mettre fin ou à ne pas entreprendre
un traitement jugé dispro portionné
pour son patient.
Les droits des malades sont protégés
par l’obligation du consentement chez
les personnes conscientes ou par le
respect des directives anticipées si
elles ont été rédigées ou la consulta-
tion de la personne de confiance dé-
signée par le patient pour exprimer sa
volonté le jour où ce dernier ne serait
plus en mesure de le faire ;
En l’absence d’une expression claire de
la volonté du patient, le choix thérapeu-
tique se fonde sur une décision collé-
Progrès des techniques de suppléance
et vieillissement des insuffisants rénaux :
ESPOIRS ET RÉTICENCES
DDRR CCAATTHHEERRIINNEE
DDUUPPRRÉÉ--GGOOUUDDAABBLLEE
Néphrologue spécialiste de
l'insuffisance rénale chronique,
exerce ses fonctions de
médecin hospitalier au CHU de
Toulouse. Elle est membre de la
Société française de
néphrologie, dont elle préside la
Commission éthique, et a
participé aux travaux du Comité
national de suivi du développe-
ment des soins palliatifs et de
l’accompagnement présidé par
Régis Aubry.
octobre 2008 - Reins-Échos n°5
///
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
1
/
60
100%