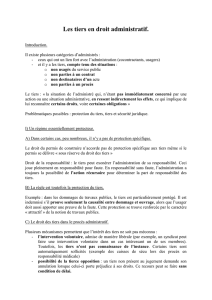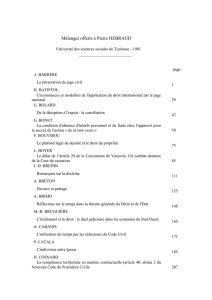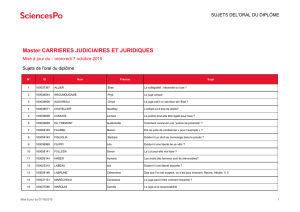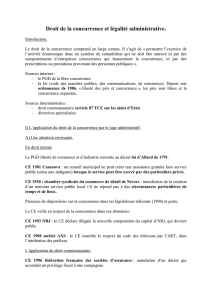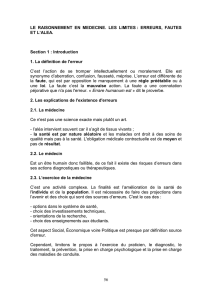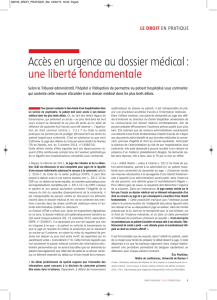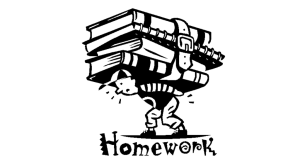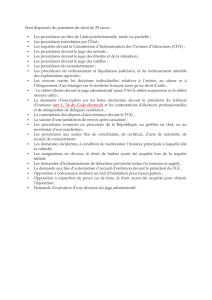LES DROITS DU PATIENT `

Avec Jean-Marie CLEMENT
Directeur Pédagogique de l’Association pour la Promotion du Droit Hospitalier
de I’Economie de la Santé (APDHES)
Professeur de Droit Hospitalier et Médical à Paris VIII
Conférence prononcée à l’occasion de
la
@me journée infirmière de Vendée, le 12 mars 1998, organisée par
le Centre Hospitalier Départemental de LA ROCHE SUR YON (Vendée)
LES DROITS DU PATIENT ’
Mots-clés : Droits
-
patients
-
hospitalisé
-
respect
-
responsabilité hospitalière.
La notion de patient recouvre celle du malade en ce
que la personne qui consulte n’est pas obligatoirement
atteinte par une maladie. Le fait de visiter un médecin
n’est pas exclusivement pour des raisons de maladie,
puisque d’abord le diagnostic n’est pas assuré et
ensuite parce que l’on peut recourir à un médecin pour
des raisons diverses qui n’ont rien à voir avec une
maladie, comme par exemple l’interruption de gros-
sesse, la chirurgie réparatrice ou reconstructive et plus
généralement à titre préventif pour quelques raisons
que ce soit.
Jusqu’à la fameuse loi du 21 décembre 1941, l’hôpital
était réservé aux pauvres ; ce n’est qu’avec les progrès
médicaux significatifs à compter du milieu du
XIXe
siècle et surtout avec l’avènement d’une véritable
protection sociale avec la loi du 5 avril 1928 sur les
assurances sociales, que l’hôpital s’ouvre aux malades
payant par tiers que sont les caisses d’assurance sociale
voire sur leurs propres deniers. Ces derniers, pour les
distinguer des autres, étaient appelés les «grands
payants
»
jusqu’en 1941.
La généralisation de la protection sociale avec la créa-
tion de la sécurité sociale par l’ordonnance du
4 octobre 1946 scelle définitivement l’ouverture de
l’hôpital à toutes les couches sociales de la société.
Dès lors, l’appréhension des relations entre patients et
soignants à l’hôpital va changer car si les pauvres
devaient se contenter d’être accueillis, les payants vont
exiger des égards. Que l’on ne s’y méprenne pas, les
pauvres étaient selon les principes chrétiens qui gou-
vernaient les hôpitaux, l’objet de toutes les attentions
puisqu’ils représentaient la rédemption, mais il est évi-
dent qu’entre ces principes et la réalité il y avait des
écarts sur lesquels il n’est point besoin d’épiloguer. Les
payants ne vont pas revendiquer des égards, mais vont
1 Droits des malades et bioéthique
-
Jean-Marie CLEMENT
Berger-
Levrault 1996
les exiger au nom du respect de la personne, sujet de
droits et non objet de droits. Qn assiste à une modifica-
tion radicale du droit des patients, ce n’est plus le droit
octroyé c’est le droit reconnu, il n’est pas octroyé par
les soignants, il est reconnu par ceux-ci comme un
droit consubstantiel à la personne soignée. Cette
reconnaissance ne va pas se faire extemporanément.
On assiste à une lente émergence des droits des
patients de 1941 à 1991, puis à partir de cette date la
loi va mettre en exergue le droit des patients comme
un levier de changement des pratiques professionnelles
hospitalières.
1
-
LA RECONNAISSANCE DU DROIT DES
PATIENTS
L’ouverture de l’hôpital à toutes les catégories sociales
fut un droit avant d’être un fait car si la loi est promul-
guée le 21 décembre 1941, les conditions d’hospitali-
sation, marquées par une profonde promiscuité
-
les
salles étaient communes à
30
voire 40 malades
-
et
une grande vétusté, interdisaient aux classes moyennes
et a fortiori supérieures d’être hospitalisées à l’hôpital
public. A cela s’ajoutaient les dispositions de réception
des patients qui dataient de l’assistance aux pauvres.
Or, les progrès médicaux commençaient à rénover les
soins hospitaliers et, à compter des années 1950, il
n’était plus justifié de considérer l’entrée à l’hôpital
comme celle de l’antichambre de la mort. En outre, à
compter du début de la décennie 1960, l’introduction
de la médecine plein temps obligatoire pour les méde-
cins enseignant dans les facultés de médecine et
encouragée pour les praticiens des centres hospitaliers
non universitaires, renforce l’image nouvelle de I’hôpi-
tal comme un centre de soins performant pouvant riva-
liser avec les meilleures cliniques privées. C’est dans
4
Recherche en soins infirmiers
N”
55
-
Décembre 1998

ENCONTRE
LES DROITS DU PATIENT
ces circonstances que l’opinion exigeat une humanisa-
tion tant des locaux d’hospitalisation que des relations
entre soignés et soignants. Le mouvement aboutit à la
publication du fameux décret du 14 janvier 1974 qui
fixe les droits des malades tant pour les droits élémen-
taires qui sont confirmés, que pour l’accession des
droits nouveaux qui sont ceux jusqu’alors réservés aux
consommateurs extra-hospitaliers. Cela souffre de
quelques exceptions dues aux incapacités ou aux situa-
tions médicales des patients. Mais dans tous les cas, le
juge va intervenir plus vigoureusement à la requête des
patients qui ainsi, par une jurisprudence nouvelle, fixe
les contours de la protection juridique de la personne
hospitalisée.
1
.l
-
La confirmation des droits élémentaires
Le patient hospitalisé n’a pas un statut inférieur dès
qu’il franchit l’enceinte hospitalière, il reste une per-
sonne et, à ce titre, il continue à bénéficier des droits
élémentaires qui sont ceux de se déplacer librement,
d’avoir son intimité préservée et de pouvoir continuer
à exercer sa liberté de penser. Comme tous les prin-
cipes, ceux-ci souffrent de quelques exceptions qui
concernent les hospitalisés sous contrainte et les
mineurs.
1.1.1
-
LES PRINCIPES
-
L’hospitalisé est libre d’aller et venir certes dans
les limites de son état médical. Cela ne peut
remettre en cause quoi qu’il arrive, sa liberté de
quitter l’hôpital malgré la contre
-
indication
médicale. II devra cependant signer sa volonté de
départ ou en tout état de cause la manifester libre-
ment devant les soignants qui attesteront par écrit
ce fait. Sauf cas exceptionnels que nous examine-
rons ci-dessous, on ne peut hospitaliser et retenir
contre son gré une personne à l’hôpital.
-
L’intimité est un droit élémentaire qui protège tout
être humain et cela se traduit à l’hôpital par la
reconnaissance du caractère privatif de la
chambre d’hospitalisation lorsqu’elle est indivi-
duelle (arrêt de la cour d’appel de Paris, Chantal
Nobel, 1986). Ce droit est préservé par le secret
professionnel qui s’impose à tous les personnels
et pas seulement aux médecins, même si pour
ceux-ci le secret médical est fondamental pour
préserver la franchise des relations entre patients
et praticiens
-
ce principe vient d’être rappelé
avec éclat à propos de la condamnation du
médecin d’un ancien président de la République
qui a révélé après la mort de celui-ci la nature des
maux dont il souffrait (CA de Paris, Dr Gubler
1997).
-
L’intimité ne se limite pas à la confidentialité des
bilans médicaux, car elle embrasse l’ensemble
de la vie du patient et tout soignant doit être
convaincu que sa discrétion dans les gestes quo-
tidiens afférents aux soins est la reconnaissance
de l’être unique qui, malade, est obligé de s’en
remettre à des tiers pour vaincre sa maladie.
-
La liberté de penser ne s’arrête pas aux portes de
l’hôpital et pour cela l’administration hospitalière
ne doit pas privilégier une pensée plutôt qu’une
autre. C’est ainsi que tout signe religieux ou iden-
tifiant une pensée politique ou philosophique
voire syndicale est interdit en présence des
malades. Ces derniers pour exercer librement leur
liberté de penser doivent pouvoir disposer des
moyens de son exercice, c’est-à-dire des moyens
d’information (presse écrite et parlée, télévisuelle)
qu’ils pourront se procurer à titre payant, de
même des moyens de communication (téléphone,
télécopie) et enfin du droit de réception.
Ces droits élémentaires s’avèrent de mieux en mieux
respectés et les difficultés n’apparaissent que lorsqu’il y
a une contradiction entre l’état médical du patient et
l’exigence de ces droits. Cette contradiction est fla-
grante dans le cas des incapables majeurs et des
mineurs.
1.1.2
-
LES EXCEPTIONS
-
Les hospitalisés sous contrainte, que ce soit d’of-
fice ou à la demande d’un tiers qui relèvent des
dispositions de la loi du 27 juin 1990, ne peuvent
bénéficier pleinement des droits élémentaires
exposés ci-dessus. II reste cependant que si leurs
mouvements sont contenus dans les limites fixées
par le médecin, le secret de leurs correspon-
dances ne peut être transgressé, comme l’a rap-
pelé très clairement la cour européenne des droits
de I’Homme dans un arrêt désormais célèbre :
Herczegfalvy/Autriche, 24 septembre 1992, req.
no
48~~991/300/371.
-
Les mineurs ne peuvent bénéficier de la liberté de
mouvement et leur intimité est amoindrie par
l’obligation de surveillance qui incombe à
l’hôpital.
5
Recherche en soins infirmiers
N”
55
-
Décembre 1998

1.2
-
l’accession aux droits du consommateur
Le consommateur a des exigences qu’un usager du ser-
vice public s’interdit de revendiquer. Le consomma-
teur, fort de l’argent qu’il dépense pour accéder aux
prestations sollicitées, est plus acerbe dans ses critiques
et plus déterminé dans ses demandes de réparation
lorsque le service s’est avéré de mauvaise qualité.
Le patient est devenu un véritable consommateur de
soins tout au moins si l’on considère les exigences de
consentement, d’informations et de qualité des soins.
-
Le consentement est devenu un credo dans la
revendication des patients. II est vrai que pour
optimiser le bénéfice de la thérapie, il faut en
général que le malade y adhère pleinement. Or,
comment peut-on adhérer à un protocole de soins
si le thérapeute ne divulgue pas la nature de la
pathologie? Le code de déontologie impose aux
médecins le consentement du patient puisque
l’article 36 dudit code (décret du 6 septembre
1995) précise que
«
le consentement de la per-
sonne examinée ou soignée doit être recherché
dans tous les cas
».
Or, on ne peut consentir sans être informé, ce qui est
une revendication constante des patients vis-à-vis de
leur médecin.
-
L’accès aux informations médicales est une diffi-
culté pour le patient qui pourtant bénéficie des
dispositions en ce sens de la loi hospitalière du
31
juillet 1991 et de ses décrets d’application. Le
malade a accès à son dossier médical par I’inter-
médiaire d’un médecin qu’il aura préalablement
désigné pour recevoir les informations contenues
dans ce dossier. La difficulté réside dans la nature
des informations divulguées et leur contenu, en
d’autres termes, faut-il que tout le dossier soit
transmis, une partie de celui-ci ou une synthèse,
ce qui est encore différent. Aux termes de l’article
L 145-8 du Code de la Santé Publique issu du
I
de l’article 77 de la loi du 18 janvier 1994 :
«
Dans le respect des règles déontologiques appli-
cables, les chirurgiens-dentistes, les
sages-
femmes, les médecins et les établissements de
santé publics et privés communiquent au méde-
cin (choisi par le malade) une copie ou une syn-
thèse des informations médicales qu’ils détien-
nent concernant le patient et qu’ils estiment utile
d’insérer dans le dossier de suivi médical ». Les
malades doivent être informés directement par
leur médecin avant et après la thérapie et une
décision de la cour de cassation (25 février 1997)
a imposé que le médecin fasse la preuve de cette
information qu’une décision de la même cour du
14 octobre 1997 a quelque peu atténuée en ajou-
tant que la preuve de l’information par le méde-
cin peut être apportée par tout moyen (ce qui
exclut les seuls documents écrits et réhabilite le
colloque singulier basé sur l’oralité).
-
La qualité des soins ne manque pas d’être au
centre des recours exercés par les patients tant à
l’encontre des médecins que de leurs consultants
(infirmiers(ères),
kinésithérapeutes, etc.). La loi
exige cette qualité qui se traduit par l’évaluation
de tout acte médical depuis la loi du 31 juillet
1991 et par l’accréditation imposée à tout établis-
sement de santé par l’ordonnance hospitalière du
24 avril 1996. La qualité des soins est passée du
strict minimum qui est l’obligation de moyens à
une exigence de résultats dans les cas patholo-
giques les mieux maîtrisés lorsque les échecs
s’avèrent patents. Certes, cette obligation de
résultats ne concerne pour l’instant que des cas
peu nombreux, mais le fait qu’elle puisse être
reconnue par le juge démontre l’évolution consi-
dérable des mentalités. Cette évolution de la juris-
prudence marque l’avènement d’un droit des
patients en tant que consommateurs de soins dans
le sens où un consommateur a plus de droits
qu’un simple bénéficiaire de prestations. Peu à
peu la notion d’usager du service public s’es-
tompe au profit de la notion de client d’un éta-
blissement de soins. Cela participe à une mise en
exergue du droit des patients.
II
-
LA MISE EN EXERGUE DES
DROITS DU PATIENT
La reconnaissance des droits du patient vient de chan-
ger de nature car elle n’est plus acceptée, mais elle est
imposée par le législateur. Celui-ci semble même
parier sur l’intervention des malades ou de leurs repré-
sentants pour faire évoluer les institutions hospitalières.
Le patient n’est plus supporté, il est espéré comme
levier de changement dans des institutions fortement
empreintes de l’immobilisme que leur confère un cor-
poratisme très présent. A un usager quelque peu passif
du service public hospitalier fait de plus en plus place
un client revendicatif et qui plus est participatif. On
constate que le service public incapable de se transfor-
mer, alors que les techniques n’ont cessé d’accroître les
6
Recherche en soins infirmiers
N”
55
-
Décembre 1998

contradictions entre son fonctionnement et les exi-
gences de nouveaux modes de gestion, en appelle aux
patients pour entreprendre les modifications organisa-
tionnelles des structures. Cette intrusion de l’usager en
tant que tel est révélatrice d’une organisation en perte
de sens. Depuis la loi du 21 décembre 1941,
I’Etat
après avoir pris le parti d’intervenir directement dans
le fonctionnement des hôpitaux avec la création d’une
autorité directoriale qu’il nomme et peut sanctionner,
entraînant en contrepartie l’effacement des pouvoirs du
président du Conseil
d’Administration,
favorise
I’inter-
vention
directe des patients en mettant en exergue
leurs droits dans diverses instances. Cette évolution
complète ou accompagne une transformation des juge-
ments administratifs car l’on constate que le juge admi-
nistratif s’aligne sur le juge judiciaire et devient plus
longanime que celui-ci quant à la mise en cause de la
responsabilité médicale.
2.1
-
l’intervention des patients dans les instances
Lorsqu’en 1945 s’est posée l’homologation de la loi
vichyste
du 21 décembre 1941, les pouvoirs publics
ont installé dans la commission administrative des
hôpitaux des représentants de la sécurité sociale qui
venait d’être créée au nom de la représentation des
usagers. Depuis cette date, les différentes réformes hos-
pitalières ont augmenté la représentation des caisses de
sécurité sociale dans l’instance délibérante qui s’est
dénommée Conseil
d’Administration
depuis la loi du
31 décembre 1970.
L’ordonnance hospitalière du 24 avril 1996 a supprimé
les représentants de la sécurité sociale dans les
Conseils
d’Administration
des établissements publics
de santé et lui a substitué une représentation à part
entière des usagers. On est passé d’une représentation
indirecte par représentants des caisses de sécurité
sociale à une représentation directe des usagers.
Désormais, l’ordonnance du 24 avril 1996 accroît
considérablement l’intervention des patients dans les
différentes instances de l’hôpital.
-
Deux représentants des usagers sont désormais
membres du Conseil
d’Administration
des diffé-
rents établissements publics de santé. Ils représen-
tent un faible pourcentage des administrateurs
mais leur présence effective indique que les pou-
voirs publics comptent sur eux pour faire évoluer
les structures hospitalières. Ces usagers sont dési-
gnés par le préfet de département qui les choisit
sur une liste d’association de consommateurs
parmi les plus autorisées à intervenir dans le
LES DROITS DU PATIENT
domaine hospitalier. Le directeur de I’ARH
nomme ces usagers, entérinant ainsi le choix du
préfet. A ces usagers s’ajoute un représentant des
familles de patients en hospitalisation de long
séjour qui depuis la loi du 31 juillet 1991 a une
voix consultative dans le Conseil d’administration
de l’établissement.
-
L’ordonnance du 24 avril 1996 crée une nouvelle
instance, la commission de conciliation, qui doit
recueillir toutes les doléances des malades ou de
leur famille. Cette commission, qui pour l’heure
n’a pas d’existence puisque le décret d’applica-
tion n’a pas été publié, devrait être composée des
représentants des usagers au Conseil d’Adminis-
tration auxquels s’adjoindraient le directeur de
l’établissement, le président de la Commission
Médicale
d’Etablissement
et le directeur du ser-
vice des soins infirmiers. La commission devrait
connaître les litiges entre les malades et I’établis-
sement afin de permettre une conciliation évitant
ainsi un contentieux long et aléatoire pour les
parties.
-
Enfin, l’ordonnance du 24 avril 1996 prévoit que
l’accréditation obligatoire de chaque établisse-
ment de santé devrait largement reposer sur les
enquêtes de satisfaction effectuées auprès des
malades. Ces enquêtes organisées par des orga-
nismes totalement indépendants devraient per-
mettre de mieux connaître les avis des malades
sur les qualités hôtelières et médicales des établis-
sements qui les ont accueillis.
2.2
-
L’alignement du juge administratif sur le juge
judiciaire
*
Le juge judiciaire a très vite reconnu la responsabilité
du médecin ou de la clinique, selon qu’il s’agissait
d’un acte médical ou d’un acte non-médical, vis-à-vis
du patient. On cite souvent l’arrêt de la cour de cas-
sation de 1835 (affaire Thouret-Noroy) où le procu-
reur général Dupin concluait : «Pourquoi donc les
médecins et les chirurgiens seraient-ils seuls exempts
de cette responsabilité naturelle qui pèse à la fois sur
toutes les fonctions publiques et sur toutes les profes-
sions
?
». Dans ce cas pour la première fois, un méde-
cin allait être condamné sur le fondement de la res-
ponsabilité délictuelle. Ce n’est qu’en 1936 que le
juge judiciaire reconnaît en droit privé le caractère
2
L’évolution de la responsabilité médicale en secteurs hospitaliers
publics et privés
-
Cyril CLEMENT thèse Paris 8
-
1997.
7
Recherche en soins infirmiers
N”
55
-
Décembre 1998

contractuel de l’acte médical. La faute est depuis lors
constamment sanctionnée par le juge sans que celui-
ci s’interroge sur le degré de gravité de celle-ci,
contrairement au juge administratif qui distingue une
faute lourde pour sanctionner l’hôpital dans le cas
d’un acte médical. On constate alors une différence
de traitement selon le juge, le juge judiciaire duquel
relève le contentieux entre les malades et les méde-
cins ou les cliniques privées et le juge administratif
auquel échoit le contentieux entre les malades et les
hôpitaux et leurs médecins. Or depuis 1990, le juge
administratif a abandonné la notion de faute lourde et
a été au-delà des jugements civils puisqu’il condamne
en outre pour une absence de faute lorsque le risque
est avéré.
-
C’est avec le jugement du CE Dame V. du 10 avril
1992 que les juges du Palais Royal abandonnent
la notion de faute grave pour lui substituer celle
de faute tout simplement, sans qualification. II
faut tout de même préciser que la faute doit revê-
tir une certaine gravité pour être reconnue et sur-
tout indemnisée. Dès lors, le juge administratif
s’aligne sur le juge judiciaire qui est cependant
dépassé avec la mise en œuvre du concept de
responsabilité sans faute.
-
La notion de responsabilité sans faute est appa-
rue avec l’arrêt de la CAA de Lyon
-
Cornez du
21 décembre 1990
-
auquel le CE a apporté une
consécration avec l’arrêt Bianchi du 9 avril 1993.
Dans l’arrêt Cornez, les juges condamnent les
Hospices Civils de Lyon pour
«
l’utilisation d’une
thérapeutique nouvelle entraînant un risque spé-
cial pour le malade alors qu’une telle thérapeu-
tique ne s’imposait pas pour des raisons vitales
».
Dans l’espèce Bianchi, le Conseil
d’Etat
admet la
responsabilité hospitalière sans faute pour les
actes médicaux dont les risques sont connus
mais dont la réalisation est exceptionnelle. C’est
au nom de la jurisprudence Bianchi que la CAA
de Lyon a dans un arrêt
-
Hôpital Joseph Imbert
d’Arles du 30 septembre 1993
-
condamné le
centre hospitalier parce que : «lorsqu’un acte
médical nécessaire au diagnostic ou au traite-
ment du malade présente un risque dont
I’exis-
tente est connue mais dont la réalisation est
exceptionnelle et dont aucune raison ne permet
de penser que le patient y soit particulièrement
exposé, la responsabilité du service public hos-
pitalier est engagée si l’exécution de cet acte est
la cause directe de dommages sans rapport avec
l’état initial du patient comme avec l’évolution
prévisible de cet état, et présentant un caractère
d’extrême gravité.
»
Le juge administratif après avoir été longtemps le pro-
tecteur parfois abusif de l’administration n’est-il pas en
train de basculer dans l’excès en protégeant les patients
pour des risques qui, certes pour l’instant d’extrême
gravité, pourront dans l’avenir être beaucoup plus dis-
cutables, ne serait-ce que parce que la médecine pré-
sente un risque que nul ne peut méconnaître
!...
CONCLUSION
II est devenu naturel de disserter sur le droit des
patients, or voici seulement quarante ans, il n’était
guère imaginable que le malade puisse être identifié
comme une personne pouvant bénéficier de tous les
privilèges juridiques y afférents. L’évolution du droit
des patients a permis fort heureusement de passer du
malade objet de droits au malade sujet de droits. Nous
ne pourrons que nous réjouir de ce changement, mais
il ne faudrait pas que cela entraîne un juridisme exces-
sif dans les relations entre patients et médecins. Si les
praticiens sont dans la hantise du procès que risque de
leur intenter le malade, on va voir apparaître une
médecine sans risque, c’est-à-dire stagnante dans ses
recherches. Cela se fera au détriment des malades. Là
encore, il faudra rechercher et trouver le juste milieu,
équilibre entre les droits du patient et la liberté théra-
peutique du médecin.
8
Recherche en soins infirmiers N” 55
-
Décembre 1998
1
/
5
100%