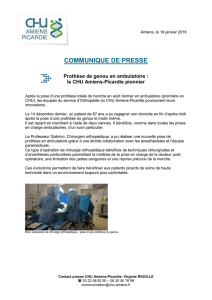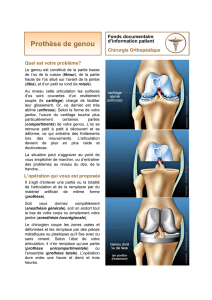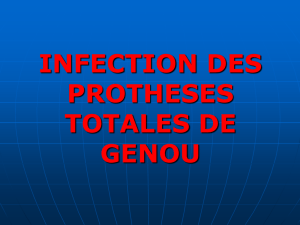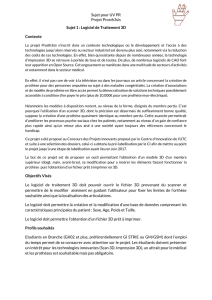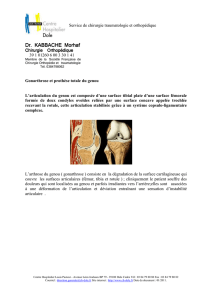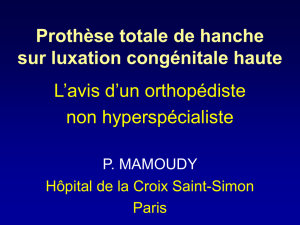Douleurs après la pose d`une pro- thèse de genou: que faire et

HIGHLIGHTS 2016 1110
Orthopédie
Douleurs après la pose d’une pro-
thèse de genou: que faire et quand?
PD Dr méd. Michael T. Hirschmann
Klinik für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Kantonsspital Baselland (Bruderholz, Liestal, Laufen), Bruderholz
Les implantations de prothèses de genou sont considérées comme des opérations
ecaces, ce qui est à la fois dû aux progrès accomplis au niveau des matériaux
utilisés et aux avancées des techniques chirurgicales. Malgré cela, env. –% des
patients ne sont pas satisfaits du résultat en raison de douleurs, d’une instabilité ou
d’une limitation des mouvements et doivent donc faire l’objet d’un diagnostic
fastidieux et d’une prise en charge interdisciplinaire.
Introduction
L’implantation d’une prothèse de genou est considérée
comme une opération très ecace pour le traitement
d’une gonarthrose pour laquelle toutes les possibilités
de traitement conservateur ont été épuisées []. Après
l’opération, la plupart des patients sont satisfaits du ré-
sultat et exempts de douleurs. Au cours des dernières
années, les taux de survie des prothèses à ans se sont
nettement améliorés, s’élevant à –%, notamment
en raison des progrès accomplis au niveau des prothèses
et matériaux utilisés, des avancées dans les techniques
chirurgicales et d’une meilleure compréhension de la
mécanique complexe du genou [].
On pourrait ainsi penser que tout va pour le mieux,
mais en y regardant de plus près, –% de tous les
patients sont malgré tout insatisfaits du résultat après
la pose d’une prothèse de genou []. Ces patients se
plaignent entre autres de douleurs, d’un sentiment
d’insécurité (instabilité) ou d’une limitation de la mo-
bilité (exion et/ou extension) de l’articulation du
genou []. Une hyperthermie et un gonement de l’arti-
culation du genou sont aussi fréquemment rapportés
[]. Les attentes croissantes et le souhait du patient de
pouvoir à nouveau pratiquer certaines activités spor-
tives après l’opération peuvent également contribuer à
l’insatisfaction vis-à-vis du résultat de l’opération [].
Les patients sourant de douleurs après la pose d’une
prothèse du genou requièrent un diagnostic clinique et
radiologique très fastidieux []. Un examen clinique
succinct et une brève inspection du cliché de radiogra-
phie conventionnelle s’avèrent souvent insusants.
Dès lors, les patients qui ressentent encore des douleurs
après la pose d’une prothèse de genou devraient, dans
le cas idéal, être pris en charge dans un centre qui s’est
spécialisé dans l’évaluation et le traitement de tels
patients []. L’évaluation de ces patients implique un
investissement élevé en personnel et en ressources
nancières qui, à l’ère des DRG, peut être mutualisé
an d’atteindre le meilleur résultat possible pour les
patients et les organismes payeurs.
Il est en outre essentiel d’obtenir une coopération
étroite entre le patient, le médecin de famille, le phy-
siothérapeute et l’orthopédiste spécialisé dans le trai-
tement des patients insatisfaits après la pose d’une
prothèse de genou []. L’objectif principal est de trouver
la/les cause(s) des symptômes du patient, puis de la/les
traiter de manière optimale []. A moins que le patient
s’y oppose, il convient en règle générale de tenter acti-
vement de prendre contact avec l’opérateur précédent
an, d’une part, de mieux comprendre les problèmes,
les conditions de vie et le caractère du patient et, d’autre
part, de discuter ensemble du contexte particulier du
patient sur le plan technique [].
Notre propre expérience nous a montré qu’il est déter-
minant pour le patient qu’il ne s’entête pas à surmonter
son passé, autrement dit l’échec de sa précédente opé-
ration, mais qu’il s’emploie de toutes ses forces à l’amé-
lioration de la situation actuelle.
Diagnostic: le «concept du puzzle»
En règle générale, les douleurs persistantes ou récur-
rentes après la pose d’une prothèse de genou ne sont
pas dues à une cause unique, mais à une combinaison
de plusieurs causes [].
Michael T. Hirschmann
SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2016;16(51–52):1110–1112

HIGHLIGHTS 2016 1111
La démarche diagnostique consiste à assembler un
puzzle à partir de diérentes pièces diagnostiques [].
C’est uniquement lorsque les diérentes pièces s’im-
briquent et forment une image cohérente qu’il est pos-
sible de savoir avec une certitude susamment élevée
que le patient protera d’une opération additionnelle
[]. La sourance du patient joue également un rôle
déterminant dans cette évaluation des risques [].
Les quatre grands piliers du diagnostic sont:
. anamnèse standardisée circonstanciée au moyen
d’un questionnaire d’évaluation spécialisé;
. examen clinique détaillé;
. analyses de laboratoire, y compris bactériologie et
histologie;
. examens de radiologie-médecine nucléaire.
Le schéma diagnostique de base est présenté dans la
gure []. Les autres algorithmes diagnostiques plus
spéciques peuvent être téléchargés à partir de notre
site internet [].
Le recueil de l’anamnèse et des antécédents du patient
se fait au moyen d’un questionnaire standardisé [].
Celui-ci est conçu de telle manière que les questions
permettent de rechercher des modes de présentation
typiques de certaines pathologies []. Ces modes de pré-
sentation sont ensuite mis en relation avec les résul-
tats de l’examen clinique et de l’examen radiologique
et évalués selon le principe clé-serrure [].
Qu’est-ce qu’une prothèse de genou
correctement positionnée?
La prothèse de genou peut être positionnée selon six
degrés de liberté, en distinguant pour le fémur et le
tibia une orientation en exion-extension, en varus-
valgus et en rotation interne-rotation externe []. En
outre, une translation en direction médiale-latérale,
antérieure-postérieure et proximale-distale est pos-
sible []. En règle générale, il existe des recommanda-
tions plus ou moins claires quant au positionnement
et à l’orientation de la prothèse de genou []. Malgré tout,
nous rencontrons toujours, d’une part, des patients
dont l’orientation de la prothèse paraît bonne à la
radiographie mais qui sourent de douleurs et, d’autre
part, des patients dont l’orientation de la prothèse
paraît mauvaise à la radiographie mais qui n’ont aucun
symptôme.
A notre avis, cela s’explique par le fait que le position-
nement optimal de la prothèse de genou n’est pas le
même pour tous les patients []. Le positionnement op-
timal dépend fortement de l’anatomie individuelle et
de l’alignement []. Chaque patient possède un espace
propre dans lequel la prothèse peut être orientée et
fonctionne bien pour lui []. Chez certains patients, cet
espace est plus large, tandis que chez d’autres, il s’avère
plus étroit. Ainsi, une rotation interne de ° sera par ex.
Patient avec douleurs/problèmes après pose de prothèse de genou
TEMP/TDM avec détermination de la position de la prothèse à la TDM 3D (si impossible, TEMP et TDM)
Anamnèse détaillée
Appareil
extenseur Infection Instabilité Raideur Autres
Descellement/
usure par
abrasion
Mauvaise posi-
tion/dimension
inappropriée
Problèmes
patello-fémoraux
Problème
de genou
oui non
Radiographie du genou
(clichés sous contrainte
en projection antéro-postérieure,
latéral, rotule, cliché
de la jambe entière)
Examen clinique
Diagnostic différentiel?
Articulation de la hanche?
Colonne vertébrale? Autres?
Diagnostic spécifique supplémentaire
Figure 1: Schéma de base pour le diagnostic des patients avec douleurs après la pose d’une prothèse de genou.
Abréviations: TEMP = tomographie par émission monophotonique, TDM = tomodensitométrie.
SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2016;16(51–52):1110–1112

HIGHLIGHTS 2016 1112
possible chez un patient, alors qu’elle provoquera des
symptômes chez un autre patient [].
Chaque patient possède donc une zone de confort spé-
cique individuelle en termes de positionnement de la
prothèse []. Il est dès lors judicieux de ne pas considérer
les valeurs mesurées d’orientation de la prothèse comme
des valeurs absolues, mais de les mettre en corrélation
avec les symptômes cliniques, l’anamnèse et les résul-
tats d’examen dans l’esprit du «concept du puzzle» [].
Un positionnement non optimal de la prothèse de genou
est uniquement problématique lorsqu’il occasionne
des symptômes correspondants [].
A l’avenir, il convient donc améliorer la planication
avant la pose de la prothèse de genou an de réduire la
problématique inhérente à la prothèse de genou dou-
loureuse. Une possibilité serait de réaliser la plani-
cation en D, et non pas en D comme c’est le cas ac-
tuellement.
Traitement de la prothèse de genou
douloureuse
C’est uniquement lorsque la/les cause(s) des symp-
tômes parvient/parviennent à être correctement iden-
tiée(s) que le traitement consécutif peut apporter une
amélioration pour le patient [].
Les principales composantes du traitement conser-
vateur sont un traitement de la douleur et une physio-
thérapie adaptés au patient []. Face à un problème
mécanique évident ou à une infection, il est le plus
souvent judicieux d’attendre mois avant d’entre-
prendre une nouvelle opération, car une amélioration
des symptômes peut encore être espérée avec un trai-
tement conservateur ciblé []. Cette information doit
aussi clairement être communiquée au patient. De notre
point de vue, une évaluation des troubles fonctionnels
conjointement avec le physiothérapeute devrait faire
partie du bilan standard chez ce groupe de patients
délicat []. Il est surprenant de constater toutes les amé-
liorations qui peuvent encore être obtenues pour le
patient moyennant ce biais-là.
En l’absence d’amélioration des symptômes après
l’épuisement de toutes les options thérapeutiques
conservatrices, l’indication d’une opération de révision
peut à nouveau être évaluée [].
Système de feux de signalisation
Il n’est aujourd’hui plus admissible de pratiquer une
révision en cas de douleurs d’origine indéterminée [].
Seuls les patients avec une cause des symptômes clai-
rement identiée et une amélioration prévisible après
la révision devraient être opérés []. A cet eet, nous
utilisons un système de feux de signalisation, qui classe
les indications de révision en trois catégories (verte,
orange, rouge) [].
La catégorie
«verte»
englobe les patients pour lesquels
le puzzle diagnostique a livré une image claire. Il s’agit
notamment de:
– problèmes clairement mécaniques, comme par ex.
sollicitation excessive du tractus ilio-tibial et ano-
malie de la course rotulienne dans le cadre d’une
instabilité asymétrique à mi-exion dans un com-
posant prothétique fémoral avec une forte rotation
interne;
– infection;
– descellement des composants prothétiques;
– instabilité;
– raideur d’origine mécanique ou liée à une instabilité.
Sont typiquement classés dans la catégorie
«orange»
les patients chez lesquels certaines parties du puzzle
sont facilement reconnaissables tandis que d’autres
parties restent confuses. Il s’agit typiquement de:
– raideur liée à une rotule basse dans le cadre d’une
ligne articulaire déplacée;
– syndrome douloureux régional complexe (SDRC);
– aections neurologiques progressives sous-jacentes.
Les patients de la catégorie
«rouge»
, autrement dit ceux
chez qui une révision chirurgicale n’est pas indiquée,
sont ceux chez lesquels les symptômes et résultats
d’examen ne concordent pas.
Par ailleurs, il existe des facteurs spéciques au pa-
tient, qui peuvent avoir une inuence négative sur le
résultat après la révision et qui doivent dès lors être
pris en compte dans l’évaluation de l’indication []. Il
s’agit par ex. d’attentes trop élevées et irréalistes du pa-
tient, de problèmes psychiques chroniques, de la
dépendance à des médicaments, à des drogues ou à
l’alcool et de tous les facteurs pouvant contribuer à un
manque d’observance et à des problèmes durant la
réhabilitation.
Disclosure statement
L’auteur n’a pas déclaré des obligations nancières ou personnelles
en rapport avec l’article soumis.
Références
Hirschmann MT, Becker R, editors. The unhappy total knee
replacement – a comprehensive review and management guide.
Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer; .
Kniedoktor.ch (site internet). Basel: Diagnostisches
Aklärungsschema für schmerzhae Knieprothesen (mise à jour
sept. ).
Correspondance:
PD Dr méd.
Michael Hirschmann
Teamleiter Kniechirurgie,
Leitender Arzt
Klinik für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates,
Kantonsspital Baselland
CH- Bruderholz
Michael.Hirschmann[at]
unibas.ch
www.kniedoktor.ch
SWISS MEDICAL FORUM – FORUM MÉDICAL SUISSE 2016;16(51–52):1110–1112
1
/
3
100%