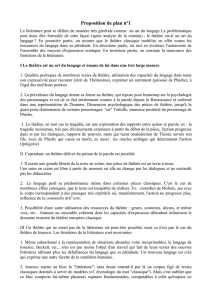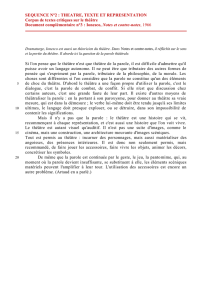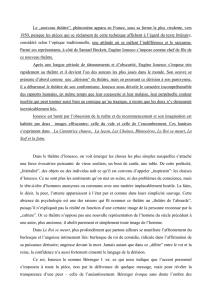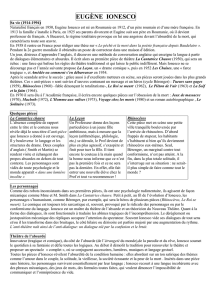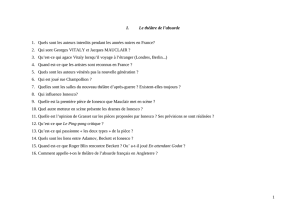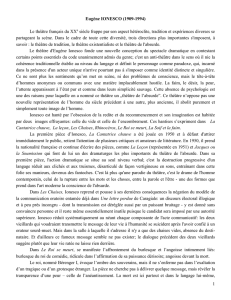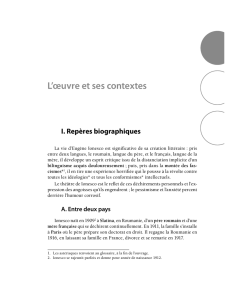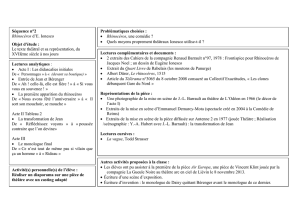Les Chaises - Théâtre de la Tempête

Textes et documents
Les Chaises
de Eugène Ionesco
mise en scène Philippe Adrien
Théâtre de la Tempête
du 15 octobre au 5 novembre 2011

Le « nouveau théâtre »
Dans les années 1950 apparut une série de pièces et d’auteurs en rupture intégrale et brutale avec les
conventions et les traditions théâtrales. Eugène Ionesco (1909-1994), Samuel Beckett (1906-1989), Arthur
Adamov (1908-1970), Fernando Arrabal (né en 1932), Romain Weingarten (né en 1926), écrivains de
langue française et d’origine étrangère - auprès desquels se rangent en désordre, et pour s’en tenir aux plus
connus parmi les auteurs français, Jean Genet (1910-1986), Boris Vian (1920-1959), Jean Vauthier (1910-
1992), Jean Tardieu (1903-1995), Jacques Audiberti (1899-1965), René de Obaldia (né en 1918), Roland
Dubillard (né en 1923), François Billetdoux (né en 1927), Georges Schéhadé (1910-1989), Robert Pinget
(1919-1997), Marguerite Duras (1914-1995) -, tous ces écrivains, fort originaux et différents de style autant
que d’esprit, ne constituent aucunement une « école ». Ils ont seulement en commun le fait d’appartenir à
« l’avant-garde », une catégorie naturellement relative à une époque, à un état de la société, de l’art et de
la pensée, que Ionesco définissait
« en termes d’opposition et de rupture », comme un esprit de protestation et d’insurrection contre tous les
conformismes, hérités ou imposés, esthétiques et idéologiques : L’avant-garde, affirmait-il en conclusion de
son discours d’inauguration des Entretiens de Helsinski sur le théâtre d’avant-garde en 1959, c’est la liberté.
Ionesco (Notes et Contre-notes)
L’ anti-théâtre
Le nouveau théâtre est d’abord un anti-théâtre, agressif et provocant, se posant en s’opposant notamment
à toutes les normes et les formes en vigueur à son époque : Anti-thématique, anti-idéologique, anti-réaliste-
socialiste, anti-philosophique, anti-psychologique de boulevard, anti-bourgeois, redécouverte d’un nouveau théâtre
libre. Ionesco, Notes et Contre-Notes. Au moment où le public se plaît aux pièces imprégnées de politique et
de philosophie, quand les œuvres et les théories de Brecht sont portées au pinacle et érigées en dogmes
incontestables, Ionesco s’en prend vigoureusement à Brecht et aux brechtiens, qu’il qualifie de « terroristes
», et fait le procès d’un « théâtre d’édification et d’éducation politique », où il ne reconnaît qu’un « théâtre
de patronage », également infidèle à la fonction du théâtre et à l’intégrité des idées qu’il prétend diffuser :
Le théâtre n’est pas le langage des idées. Quand il veut se faire le véhicule des idéologies, il ne peut être que leur
vulgarisateur. Un théâtre idéologique est insuffisamment philosophique. Ionesco
Plus radicalement encore, Ionesco conteste et prétend écarter non seulement, comme Artaud, la littérature
et la psychologie, mais jusqu’aux éléments jusqu’alors tenus pour constitutifs du théâtre : intrigue,
action, situation, identification des personnages et de leurs motivations. Ainsi La Cantatrice chauve, sa
première pièce, est non seulement dénuée de caractères et d’action, mais dépourvue de sujet même et de
signification, sinon cette absence et cette nullité de sens. C’était, écrivait l’auteur dans ses Notes et Contre-
Notes, un essai de « fonctionnement à vide du mécanisme du théâtre », un échantillon de « théâtre abstrait
ou non figuratif », sans référence au réel ni contenu psychologique ou moral. A l’issue de ce processus
de dépouillement, Ionesco concevait l’idéal d’un « drame pur », d’un « dramatisme » analogue à ce qu’est
en peinture un art non figuratif. Le théâtre, expliquait-il dans Victimes du devoir, sur un ton mi-ironique et
mi-sérieux n’a jamais été que réaliste et policier, constitué d’un fait divers et d’une énigme à résoudre. Le
théâtre classique est lui-même un théâtre policier distingué. Au théâtre actuel, prisonnier de ses vieilles
formes et qui n’est pas allé au-delà de la psychologie de Paul Bourget il opposait donc la conception d’un
théâtre irrationaliste et non aristotélicien, affranchi du principe de l’identité et de la causalité comme de
l’unité des caractères.
Au-delà des conventions proprement dramatiques, en effet, ce sont alors toutes les lois de la logique et
les notions de vraisemblance et de rationalité qui sont ébranlées, défiées et rejetées par une dramaturgie
qui s’inspire ouvertement de l’univers du rêve, de l’insolite et de l’absurde. Ionesco dans Le Piéton de l’air,
Adamov dans Le Professeur Taranne ou La Grande et la Petite Manœuvre, ont porté des songes à la scène.
La reconnaissance des époux dans La Cantatrice chauve et l’assassinat de quarante élèves en un jour par le
professeur de La Leçon de Ionesco, l’abandon des parents dans les poubelles de Fin de partie et l’enlisement
de Winnie dans Oh! les beaux jours de Beckett sont pour le moins peu conformes aux faits habituels. La
croissance ininterrompue du cadavre enfermé dans l’appartement d’Amédée ou Comment s’en débarrasser, la
transformation des ronds-de-cuir de Rhinocéros en pachydermes et la dégradation accélérée du royaume
et du souverain dans Le Roi se meurt de Ionesco sont une parodie de fantastique. Sont ici bannis et bafoués
non seulement tout souci de réalisme et de vraisemblance, mais aussi tout respect de la logique et de la
rationalité. Ignorant et répudiant superbement les données de l’expérience et les fondements de la raison,
ce théâtre est ouvert sans limites à toutes les fantaisies d’une imagination de l’absurde.
Le nouveau théâtre apparaît alors souvent comme une parodie du théâtre. Ionesco le signifiait clairement
en recourant, pour qualifier ses pièces, à des catégories contradictoires : La Cantatrice chauve est une
« anti-pièce », La Leçon, un « drame comique », Les Chaises une « farce tragique » et Jacques ou la
Soumission un « pseudo-drame ». Macbett, par son titre et sa teneur, est une référence ironique au Macbeth
de Shakespeare. Mais cet anti-théâtre, affirmait Ionesco, était encore et toujours du théâtre. La dérision
du théâtre est paradoxalement l’un des aliments et des ferments du nouveau théâtre.
La crise du langage
Comme les personnages et l’action, le langage est l’objet d’une subversion dévastatrice. La parole est
minée de l’intérieur par une abondance incontrôlée. « Nous sommes intarissables »
avouent les clochards d’En attendant Godot, prêts à dire « n’importe quoi » pour soutenir un semblant de
conversation. Le cours délirant du professeur de La Leçon, la tirade inaboutie de Lucky dans En attendant
Godot, sont le déferlement d’un flux verbal sans mesure et sans fin. Quand « le verbe est devenu verbiage »,
écrivait Ionesco dans son Journal en miettes, « le mot use la pensée. Il la détériore ». La logorrhée discrédite
et détruit le langage.
Un théâtre de la dérision
Le nouveau théâtre offre en effet de la condition humaine une image affligeante. Les clochards d’En
attendant Godot sont le symbole achevé d’une existence insignifiante où, selon le premier mot de la pièce,
il n’y a « rien à faire », où l’on expie sans fin et sans raison le péché d’« être né », où tout espoir est vain :

Godot, quoi qu’il symbolise ou qu’il soit, ne viendra jamais. La vie n’est, selon le titre éloquent de Beckett,
qu’une « fin de partie » interminable, aussi dénuée de bonheur que de sens, une agonie « sans remède» et
définie d’une formule où l’on reconnaît une version désespérée du cogito : « Il pleure. - Donc il vit. »
L’univers d’Eugène Ionesco n’est pas moins désespérément pessimiste, en dépit de la loufoquerie des
situations : solitude et déréliction des vieux dans Les Chaises, abandonnés du monde à la fin de leur misérable
existence ; angoisse et agonie du roi dans Le roi se meurt; triomphe universel de la mort, du meurtre et
du mal dans Jeux de massacre et dans Macbett, où l’assassinat du tyran ne laisse espérer, contrairement à la
tragédie shakespearienne, aucune restauration du bonheur et du bien. Le monde et la vie ne sont qu’un
formidable bordel, selon le titre évocateur de cette pièce, une « bonne blague », une farce ironique et cruelle
inventée par un Dieu inaccessible ou absent pour le malheur et la confusion de l’homme.
La dramaturgie du nouveau théâtre est bien accordée à l’expression du désespoir. L’absurdité de l’action
n’est que la métaphore et la manifestation de l’absurdité de
l’existence. L’absurde est même ici bien plus radical que dans le
théâtre et la pensée de Sartre et de Camus, où la rationalité de
l’intrigue et du langage impliquait une confiance en la raison et
où la négation de Dieu ne faisait qu’augmenter le prix de la vie
et des valeurs humaines.
Plutôt que d’un théâtre de l’absurde, il s’agit en effet, selon le titre
et l’expression d’Emmanuel Jacquart, d’un théâtre de la dérision, où
l’absurdité même est dérisoire. Dans un monde où rien n’échappe
au non-sens, la vie, la souffrance et la mort sont dépouillées de
tout pathétique. Le tragique est absorbé par le comique, et cette
bouffonnerie même est le malheur de 1’homme.
Dans Fin de partie comme dans la plupart des pièces de Beckett,
« rien n’est plus drôle que le malheur ». La confusion des genres
est à la fois un procédé dramatique et un parti pris métaphysique.
Ionesco prétendait n’avoir jamais compris la distinction entre
le comique et le tragique car « le comique étant « intuition de
l’absurde », il lui semblait « plus désespérant que le tragique ». Il se justifiait ainsi de recourir, dans la qualification
de ses pièces, à des catégories hybrides et contradictoires : J’ai intitulé mes comédies « anti-pièces », « drames
comiques », et mes drames « pseudo-drames » ou « farces tragiques », car, me semble-t-i1, le comique est tragique ; et
la tragédie de l’ homme, dérisoire. Ionesco
Un théâtre concret
L’originalité de ce théâtre est notamment d’avoir su conférer à la représentation des idées et des sentiments
une force exceptionnelle et proprement spectaculaire. Bien d’autres dramaturges avaient écrit, parlé,
disserté de la misère et des folies humaines. Mais plutôt qu’au langage, Ionesco et ses pairs ont préféré,
conformément à la leçon d’Artaud, recourir aux images, aux objets, aux sens, pour figurer concrètement
les terreurs, les fantasmes et les obsessions qu’ils entendaient exprimer et communiquer. Le théâtre alors
recouvrait sa nature et sa fonction qui ne sont pas tant de dire et de parler que de montrer, de représenter
ou de suggérer par l’image et l’action : Un théâtre où l’invisible devient visible, où l’idée se fait image concrète,
réalité, où le problème prend chair ; où l’angoisse est là, évidence vivante, énorme. Ionesco
Comment en effet mieux manifester la solitude et le désespoir que par la claustration des vieux dans Les
Chaises, enfermés dans une tour entourée d’eau où des invités invisibles et un orateur muet sont leur seule
et ultime assistance ? L’errance interminable et le vain espoir des clochards d’En attendant Godot, l’infirmité
des héros de Fin de partie, l’enlisement progressif de Winnie dans Oh ! les beaux jours, sont les plus frappantes
illustrations de la désespérance et de la déchéance. L’épidémie de métamorphoses et l’envahissement des
rhinocéros, dans la pièce de Ionesco, sont la plus terrifiante expression de la déshumanisation des individus
en proie à la contagion idéologique. Les infirmes et les boiteux dont Adamov a peuplé ses premières
pièces, de La Grande et la Petite Manœuvre à Tous contre tous, sont à la fois l’aveu d’une obsession de la
mutilation propre à l’auteur et la dénonciation de la cruauté d’une société intolérante ou raciste envers ses
étrangers et ses exclus. Le rétrécissement inexorable et continu de l’appartement des Bâtisseurs d’empire
de Boris Vian et l’inquiétante apparition du Schmürtz, figure anonyme et masquée que les personnages
accablent inexplicablement de coups, suggèrent avec vigueur le malaise et la terreur d’une existence ou
d’une société empoisonnées par des paniques et des haines irraisonnées. Le Cimetière des voitures d’Arrabal
est aussi le décor symbolique et désolé d’une civilisation mécanique envahie et submergée par ses déchets.
Ainsi fondées sur la représentation concrète et imagée des angoisses et des malheurs de l’homme et
des sociétés, ces pièces acquièrent une remarquable efficacité dramatique. La traditionnelle expression
rhétorique est ici relayée, renforcée ou remplacée par la réalisation scénique. La fantaisie du décor et de
l’action, tout en détruisant la vraisemblance et la rationalité de l’ œuvre, en fortifient le pouvoir dramatique
et symbolique. Il s’ensuit, comme l’affirmait Ionesco, que la parodie du théâtre était éminemment théâtrale.
Si révolutionnaire et provocant qu’il apparût, cet « anti-théâtre », en définitive, était paradoxalement mais
incontestablement du théâtre. Le bouleversement des structures et des conceptions traditionnelles avait
singulièrement ébranlé, mais aussi renouvelé et stimulé, pour un temps, la création théâtrale.
Du début du siècle aux années cinquante, on observe ainsi un foisonnement d’œuvres et d’idées, de
tentatives et de réalisations dramatiques. La multiplicité des talents, le nombre et la qualité des dramaturges
et des metteurs en scène, ont entretenu un bouillonnement constant de la vie théâtrale. La diversité,
l’originalité, la nouveauté des théories et des œuvres ont engendré des évolutions, des mutations, parfois
des révolutions fondamentales. L’apparition et le succès du « nouveau théâtre », au milieu du siècle, ainsi
que les polémiques et les confrontations auxquelles il a donné lieu parmi les auteurs et les critiques, ont
ébranlé et bouleversé les conceptions et traditions théâtrales. La disparition de ses principaux créateurs, le
tarissement relatif de leurs épigones, enfin la rapide évolution des modes et des goûts, ont paru menacer
la vie même et le renouvellement du genre. Le théâtre allait-il survivre à la mise en question, à la parodie,
à la destruction annoncée de ses structures et de ses prestiges?
Mort de Godot ? Démence et mort du théâtre. Faut-il dire adieu au théâtre ? Le théâtre allait-il, avait-il déjà joué
sa Fin de partie ? Bien des symptômes et des essais pouvaient le laisser croire. Mais la crise du théâtre
est de tous les temps. Sa renaissance et son renouveau aussi. L’avenir l’a montré : le théâtre des années
cinquante, ici considéré comme aboutissement d’un mouvement amorcé à la fin du siècle dernier par Ubu
roi, est pris pour base et point de départ dans l’ouvrage que Jean-Pierre Ryngaert a consacré, dans la même
collection, à Lire le théâtre contemporain (Dunod, 1993). L’idée de modernité est par définition relative
et transitive. L’avant-garde, écrivait Ionesco dans son discours de 1959, est destinée à devenir l’arrière-
garde. Rupture et renouvellement, métamorphose et continuité, révolution et continuation : ce sont les
conditions et les manifestations nécessaires à la vie du théâtre.
M. Lioure, Le Drame moderne, Editions Dunod

Les Chaises : une constellation de thèmes
Par rapport aux pièces antérieures, les Chaises présente une plus grande richesse thématique, une construction
dramatique plus abstraite, un symbolisme plus élaboré.
Une fois encore, Ionesco met en scène le couple mais il l’évoque sous un jour nouveau. Les Vieux ont
derrière eux un passé : une histoire vraie ou fictive, des souvenirs, des regrets, des rêves. Le couple est ici
une réalité morale et non biologique. Cette perspective explique le réseau thématique de la pièce.
L’âge des personnages appelle le thème du temps qui use et dégrade. Les Vieux n’ont pas la « sagesse
des anciens », leur dialogue n’est qu’un radotage, un tissu d’inepties sur des sujets insignifiants. Le temps
use l’intelligence ; il use aussi les sentiments : un ennui moite et lourd comme l’eau croupie de la lagune
enveloppe toute la première partie de la pièce. La comédie qu’ils se donnent ne les trompe qu’à partir du
moment où le rêve se change en délire, où ils peuplent leur solitude de présences imaginaires. Le temps
est aussi la mort, une mort absurde et grotesque. Le suicide des Vieux est vanité et dérision : personne ne
délivrera leur message, ils n’entreront pas dans la légende, ils n’auront pas leur nom sur les plaques d’une
rue. Il n’y a pas pour Ionesco de mort sereine et douce. La fin de la pièce est une parodie grinçante de la
légende de Philémon et Baucis. La peur de la mort se grime en nostalgie de l’enfance. Lorsque le Vieux
sanglote dans les bras de la Vieille et gémit qu’il est orphelin, il croit tromper le temps ; elle le console,
elle lui tient lieu de mère, jouant son jeu et sa folie. Mais le thème de l’enfance prend une autre dimension
quand les Vieux parlent de leur fils. Un fils qui, malgré leurs supplications les a quittés sans retour «
lorsqu’il a eu sept ans, l’âge de raison », dit la Vieille. Un fils qu’ils auraient bien voulu avoir mais ils n’ont
jamais eu d’enfant, dit le Vieux. Souvenir ou regret, cette image les hante. L’enfance est-elle vraiment un
paradis ? La Vieille raconte comment son fils a pris conscience du mal. D’autre part elle parle de la piété
filiale de son mari tandis que lui raconte comment il a abandonné sa mère et l’a laissée mourir seule dans
un fossé. Leurs paroles contradictoires évoquent une vérité toujours ambiguë : le temps de l’innocence est
aussi celui de la cruauté : « Les fils, toujours, abandonnent leur mère, tuent plus ou moins leur père ... La
vie est comme cela ... »
Enfin dans la conversation des Vieux il y a tous les rêves déçus. Elle parle de son génie : « Si tu avais voulu
... », de tout ce qu’il aurait pu être ou faire. Il se donne une contenance en trouvant les raisins trop verts : «
A quoi cela nous aurait-il servi ? On n’en aurait pas mieux vécu ... » Elle tient au photograveur des propos
érotiques et son jeu obscène avoue une personnalité refoulée. Il raconte à « la Belle » un amour qui n’a
pas osé être et qui reste comme une écharde au cœur des souvenirs. Ainsi l’image du couple sert de pôle
à toutes les pensées d’une vie d’échecs. Les thèmes de la pièce composent la constellation de l’existence
ratée.
La « Parlerie »
Le mouvement dramatique qui ordonne les thèmes est d’abord le flux de la parole. Les souvenirs et les
rêves, les personnages invisibles n’existent que par les mots qui les évoquent. Les Vieux parlent, rabâchent,
ressassent - et une réalité se cristallise. Mais si, au début, les personnages semblent penser ce qu’ils disent,
très vite, et de plus en plus nettement, on sent qu’ils ne font que transmettre une parole qui s’organise
seule, selon ses mécanismes propres. Quelque chose parle à travers les personnages.
Les mots, à l’état brut, s’alignent dans le lexique. Et dans la parlerie des Vieux les énumérations tournent
à l’inventaire, à l’enchaînement métonymique des images : toutes les divisions du temps, ou les parties du
corps, le nom des professions ou des maladies à virus.
- On était tout mouillés, glacés jusqu’aux os, depuis des heures, des jours, des nuits, des semaines ...
- Des mois ...
- Dans la pluie ... On claquait des oreilles, des pieds, des genoux, des nez, des dents.
Quelquefois la chaîne métonymique accroche et entraîne des mots d’un autre registre :
- Les gardiens ? les évêques ? les chimistes ? les chaudronniers ? les violonistes ? les délégués ? les
présidents ? les policiers ? Les marchands ? les bâtiments ? les porte-plume ? les chromosomes ?
Ailleurs, le lien associatif n’est plus la métonymie mais l’homophonie : « Le Pape, les papillons et les
papiers ? » La phrase n’est plus qu’un jeu sonore :
- Alors on a ri du drôle, alors arrivé tout nu, on a ri, la malle, la malle de riz, le riz au ventre, à terre...
- Pour préparer des crêpes de Chine? Un œuf de bœuf, une heure de beurre, du sucre gastrique...
Vous avez des doigts adroits...
Ces énumérations sont burlesques ou humoristiques. Mais le jeu n’est pas toujours gratuit. Dans les
associations surgissent des images insolites qui révèlent, comme un lapsus, des pensées qu’on refuse
d’avouer. Parfois aussi le flot des paroles charrie des maximes morales ou des citations littéraires qui
grimacent en surface avant de disparaître :
- Je ne suis pas moi-même. Je suis un autre. Je suis l’un dans l’autre.
- Mes enfants, méfiez-vous les uns des autres.
Le mouvement de cette parole mécanique, de cette logorrhée, est un crescendo brusquement rompu. Le
dialogue intime devient bavardage insipide; et le flot des mots grossit ; le Vieux déclame, debout sur une
chaise ; la Vieille répète en écho ses paroles ; ce sont enfin les cris de « Vive l’Empereur ! » Puis tout cesse ;
on n’entend plus que les grognements du sourd-muet.
Le tourbillon
Le mouvement du dialogue est doublé par le jeu des acteurs. Au début les gestes des Vieux portent
la marque de l’âge. Le rythme est lent. Jusqu’au premier coup de sonnette. La vieille amène alors une
chaise, puis une autre et le mécanisme peu à peu se met en branle : les portes s’ouvrent et se ferment, les
chaises circulent et s’alignent, les personnages vont et viennent de plus en plus vite. La vie est mangée par
l’automatisme ; tout n’est plus que mécanique. Ce mouvement de tourbillon est la figure du vide. Il crée
un monde imaginaire qui sombre brutalement à la fin comme un rêve doré au néant. Il donne à la pièce
sa signification. C’est pourquoi un jeu réaliste trahit l’intention de l’auteur. Si la «Vieille» reste pendant la
réception une vieille femme aux gestes lents, si le metteur en scène calcule que le dialogue ne fait allusion
qu’à douze personnages invisibles et se contente d’un nombre égal de chaises, le ballet fantastique est
supprimé, l’impression de foule absente disparaît ; il ne reste plus que deux vieillards gâteux qui se donnent
la comédie.

Le néant et la solitude
Le mouvement du tourbillon ôte au réel sa consistance. Les personnages sont des pantins, les actes se
réduisent à des gestes, les invités sont une absence, la parole ne communique aucun message. Le monde,
dérisoire ou illusoire, perd toute essence et toute valeur. Il n’existe plus vraiment. Le tourbillon crée un
vertige métaphysique. « Farce tragique », écrit Ionesco en sous-titre : des êtres médiocres, une pantomime
burlesque tentent de combler le vide et dévoilent le néant. Mais la pièce signifie aussi la solitude humaine,
une autre forme du vide. Dans leur tour, dans leur île entourée d’eau à perte de vue, les Vieux sont seuls,
brouillés avec le monde entier, n’ayant jamais rien réussi : leur solitude n’est pas l’impossible rencontre
de deux consciences séparées ; c’est une situation vécue archétypale, c’est une forme de la condition
humaine : la solitude de la médiocrité et de l’échec. Avec les Chaises, le théâtre de Ionesco acquiert une
dimension métaphysique.
C. Abastado, Ionesco, Editions Bordas.
De la machine à rire à la quête mystique
L’œuvre majeure de Ionesco fut écrite en quinze ans, de 1950 à 1966. Chacune des vingt-cinq pièces créées
alors jaillit d’un seul jet, sans que des repentirs ne vinssent en modifier la texture, tant la vision qui s’imposa
à l’artiste fut précise et impérieuse. La production dramatique se ralentit ensuite. Ionesco, se penchant sur
son passé, entreprit son autobiographie, œuvre au long cours, dans laquelle il puisa les matériaux de ses
dernières pièces.
Avec Ionesco est né, sur la scène européenne, un rire nouveau, qui résonne sur des gouffres d’angoisse.
Ce théâtre vient réaliser, bien longtemps après, l’objectif essentiel du drame, ce mélange des tons, que
Diderot, et Hugo après lui, avait tenté vainement de saisir. Ni le drame bourgeois, larmoyant, ni le théâtre
romantique, héroïque, n’avaient pu mêler comique et pathétique, tant il est difficile, au théâtre, de régir les
affects du spectateur, de le faire passer, sans transition, du rire à l’émotion. Le roman intègre plus aisément
au sein du pathétique des éléments de satire. Le théâtre met en jeu des forces plus archaïques, qui touchent à
l’image même du moi. Il fonde son existence sur la relation de corporéité, quasi transférentielle, qui s’établit
du spectateur à l’acteur. Aussi les sentiments suscités chez le spectateur sont-ils plus entiers. Ionesco,
qui allie à un tempérament mélancolique un humour corrosif, sut concilier des éléments profondément
hétérogènes, tandis que Beckett, de son côté, accomplissait un prodige identique. Sans doute n’est-ce pas
un hasard si ces tenants de la théorie des contraires marièrent des forces antagonistes, la férocité du rire,
la pitié des larmes.
La vis comica de Ionesco, qui intégra, au fil du temps, de plus en plus d’éléments pathétiques, offre
toute une gamme de rires. L’intrusion de traits autobiographiques, la présence grandissante du matériel
onirique modifièrent très vite le ton farcesque des premières pièces, ajoutant au comique grinçant de
La Cantatrice chauve ou de La Leçon une « inquiétante étrangeté ». Le recours au fantastique vint, dans
certaines œuvres, rendre sensible l’opacité d’un monde que nous ne percevons que diffracté par nos sens,
fallacieux. Si l’auteur contemplait ses premiers personnages d’un œil extérieur, la perspective changea peu
à peu. L’apparition, avec Bérenger, d’un porte-parole, signant la présence grandissante de l’auteur dans
sa création, infléchit le ton, accentuant les éléments pathétiques. La force de ce comique déroutant, c’est
qu’il est chargé de questions métaphysiques, rôle qui n’était dévolu antérieurement qu’à la tragédie. Ce
théâtre de l’après-guerre, ancrant fantasmes personnels et questions existentielles dans la problématique
du xxe siècle, crie l’éternelle révolte de l’homme devant le mal et la mort, comme l’épouvante face à toutes
les formes de barbarie qu’a follement machinées le xxe siècle. C’est par le biais du burlesque que Ionesco
nous communique son angoisse face à un monde où tout n’est que « bruit et fureur », où disputes privées
et catastrophes cosmiques apparaissent comme les deux faces du satanisme. Le rire est l’expression d’un
étonnement permanent devant un monde incompréhensible.
Cette œuvre est attente de la Manifestation, recherche de la parole libératrice qui seule pourrait guérir,
quête de la lumière mystique, jadis fugitivement entrevue. Mais le chaos règne au sein d’un langage disloqué
qui ne peut que blesser. Le rire masque l’épouvante de l’être devant un tel constat. Si les surréalistes
recherchaient surtout les effets de surprise, dans leurs jeux sur les mots, Ionesco, plus proche de Kafka,
veut faire saisir au spectateur sa propre inquiétude devant le champ énigmatique du langage, dans lequel
l’homme se hasarde, les yeux bandés et à tâtons. Le désordre convertit également l’espace en un labyrinthe
vertigineux et sombre où l’être s’enlise, anéanti par une matière dont rien ne peut arrêter la prolifération.
Ionesco, faisant de l’espace scénique une force persécutoire, pose en des termes neufs le rapport de l’être
à l’univers, méditant ainsi sur le problème des limites entre le moi et le monde. En somme, monde intérieur,
monde extérieur, ce sont des expressions impropres, il n’y a pas de véritables frontières pourtant entre ces deux
mondes; il y a une impulsion première, évidemment, qui vient de nous, et lorsqu’elle ne peut s’extérioriser, lorsqu’elle
ne peut se réaliser objectivement, lorsqu’il n’y a pas un accord total entre moi du dedans et moi du dehors, c’est la
catastrophe, la contradiction universelle, la cassure. (Tueur sans gages.)
Parole perdue, espace ténébreux, telles sont les deux sources de l’angoisse dans le théâtre de Ionesco.
Ionesco confère aux éléments les plus fondamentaux de la scénographie, porte, lumière, la délicate
fonction de visualiser 1’« autre scène» du fantasme, de refléter un espace intérieur, car c’est bien l’espace
du fantasme qui constitue le décor ionescien.
L’espace est immense à l’intérieur de nous-mêmes. Il nous faut des explorateurs, des découvreurs des mondes inconnus
qui sont en nous, qui sont à découvrir en nous. (Notes et Contre-Notes)
M.-C. Hubert, Ionesco, Les Contemporains, Le Seuil.
1
/
5
100%