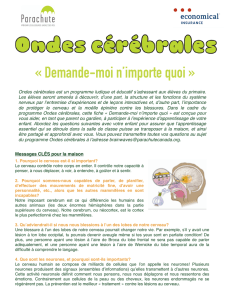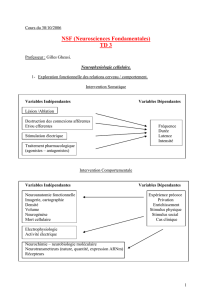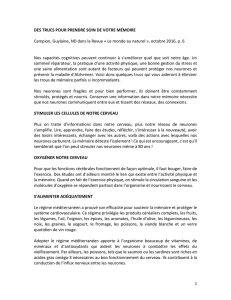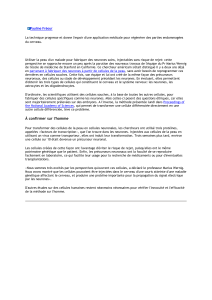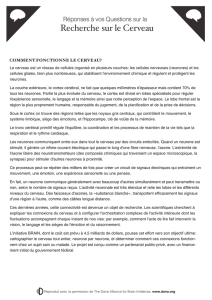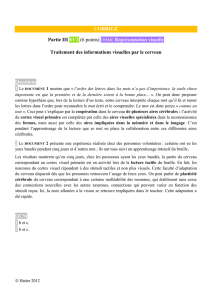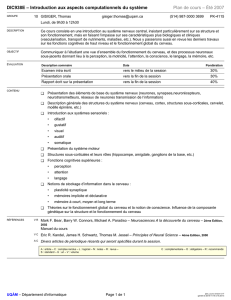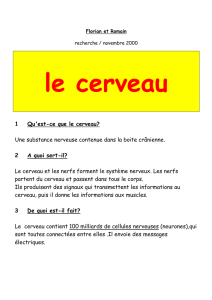Master QS - Université Laval

es ordres sont donnés,
des appareils sont mis
en marche, beaucoup
de monde s’active dans
cette salle où la vie et
la mort se côtoient der-
rière des paravents bleu pâle.
Un médecin tente de stabiliser un patient
qui vient tout juste d’arriver. Ce dernier
s’est fracturé le crâne lors d’une collision
à vélo. À l’étage, aux soins intensifs, une
infirmière pince la peau d’un homme de 80
ans, dans le coma depuis une semaine, pour
déterminer son état neurologique. Il est
tombé dans l’entrée de son domicile. Diag-
nostic : hématome épidural.
Ressent-il la douleur? Le visage de l’homme
se crispe, ses pieds se contractent. «Les pa-
tients âgés qui ont subi un traumatisme crâ-
nien présentent souvent des complications,
explique Marc Giroux, chef du service de
neurochirurgie à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal. Mais celui-ci a de bonnes chances
de s’en sortir sans trop de séquelles. Il récu-
père bien et devrait se réveiller bientôt.»
Nous sommes dans l’unité de trauma-
tologie de l’hôpital. Deux mille cinq cents
patients y sont admis chaque année, dont
plus de 350 sont soignés pour des blessures
à la tête.
C’est que les traumatismes crâniens, ou
cranio-cérébraux, sont la première cause
de décès chez les Québécois de moins de
35 ans, et une des principales causes d’in-
capacité. Près de 13 000 personnes en sont
victimes chaque année dans la province.
Qu’ils soient dus à des accidents de la route
ou de sport, à des chutes dans un escalier ou
sur une chaussée glacée, à des bagarres ou
à des agressions, à un plongeon dans un lac
ou une piscine, ces chocs à la tête peuvent
laisser de graves séquelles, même si le blessé
ne présente aucun symptôme visible. C’est
ce que médecins et chercheurs commen-
cent tout juste à comprendre.
«Il y a 15 ans, on renvoyait à la maison
les gens qui avaient subi une commotion
cérébrale, sans intervenir. Ceux-ci reve-
naient à l’hôpital un ou deux ans après en
se plaignant de pertes de mémoire», ex-
plique Marc Giroux. En 20 ans de métier,
il a tout vu, y compris un adepte de ski nau-
22 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010
TÊTE PREMIÈRE
Juin ~ Juillet 2010 |Québec Science 23
"&+.!#$ $
$ %'%$/&%#&%$
#)&&+ % #%+
$&#$# &%$ $! %
& !# $&# &$
%( !##"&$
!$$$%,%"&*
par Mathieu Gobeil
LEE TORRENS/MURAT GIRAY KAYA/FÉ/ISTOCK PHOTO

alors violemment. Sonja s’évanouit sur le
coup. Diagnostic : traumatisme crânien sé-
vère. Deux semaines de coma.
Aujourd’hui, rien ne laisse soupçonner
les mois de souffrance et d’efforts qu’elle a
dû traverser pour retrouver ses capacités.
Mais si elle s’en est si bien sortie, c’est que
les médecins sont intervenus très tôt après
la collision.
Les heures et les jours qui suivent le
trauma sont en effet déterminants, car
c’est au cours de cette période fatidique
que des lésions secondaires se forment.
Médecins et chercheurs ont en effet dé-
couvert que les neurones endommagés
lors de l’impact déclenchent une réaction
immunitaire dans le cerveau. De l’eau s’y
accumule. Il enfle; c’est l’œdème cérébral.
L’encéphale manque de place dans la boîte
crânienne. La pression empêche le sang
et l’oxygène de s’y rendre en quantité suf-
fisante, ce qui cause la mort d’autres cel-
lules. Pour réduire la pression, il faut alors
diminuer la quantité de liquide qui s’ac-
cumule dans la matière grise ou entailler
l’os crânien pour permettre l’expansion
du cerveau.
N’empêche, même si on agit vite, les cel-
lules abîmées ont déjà libéré en quantité
du glutamate, un neurotransmetteur qui, en
excitant trop les neurones, finit par les dé-
truire, et des radicaux libres, des molécules
instables qui endommagent les neurones
sains et les font mourir à leur tour.
Le docteur David Wright pense avoir
trouvé le moyen de minimiser ces dom-
mages collatéraux en injectant de la pro-
gestérone dans les heures suivant le trau -
ma. L’hormone, habituellement sécrétée
dans le cerveau en quantité modeste et
nécessaire au développement des neu-
rones, est produite en grande quantité
par les femmes enceintes. C’est précisé-
ment chez des rates gravides qu’on en a ob-
servé les surprenants effets, dans les an-
nées 1980. « Les femelles enceintes chez
qui on avait provoqué un traumatisme
crânien faisaient moins d’œdèmesk et
avaient plus de chances de survivre que les
autres », relate l’urgentologue et profes-
seur à l’université Emory, à Atlanta, aux
États-Unis.
Injectée lors d’une blessure à la tête, la
progestérone diminuerait la réaction in-
flammatoire, et donc l’œdème. Elle frei-
nerait aussi la cascade chimique au cours
de laquelle les neurones moribonds em-
poisonnent les cellules environnantes et
entraînent leur mort.
«C’est le premier médicament qui agit
directement sur les neurones pour prévenir
la mort cellulaire après le trauma», affirme
le chercheur. Plus de 1 000 patients parti-
ciperont bientôt à la dernière étape des tests
aux États-Unis avant une approbation éven-
tuelle du traitement.
Marc Giroux émet toutefois des réserves :
«Il est difficile de généraliser les cas de
traumatismes crâniens; il n’y en a pas deux
semblables. Les chercheurs ont essayé les
stéroïdes, les antioxydants, l’hypother-
mie, et maintenant la progestérone. Mais
il n’y a pas de consensus au sein de la com-
munauté médicale.» Chose certaine, une
fois les neurones abîmés, c’est peine perdue
car ils ne se régénèreront pas.
tique dont le crâne a été coupé en deux par
l’hélice du bateau et un golfeur devenu muet
après avoir reçu une balle à la tête. Quelle
qu’en soit la cause, les cas de traumatismes
crâniens sont rarement simples. «Notre
cerveau est comme un ordinateur, explique
le docteur Giroux. Il suffit d’une petite er-
reur dans un programme, et on se retrouve
avec un bogue généralisé.»
Quand un patient arrive dans son ser-
vice, le médecin commence par scruter son
encéphale. Bien souvent, le choc entraîne
une fracture et provoque des lésions céré-
brales. Mais même quand la boîte crânienne
est intacte, le cerveau peut être atteint à la
suite des secousses violentes auxquelles il
a été soumis.
Lorsqu’une voiture entre en collision avec
une autre, par exemple, la décélération su-
bite entraîne le corps des occupants vers
l’avant. Le cerveau, qui flotte dans la boîte
crânienne, en percute les parois
avec force. Au point d’impact, les
neurones son endommagés et meurent
aussitôt. Le contrecoup pro-
jette ensuite le cerveau vers
l’arrière du crâne. Les lobes
frontaux et temporaux sont les
plus touchés, à l’avant et sur les cô-
tés, et parfois les lobes occipi-
taux, à l’arrière.
C’est sans compter
les hémorragies et
les hématomes. Souvent, des ar-
tères et des veines sont sectionnées.
Du sang s’accumule dans la boîte crâ-
nienne, augmentant dangereusement
la pression et détruisant d’autres neu-
rones. Dans ces cas, très graves, la
mémoire, l’attention, la personna-
lité et la motricité sont affectées.
Chez Sonja Boodajee, c’est la région fron-
tale droite qui a été atteinte. «Dans les pre-
miers mois, il a fallu que je réapprenne à
apprendre! Je dessinais comme une enfant
de deux ans. Je confondais certains mots
en parlant. Ma mémoire à court terme était
nulle. J’avais aussi perdu mes inhibitions.
Je parlais sans arrêt et disais des choses
grossières», raconte-t-elle.
n septembre 1994 – elle
avait 22 ans –, elle termine
des vacances de rêve dans
le Sud avec son amou-
reux. Ils roulent vers l’aé-
roport de Mexico quand
il se met à tomber des cordes. «J’ai vu
quelque chose arriver très vite. Je me suis
recroquevillée, tête baissée et bras croisés»,
se rappelle Sonja. Une voiture les percute
24 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010
TÊTE PREMIÈRE
VENEZ VOIR
NOS
INSTALLATIONS
GRANDEUR
NATURE
Sortez des sentiers battus et partez
à la découverte d’Hydro-Québec
en parcourant le circuit électrisant
des centrales, barrages et autres
installations. Gratuites, amusantes,
instructives et fascinantes, ces visites
plairont à toute la famille !
Pour en savoir plus, composez
le 1 800 ÉNERGIE ou consultez le
www.hydroquebec.com/visitez
Il est difficile de généraliser les cas de traumatismes
crâniens; il n’y en a pas deux semblables. Chose certaine,
une fois les neurones abîmés, c’est peine perdue
car ils ne se régénèreront pas.
Quand une voiture entre en collision
avec une autre, la décélération
subite entraîne le corps des
occupants vers l’avant. Le cerveau,
qui flotte dans la boîte crânienne,
en percute les parois avec
force. Au point d’impact,
les neurones son
endommagés et
meurent aussitôt. Le
contrecoup projette
ensuite le cerveau
vers l’arrière du
crâne. Les lobes
frontaux et
temporaux sont les
plus touchés, à l’avant et
sur les côtés, et parfois les
lobes occipitaux, à l’arrière.
© 2010 NUCLEUS MEDICAL MEDIA/WWW.NUCLEUSINC.COM
CLIFFORD SKARSTEDT/LA PRESSE CANADIENNE

cognitives. La moitié avaient subi une com-
motion au hockey, au football ou au soc-
cer. Il a constaté que les séquelles sont plus
importantes chez les adolescents, en parti-
culier pour ce qui est de la mémoire de tra-
vail et la capacité de manipuler des éléments
d’information. «On sait que la circuiterie de
la région frontale, qui est la plus affectée
lors d’une commotion, se solidifie à l’ado-
lescence. Cela pourrait peut-être expliquer
les différences.» Ce qui est sûr, c’est que les
conséquences d’une commotion – des
problèmes de concentration notam-
ment –, peuvent compromettre le che-
minement scolaire des enfants et des ado-
lescents.
À l’Université Laval, on a identifié
d’autres séquelles. Bradford McFa-
eureusement, la ma-
jorité des traumatisés
crâniens s’en sortent
avec des séquelles
beaucoup moins im-
portantes. Le 13 sep-
tembre 2009, le quart-arrière de l’équipe
de football des Carabins de l’Université de
Montréal, Marc-Olivier Brouillette, fonce
avec le ballon vers la zone des buts quand
il est solidement plaqué à hauteur de la poi-
trine et tombe à la renverse. Sa tête frappe
durement le sol. Le joueur de 24 ans perd
connaissance quelques secondes, puis re-
prend ses esprits sur le banc. «J’étais étourdi.
Je ne me souvenais plus du pointage ni dans
quel quart on était.» Pendant plusieurs
jours, il éprouvera de la difficulté à se
concentrer et ressentira des maux de tête.
Mais il reprendra tranquillement l’entraî-
nement et sera de retour sur le terrain deux
semaines plus tard.
Les commotions cérébrales, ou trauma-
tismes crâniens légers, comme celui qu’a
subi Marc-Olivier Brouillette, représen-
tent 85% de toutes les blessures au cer-
veau, mais elles passent la plupart du temps
inaperçues.
«C’est un problème sous-estimé», af-
firme Alain Ptito, neuropsychologue et
chercheur à l’Institut neurologique de Mont-
réal. Ces blessures provoquent des maux de
tête, de la fatigue, ainsi que des problèmes
de mémoire et d’attention qui, normale-
ment, s’estompent dans les jours suivant
le choc. Mais 5% à 15% des victimes gar-
dent des séquelles qui chambardent leur
vie pour toujours.
«On a longtemps pensé que les symp-
tômes ressentis après une commotion
étaient temporaires, notamment parce que
les tests neuropsychologiques et les tech-
niques d’imagerie utilisés jusqu’à mainte-
nant ne permettaient pas de déceler de dif-
férences avec des cerveaux “normaux”»,
poursuit Alain Ptito.
S’il persistait quelques troubles, les mé-
decins les attribuaient à une réaction psy-
chologique au choc. «C’est oublier que ces
gens-là ont eu une atteinte neurologique»,
précise M. Ptito. En fait, jusqu’à 20% d’en-
tre eux souffriront de dépression plus tard,
selon une étude parue en 2007 dans le jour-
nal Medicine and Science in Sports and
Exercise. C’est trois fois plus que dans la po-
pulation en général.
Alain Ptito croit savoir pourquoi. De-
puis des années, il examine des hockeyeurs
et des footballeurs des équipes de l’Uni-
versité McGill. En début de saison, il les
soumet à des tests de mémoire en leur pré-
sentant des images à retenir ou en les plon-
geant dans un environnement 3D simulé
par ordinateur. Quand un athlète subit
une commotion, il repasse les mêmes tests.
On mesure alors son activité cérébrale à
l’aide de l’imagerie par résonance ma-
gnétique fonctionnelle. Chez plusieurs des
patients ayant subi une commotion, on
observe une baisse de l’activité électrique
dans une région associée à la mémoire de
travail et au traitement des tâches cou-
rantes, le cortex préfrontal dorsolatéral.
Par contre, l’activité est plus élevée dans
le cortex orbitofrontal médial et le cortex
cingulaire antérieur, qui sont liés aux émo-
tions. Un profil très semblable à celui re-
marqué chez des personnes dépressives.
«Le brassage violent dans le crâne en-
traîne un étirement des axones, les longs
prolongements des neurones, qui sont les
fils électriques du cerveau. Certains se bri-
sent, causant des lésions dispersées, diffi-
ciles à déceler. Elle n’apparaissent généra-
lement pas lorsqu’on effectue un scan»,
explique Marc Giroux.
Voilà pourquoi certains traumatisés gar-
dent des séquelles qui échappent aux spé-
cialistes, mais qui ne pardonnent pas. Les
recherches ont notamment montré que le
temps de réaction des sportifs ayant subi
une commotion récente est plus lent. Leurs
réflexes sont moins aiguisés. Résultat, ils
courent cinq à sept fois plus de risque de
subir un autre coup à la tête s’ils repren-
nent le jeu trop vite. Or, les commotions
à répétition peuvent s’avérer fatales pour
un cerveau déjà fragilisé; c’est ce qu’on
appelle le syndrome du second impact.
D’où l’importance du repos avant de re-
mettre les pieds sur le terrain, surtout chez
les jeunes athlètes. «Il y a deux fois plus de
commotions chez les enfants sportifs que
chez les adultes, mentionne le neuropsy-
chologue Dave Ellemberg, professeur adjoint
au département de kinésiologie de l’Uni-
versité de Montréal. Pourtant, il n’existe
aucun plan d’intervention. Personne ne sait
trop comment agir dans ces cas-là.»
Le neuropsychologue a comparé la ré-
ponse des neurones chez des enfants de 9
et 10 ans, des adolescents de 14 à 16 ans et
des adultes lorsqu’ils effectuaient des tâches
Juin ~ Juillet 2010 |Québec Science 2726 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010
TÊTE PREMIÈRE
QUAND LA CABOCHE D-
CROCHE
$%&$ $+"&$$!&$
#'$&%#&%$#)
Beaucoup l’ignorent, mais «tomber dans les pommes» à la suite d’un
choc ou entrer dans un coma prolongé relève du même mécanisme. La
seule différence, c’est la durée… et les séquelles.
Quand on reçoit un coup sur la tête, le choc peut perturber l’activité
électrique dans les deux hémisphères du cerveau – on perd
connaissance, car les signaux dans les neurones ne sont plus relayés.
L’évanouissement peut aussi être causé par un manque d’oxygène ou de
glucose dû à un problème de circulation sanguine.
En d’autres occasions, c’est une structure située à la base du cerveau
et responsable de l’état d’éveil (la formation réticulée activatrice), qui
reçoit un choc. Là aussi, la personne perd connaissance et, s’il y a une
lésion dans cette région, le coma risque de se prolonger.
Cependant, si la structure des neurones est préservée, l’endormi
reprendra connaissance – après quelques heures, quelques jours ou
quelques semaines, selon les cas, le temps que le cerveau désenfle et
retrouve sa taille normale. Les fonctions automatiques réapparaissent, le
patient commence à bouger les membres, puis les paupières. Il se réveille.
La durée du coma est en fait proportionnelle à l’importance des
lésions, à l’âge de la personne et à son état de santé avant le
traumatisme. Quant aux séquelles, elles dépendent des régions du
cerveau qui ont été endommagées. Commence ensuite le travail de
réadaptation.
Il arrive cependant que la personne puisse ouvrir les yeux et respirer
par elle-même sans toutefois reprendre conscience. Elle est alors dans
Le quart-arrière des Carabins de l’Université de
Montréal, Marc-Olivier Brouillette, a subi une solide
commotion cérébrale en septembre 2009. Il était
de retour au jeu deux semaines plus tard. On le voit
ici, en novembre 2009, contre le Rouge et Or
de l'Université Laval.
JACQUES BOISSINOT/LA PRESSE CANADIENNE
Une
commotion
risque d’entraîner des
problèmes de concentration
qui peuvent compromettre
le cheminement scolaire
des enfants et des
adolescents.
LE CASQUE: EST-CE QUE A PROTØGE
VRAIMENT ?
Au Québec, chaque année, les accidents de vélo causent au moins 30 décès et 200 blessures graves,
la plupart chez des enfants de moins de 16 ans. Les traumatismes crâniens sont responsables des trois
quarts de ces décès et de près de un tiers des blessures graves.
Différentes études statistiques ont démontré que le port du casque diminuait le risque de traumatisme
crânien lors d’accidents ou de chutes.
Cette protection est encore plus efficace en vélo de montagne, en ski et en planche à neige. En prévenant le
contact direct de la tête avec l’obstacle, le casque diminue le risque de fracture et empêche des objets de péné-
trer à l’intérieur du crâne (des branches d’arbre par exemple) et d’atteindre le cerveau. De plus, il dissipe l’énergie
lors du choc, réduisant la transmission de la force de l’impact à la matière grise.
«Mais le casque n’a pas d’effet sur le brassage du cerveau dans la boîte crânienne. Il n’empêche pas celui-ci
de percuter l’intérieur du crâne lors de la décélération, ou le bris d’axones dus à la torsion», précise le docteur
Chez les adultes
%$# &%
&%
%%#'
%$! #% $#
$$&%
Chez les enfants
&%
%$! #% $#
%# &%
&%#
Source : Regroupement des associations
de personnes traumatisées cranio-cérébrales
du Québec
CAP53/ISTOCKPHOTO

à
a
O
dyen, professeur au département de réa-
daptation, a comparé 7 personnes sans
problèmes neurologiques, à 11 autres ayant
subi un traumatisme crânien modéré ou
sévère, mais considérées comme rétablies.
Les participants devaient marcher le long
d’un parcours. Quand celui-ci était dé-
pourvu d’obstacles, les deux groupes l’ef-
fectuaient dans les mêmes temps. Mais
lorsqu’on ajoutait des obstacles et des sti-
muli visuels et sonores «dérangeants», le
groupe de traumatisés réagissait moins
vite. Il semble que leur cerveau ait plus de
difficulté à traiter toutes ces informations.
«Dans un environnement complexe,
comme dans une usine par exemple, ça
peut être dangereux», soutient Bradford
McFadyen. C’est pourquoi il conseille de
tenir compte de l’environnement de tra-
vail quand vient le temps de rentrer au bou-
lot, une marque de prudence qui fait aussi
partie de la réadaptation.
Sa réadaptation, Sonja Boodajee n’au-
rait jamais pu l’accomplir sans une vo-
lonté de fer et un solide soutien de son
entourage. Elle a ainsi pu terminer le bac-
calauréat qu’elle avait entrepris avant
son accident, et décrocher une maîtrise.
Maintenant thérapeute par l’art, elle doit
cependant prendre garde de respecter son
endurance mentale et son niveau d’éner-
gie. «Il faut reconnaître nos limites. Le
plus important dans la vie sont les petites
choses qui nous permettent de fonction-
ner, ici, maintenant.» Elle sait qu’elle
n’est plus tout à fait la même depuis son
accident, et l’accepte : «J’aime à dire que
j’en suis à la quinzième année de ma nou-
velle vie.»
■
QS
28 Québec Science |Juin ~ Juillet 2010
TÊTE PREMIÈRE
omment le grand
pic, qui cogne du
bec sur un tronc d’arbre
près de 20 fois par se-
conde et jusqu’à 12 000
fois par jour – avec une
force de décélération de
1000 G– réussit-il à évi-
ter le traumatisme crâ-
nien? Et même à se pas-
ser d’un sacré mal de
bloc?
Tout d’abord, contrai-
rement aux humains, la
masse de son cerveau est
petite par rapport à la superficie de son
crâne. La force d’impact est ainsi distri-
buée sur une plus grande surface, endom-
mageant moins l’encéphale.
Le pic possède un crâne épais fait d’os
spongieux. Un coussin cartilagineux, situé
juste à l’endroit où la mandibule s’attache
au crâne, amortit admirablement les chocs.
De plus, le coup donné est toujours per-
pendiculaire à l’axe de la tête et du cou, et
le cerveau occupe presque tout l’espace de
la boîte crânienne. Le brassage de la ma-
tière grise est donc minimisé, ce qui em-
pêche les bris d’axones et les autres lésions.
Les muscles du bec sont très puissants. Le
pic les contracte une milliseconde avant
chaque coup, ce qui
maintient la tête et dis-
tribue la force vers le bas
du crâne, évitant ainsi
que l’impact affecte di-
rectement l’encéphale.
La langue de l’oiseau
est exceptionnelle. Ex-
trêmement longue, elle
est attachée sur le dessus
du bec. Elle fait le tour du
crâne, l’enlaçant com me
une pelote, avant de sor-
tir par-devant. Con trac-
tée à cha que impulsion,
on pense qu’elle aiderait elle aussi à maintenir
la tête, la protégeant encore davantage.
Quant à ses yeux, ils sont bien à l’abri.
Une membrane s’abaisse avant chaque
coup, empêchant les éclats de les blesser,
et retient les globes oculaires qui seraient
autrement éjectés hors de leur orbite sous
la force des impacts!
Dans les années 1970, la question a in-
téressé le psychiatre états-unien Philip
May et, plus récemment, l’ophtalmolo-
giste Ivan Schwab. Tous deux ont reçu le
prix Ig Nobel (ces prix qui récompensent
les recherches farfelues ou absurdes) d’or-
nithologie en 2006 pour avoir résolu ce
«casse-tête». M.G.
Titulaire d’un permis du Québec
www.veloquebecvoyages.com
514 521-8356 • 1 800 567-8356, poste 506
Inscrivez-vous avant le 4 juin et économisez.
Photo : Gaétan Fontaine
VÉLO + PARCOURS INÉDIT + APRÈS-VÉLO =
DE VRAIES VACANCES!
! $$ &#!$%#&%$#)-
&## $ &$ &$$!##
ISTOCKPHOTO
1
/
4
100%