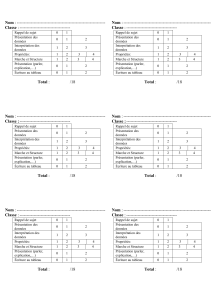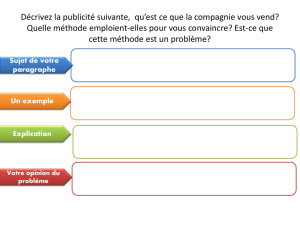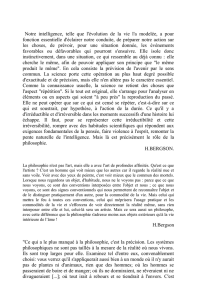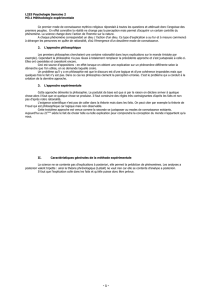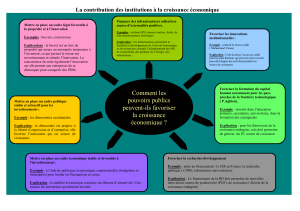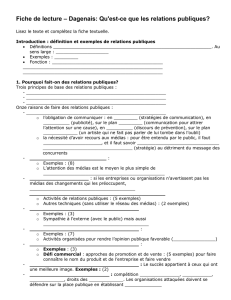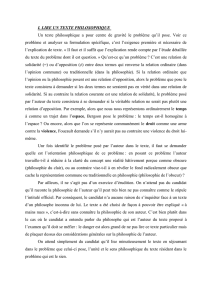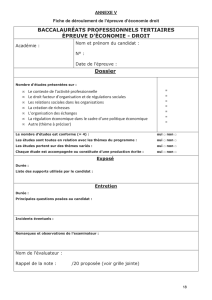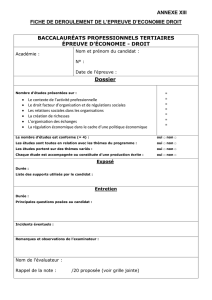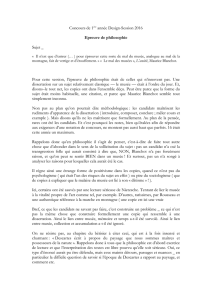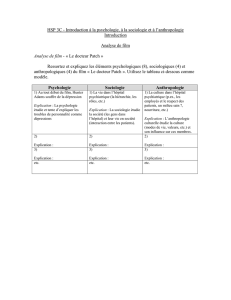agrégation interne et CAERPA de philosophie

Concours du second degré
Rapport de jury
________________________________________________________________________________
© www.education.gouv.fr
Concours : Agrégation interne et CAERPA
Section : Philosophie
Session 2015
Rapport de jury présenté par :
Monsieur Paul MATHIAS
Inspecteur général de l’Éducation nationale
Doyen du groupe de philosophie
Président du jury


Les rapports des jurys de concours sont établis sous la responsabilité des
présidents de jury.


SOMMAIRE
COMPOSITION DU JURY 7
PRÉAMBULE 9
ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ 11
PREMIÈRE ÉPREUVE EXPLICATION DE TEXTE 11
Données concernant l’épreuve 11
Rapport d’épreuve 13
DEUXIÈME ÉPREUVE DISSERTATION 19
Données concernant l’épreuve 19
Rapport d’épreuve 19
ÉPREUVES D’ADMISSION 25
PREMIÈRE ÉPREUVE LEÇON 25
Données concernant l’épreuve 25
Rapport d’épreuve 27
DEUXIÈME ÉPREUVE EXPLICATION DE TEXTE 31
Données concernant l’épreuve 31
Rapport d’épreuve 37
DONNÉES STATISTIQUES GLOBALES 47
1. Bilan de l’admissibilité 47
• Agrégation interne 47
• CAERPA 47
2. Bilan de l’admission 47
• Agrégation interne 47
• CAERPA 47
3. Répartition par académie d’inscription 48
• Agrégation interne 48
• CAERPA 49
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
1
/
49
100%