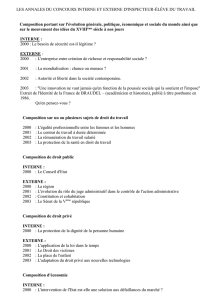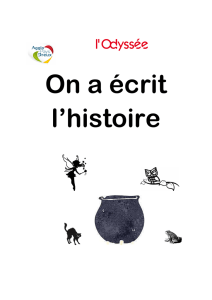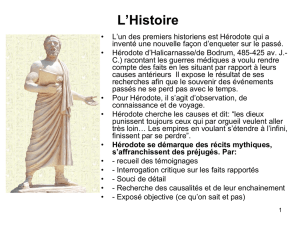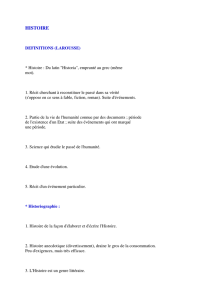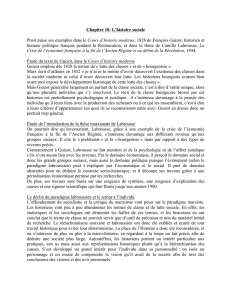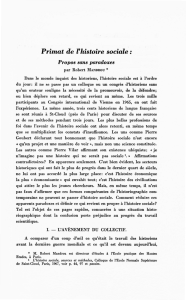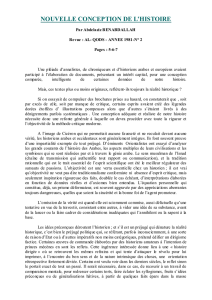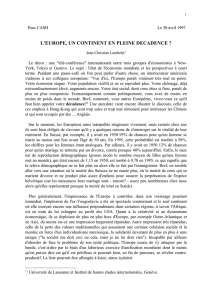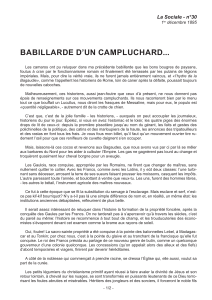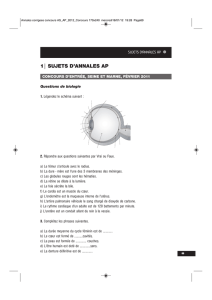historien être contestation

1
1
Histoire et historiens : Les paradigmes historiques et leurs
mutations au cours des XXe et XXIe siècles
Introduction :
Reinhart Koselleck a montré que "le concept actuel d'histoire [...] s'est élaboré seulement vers la fin du
XVIIIe siècle". La philosophie des Lumières et la Révolution française ont bouleversé les rapports que
les hommes entretenaient, traditionnellement, avec le temps. Alors que l'histoire était appréhendée
comme une pluralité d'exemples, elle apparaît de plus en plus comme un singulier collectif, la somme
de toutes les expériences humaines. Un même concept sert désormais à nommer à la fois l'histoire en
tant que réalité et en tant que réflexion sur cette réalité. Ces bouleversements des manières de penser
donnent naissance à l’histoire universelle et à la philosophie de l’histoire (Kant, Schiller, Herder,
Voltaire…). Du coup ce ne sont pas seulement les questions que l’on pose à l’histoire qui changent
mais aussi les objets de l’histoire, les méthodes et les formes d’écriture.
Plus tard, dans le dernier quart du XIXème siècle, la philosophie de l’histoire a été remise en
cause par ceux qui voulaient faire de l’histoire une discipline scientifique en la détachant des
téléologies. Ce changement a permis l’éclosion de l’histoire universitaire et de ce que nous nommons
« l’école méthodique ».
Deux lectures historiographiques peuvent être faite de cette rapide séquence de « révision » du
cours précédant. La première lecture insiste sur les ruptures et considère qu’il y a, au cours du
XIXème siècle, deux façons radicalement différentes d’envisager l’histoire, incompatibles, c'est-à-dire
que le triomphe de la seconde suppose la défaite de la première. La seconde lecture insiste sur les
continuités, considérant qu’après la grande rupture des Lumières, l’histoire connait une évolution vers
toujours plus de rigueur méthodologique, des changements de centres d’intérêt (de la monarchie à la
République par exemple) et de style d’écriture mais pas de changement fondamental.
Les partisans de la théorie des ruptures s’appuient sur une conception de l’histoire de la
science proposée par l’épistémologue des sciences Thomas Kuhn dans un ouvrage devenu un
classique, La structure des révolutions scientifiques (1962). Pour Kuhn l’existence d’un "paradigme"
scientifique suppose la constitution préalable d'une communauté de chercheurs ayant reçu la même
formation, assimilé la même littérature technique dont ils ont retiré le même enseignement. Dans ce
cadre, un "paradigme"' peut être considéré comme l'ensemble des croyances, des valeurs et des
techniques qui sont communes aux membres du groupe considéré à une époque considérée. C'est ce
que Kuhn appelle la "matrice disciplinaire". Kuhn insiste sur le fait que ces matrices disciplinaires
permettent à la science de produire des savoirs solides, fortement corrélés et produisent des
explications du monde qui servent les sociétés dans lesquelles elles s’épanouissent. Ces paradigmes ont
le défaut de leur qualité : la stabilité. Toute production scientifique qui « sort du paradigme » est
qualifiée de non scientifique, c’est ce qui est arrivé à Galilée). Il faut que le paradigme épuise son
efficacité à rendre compte du réel et à servir la société pour qu’intervienne une « révolution
scientifique » souvent après plusieurs échecs de précurseurs malheureux, pour qu’un nouveau
paradigme s’impose. Ainsi la science progresserait par cycles et par à coup.
Ce concept de paradigme est-il pertinent en ce qui concerne la discipline historique au XXème
siècle ? L’intitulé du cours d’aujourd’hui tend à répondre « oui », je vais essayer de vous donner les
éléments du débat à travers un récit de l’historiographie du XXème siècle en interrogeant les ruptures
et les continuités dans les conceptions et les façons de faire l’Histoire, pour repérer d’éventuelles
« révolutions scientifiques » réussies ou avortées qui justifieraient l’application de la théorie khunienne
à la discipline historique. Nous partirons d’une première « rupture supposée : celle qui est marquée par
la naissance de la revue des Annales. C’est l’évolution de cette revue qui nous permettra de nous
interroger sur la réalité de deux autres changements de paradigme après la Seconde Guerre mondiale
et dans les années 70 et nous terminerons en examinant l’impact des « tournants » des années 90 sur
l’histoire française actuelle.

2
2
I. La naissance des Annales : rupture ou continuité ?
L’expression même « école des annales » est contestable et contestée : quelle unité dans le temps ?
quelle unité dans les approches ?
A/ Une revue dans le siècle 1929-1946 : les Annales d’Histoire Economique et Sociale
Lorsque Lucien Febvre et Marc Bloch, tous deux à l’université de Strasbourg, fondent la revue
qu’ils nomment Annales d’histoire économique et sociale en 1929, c’est le fruit d’un choix de rupture
avec la partie de leurs collègues (et maîtres) qui « règne » sur l’Histoire universitaire depuis un demi-
siècle et que l’on a, par la suite, nommé « méthodistes ». Les jeux d’ambition personnelle et de pouvoir
universitaire y sont sans doute pour quelque chose mais la rupture est avant tout idéologique.
Les Lavisse, Langlois et Seignobos avaient fait de l’Histoire dans un contexte où il s’agissait de
fournir un passé à la République et à la Nation dans sa préparation de la Revanche et d’imposer
l’Histoire comme une discipline universitaire. Tout naturellement ils avaient fait une Histoire du
politique, dans le cadre national et avec des objets et des méthodes spécifiques bien séparées de ceux
des autres sciences sociales.
Lucien Febvre et Mac Bloch affichent leur rejet d’une histoire ainsi au service du politique : ce
sera une constante du discours « annaliste ». Ils affichent leur rejet d’une histoire enfermer la
reconstitution d’un passé conçu principalement comme le récit d’évènements dont le seul lien est la
succession chronologique, enfermée dans le cadre de la seule recherche historique sans prendre en
compte les apports des autres sciences sociales (économie sociologie ethnologie…) enfermée dans le
cadre national associé aux archives nationales.
Le premier éditorial des Annales insiste sur la rupture qui consiste à faire tomber le mur qui
séparait l’Histoire des autres « sciences humaines ». Autre constante du discours analyste. Ce
rapprochement supposait un terrain de recherche commun. L’économie, la sociologie, l’ethnologie,
l’anthropologie, la géographie de l’école vidalienne sont implantées dans l’université, ces domaines de
recherches sont eux aussi en quête de scientificité. La psychologie, la philosophie, la linguistique
naissante sont moins implantées et suspectes de subjectivité, elles ont par ailleurs l’image de sciences
« bourgeoises » tournée sur l’introspection quand l’heure est au mouvement social. Ainsi dans son
livre sur la religion de Rabelais, Febvre explique pourquoi Rabelais ne « pouvait pas être athée » dans
le contexte intellectuel de son époque, il décrit un individu « prisonnier de son temps », des structures
de pensée en s’attachant davantage au contexte dans lequel a vécu son personnage qu’au personnage
lui-même. Rabelais est moins le sujet du livre que la religiosité au XVI°s. Cette idée de la primauté du
social sur l’individu rapproche les historiens des sociologues et des économistes, elle constitue
jusqu’au années 90 en tout cas une obsession des Annales (peut-on parler de paradigme ?), que nous
retrouverons porté à son paroxysme chez le meilleur élève de Lucien Febvre, Fernand Braudel.
Les historiographes des Annales ont tous souligné l’importance de l’expérience de la Grande
Guerre, en particulier pour Marc Bloch. L’expérience collective, le poids du nombre et la faiblesse des
individus que Bloch a éprouvé dans son expérience du front, puis ses interrogations sur l’étrange
défaite » de 1940 l’incite à rechercher des explications plus « profondes » que le choix des « grands
hommes » dans les évolutions de la société… Pour comprendre le monde dans lequel ils vivent les
historiens doivent s’intéresser aux collectifs. Le rôle des grands hommes apparaît comme contingent à
l’heure où les masses écrivent l’histoire. Le contexte du premier vingtième siècle guerre, révolution,
totalitarismes, apparaît aux historiens comme l’avènement du nombre. François Dosse fait par ailleurs
observer que si les Annales ne sont pas nées de la crise économique, la coïncidence est cependant
parlante : elle dit que la revue émerge dans un contexte ou la diplomatie (après l’épisode des traités) a
cédé le pas à l’économie comme le « rouage essentiel du pouvoir ». L’Histoire est fille de son temps !

3
3
B/ Les orientations épistémologiques : peut-on parler d’un paradigme des Annales ?
Dans l’éditorial du numéro du premier anniversaire (« Au bout d’un an, Annales 1930) les
directeurs écrivaient : « Si on avait mieux connu l’histoire économique, la situation économique, la
situation contemporaine en aurait été mieux élucidée »
C’est une position forte de la revue : toute histoire est contemporaine. Cette expression est du
philosophe italien Benedetto Croce. Cette position conduit Marc Bloch et Lucien Febvre à faire la
part belle à la période contemporaine dans la revue (Olivier Desmoulin a compté 42% des articles
entre 29 et 39).
Mais « contemporaine » l’Histoire l’est surtout, au sens où l’affirmait Croce, parce qu’elle
répond toujours à des problèmes que se posent les contemporains. On l’a vu c’était le cas des
historiens méthodistes qui s’occupait d’histoire politique et diplomatique, sans doute de façon assez
peu consciente. Febvre et plus encore Bloch en font un principe fondateur.
Dans son Rabelais, Lucien Febvre met en œuvre la première dimension de ce principe : la
problématisation. Il part explicitement d’un problème : l’incroyance supposée de Rabelais. Il construit
son étude à partir de cette hypothèse qu’il s’efforce d’invalider par l’étude du contexte dans lequel
évolue son sujet. Cette démarche hypothético-déductive est radicalement opposée à celle des
« méthodistes » pour lesquels l’histoire était avant tout « reconstitution du passé révolu ». C’est aussi à
travers ce type de démarche que l’Histoire s’ouvrait aux autres sciences sociales (sociologie, économie,
anthropologie…) qui s’attachent à « construire leur objet » selon une formule dont je vous ai déjà
parlé.
Selon Marc Bloch, dans l’Apologie pour l’histoire (1942), ce qui fait l'importance d'un
problème historique, ce n'est pas, principalement, la perspective théorique qui le sous-tend, mais le fait
que les historiens concernés soient d'accord pour privilégier l'étude de ce problème. La perspective
développée dans l'Apologie repose donc sur deux principes indissociables: pour élaborer leurs
questionnements et leurs vérités, les historiens doivent être à l'écoute du monde extérieur, mais dans
le même temps, ils doivent se montrer capables de "traduire" dans leur propre langage ses
interrogations et ses innovations. Selon lui, ce qui différencie la littérature et les sciences, c'est le fait
que ces dernières sont capables d'élaborer un langage commun à tous les chercheurs qui les
pratiquent.
L’articulation entre problématique sociale et problématique savante est au cœur de la réflexion
de Marc Bloch. L'historien s'adresse à deux communautés de lecteurs qu'il faut distinguer: la
communauté de savoir (les "historiens de métier") et la communauté de mémoire (le "grand public").
La difficulté tient au fait que les deux univers sont étroitement imbriqués. Marc Bloch insiste sur le
fait que l'exercice du métier d'historien exige un va et vient permanent entre le monde social, dont le
savant fait partie et auquel il est tenu de rendre des comptes, et la communauté professionnelle dont il
dépend. Les thèmes de recherche sur lesquels il travaille ne sont pas sans rapport avec les curiosités
ou les préoccupations qui dominent la société de son temps. Mais ils ne deviennent des problèmes
véritablement "historiques" que si l'historien est capable de les transformer en objets de recherche
adaptés aux exigences scientifiques de sa communauté. Dans un second temps, il doit néanmoins
restituer à la société les connaissances qu'il a élaborées grâce à ce travail de distanciation, afin d'aider
les hommes "à mieux vivre" en les guidant dans leurs activités pratiques. C'est grâce à ce double
mouvement que l'histoire peut à la fois conserver son autonomie et assumer son rôle social.
Ainsi s’établi un lien entre le présent (qui pose les questions) et le passé (qui apporte des réponses).
L’histoire contemporaine et le présent sont dans une continuité mais, pour les historiens des
Annales, le passé est passé, c’est bien ce qui différencie le passé historique du passé mémoriel. Il faut
donc, aux historiens, résoudre le problème qui consiste à comprendre les hommes du passé, bien
qu'ils n'appartiennent pas au même monde. Pour Marc Bloch, cette compréhension est possible par le
fait que les hommes à travers le temps ont en commun des caractéristiques qui définissent l'humanité
dans son universalité. C’est cette universalité qui permet aux historiens d’employer des concepts
comme «pouvoir, guerre, économie, classe sociale » à propos de périodes où ces concepts n’existaient
pas.

4
4
Pour autant ces historiens ne sont pas dupes de l’écart qui existe entre le discours des
historiens et la « vérité » historique. S'il n'existe aucun critère universel permettant d'évaluer l'activité
scientifique, il revient à chaque discipline d'élaborer ses propres normes de vérité. Comme les
"méthodistes" du début du XXe siècle, Marc Bloch pense lui aussi qu'une connaissance peut être
considérée comme "vraie" quand elle est acceptée comme telle par l'ensemble des spécialistes du
domaine concerné.
Au plan des méthodes de l’histoire, Marc Bloch et Henri Irénée Marrou s’attaquent à la
méthode érudite : Marrou : « peu à peu s’accumulent dans nos fiches le pur froment des « faits » :
l’historien n’a plus qu’à les rapporter avec exactitude et fidélité, s’effaçant devant les témoignages
reconnus valides. En un mot, il ne construit pas l’histoire, il la retrouve » Bloch : « Beaucoup de
personnes et même, semble-t-il, certains auteurs de manuels se font de la marche de notre travail une
image étonnamment candide. Au commencement, diraient-elles volontiers, sont les documents.
L’historien les rassemble, les lit, s’efforce d’en peser l’authenticité et la véracité. Après quoi, et après
quoi seulement, il les met en œuvre. Il n’y a qu’un malheur : aucun historien, jamais, n’a procédé ainsi.
Même lorsque d’aventure il s’imagine le faire ». C’est au manuel de Louis Halphen paru en 1946 qu’il
fait allusion « II suffit, de se laisser en quelque sorte porter par les documents, lus l'un après l'autre,
tels qu'ils s'offrent à nous, pour voir la chaîne des faits se reconstituer presque automatiquement. »
La source écrite n’est plus uniquement le texte : les historiens s’emparent de tout ce qui « fait trace »
iconographie (pas seulement artistique) objets (charrue) cartes… et du coup la source n’a plus de
limite. La perspective d’une fin du travail de l’histoire avec la fin du dépouillement des archives que
pouvait envisager Langlois et Seignobos disparaît.
Après les remous de la période de la guerre et la disparition de Bloch, Lucien Febvre prépare la relève
en annonçant un vent nouveau (éditorial du premier numéro de 1946 qui justifie le changement de
nom) avant de passer la main à un groupe de jeunes historiens qu’il a contribué à former autour d’une
pratique renouvelée du métier et de quelques convictions solidement établies. Retenons trois éléments
de cet héritage dans la pratique du métier
- L’appui sur la méthode historique
- L’importance des enquêtes collectives
- Le renouvellement des sources
Et cinq principes :
l’histoire est une : pas de cloisons étanches entre économie, politique, idées, art, etc ; Febvre
parle d’Histoire totale (notamment à propos d’Henri Pirenne, médiéviste, historien des villes)
l’historien procède par problèmes : le document ne répond que si on l’interroge, le travail de
l’historien repose sur des hypothèses de travail qu’il tente de vérifier à la lumière des
documents.
l’histoire traite des faits de masse plus que des « événements » ;
L’histoire ne traite pas seulement des faits matériels mais aussi des faits idéels (mentalités,
représentations…)
il existe une hiérarchie, et un jeu réciproque entre économies, sociétés, civilisations (cf. Marx :
infrastructures, structures, superstructures).
II. Le temps des géants : Labrousse, Braudel, 1946-fin des années 80
A/ Le modèle Labroussien
1) L’économie et les forces profondes
Dans la période précédente sous l’impulsion de Georges Lefebvre (moderniste spécialiste de
l’histoire rurale et de la Révolution) et du sociologue Maurice Halbachs, les Annales avaient déjà
privilégié l’histoire économique et sociale. Désormais celle-ci devient hégémonique. A la Sorbonne
règne pendant près de quarante ans, Ernest Labrousse qui place l’histoire économique au cœur de la
discipline historique. Son influence est telle que l’un de ses disciples, Pierre Chaunu peut affirmer «
toute l’école historique française est labroussienne. La pensé de Labrousse est tellement incorporée à

5
5
notre pratique de l’histoire (traitement du matériau et conceptualisation du discours) qu’il arrive qu’on
en oublie l’origine tant elle est devenue indiscernable à force d’avoir triomphé ».
Camille-Ernest Labrousse est à l’origine un économiste, il s’est imposé aux historiens (par
l’entremise de Georges Lefebvre) par sa démarche originale. La thèse de Labrousse (esquisse du
mouvement des prix et des revenus en France au XVIII° siècle, 1933) et son second grand ouvrage
fondateur (la crise de l’économie française à la fin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution,
P.U.F, 1944) posent la méthode labroussienne : une extrême rigueur dans la collecte des données et la
critique de la source (mercuriale des prix pour l’esquisse), une mise en série des informations pour
produire des « faits historiques » qui se définissent par la répétition et non par l’unicité, Labrousse
privilégie le régulier au détriment du singulier, une maîtrise des outils conceptuels de l’économie mis
au service de l’interprétation de ces faits et non l’inverse, une recherche des liens de causalités entre les
évolutions ainsi construites (prix, revenus, rente…) et les faits sociaux (Révolution).
Ce qui fait la force du modèle c’est le fait qu’il ne se réduit pas à une histoire économique
descriptive mais que les fluctuations de l’économie à travers les cycles de moyenne durée (10 ans cycle
Juglar) ou de longue durée (40-60 ans cycle Kondratieff) sont considérés comme des forces profondes
qui expliquent les faits sociaux. Pour parvenir à ce résultat Il faut comparer l’évolution des revenus
des différents groupes sociaux et observer leurs contradictions. Ainsi l’histoire économique du
XVIIIème siècle est-elle toute entière vouée à l’explication de l’évènement social par excellence qu’est
la Révolution Française. Labrousse démontre qui celle-ci intervient au moment où deux cycles (Juglar
et Kondratieff) sont à leur sommet c'est-à-dire à un moment où les écarts sont les plus forts entre les
revenus des salaires et les revenus de la rente foncière, entre les revenus des salaires et les prix. Le
modèle Labroussien fonctionne comme une pyramide dont la base est l’économie, sur laquelle se
construisent les réalités sociales (en particulier les différences de classe), la politique arrivant en fin de
raisonnement comme la résultante, la mise en acte des forces profondes. Du coup le travail de
l’historien se détache de l’écume du politique considéré comme superficielle pour s’intéresser aux
forces profondes. Le schéma emprunte largement à Marx. Labrousse a quitté le Parti Communiste
auquel il avait adhéré dans sa jeunesse dès les années 30, il demeure cependant marxiste dans sa
conception de la relation entre l’économie et la société.
2) La méthode sérielle
Ce qui permet à Labrousse d’emporter l’adhésion des historiens, y compris non marxistes
comme Braudel par exemple, c’est la position médiane qu’il adopte entre la simple restitution de
l’information de ses sources (attitude de l’histoire historisante) et la généralisation théorique (attitude
des sciences économiques). Bernard Lepetit expliquait sa démarche ainsi : « en schématisant le prix
relevé à la halle de Charleville est un prix réel, mais suspect de fausseté, tandis que le prix moyen du
royaume est un prix vrai mais sans réalité au sens ou il ne correspond à aucune expérience vécue. On
voit bien l’intérêt de la mercuriale pour résoudre la tension entre le principe de réalité et le principe de
vérité : par nature le document est représentatif du prix local et par sa masse du prix national ». C’est
l’ancrage dans le réel qui rattache la démarche à l’histoire classique et la capacité à lui en faire dire
davantage qui lui donne sa force novatrice.
Et pour maintenir ce fragile équilibre entre la généralisation et la prise en compte du « réel »,
Labrousse privilégie la monographie régionale et lance ainsi de grandes enquêtes, dont les Annales se
font le relais, sur le mouvement des prix dans les provinces sous l’Ancien Régime, formant pour cela
plusieurs générations d’historiens aux méthodes de l’histoire économique sérielle.
Labrousse lance une série d’études sur les groupes sociaux, dont la définition, préalable à la
recherche, est donnée par le critère économique (position dans le processus de production). Ce
qu’exprime clairement Jean Bouvier en 1965, « les « différences économiques sont le bâti sur lequel
prennent corps les diverses classes sociales ». Cette objectivation des groupes sociaux, pendant une
trentaine d’années, (jusqu’au années 70) a servi la production historique. Pour comparer les enquêtes il
fallait utiliser des catégories comparables.
Cette histoire sociale trouve en effet sa scientificité dans la démarche sérielle : elle s’organise
autour du dépouillement systématique de sources quantifiables (les mercuriales des prix pour les
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%