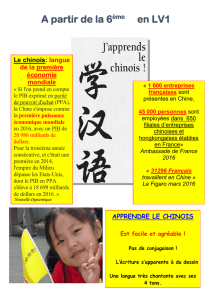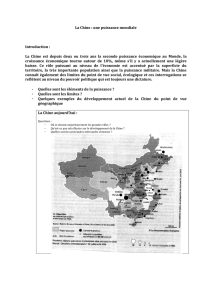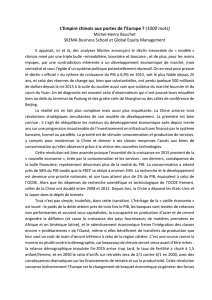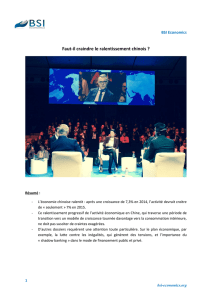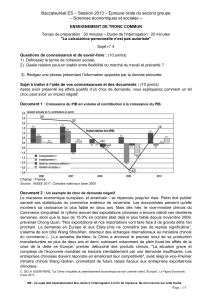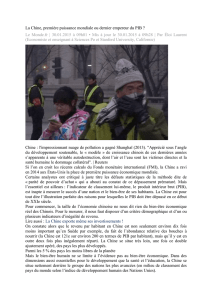estimation de l`impact sur l`économie mondiale d

N°32 JUILLET 2016
ECONOTE
Société Générale
Département des études économiques et sectorielles
CHINE : ESTIMATION DE L’IMPACT D’UN
RALENTISSEMENT CHINOIS SUR L’ÉCONOMIE
MONDIALE
Le ralentissement économique de la Chine et sa transition vers un
nouveau modèle de croissance pourraient fortement impacter l’économie
mondiale, en raison du rôle important et toujours croissant de ce pays dans
le commerce mondial et de son modèle économique fortement intensif en
matières premières.
Cette étude évalue dans quelle mesure un ralentissement
économique chinois impacterait l’économie mondiale, à travers trois canaux
de transmission : le commerce, les prix des matières premières, et les
marchés financiers. Pour quantifier cet impact, nous utilisons une
méthodologie de modélisation appelée «Global Vector Autoregressive
(GVAR)». Le modèle est estimé pour 36 pays (émergents et développés) sur
la période allant du T1-1995 au T3-2015.
Nos résultats montrent qu’un ralentissement chinois impacterait
fortement les économies asiatiques et les pays exportateurs de matières
premières à travers le ralentissement des échanges commerciaux, la baisse
des prix mondiaux de matières premières, et le choc de confiance sur les
marchés financiers mondiaux qu’il engendrerait. Les économies
développées seraient quant à elles moins vulnérables.
-0,35
-0,30
-0,25
-0,20
-0,15
-0,10
-0,05
0,00
Asie
Émergente
Amérique
Latine
Zone Euro
Developpés
Autres
Émergents
En %
IMPACT SUR LE PIB RÉEL D'UN CHOC
DE -1% SUR LE PIB RÉEL CHINOIS
Note: As ie Émergente: Corée du Sud, Inde, Indonésie, Malaisie, Ph ilippines, Thaïlande;
Autres Ém ergen ts : Arabie S aoudite, Afrique du Sud, Pologne, Russie, Turquie; Developpés:
Aus tralie, Canada, États-Unis, Nouvelle Zélande, Norvège, Suède, Suiss e, Royaum e-Uni;
Am érique Latine: Argentine, Brésil, Chili, Mexique, Pérou; Zone Euro: Autriche, Belgique,
Es pagne, Fin lande, Fran ce, Allem agne, Italie, Pays -Bas.
Sopanha SA1
+33 1 58 98 76 31
Sopanha.sa@socgen.com
Théodore RENAULT2
1 Nous remercions Jaime LEYVA
MARIN pour son aide à
l’élaboration de cette étude.
2Théodore RENAULT était
Économiste au sein du
Département des Études
Économiques et Sectorielles, au
moment de l'élaboration de cette
étude.

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016
2
INTRODUCTION
Depuis deux ans, le rééquilibrage de l’économie
chinoise au profit de la consommation et au détriment
de l’investissement et des exportations a débuté. Mais,
il s’est fait au prix d’une croissance économique plus
faible. Compte tenu du modèle économique de la
Chine fortement intensif en matières premières et de
l’importance croissante de ce pays dans l’économie
mondiale, un ralentissement et un changement dans la
structure de l’économie chinoise pourraient avoir des
répercussions importantes sur les autres économies.
Les canaux de transmission d’un ralentissement
chinois à l’économie mondiale sont multiples et
incluent le commerce, les matières premières, et les
marchés financiers. Un ralentissement chinois
entraînerait une baisse des exportations pour les
partenaires commerciaux de la Chine; les prix des
matières premières baisseraient également, affectant
les pays exportateurs de matières premières. La
dépréciation de la devise chinoise impacterait les pays
concurrents de la Chine sur leur marché domestique
et/ou sur des marchés tiers, alimentant des pressions
baissières sur leurs taux de change. Enfin, les
incertitudes sur la capacité des autorités chinoises à
réussir une transition en douceur vers le nouveau
modèle de croissance pourraient peser sur la confiance
des investisseurs et accroître l’aversion au risque, se
traduisant par une volatilité accrue sur les marchés
financiers mondiaux.
L’objectif de cette étude est d’évaluer dans quelle
mesure un choc sur la croissance chinoise affecterait
l’économie mondiale. En premier lieu, l’article présente
le nouveau modèle de croissance de la Chine et
l’impact observé sur l’économie mondiale. Puis, il
décrit la méthodologie utilisée pour quantifier cet
impact et détaille le modèle utilisé. Enfin, il présente les
répercussions qu’un choc négatif sur le PIB réel de la
Chine pourrait avoir sur le PIB réel des pays du reste
du monde, sur les prix des matières premières, et sur
les variables financières.
LE NOUVEAU MODELE DE CROISSANCE
DE CHINOIS ET SON IMPACT SUR
L’ECONOMIE MONDIALE
LA « NOUVELLE NORME »
Entre 1980 et 2006, l’économie chinoise a bénéficié
d’une croissance économique élevée, avec une hausse
du PIB réel de 10 % en moyenne par an — une
success-story due en grande partie à un modèle
économique reposant sur l’investissement et les
exportations. Au cours de cette période, les taux
d’investissement et d’exportation ont augmenté de
30 % et 5 % du PIB à 40 % et 36 % respectivement.
Ce fort taux d’investissement s’explique par trois
distorsions importantes de prix dans l’économie
chinoise. En premier lieu, les faibles taux d’intérêt ont
joué un rôle clé dans la hausse de l’investissement. Au
travers de la répression financière, les banques
publiques pouvaient financer l’investissement à
moindres coûts. En second lieu, le faible niveau des
salaires a dopé les exportations chinoises. L’offre
excédentaire de main-d’œuvre rurale et la politique des
« hukou »3 ont permis de maintenir des coûts salariaux
bas. Enfin, la sous-évaluation du renminbi (RMB) a
permis à la Chine de renforcer la compétitivité de ses
exportations et de gagner des parts de marché dans le
cadre de sa stratégie mercantiliste.
Depuis la crise financière mondiale de 2008, le modèle
de croissance de la Chine a subi d’importants
changements4. Tout d’abord, les exportations ont
considérablement ralenti et ne devraient pas fortement
rebondir à court terme. Une demande plus faible de la
part des économies développées ainsi que la perte de
compétitivité-prix liée à l’appréciation du RMB et à la
hausse des coûts salariaux ont pesé sur les
exportations chinoises. Par ailleurs, en réponse à la
crise financière de 2008, le gouvernement chinois a mis
en œuvre un important programme de relance
budgétaire, qui a entrainé une hausse du taux
d’investissement à 45 % du PIB en 2009. Ces
investissements massifs se sont traduits par des
surcapacités croissantes dans certains secteurs
industriels (tels que le cuivre, le charbon, etc.), comme
en témoigne la baisse des indices de prix à la
production, mais aussi dans le secteur immobilier, qui
accuse une forte hausse des surfaces vacantes depuis
2012. Enfin, la hausse des investissements, parfois
dans des projets inefficaces en raison d’une mauvaise
allocation des ressources, a été financée par une
croissance rapide et soutenue du crédit bancaire,
faisant croître le niveau d’endettement de l’économie
chinoise de 150 % du PIB en 2007 à 250 % en 2015.
Au cours du troisième plénum de 2013, reconnaissant
les limites du modèle de croissance, les autorités
chinoises ont annoncé un ensemble de réformes
destinées à rééquilibrer l’économie en axant la
croissance davantage sur la consommation et moins
sur l’investissement. Les réformes les plus poussées
ont été la libéralisation financière et l’ouverture du
compte de capital, mais toutes deux ont été rendues
3 Le Hukou est un système d’enregistrement des ménages
donnant accès à tous les services publics (éducation, santé,
logement) et à la protection sociale (maladie et soins pour les
personnes âgées) d’une région/province donnée.
4 Voir O. De Boysson et S Sa : « Chine : débat sur la croissance »,
Econote Société Générale, 2013.

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016
3
plus compliquées par les turbulences financières
survenues en 2015. Depuis lors, la Chine a lancé sa
transformation d’un modèle manufacturier traditionnel
tiré par l’investissement et les exportations vers une
nouvelle économie axée sur les services et la
consommation des ménages. Ce rééquilibrage n’est
néanmoins pas sans conséquence sur la croissance
économique. En 2015, la croissance chinoise a chuté à
6,9 %, son plus bas niveau en 25 ans. Elle devrait
continuer à baisser en dessous de 6 % à l’horizon
2020. Cependant, certaines inquiétudes demeurent sur
la capacité des autorités chinoises à assurer un
rééquilibrage en douceur et un ralentissement plus
prononcé de la croissance n’est donc pas à exclure.
LES EFFETS DE TRANSMISSION DU
RALENTISSEMENT CHINOIS : QUELQUES FAITS
STYLISÉS
Alors qu’à la fin des années 1990, la Chine représentait
environ 4 % du PIB mondial, elle est aujourd’hui la plus
grande économie mondiale (en termes de parité de
pouvoir d’achat), représentant plus de 17 % du PIB
mondial. La Chine est aussi devenue la première
puissance exportatrice au monde, les exportations
chinoises représentant environ 14 % des échanges
mondiaux de biens, contre 2 % en 1990 (Graphique 1).
0
2
4
6
8
10
12
14
1992
1995
1998
2001
2004
2007
2010
2013
En %
GR 1: PART DE MARCHÉ DANS LES
EXPORTATIONS MONDIALES -
COMMERCE DE BIENS
Chine
États-Unis
Allemagne
Japon
France
Inde
Brésil
Russie
Source : IMF, SG
Etant donné l’émergence de la Chine dans l’économie
mondiale au cours de ces dernières décennies, un
ralentissement de cette économie et/ou une
modification de sa structure pourraient avoir des
répercussions importantes sur l’économie mondiale,
notamment par le biais de trois canaux: ralentissement
du commerce mondial, chute des prix mondiaux des
matières premières, et choc de confiance sur les
marchés financiers mondiaux.
Le canal commercial
Le commerce international est un mécanisme de
transmission clé par lequel un choc sur le PIB chinois
pourrait avoir des effets importants sur l’économie
mondiale. Un ralentissement de l’activité économique
chinoise réduirait la demande de biens et de services
produits par le reste du monde, impactant ainsi
l’activité mondiale.
Les pays les plus exposés à un ralentissement de la
Chine au travers de ce canal commercial seraient les
pays dont les exportations vers la Chine représentent
une part importante de leurs exportations totales, mais
aussi dont les exportations comptent pour une part
importante de leur PIB. Le graphique 2 montre un
premier groupe de pays, incluant le Chili, la Corée du
Sud, la Thaïlande, et la Malaisie. Ces pays affichent
des taux élevés d’exportations par rapport à leur PIB et
d’exportations vers la Chine par rapport à leurs
exportations totales. Un second groupe de pays (Brésil,
Japon, et Philippines) affiche une exposition
commerciale modérée à la Chine, notamment avec un
taux relativement élevé d’exportations vers la Chine par
rapport aux exportations totales, mais avec un taux
faible des exportations totales par rapport au PIB. Ces
deux premiers groupes de pays, composés
exclusivement de pays d’Asie et d’Amérique latine,
devraient être plus impactés par un ralentissement
chinois que le troisième groupe de pays, composé
essentiellement de pays développés.
Néanmoins, au-delà des relations commerciales
directes bilatérales, quelques pays qui ont une part
relativement faible de leurs exportations à destination
de la Chine pourraient être affectés par un
ralentissement chinois du fait de la part élevée de leurs
exportations à destination de pays fortement
dépendant de la demande chinoise et/ou fortement
exposés aux prix mondiaux des matières premières.
AG
BR
CL
FR
BD
IN
ID
JP
KO
MY
MX
PH
RS
SA
SD
SW
TH
TK
UK
US
0
5
10
15
20
25
30
020 40 60 80
Exportations
vers la Chine en
% des
Exporta tions
Totales
Exportations en % du PIB
GR 2: EXPOSITION À LA CHINE
Source : IMF
Faible Moderée Forte
Le canal des prix des matières premières
Un ralentissement de la croissance chinoise risquerait
de peser également fortement sur les prix des matières
premières et, donc, sur les pays exportateurs de
matières premières. La demande croissante de la
Chine, due à son taux d’investissement élevé et à son

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016
4
processus d’urbanisation toujours en cours, a joué un
rôle clé dans le « supercycle des matières premières »
au cours de cette dernière décennie. La Chine
représente aujourd’hui 54 % de la demande mondiale
d’aluminium et environ 50 % de la demande mondiale
de nickel et de cuivre (Graphique 3). Les prix des
matières premières dépendent donc en grande partie
de la croissance chinoise. Les prix des métaux de base
seraient particulièrement sensibles à un ralentissement
de la Chine compte tenu de la place que tient
l’investissement dans le modèle économique chinois.
L’impact sur le prix du pétrole serait en revanche plus
limité compte tenu de la part beaucoup moins
importante de la Chine dans la consommation
mondiale de pétrole (12%). Cette part pourrait
néanmoins augmenter avec le rééquilibrage de la Chine
en faveur de la consommation, avec un fort potentiel
pour la demande de véhicules automobile (32 véhicules
motorisés pour 1 000 d’habitants actuellement, contre
814 aux États-Unis).
GRAPHIQUE 3 : PART DE LA CHINE DANS LA
CONSOMMATION MONDIALE
ALUMINIUM
54%
CUIVRE
48%
ZINC
46%
ACIER
45%
PÉTROLE
12%
SOJA
27%
MAÏS
22%
RIZ
30%
NICKEL
50%
La baisse de la croissance économique chinoise et la
transition d’une croissance basée sur l’investissement
vers un modèle axé sur la consommation sont
susceptibles de peser sur les prix mondiaux des
matières premières. Cet effet serait renforcé par les
efforts entrepris par les autorités chinoises pour réduire
les dommages environnementaux causés par le
modèle économique chinois fortement intensif en
matières premières. Par conséquent, les pays
exportateurs de matières premières (comme le Brésil,
le Chili, l’Angola, et l’Afrique du Sud) fortement
exposés à la Chine (par rapport à leurs exportations
totales et à leur PIB) risquent d’être fortement affectés
par le ralentissement chinois.
Le canal financier
Un ralentissement économique chinois devrait avoir un
impact direct assez limité sur les marchés financiers
mondiaux (actions, obligations, et changes), étant
donné la faible intégration financière mondiale de la
Chine (notamment due aux contrôles de capitaux
toujours en vigueur) comparée à son intégration dans
le commerce et l’économie mondiaux. Cependant, un
recul de l’activité en Chine et les incertitudes
concernant la transition en douceur vers le nouveau
modèle de croissance pourraient peser sur la confiance
des investisseurs internationaux et donc,
indirectement, sur les marchés financiers mondiaux,
notamment, sur les marchés de change et d’actions.
En août 2015, afin de rendre le régime de change du
RMB plus flexible, la Banque populaire de Chine
(PBoC) a établi un nouveau système de fixation du
cours du RMB qui s’est traduit par une mini-
dévaluation de 4% du RMB par rapport à l’USD
(Graphique 4). Cependant, suite à cette dépréciation du
RMB, les devises asiatiques se sont davantage
dépréciées, les marchés craignant la mise en œuvre
d’une politique de dévaluation compétitive de la part
de la PBoC.
90
100
110
120
130
140
150
160
janv.-15
mai-15
sept.-15
janv.-16
mai-16
2015 = 100
GR 4: TAUX DE CHANGE CONTRE USD
CNY
IDR
KRW
BRA
CHL
Source : Datastream
Le taux de change effectif défini comme la valeur d’une
devise par rapport à une moyenne pondérée par les
échanges commerciaux de taux de change bilatéraux
constituerait un meilleur indicateur que le taux de
change bilatéral pour évaluer l’impact d’un choc
externe (comme une dépréciation du RMB) sur les
devises. À cet égard, le poids important du RMB sur le
taux de change effectif du yen japonais, du won coréen
et du dollar taïwanais laisse penser qu’en cas de
dépréciation du RMB, ces devises pourraient subir
d’importantes pressions à la hausse. Outre leurs liens
commerciaux directs avec la Chine, le Japon, la Corée
du Sud, et Taïwan font aussi concurrence à la Chine
sur des marchés tiers (États-Unis et Europe), ce qui
rend leurs devises fortement exposées à une
dépréciation du RMB en cas de ralentissement de
l’économie chinoise.

ECONOTE | N°32 – JUILLET 2016
5
0
5
10
15
20
25
30
JP
KR
CL
AU
US
PE
NZ
TH
MY
SG
IN
ID
ZA
PH
BR
HK
AR
MX
TR
UK
DE
NL
NO
FR
CH
En %
GR 5: POIDS DU RENMINBI DANS LES
TAUX DE CHANGE EFFECTIFS RÉELS
Source : BIS
Les corrections enregistrées par le marché boursier
chinois en août 2015 et janvier 2016 (Graphique 6) ont
également impacté les prix des actifs mondiaux. Une
volatilité excessive des marchés financiers mondiaux
pourrait émaner d’incertitudes sur l’économie chinoise.
En effet, un choc négatif sur les perspectives de la
croissance chinoise pourrait augmenter l’aversion au
risque et avoir des répercussions considérables sur
l’économie mondiale.
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
Jan-16
Apr-16
2015=100
GR 6: INDICES DES MARCHÉS
FINANCIERS
Shanghai A
MSCI Monde
MSCI Pays Émergents
Source : Datastream
MODÉLISATION DES EFFETS D’UN
RALENTISSEMENT CHINOIS :
L’APPROCHE GVAR
LA MÉTHODOLOGIE GVAR
Etant données les interdépendances économiques et
financières entre les pays, l’analyse macro économique
a besoin d’étudier à la fois les variables domestiques et
étrangères. Initialement développé par Pesaran,
Schuermann et Weiner5 (2004), puis étendu par Dees,
5 M. H. Pesaran, T. Schuermann, and S.Weine: ”Modeling regional
inter-dependencies using a global error-correcting
macroeconometric model”; Journal of Business and Economic
Statistics, 2004.
di Mauro, Pesaran et Smith (2007)6, le modèle Global
Vector Auto-Regressive (GVAR) permet de prendre en
compte ces interdépendances entre un grand nombre
de pays à travers différents canaux de transmission.
Afin de tenir compte du rôle croissant de la Chine dans
l’économie mondiale, nous utilisons la méthodologie
GVAR pour modéliser les effets de transmission d’un
ralentissement chinois sur les différents pays (à travers
l’impact sur le PIB réel, sur le taux de change effectif
réel, et sur le cours des indices boursiers) et sur les prix
mondiaux des matières premières. Le modèle GVAR
présente plusieurs avantages par rapport aux autres
techniques de modélisation. En premier lieu, il nous
permet de modéliser les différents types d’interactions
entre un grand nombre de pays prenant donc en
compte les canaux indirects à travers des pays tiers
au-delà des seules relations bilatérales directes. En
second lieu, il nous permet de modéliser des variables
économiques (PIB réel) et financières (inflation, taux de
change effectif réel, cours des indices boursiers, et
taux d’intérêt) et des prix mondiaux de matières
premières de façon conjointe, à la différence des
travaux de recherche antérieurs qui les considéraient
de façon indépendante. L’estimation s’effectue en
deux étapes. Dans un premier temps, chaque pays de
l’échantillon est estimé individuellement à l’aide de
variables domestiques, de variables étrangères7
spécifiques à ce pays, et de variables mondiales
communes à tous les pays. En second lieu, un modèle
global est construit en combinant tous les modèles
individuels des pays et en les reliant par une matrice
reflétant les relations commerciales entre les pays.
Plusieurs articles ont estimé l’impact négatif d’un
ralentissement chinois sur différentes régions du
monde à travers différents canaux de transmission.
Utilisant un modèle GVAR, Gauvin et Rebillard8 (2015)
ont étudié l’impact d’un atterrissage brutal de
l’économie chinoise en adoptant une approche axée
sur les matières premières. Inoue, Kaya et Ohsige
(2015)9 ont analysé, également à l’aide d’un modèle
GVAR, les implications d’un ralentissement chinois sur
la région Asie-Pacifique. Enfin, face au récent regain de
6 S. Dees, F. Di Mauro, and M. H. Pesaran: “Exploring the
international linkages of the Euro Area: a global VAR analysis”;
Journal of Applied Econometrics, 2007.
7 Dans notre modèle, les poids dans le commerce sont utilisés
pour pondérer les variables étrangères.
8 L. Gauvin and Rebillard C : “Toward recoupling? Assessing the
global impact of a Chinese hard landing through trade and
commodity price channels”; Banque de France Working Papers,
2015.
9 T. Inoue, D. Kaya, and H. Ohshige: “The impact of China's
slowdown on the Asia Pacifc region”; World Bank Working
Papers, 2015.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%