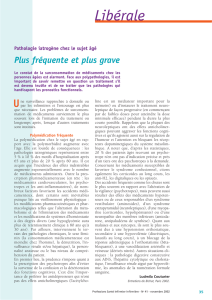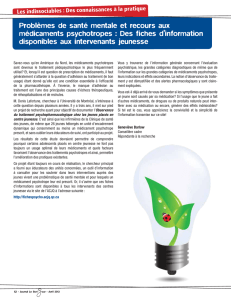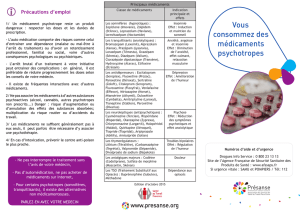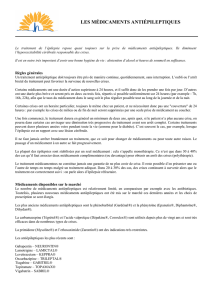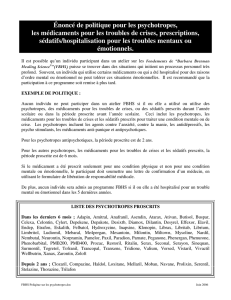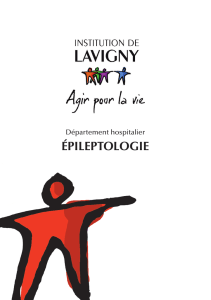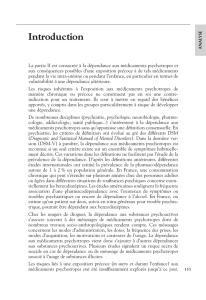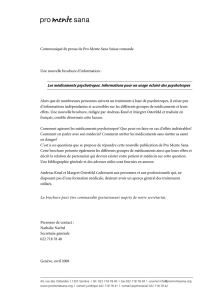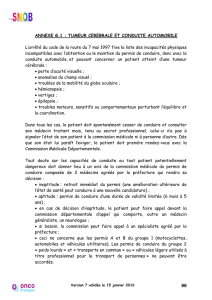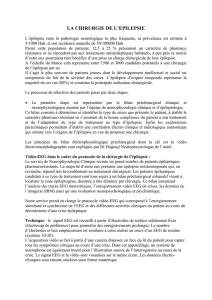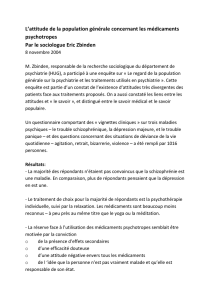effets psychotropes des antiépileptiques

à connaître
174 Neurologies • Mai 2014 • vol. 17 • numéro 168
ÉTAT DES LIEUX
DES PRESCRIPTIONS
D’ANTIÉPILEPTIQUES
La littérature nous apporte une
vision objective et récente des
prescriptions d’antiépileptiques
à l’échelle d’un pays : Landmark
et al. [1] quantifièrent l’usage des
antiépileptiques dans l’épilepsie
mais également dans d’autres in-
dications telles que la psychia-
trie, les douleurs neuropathiques
et les céphalées, au sein de la po-
pulation norvégienne entre 2004
et 2007, grâce à la base de don-
nées centralisée des prescrip-
tions de Norvège (soit un total de
5,1 millions de prescriptions pour
144 653 patients).
L’indication des prescriptions des
AE restait majoritairement l’épi-
lepsie, suivie par les indications
psychiatriques puis les douleurs
neuropathiques et enfin les mi-
graines. La répartition des pres-
criptions d’AE selon l’indication
clinique est présentée en
figure 1
.
De façon globale, les trois molé-
cules les plus employées en terme
de volume de prescriptions sont
la carbamazépine, la lamotrigine
et le valproate. Les nouvelles gé-
nérations d’AE concernent es-
sentiellement les prescriptions
pour migraine ou douleurs neu-
ropathiques (96 et 94 % du vo-
lume total des prescriptions dans
ces indications), alors qu’en psy-
chiatrie elles ne représentent que
64 % des prescriptions et seu-
lement 49 % pour une indica-
tion d’épilepsie. Les prescriptions
d’AE toutes indications confon-
dues sont à la hausse entre 2004
et 2007 avec une augmentation
de 642 % pour la migraine, 360 %
pour les douleurs neuropathiques,
Effets psychotropes
des antiépileptiques
Risques et bénéfices
n
Les antiépileptiques (AE) sont connus pour leurs propriétés psychotropes positives au travers
de leurs nombreuses indications dans le champ de la psychiatrie. Et ces indications peuvent
guider des prescriptions chez des patients épileptiques porteurs de symptômes psychiques
associés. Cependant, la connaissance des effets psychotropes négatifs de cette classe médi-
camenteuse est moins certaine et fait souvent appel à l’expérience personnelle des prescrip-
teurs. Or il s’agit d’un questionnement primordial pour le médecin neurologue car l’épilepsie
en elle-même, plus qu’une autre pathologie chronique, est associée à des pathologies psychia-
triques telles que les troubles de l’humeur, les troubles anxieux, la psychose…
Jean-François Visseaux1 et Anne Thiriaux2
1. Psychiatre, Hôpital Maison Blanche, service de Neurologie,
CHU de Reims
2. Neurologue, Hôpital Maison Blanche, service de Neurologie,
CHU de Reims
L’objectif de notre tra-
vail était de réaliser
une revue de la littéra-
ture afin d’éclairer cette question
des effets psychotropes des traite-
ments antiépileptiques tant posi-
tifs que négatifs et de proposer des
pistes d’optimisation des prescrip-
tions en tenant compte du terrain
sous-jacent. Au lieu de présenter
les résultats molécule par molé-
cule comme cela est souvent le cas
dans ce type de travail, nous avons
souhaité catégoriser les effets psy-
chotropes par grandes fonctions
psychiques impactées ou classe
de symptômes psychiatriques in-
duits, pour plus de lisibilité.

EffEts psychotropEs dEs antiépilEptiquEs
Neurologies • Mai 2014 • vol. 17 • numéro 168 175
200 % en psychiatrique et 7 % dans
l’épilepsie.
Il conviendra de retenir de ces
données qu’il existe une utilisa-
tion large des AE, avec une prédo-
minance des nouvelles molécules,
ainsi qu’une tendance à la hausse
des prescriptions plus marquées
en dehors des indications pour
épilepsie.
PHYSIOPATHOLOGIE DES
EFFETS PSYCHOTROPES
ET USAGE
EN PSYCHIATRIE
Les antiépileptiques font main-
tenant partie des thérapeutiques
médicamenteuses utilisées régu-
lièrement en psychiatrie. La litté-
rature identifie avec un fort niveau
de preuve des indications cliniques
en psychiatrie où les AE ont mon-
tré une efficacité clinique notable
[2] : efficacité des benzodiazépines
et du phénobarbital dans l’insom-
nie, efficacité des benzodiazé-
pines et de la gabapentine dans
les troubles anxieux, efficacité de
la carbamazépine, de l’oxcarbazé-
pine et du valproate dans la phase
maniaque des troubles bipolaires,
efficacité de la lamotrigine dans les
phases de dépression du trouble
bipolaire et enfin de la carbamazé-
pine et des benzodiazépines dans
le sevrage de l’alcool.
Cette efficacité et plus largement
les effets psychotropes des AE sont
liés à une physiopathologie spéci-
fique. Les effets psychotropes des
antiépileptiques s’expliquent par
deux mécanismes principaux [3],
à savoir :
• un premier mécanisme reposant
sur le profil psychotrope de l’AE
avec deux polarités définies par
Ketter et al. [4], l’une GABAergique
et l’autre anti-glutamatergique ;
• et un second mécanisme ré-
sultant d’une interaction entre
l’AE et le processus épileptique
sous-jacent.
A ces deux mécanismes viennent
s’ajouter deux mécanismes mi-
neurs complémentaires de nature
à engendrer des effets psycho-
tropes (5) :
• les phénomènes de toxicité
dose-dépendante ;
• et les syndromes de sevrage à
certaines molécules.
Précisons que le blocage des ca-
naux sodiques voltage-dépen-
dants ne semble pas participer
à la production d’effet psycho-
trope [4], bien qu’il s’agisse d’un
mécanisme d’action majeur des
antiépileptiques.
La classification établie par Ketter
et al. [4], bien que simpliste, auto-
rise un cadre de réflexion autour
du profil psychotrope des antiépi-
leptiques. Ce dernier oppose d’un
côté un effet GABAergique de type
sédatif indiqué sur les symptômes
psychiatriques, tels l’agitation et
l’angoisse, avec de l’autre côté un
effet antiglutamatergique de type
stimulant indiqué principalement
en cas de ralentissement et symp-
tômes dépressifs. Les différents
éléments et corollaires cliniques
de cette classification sont repris
dans le
tableau 1
.
EFFETS
PSYCHOTROPES
DES ANTIÉPILEPTIQUES
Au travers d’une revue de la lit-
térature [3-7], nous avons pu dé-
gager des catégories au sein des
grandes fonctions psychiques im-
pactées ou des symptômes psy-
chiatriques induits par les effets
psychotropes des AE. Ces effets
sont, pour une même catégorie,
soit positifs, soit négatifs, allant
dans le sens d’une amélioration ou
d’une détérioration.
Les grandes catégories ainsi iden-
tifiées comportent :
• la thymie,
• le comportement,
• l’anxiété,
• la psychose,
• la cognition,
• et le sommeil.
De façon accessoire existent éga-
lement des effets anorexigènes ou
confusiogènes. L’ensemble des ef-
fets répertoriés par cette revue de
la littérature est présenté dans le
tableau 2
.
Figure 1 - Répartition des prescriptions d’antiépileptiques en population générale
selon l’indication clinique. D’après Landmark et al. [1].

176 Neurologies • Mai 2014 • vol. 17 • numéro 168
à connaître
FACTEURS DE RISQUE
D’EFFET PSYCHOTROPE
NÉGATIF
Au-delà de la mise en évidence d’ef-
fets psychotropes négatifs, il est in-
téressant pour le prescripteur de
pouvoir identifier des facteurs de
risque de survenue de ces effets.
Il existe quatre grands types de
facteurs de risque :
1. Tout d’abord, Weintraub et al. [8]
mettent en évidence des facteurs
de risque liés à la molécule en
elle-même: certains AE sont plus
à risque de survenue d’effets psy-
chotropes négatifs en terme de
fréquence de survenue. Parmi les
AE à risque élevé, on retrouve le
lévétiracetam et la tiagabine ; pour
les AE à risque intermédiaire on
retouve le topiramate et le zonisa-
mide ; et enfin, pour les AE à risque
faible, on retrouve le vigabatrin, le
felbamate, l’oxcarbazépine, la ga-
bapentine et la lamotrigine.
2. Ensuite des facteurs de risque
liés aux antécédents neurolo-
giques sont soulignés par Mula
et al. [9], avec comme seul para-
mètre statistiquement significa-
tif la survenue de convulsions fé-
briles ; alors que l’âge de début de
l’épilepsie, la durée d’évolution
de l’épilepsie ou encore le type de
syndrome épileptique ne présen-
taient pas de significativité. Cette
sensibilité plus grande aux effets
psychotropes négatifs en cas de
convulsions fébriles s’expliquerait
par des lésions précoces du sys-
tème limbique [10].
3. Bien entendu, les antécédents
psychiatriques personnels et
familiaux sont des facteurs de
risque essentiels [8, 9]. Weintraub
et al. objectivaient 23 % d’effets
psychotropes négatifs sous AE
contre 12 % en l’absence de tels an-
técédents [8]. Il existe par ailleurs
une continuité entre les antécé-
dents psychiatriques personnels
et le symptôme potentiellement
induit par l’effet psychotrope né-
gatif : des antécédents de psy-
chose ou de troubles de l’humeur
auront tendance à engendrer des
symptômes du même champ psy-
chiatrique [11]. Au travers de ces
constatations, se pose la question
de savoir si l’effet psychotrope né-
gatif constaté est uniquement à
rapporter à la iatrogénie de l’AE,
ou s’il constitue plutôt une pre-
mière étape d’un processus patho-
logique conduisant à une patholo-
gie psychiatrique chronique [9].
4. Enfin, l’équilibre de la patho-
logie épileptique en lui-même
semble jouer un rôle dans la sur-
venue de certains effets psycho-
tropes, particulièrement les
symptômes psychotiques, et plus
accessoirement les comporte-
ments agressifs et les troubles
de l’humeur [9]. Il existe un lien
entre l’apparition d’une sympto-
matologie psychotique et la dispa-
rition des crises d’épilepsie sous
traitement, plus particulièrement
en cas de contrôle trop rapide [9].
Cette association pourrait être
une façon d’expliquer le concept
de “normalisation forcée”, encore
débattu à ce jour.
OPTIMISATION
DES PRESCRIPTIONS
D’ANTIÉPILEPTIQUES
L’optimisation du traitement an-
tiépileptique est à considérer se-
lon deux grands axes de réflexion :
• tout d’abord, l’adaptation de trai-
tement AE aux comorbidités et
antécédents psychiatriques du su-
jet traité ;
• ensuite, selon les interactions
médicamenteuses réciproques
entre AE et psychotropes.
Le premier axe peut se décliner se-
lon les quatre principaux cadres
Tableau 1 - Catégorisation des antiépileptiques selon leur profil
d’action et considérations cliniques. D’après Ketter et al. [4].
Profil GABAergique Profil
antiglutamatergique
Effets psychotropes
Sédatif, anxiolytique,
dépressogène,
antimaniaque
Stimulant, anxiogène,
antidépresseur
Molécules
Barbituriques
Benzodiazépines
Valproate
Vigabatrin
Tiagabine
Gabapentine
Topiramate*
Zonisamide
Felbamate
Lamotrigine
Oxcarbazépine
Lévétiracétam*
Profil psychique
”activé”1Indiqué Contre-indiqué
Profil psychique
”sédaté”2Contre-indiqué Indiqué
1. Le profil psychique dit “activé” regroupe les symptômes psychiques suivants : insomnie, agitation,
anxiété, tachypsychie et perte de poids.
2 . Le profil psychique dit “sédaté” regroupe les symptômes suivants : hypersomnie, asthénie, apathie,
affects dépressifs, ralentissement idéo-moteur et prise de poids.
* Le topiramate et le lévétiracétam s’intègrent imparfaitement dans cette classification [4, 5] mais, par
extension, on peut les classer ainsi [3].

EffEts psychotropEs dEs antiépilEptiquEs
Neurologies • Mai 2014 • vol. 17 • numéro 168 177
Tableau 2 - Effets psychotropes positifs et négatifs des antiépileptiques.
Effets psychotropes négatifs Effets psychotropes positifs
Thymie
Dépressogène :
• PB (adultes/enfants) avec idéations suicidaires
• PHT
• VGB (si antécédents de dépression)
• TPM (si polythérapie, titration rapide, antécédents
psychiatriques) avec troubles cognitifs
• FBM
• TGB (peu de données), avec possiblement troubles
cognitifs et psychose
• LEV (si antécédents de dépression)
• ZNS
Thymorégulateur :
• PHT (non conrmé)
• CBZ (thymorégulateur et antimaniaque)
• VPA (thymorégulateur, antimaniaque, antidépres-
seur)
• GBP
• LTG (thymorégulateur, antidépresseur)
• OXC (non conrmé)
Comportement
Agitation, agressivité :
• PB : syndrome de désinhibition (dès faibles doses,
adultes/enfants, sur retard mental)
• PHT (enfants surtout)
• BZD : réaction paradoxale
• VGB, FBM (surtout enfants avec troubles des appren-
tissages)
• GBP (adultes/enfants, sur retard mental)
• LTG (rare, sur retard mental)
• LEV (sur épilepsie avec risque majoré chez les
enfants) possible passage à l’acte hétéro-agressif
Sédation :
• PB
• PHT (effet dose-dépendant)
• CBZ (moindre)
• BZD
• VPA (moindre)
• GBP
• ZNS
Effet anti-impulsif :
• CBZ
• VPA (pour troubles de personnalité, hors démences)
• TPM (pour troubles de personnalité et patients
institutionnalisés)
Anxiété
Anxiogène :
• LTG (rare, avec symptômes obsessionnels compul-
sifs)
• FBM
• LEV (surtout si trouble anxieux préexistant)
Anxiolytique :
• PB
• CBZ
• BZD
• GBP (anxiété généralisée et trouble panique)
• TGB (anxiété généralisée)
• PGB (anxiété sociale)
Psychose
Propsychotique :
• PHT (effet dose-dépendant)
• VGB (en post-ictal ou lors du sevrage), surtout si
épilepsie sévère
• TPM (adultes/enfants, si polythérapie et antécédents
psychiatriques, et même hors pathologie épileptique)
• LEV
• ZNS
Antipsychotique :
• VPA (pour schizophrénie résistante)
• BZD, CBZ, LTG (à un degré moindre)
Toujours en association à un neuroleptique pour
renforcer son activité antipsychotique
Cognition
Altération cognitive :
• PB (dose-dépendant)
• PHT
• CBZ (modéré)
• BZD
• VPA (modéré)
• TPM (dose-dépendant, épilepsie ou non) avec
ralentissement, perplexité, troubles de concentration
et du langage
• ZNS (modéré)
Amélioration cognitive :
• LTG
• FBM
Sommeil
Insomnie :
• LTG (avec anxiété et irritabilité)
• FBM (augmentation des capacités de veille et
d’attention)
Hypnotique :
• PB
• BZD
Autre
Confusion :
• PB
• PHT (possible encéphalopathie chronique)
• BZD sur sevrage
• VPA (encéphalopathie, effet dose-dépendant)
Anorexigène :
• FBM
• TPM
• ZNS
PB (barbituriques) ; PHT (phénytoïne) ; CBZ (carbamazépine) ; BZD (benzodiazépines) ; VPA (valproate) ; VGB (vigabatrin) ; GBP (gabapentine) ; LTG (lamotrigine) ;
FBM (felbamate) ; TGB (tiagabine) ; TPM (topiramate) ; OXC (oxcarbazepine) ; LEV (lévétiracétam) ; PGB (pregabaline) ; ZNS (zonisamide).

178 Neurologies • Mai 2014 • vol. 17 • numéro 168
à connaître
nosologiques psychiatriques ren-
contrés en association avec l’épi-
lepsie [5, 6] :
1. Pour un patient épileptique
présentant une comorbidité
psychiatrique de type dépres-
sion, il convient d’éviter les AE
dépressogènes, et plus particuliè-
rement le phénobarbital, le viga-
batrin, la tiagabine, le topiramate
et de préférer la lamotrigine.
2. En cas de comorbidité de
type psychotique, on évitera les
AE propsychotiques, et plus par-
ticulièrement le vigabatrin, le to-
piramate, la phénytoïne . Et il
conviendra de porter une atten-
tion particulière en cas d’usage du
lévétiracétam. On préférera utili-
ser le valproate, possiblement en
association à un neuroleptique si
la clinique psychiatrique l’exige.
3. En cas d’anxiété associée, on
évitera les AE à effet anxiogène et
plus particulièrement la lamotri-
gine, le felbamate et le lévétiracé-
tam au profil d’AE anxiolytiques, à
savoir les benzodiazépines, la ga-
bapentine et le prégabalin.
4. Enfin, en cas d’agitation et
ou trouble du comportement
on évitera l’usage de la lamotri-
gine pouvant entraîner insom-
nie, anxiété, voire hypomanie,
ainsi que le lévétiracétam de na-
ture à déclencher des passages à
l’acte violents. On préférera dans
ce cas le valproate pour ses effets
sédatifs et anti-impulsifs, et ce
plus particulièrement si coexiste
un trouble de la personnalité
sous-jacent.
Le second axe doit prendre en
compte les interactions réci-
proques entre AE et psychotropes.
Les principaux éléments du travail
de Brodtkorb et al. (6) sur ce point
sont repris ci-dessous :
• La première donnée à consi-
dérer est le pouvoir inducteur
enzymatique de certains AE
(carbamazépine, phénobarbital,
phénytoïne) responsables d’une
décroissance des taux plasma-
tiques en psychotropes. Par op-
position, le valproate ne pré-
sente pas ce problème et devra
donc être privilégié si l’on sou-
haite minimiser ce premier type
d’interaction.
• Inversement, certains psycho-
tropes sont de nature à modifier
les concentrations circulantes
d’AE. A ce titre, il conviendra de
préférer les antidépresseurs séro-
toninergiques aux tricycliques qui
présentent moins d’interactions
avec les AE et, au sein de cette
classe la paroxétine, le citalopram
et la sertraline qui ne semblent
pas influer sur les concentrations
d’AE. Pour ce qui est des neurolep-
tiques, on privilégiera la risperi-
done pour les mêmes raisons.
• Ensuite, il faut considérer les ef-
fets indésirables add-on syner-
giques entre AE et psychotropes.
Ces effets peuvent intéresser le
système nerveux central, avec
des symptômes comme la séda-
tion, la prise de poids ou les trem-
blements, ou encore le système
hématopoïétique, avec des risques
d’anémie ou de leucopénie pou-
vant aller jusqu’à l’agranulocytose
(on se méfiera particulièrement
de l’association carbamazépine/
clozapine).
• Si l’action principale des an-
tiépileptiques est d’augmenter
le seuil épileptogène, certains
psychotropes présentent l’ef-
fet inverse: on évitera ainsi plus
particulièrement la clozapine et
la chlorpromazine pour les neu-
roleptiques et le bupropion pour
les antidépresseurs (12) qui pré-
sentent un risque épileptogène
élevé. Précisons que ce risque est
faible pour la plupart des autres
psychotropes à dose usuelle et en
association à un traitement AE
bien conduit.
CONSENSUS AUTOUR
DES TROUBLES NEURO-
COMPORTEMENTAUX
LIÉS AUX AE DANS
L’ÉPILEPSIE
Bien qu’il n’existe pas de recom-
mandations officielles en France
concernant la prise en charge
1. Troubles neuro-comportementaux et AE :
recommandations d’experts [13]
Concernant l’estimation et la prise en charge des troubles neuro-com-
portementaux des AE dans l’épilepsie, les recommandations issues du
groupe de travail expert sont les suivantes :
• Risque plus élevé de troubles cognitifs et comportementaux : en cas
de polythérapies, titration rapide, hauts dosages.
• Atteinte cognitive : plus marquée avec le phénobarbital et le topiramate,
mais égale pour les autres molécules. Nécessité de prévenir le patient.
• Suivi plus régulier à l’introduction d’un AE si : épilepsie pharmaco-
résistante, épilepsie impliquant les régions temporo-limbiques, ou
antécédents psychiatriques personnels ou familiaux.
• Suivi régulier une fois le patient épileptique libre de crises si : antécé-
dent de décompensation psychotique ou de modications transi-
toires du comportement.
• Si décroissance d’un AE thymorégulateur : décroissance précaution-
neuse et lente chez les patients avec des antécédents de troubles de
l’humeur.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%