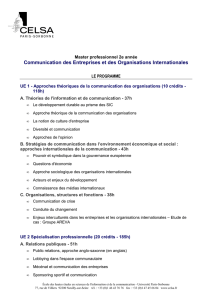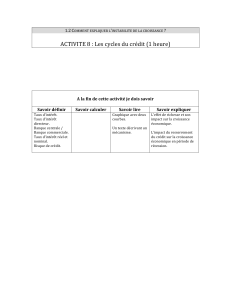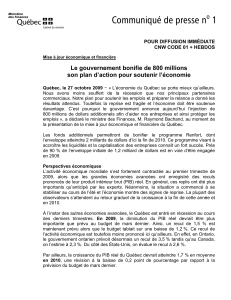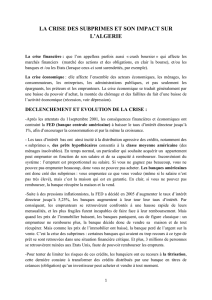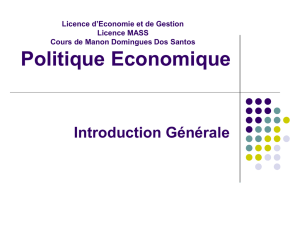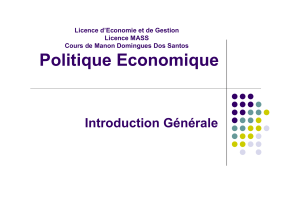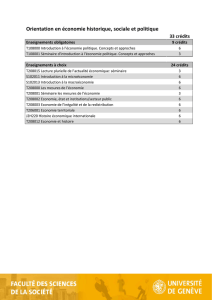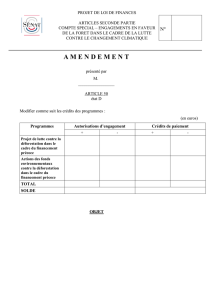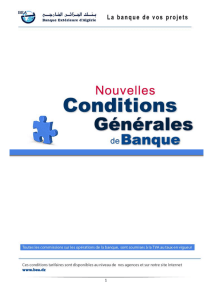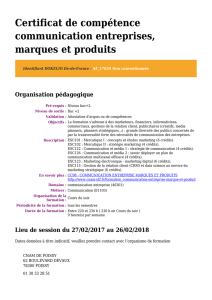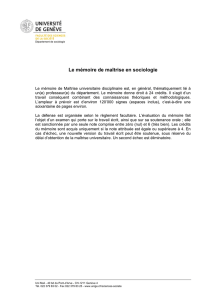Mille milliards de dollars pour sauver l`économie mondiale

28
Le groupe des États économiquement les plus forts (G20) s’est entendu
sur un paquet de mesures pour combattre la crise économique et nan-
cière mondiale. Le Premier ministre du pays hôte, Gordon Brown, estime :
« Un nouvel ordre mondial émerge et nous entrons par conséquent dans une
nouvelle ère de coopération internationale ». C’est à coup sûr une exagération.
Des principes pour la réforme du système nancier ont été débattus à la
conférence, avec plus de régulation pour les banques, les hedge funds et les
rémunérations des dirigeants. Les pas concrets ne sont pas clairs. Est restée
ouverte aussi la manière de se débarrasser des crédits et des titres toxiques.
C’est ce que le FMI, soutenu par de nombreux économistes, considérait pour-
tant comme une condition importante pour combattre avec succès le crise -
nancière.
Quels sont les résultats concrets ? D’abord l’augmentation de la dotation
permettant au FMI de disposer de 500 milliards de dollars, ainsi que des droits
de tirage additionnels de 250 milliards de dollars. Par ailleurs, un paquet de
250 milliards de dollars a été alloué au commerce international et les fonds
des banques de développement ont été augmentés. L’ensemble de ces mesures
se monte à 1 100 dollars. L’élargissement des lignes de crédit est à coup sûr
une contribution à la stabilisation de l’économie mondiale mais la mise en
œuvre concrète prendra un certain temps.
Mille milliards de dollars
pour sauver l’économie mondiale
Crise économique mondiale et alternatives
Joachim Bischoff

29
Mille millards de dollars pour sauver l’économie mondiale
Depuis des années, nous voyons le fossé entre les annonces de ce type de
sommets et leur mise en œuvre pratique. Il y a de petits progrès mais il n’y a
pas eu jusqu’ici de décision marquant un changement d’époque. Cela sera encore
le cas avec le sommet de Londres. Les déclarations nales consistent en promes-
ses, vite oubliées, violées sans vergogne et qui, dans le meilleur des cas, n’ont pas
de contenu. Pour les responsables politiques participant, le plus important était de
donner aux électeurs l’impression qu’on essaie ensemble de sortir de la crise.
Où en sommes-nous en n de compte ?
La crise nancière qui a éclaté en 2007 s’est transformée à partir du sec-
teur étroit des prêts hypothécaires – c’est-à-dire des crédits sur des terrains
bâtis – en une crise nancière et une crise du crédit mondiales. Il n’est plus
contestable que la suite nous a confrontés à la décroissance de l’économie
réelle, ce qui veut dire que l’industrie, les services et le commerce mondial
sont en forte régression.
La thèse d’une récession mondiale, forte, ayant pris cette fois une forme
plus aiguë mais clôturant le cycle économique conjoncturel, donne une image
fausse du développement social. Nous sommes confrontés à une crise sévère.
De mon point de vue, le débat pour savoir s’il s’agit d’une crise systémique
ou de l’effondrement de l’économie capitaliste apporte peu d’explications.
Je soutiens par conséquent qu’il s’agit d’une « crise du siècle », que l’on peut
comparer à maints égards à la crise économique mondiale des années 1930 1.
Certes, la réaction à la rupture structurelle dans l’accumulation monétaire
et celle du capital n’a pas été une diminution des revenus ou une politique
nancière et scale restrictive pour les budgets publics, contrairement à ce
qui s’est passé dans les années 1920. Que les sociétés capitalistes s’engagent
durablement dans une phase déationniste et dépressive dépendra pour une
large part de l’importance et de la forme de l’intervention des États.
Les problèmes liés à la crise du siècle dureront pendant au moins une ou
deux périodes d’un cycle économique (4 à 6 ans). Ce sont les programmes
anticrise qui ont été adoptés n 2008 qui décideront de la longueur et du dé-
roulement de la crise économique. Ils sont certes beaucoup mieux adaptés
que dans les années 1930 mais restent cependant insufsants par rapport à ce
qu’il faudrait. La crainte des effets négatifs de l’apport de crédits publics agit
comme un élément de blocage des mesures anticrise. Keynes faisait remar-
quer à juste titre : « Le long terme induit en erreur dans l’action quotidienne.
À long terme nous serons tous morts. Les économistes (et les politiques) se
rassurent à bon compte quand ils se contentent de dire, en période de tempête,
que la mer redeviendra calme quand la tempête sera passée ». Jusqu’ici rien
n’indique que la tempête faiblisse et, dans cette mesure, il existe toujours des
possibilités d’inuencer son cours.

30
Joachim Bischoff
Double stratégie de la gauche politique
Fondamentalement, la gauche politique doit adopter une stratégie double
de conquête de l’hégémonie politique. D’un côté il s’agit, au cours du pro-
cessus de crise, de mettre le néolibéralisme, à qui la crise a enlevé les bases
économiques et sociales de son action politique, conceptuellement aussi sur la
touche dans le cadre des politiques anticrise. D’un autre côté, on peut avancer
sur cette base vers une économie solidaire, avec de nouveaux rapports entre le
marché et la régulation publique par la société.
Dans sa prise de position sur les programmes conjoncturels allemands,
l’économiste Heiner Flassbeck dit avec raison : « L’Allemagne est dans la
phase économique la plus difcile de l’après-guerre. L’auto-stabilisation de
la conjoncture n’est pas en vue. Contrairement à ce qui se passait au cours
des crises précédentes, il n’existe pas de zones et de secteurs économiques
dans le monde qui montreraient une tendance au retour de la croissance et
pourraient jouer le rôle de contrepoids à la dépression. L’Allemagne n’est pas
moins mais davantage menacée par une récession globale à cause de la part
exorbitante des exportations et une faible demande interne due à la faiblesse
des salaires réels depuis plusieurs années […] À côté de sa dimension mon-
diale, le moment présent est aussi décisif sur le plan de la temporalité : plus
la phase de décroissance sera longue, plus elle sera large et forte. Le ralen-
tissement conduit à la stagnation, la stagnation à la récession et la récession
peut donner une dépression durable. En même temps, l’ination, qui était, il
y a peu, le problème principal, se transforme en diminution notable et rapide
de l’augmentation des prix et en tendance déationniste qui peut devenir une
vraie déation […] La crise des marchés nanciers et celle de la conjoncture
se renforcent mutuellement. Beaucoup continuent à ignorer le problème cen-
tral de la crise. Ce que nous vivons, ce n’est pas un reux cyclique normal,
comme il en existe régulièrement, mais une chute sévère de l’investissement
global, dont la cause est d’abord le fait que, pendant et après la crise nan-
cière, la formation des prix, qui est décisive pour les investisseurs, a connu un
glissement important, à très grande vitesse, et partout dans le monde. » 2. Cette
appréciation vaut pour les autres principaux pays capitalistes.
Les conclusions découlant de ce schéma de « crise du siècle »
1. Nous sommes confrontés à un système nancier insolvable et à un sys-
tème bancaire en faillite qui doit être recapitalisé. Jusqu’ici on pensait que les
crédits ou les garanties publics pourraient rendre aux actifs dévalorisés leur
valeur marchande passée. Marx déjà dénonçait cette illusion pour surmonter
une crise nancière : un processus social de reproduction qui se développe
à partir du crédit ne peut naturellement pas être assaini par une banque, par

31
Mille millards de dollars pour sauver l’économie mondiale
exemple la banque d’Angleterre, qui redonnerait à tous les perdants, grâce à
son statut de banque centrale, le capital qui fait défaut en rachetant les valeurs
dévalorisées à leur valeur nominale ancienne.
Les volumes nanciers fortement gonés auparavant ont été réduits par la
crise. C’est la raison pour laquelle la nationalisation des institutions nanciè-
res n’est pas une solution en soi mais seulement un pas décisif vers un partage
organisé de la perte de valeur. Cela concerne aussi bien les corrections de la
valeur des titres de toute nature que l’annulation des crédits qui ne peuvent
plus être recouverts. L’idée qu’on pourrait assainir la situation par l’injection
de crédits publics et de garanties de l’État est une erreur qui ne fait que pro-
longer le processus d’adaptation à la crise.
2. Nous sommes nalement devant une conjoncture qui est aussi dégra-
dée – et même davantage, à l’échelle du monde – que la crise du siècle des
années 1930. Dans un système productif où la croissance économique des
années passées était due pour l’essentiel au développement du crédit, la ques-
tion des liquidités devient la question clé quand le boom du crédit prend n
et que les actifs sont fortement dévalorisés. Quand la cohésion du processus
de reproduction repose sur le crédit, que le crédit tarit brusquement, que seul
le paiement en espèces subsiste, la crise et une demande forte de liquidités
deviennent inévitables. La critique de l’économie politique considère cela
comme une phase particulière du processus de crise : « C’est là le moment
particulier des crises du marché mondial qui s’appelle crise monétaire. Le
summum bonum qu’en de pareils moments on appelle à grands cris, comme
la richesse unique, c’est l’argent, l’argent comptant, et toutes les marchan-
dises, précisément parce que ce sont des valeurs d’usage, paraissent, auprès
de lui, des choses inutiles, des futilités, des jouets. Cette subite conversion
du système du crédit en système monétaire ajoute l’épouvante théorique à la
panique pratique et les agents de la circulation demeurent consternés devant
l’impénétrable mystère de leurs propres rapports économiques. » (Karl Marx,
Critique de l’économie politique).
La crise nancière résulte fondamentalement du fait qu’une grande partie
des actifs, de titres de toute nature (c’est-à-dire des droits à une part future de
la richesse sociale), a été brutalement dévalorisée. La crise est là précisément
lorsqu’on ne peut plus payer avec ces actifs mais avec de l’argent. La fonction
de la monnaie comme moyen de paiement s’impose dans les crises nanciè-
res ; l’enchaînement des paiements est perturbé parce que la possession de
liquidités devient le principe essentiel.
3. En troisième lieu, certaines dettes doivent être effacées. C’est le cas, par
exemple pour celles des ménages privés aux États-Unis, en Grande-Bretagne,
en Australie, en Irlande, en Espagne, en Grèce, etc. Dans la mesure où, à
moyen terme, on ne peut s’attendre au nivellement des revenus et à la dispari-
tion de la fracture sociale, une réforme du système nancier risque de tourner

32
Joachim Bischoff
à vide. Une des raisons essentielles de la formation de la bulle sur les marchés
nanciers est la concentration de la richesse sociale. Une correction substan-
tielle de cette répartition inégale des revenus et des richesses est la condition
du succès de la stabilisation. Par ailleurs il faut mettre n à la privatisation de
formes importantes de la sécurité sociale et revenir sur celles qui ont eu lieu
(retraites, santé, éducation).
4. Aller vers un nouveau système économique et nancier est indispensable.
La crise a montré que le pilotage des marchés et des capitaux sans régulation
politique et contrôle démocratique a conduit de nouveau à une catastrophe
sociale. C’est pourquoi le contrôle démocratique et la coopération interna-
tionale sont nécessaires. La surveillance nancière au plan national et la
coopération internationale entre les institutions de régulation et les auto-
rités de surveillance, notamment au sein de l’UE, doivent être renforcées
et démocratisées. À l’échelle du monde, il faut imposer des limites au li-
bre-échange non régulé et à la mobilité illimitée du capital. Un nouvel ac-
cord international doit corriger les faiblesses du régime de l’après-guerre de
Bretton Woods et privilégier dans la durée la stabilité nancière, la justice
scale, la justice sociale, au détriment de la libre circulation des capitaux, des
marchandises et des services. Les droits sociaux et les acquis historiques des
salariés doivent être garantis.
Au regard de la crise économique la plus sévère depuis les années 1930, qui
a été provoquée par un effondrement du système nancier, la défense contre
les risques systémiques et la mise en œuvre d’une nouvelle régulation du sec-
teur nancier sont au centre des politiques actuelles. La thèse est certainement
pertinente : sans stabilisation du secteur nancier, il n’y aura pas de reprise
économique durable.
Nous devons prendre conscience du double caractère du système du crédit :
« Si le crédit est le levier principal de la surproduction et de la spéculation à
l’excès, il en est ainsi parce que le procès de reproduction, naturellement très
élastique, est forcé à l’extrême, ce qui est dû à ce qu’une grande partie du
capital social est appliquée par des individus qui n’en sont pas propriétaires et
qui s’en servent avec bien moins de prudence que les capitalistes produisant
avec leurs propres capitaux. Les entraves et les limites immanentes que la
mise en valeur du capital oppose à la production dans la société capitaliste
sont donc continuellement brisées par l’organisation du crédit, qui accélère
le développement matériel des forces productives et la création du marché
mondial, base matérielle de l’avènement de la nouvelle forme de production.
La dissolution de l’ancienne forme est d’autre part activée par les crises dont
le crédit accentue la fréquence. Le crédit a donc ce double caractère d’être,
d’une part, le pivot de la production capitaliste, le facteur qui transforme en
un colossal jeu de spéculation l’enrichissement par le travail d’autrui et qui
ramène à un nombre de plus en plus restreint ceux qui exploitent la richesse
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%