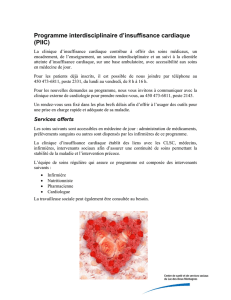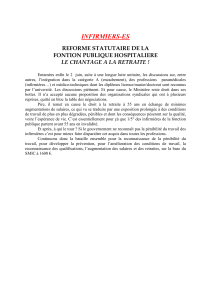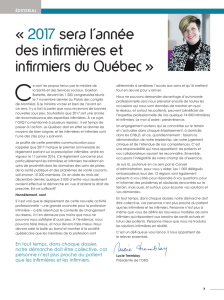Le recours à la contention physique aux soins intensifs

LE JOURNAL DES SOINS INFIRMIERS DU CHUM
Vol.12 - No 2 - Été 2012
Le recours à la
contention physique
aux soins intensifs
Le recours à la contention physique inter-
pelle le personnel des établissements de
soins aux plans éthique, légal et clinique.
Les infirmières des soins intensifs sont
particulièrement confrontées à des situa-
tions où la sécurité du patient peut être
compromise, parce que son état de santé
est critique et les risques de complications
élevés. Craignant de graves préjudices,
les infirmières ont tendance à recourir
d’emblée à la contention physique pour
tous les patients ventilés mécaniquement.
Or, les études démontrent que la conten-
tion représente aussi un risque pour le
patient (Maccioli et al., 2003; Poulain
et al., 2004). Comment donc concilier
situations critiques et recours judicieux
aux contentions?
UN GAGE DE SÉCURITÉ POUR QUI?
Aux soins intensifs, on ne peut éliminer le recours à la contention; toutefois son
utilisation doit constituer la dernière option, même si elle apparaît la solution optimale
pour prévenir l’interférence aux traitements lorsque le patient est agité ou présente
un risque d’agitation. C’est d’ailleurs la principale raison invoquée par les infirmières
des soins intensifs pour recourir à des contentions. Une fois en place, les infirmières
sont réticentes à assumer le risque et les conséquences possibles d’un retrait de ces
mesures de contrôle (Happ, 2000). Les professionnels de la santé des soins intensifs
doivent composer avec l’état critique des patients et le danger imminent et grave si
le patient enlève son tube endotrachéal ou un cathéter essentiel à sa survie. Plusieurs
études démontrent pourtant que l’utilisation d’une contention physique, comme les
attaches aux poignets, n’est pas une garantie contre l’auto-extubation (Balon, 2001;
Birkett, Southerland et Leslie, 2005; Chang, Wang et Chao, 2008; Curry et al., 2008).
Le tableau 1 répertorie les réactions possibles de l’application des contentions aux
plans physique et psychologique. À titre d’exemple, plus d’un tiers des patients mani-
festeraient des réactions psychologiques telles que la colère, l’anxiété, l’agitation, la
dépression, une augmentation de la confusion et une détérioration cognitive.
Le 7 mai dernier avait lieu au CHUM la
Journée du savoir infirmier. Instaurée en
2010 par le Conseil des infirmières et
infirmiers, cette activité est une occasion
de faire connaître les divers projets mis
en place par les infirmières, les infirmières
auxiliaires ou des étudiantes en sciences
infirmières. La communauté du CHUM
était également invitée à découvrir les
réalisations de leurs collègues des soins infirmiers. À la fin de la journée et après
la compilation des votes des visiteurs, le prix coup de cœur d’une valeur de 550 $
a été remis à Mmes Pamela Gariépy, infirmière du 5e Le Royer, et Chi Quan Bach,
infirmière en soins de pieds (pratique privée) pour leur présentation Infirmières,
avez-vous regardé mes pieds ? Les présentations suivantes ont respectivement
obtenu les 2e et 3e places : L’évaluation systématique des arythmies par Nathalie
Duchesne, infirmière du 4e Le Royer, Marie-Carla Thermidor, conseillère en soins
spécialisés, et Chantale Couture, conseillère en soins infirmiers, et L’approche
motivationnelle par quatre étudiants de la Faculté des sciences infirmières de
l’Université de Montréal. Toutes nos félicitations !
JOURNÉE DU SAVOIR INFIRMIER
Catherine Derval, inf. M.Sc.
Catherine Derval est conseillère en soins spécialisés par intérim,
regroupement oncologie et hématologie.
>> suite à la page suivante

PAGE 2 L’AVANT-GARDE VOL. 12 NO 2 - ÉTÉ 2012
L’infirmière met aussi en œuvre des stratégies préventives des
risques liés à leur utilisation et des mesures alternatives qui
respectent le patient et sa famille. Le camouflage des cathéters,
le soulagement de la douleur et la réorientation fréquente du
patient ne sont que quelques exemples de stratégies.
UN OUTIL ADAPTÉ À LA RÉALITÉ DES SOINS INTENSIFS
Afin de guider les infirmières, un outil d’aide à la décision a été
élaboré et validé par des infirmières des soins intensifs du CHUM
(voir le tableau 2). Pour chaque élément figurant dans les
encadrés, des stratégies sont proposées. Par exemple, un patient
des soins intensifs admis depuis huit jours pour choc septique
est intubé. Le rapport indique qu’il présente un délirium et
des périodes d’agitation. À votre entrée dans la chambre,
deux attaches aux poignets sont en place. Le patient est très
calme en présence de sa conjointe. Celle-ci vous demande si
elle peut faire quelque chose pour aider. Tel qu’indiqué dans le
premier encadré, l’infirmière évalue l’état clinique du patient et
la situation. La sécurité du patient est-elle compromise présente-
ment ? Le maintien de la contention est-il pertinent? Pourrait-on
tenter de détacher les attaches en présence de la conjointe ?
Si tel est le cas, quelles directives pourrait-on inscrire au PTI?
Ces quelques questions contribuent à une prise de décision
éclairée fondée sur un jugement clinique. Ainsi, il n’y a pas
de bonne ou de mauvaise décision si elle est justifiée par une
démarche réflexive.
Le recours à la contention constitue une décision réfléchie et
concertée avec l’équipe interdisciplinaire. Afin d’outiller les
infirmières des soins intensifs dans leur décision, l’algorithme
décisionnel proposé trace les différentes dimensions à considérer.
La conseillère en soins spécialisés peut aussi être consultée en
situations complexes.
Nous voici de retour avec un contenu axé sur
le partage des différentes activités (réalisées
ou en cours) pour améliorer la qualité des soins
dispensés à la clientèle. En effet, l’identification
sécuritaire d’un patient est une préoccupation de
tous les jours et nous vous sensibilisons à ce sujet;
l’amélioration continue des pratiques profession-
nelles en matière de gestion des plaies de pression
est prise en compte et parta-
gée; la Semaine de l’infirmière,
en mai dernier, et la remise
des prix Reconnaissance aux
infirmières et aux infirmières
auxiliaires du CHUM nous
ont permis d’apprécier de
nombreux modèles de rôle
dans notre organisation; et
la question des contentions
physiques aux soins intensifs a
fait l’objet d’un projet de maîtrise, lequel vous est
également présenté.
De plus, dès l’automne prochain, le développe-
ment des compétences de leadership et de
raisonnement cliniques des infirmières sera aussi
encouragé par des activités éducatives, proposées
dans le cadre d’un projet de recherche mené par
la Faculté des sciences infirmières, en partenariat
avec le CHUM et le CHU Sainte-Justine.
Voilà donc un survol du contenu du présent nu-
méro. Je profite également de cette tribune pour
vous souhaiter de belles vacances et souligner
la retraite bien méritée de notre collègue Céline
Corbeil, directrice adjointe des soins infirmiers !
Bonne lecture !
Sylvie Dubois
ÉDITORIAL
1 Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives
dans le domaine de la santé, L.Q. 2002, c. 33.
LE JUGEMENT INFIRMIER AU CŒUR DE LA DÉCISION
La décision d’utiliser des mesures de contention s’inscrit dans
une activité réservée à l’infirmière depuis l’entrée en vigueur de
la loi 90. Malgré ce droit acquis, l’infirmière a la responsabilité de
fonder cette décision sur un jugement clinique, dans la perspec-
tive de contribuer à une diminution de l’utilisation des mesures
de contrôle ou de les encadrer de façon sécuritaire et judicieuse à
partir de son évaluation et compte tenu des risques de préjudice.
L’utilisation d’une mesure de contention est une activité profes-
sionnelle balisée par des aspects éthiques et légaux. Selon son
évaluation de la condition physique et mentale du patient,
l’infirmière décide, conjointement avec celui-ci, sa famille et
l’équipe interdisciplinaire, de la mesure la plus appropriée au
moment opportun, met en place la surveillance requise et évalue
régulièrement la pertinence du maintien de la contention. Les
notes au dossier et la mise à jour du PTI rendent compte du
jugement infirmier.
Réactions physiques et psychologiques du patient
à la suite de l’utilisation de contention physique
Réactions Réactions
physiques psychologiques
Immobilité, perte de masse Détresse
osseuse et musculaire, faiblesse,
risque de plaies de pression
Incontinence, constipation Colère
Frustration
Déclin fonctionnel Anxiété
Atteinte sensitive Agitation
Séjour de soins prolongé : Confusion
risque de contracter des Dépression
infections nosocomiales Détérioration cognitive
TABLEAU 1
>> suite de la page 1

L’AVANT-GARDE VOL. 12 NO 2 - ÉTÉ 2012 PAGE 3
Évaluation du patient
Identification des causes
sous-jacentes à l’agitation
(ex. : désordres métaboliques)
Vérification des besoins de base
Facteurs liés à la condition
du patient : échelle de RASS,
IC DESC, grade d’intubation
Révision des antécédents
du patient (ex. : abus alcool,
histoire de délirium)
Révision de la médication
Facteurs contributifs liés
à l’environnement
(routine du patient)
Fonctionnement antérieur
à l’hospitalisation du patient
Mesures alternatives
Confort, positionnement des
tubes et cathéters (camouflage)
Soulagement de la douleur
et de l’anxiété
Réorientation du patient
Personnalisation et
regroupement des soins
Diversion et stratégies de
communication
Modifications environne-
mentales : ex. : limitation
des stimuli
Implication de la famille
Surveillance accrue et visibilité
Agents pharmacologiques
Documentation
Motif et comportement
(verbal et physique)
État de conscience
Mesures alternatives employées
Type de contention
Durée, fréquence (début et fin)
Réactions
Tentatives réussies ou
non de retrait
Information donnée au
patient et à la famille
Surveillance
Installation conforme
Confort et positionnement
Douleur, anxiété, agitation
Signes vitaux
Intégrité des points de pression
Références
Balon, J.A. (2001). Common
factors of spontaneous
self-extubation in a critical
care setting. International
Journal of Trauma Nursing,
7(3), 93-99.
Birkett, K.M., Southerland,
K.A. et Leslie, G.D. (2005).
Reporting unplanned extu-
bation. Intensive and Critical
Care Nursing, 21(2), 65-75.
Chang, L-Y., Wang, K.K. et
Chao, Y-F. (2008). Influence
of physical restraint on un-
planned extubation of adult
intensive care patients: a
case-control study. Ameri-
can Journal of Critical Care,
17(5), 408-416
Curry, K., Cobb, S., Kutash,
M. et Diggs, C. (2008).
Characteristics associated
with unplanned extubations
in a surgical intensive care
unit. American Journal of
Critical Care, 17(1), 45-52.
Happ, M.B. (2000). Using a
best practice approach to
prevent treatment interfer-
ence in critical care. Progress
in Cardiovascular Nursing,
15, 58-62.
Maccioli, G.A., Dorman,
T., Brown, B.R., Mazuski,
J.E., McLean, B.A., Kuszaj,
J.M. et al. (2003). Clinical
practice guidelines for the
maintenance of patient
physical safety in the
intensive care unit : Use
of restraining therapies -
American College of Critical
Care Medicine Task Force
2001-2002. Journal of Criti-
cal Care Medicine, 31(11),
2665-2676.
Poulain, G., Vanpee, D.,
Swine, C. et Schoevaerdts, D.
(2004). Réflexion sur l’usage
de la contention dans
un service de médecine
gériatrique. Ethica Clinica,
34, 14-17.
QUIZ ÉCLAIR
3 Quels sont les outils
de documentation sur la ges-
tion d’une plaie de pression ?
4 Quels sont les professionnels
qui peuvent décider d’un plan de
traitement d’une plaie de pression ?
1 Que fait-on une fois
par année dans toutes les
unités de soins, dans un but
d’amélioration continue concer-
nant les plaies de pression ?
2 Quelles sont les
caractéristiques d’une plaie
de pression de stade II ?
>> réponses à la page 4
TABLEAU 2
Évaluation de la situation :
viser la collaboration et l’interdisciplinarité
Quel est le risque pour le patient ?
La sécurité du patient est-elle compromise ?
Échelle de RASS et IC DESC
Informer le patient et la famille de la situation :
remise du Guide d’accueil aux soins intensifs à la famille
En cas de refus d’application d’une contention :
aviser le médecin intensiviste responsable
prévoir une rencontre avec l’équipe interdisciplinaire
Documentation dans les notes infirmières (bilan 24 h),
révision du plan de soins, ajustement au PTI
Surveillance q h & Réévaluation q 8h + PRN
Appliquer la contention la moins invasive
pour la plus courte durée de temps
Appliquer les
mesures alternatives
selon le contexte Risque
imminent
échec
réussite
Résultat

PAGE 4 L’AVANT-GARDE VOL. 12 NO 2 - ÉTÉ 2012
L’Avant-Garde est publié
grâce à l’appui financier
de la Fondation du CHUM.
Révision, coRRection et conception gRaphique
Direction des communications
Afin de faciliter la lecture des textes, L’Avant-Garde, de façon générale, utilise le
terme « infirmière ». Il est entendu que cette désignation n’est nullement restrictive
et englobe les infirmiers. À l’exception des entrevues personnelles, les articles de
L’Avant-Garde peuvent être reproduits sans autorisation, avec mention de la source.
ISSN : 1496-8983 Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 2012
Bibliothèque nationale du Québec, 2012 © CHUM 2012
L’AVANT-GARDE EST PUBLIÉ PAR LA DIRECTION DES
SOINS INFIRMIERS DU CHUM TROIS FOIS PAR ANNÉE.
RÉPONSES DU QUIZ ÉCLAIR DE LA PAGE 2
1 Taux de prévalence des plaies de pression (effectué
avril 2012 - demandez vos résultats à l’infirmière-chef
de votre unité)
2 Lésion de l’épiderme ou du derme, ulcère superficiel,
lit de plaie rouge-rosé, aucun tissu nécrotique (voir formation
Convelearn
à l’adresse www.convelearn.ca; mot de passe :
chumform concernant l’évaluation d’une plaie et les traite-
ments ainsi que les documents de références dans l’intranet
de la DSI :
guide clinique, outil d’évaluation de plaies et suivi
)
3 PTI, plan de soins et traitement, formulaire
Évaluation
et suivi de plaie
(déploiement du formulaire jusqu’en février
2013)
4 L’infirmière, la stomothérapeute, le médecin (la CEPI
peut évaluer la plaie, mais ne peut pas décider du traitement)
APPROCHE INTÉGRÉE DE LA FORMATION
INITIALE ET CONTINUE DES INFIRMIÈRES
Étude 4 : Évaluation d’une activité
de formation continue
Au mois de septembre prochain, des infirmières
du CHUM ayant entre 6 et 24 mois d’expérience
seront sollicitées afin de participer à l’étude 4 de
la recherche en sciences infirmières citée en titre.
Ce programme de recherche vise à améliorer la
sécurité des soins en rehaussant la formation sur
le plan de la compétence du raisonnement clinique
(réflexion et décision) et de la compétence du leader-
ship clinique (influence de personnes). L’étude 4 vise
plus spécifiquement à évaluer la mise en œuvre, dans
les milieux de travail, d’activités de formation visant le
développement continu du raisonnement et du leader-
ship cliniques ainsi que leur effet sur le développement
de ceux-ci.
Les activités de formation, d’une durée de 30 minutes,
seront animées par les assistantes infirmières-chef
des unités ciblées. L’activité consiste à discuter d’une
situation de soins ayant soulevé des émotions ou un
questionnement. Il s’agit d’une démarche de réflexion
collective au cours de laquelle, les infirmières sont invi-
tées à revoir l’interprétation de la situation et à proposer,
analyser ainsi qu’à critiquer de nouvelles hypothèses.
Cela, afin de planifier et intervenir de manière plus
optimale dans le futur.
Même si l’étude s’adresse aux infirmières ayant entre
6 et 24 mois d’expérience, toutes les infirmières des
unités ciblées sont invitées à participer aux activités
de formation afin d’enrichir l’échange et de partager
leur expertise.
RECHERCHE
Sylvie Vallée, inf. B.Sc.
Sylvie Vallée est adjointe à la Direction de
la gestion de l’information, qualité performance
et responsable de l’agrément au CHUM.
Les soins infirmiers,
la sécurité et les POR
En préparation à une visite de certification, telle
qu’Agré ment Canada, nous devons réviser la conformité
à certaines pratiques qui sont des compo santes primor-
diales de la sécurité et de l’amélioration de la qualité.
Ces pratiques sont connues sous le vocable POR (pour
pratique organisationnelle requise) et sont exigées
de tous les établissements de santé, quelle que soit
leur mission.
Saviez-vous que l’utilisation de deux identificateurs
de client avant la prestation de tout service, de toute
procédure ou de toute administration de médicament
fait partie de la liste des 34 pratiques organisationnelles
requises au CHUM ?
La conformité à cette POR permet d’éviter des événe-
ments indésirables qui peuvent entraîner ou non diffé-
rentes conséquences sur le patient, selon la situation.
L’utilisation de deux identificateurs est un moyen
facile et sûr contribuant à diminuer le risque d’erreur
sur la personne. L’identification posi tive (par le patient
lui-même), le bracelet d’identification, ou la référence à
un proche (si le patient est inapte à répondre) sont les
moyens les plus usuels pour vérifier l’identité du patient
et ainsi être certain que l’on donne le bon soin ou le
médicament à la bonne personne.
La visite d’Agrément arrivant à grands pas (avril 2013),
c’est le temps de réviser cette pratique et toutes les
autres ! La sécurité, c’est l’affaire de nous tous au
quotidien !
1
/
4
100%