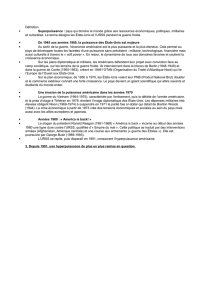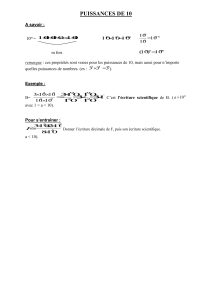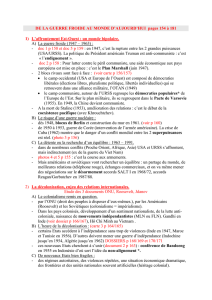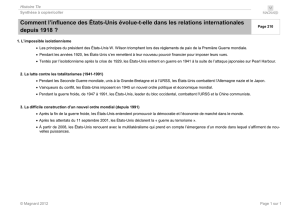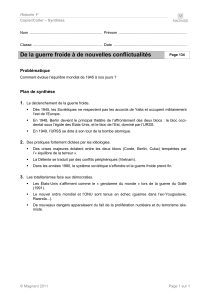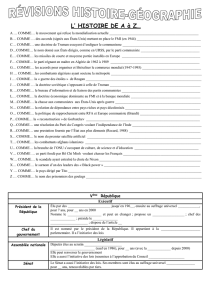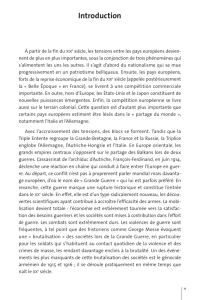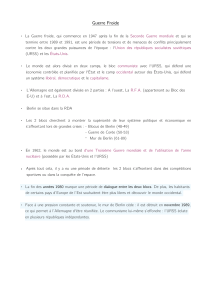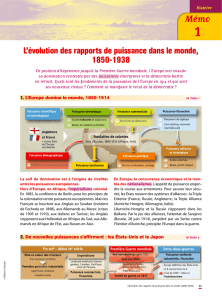Les chemins de la puissance Chine et Etats-Unis

Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale
à nos jours
Chapitre 4 : Les chemins de la puissance
1
Partie I : les Etats-Unis et le monde depuis les « quatorze points » du président Wilson
(janvier 1918)
Documents à utiliser : carte p. 220-221, carte p. 2 p. 235
Exercice amorce : Montrez que les Etats-Unis ont été une grande puissance de la Première
Guerre Mondiale à nos jours mais que cette puissance a changé.
Au début de la Première Guerre mondiale, les Etats-Unis se sont implantés dans le Pacifique
par des conquêtes successives qui leur permet d’occuper aussi bien des îles du Pacifique
comme Hawaï (1898) ou les Samoa (1900) que des territoires d’Asie du Sud-Est comme les
Philippines (1898). Ils ont aussi la mainmise sur des protectorats comme Haïti, Porto-Rico, la
République Dominicaine ou Cuba. Ils protègent également le passage du canal de Panama en
Amérique centrale come le montre leurs interventions dans la région. La mer des Caraïbes se
transforme donc en un lac étatsunien. Cependant, en dehors de cette zone d’influence proche
qui touche essentiellement à leurs intérêts, les Etats-Unis interviennent peu dans le monde,
comme le montre leur intervention tardive dans la 1GM. Ils sont donc isolationnistes.
En revanche, de nos jours, les interventions sont planétaires aussi bien du point de vue
économique que militaire, diplomatique voire culturel. Le mode d’expansion est aussi bien le
soft power que le hard power. Les Etats-Unis sont donc une superpuissance avec un
leadership mondial malgré la concurrence de nouveaux venus sur la scène économique et sur
la scène diplomatique et militaire.
Problématique : Comment les Etats-Unis ont-ils transformé et modelé la notion de puissance
tout au long du XX
ème
siècle en alternant entre un isolationnisme teinté de doctrine Monroe et
une vision wilsonienne du rôle des Etats-Unis dans le monde, le tout sur fond de « destinée
manifeste » ?
I. Une tentation de puissance sans engagement international (1917-1941)
A. Doctrine Monroe, mythe de la « destinée manifeste » et Pax Americana, les
héritages de la diplomatie en 1917.
Documents à utiliser : Extrait de la doctrine Monroe (Site de la Maison Blanche), la « destinée
manifeste » ou la raison de l’impérialisme américain (dictionnaire des Etats-Unis, 2011, p.
219-220), document 1 p. 224, la politique du « gros bâton » (P. Milza, Pax Americana, Les
collections de l’histoire n° 7, p. 42).
Document 1 : La doctrine Monroe du président américaine James Monroe (1823)
« Nous avons toujours été les spectateurs anxieux […] des événements qui se déroulent dans
cette partie du globe avec laquelle nous avons tant de liens et dont nous tirons notre origine.
Les citoyens des États-Unis se réjouissent de la liberté et du bonheur de leurs semblables de
l'autre côté de l'Atlantique. Dans les guerres […] européennes […] nous ne sommes jamais
intervenus et il n'est pas conforme à notre politique de le faire. […]
C'est seulement lorsque nos droits sont atteints ou sérieusement menacés que nous ressentons
l'offense ou faisons des préparatifs pour notre défense. Les événements de cet hémisphère
nous touchent infiniment de plus près. […]
À l'égard des colonies actuelles des puissances européennes, […] nous n'interviendrons pas.
Mais à l'égard des gouvernements qui ont déclaré leur indépendance […] nous ne pourrions
considérer aucune intervention d'une puissance européenne […] que comme la manifestation
d'une position inamicale à l'égard des États-Unis. »
Source : traduction du texte original, site de la Maison Blanche

Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale
à nos jours
Chapitre 4 : Les chemins de la puissance
2
Document 2 : La « destinée manifeste » ou la raison de l’impérialisme américain
Le concept de « destinée manifestée » recoupe toute la problématique liée à l’expansion et à
la conquête du continent. Apparue en mai 1845 dans un article de la Democratic Review sous
la plume du journaliste John O’Sullivan, l’expression fait référence au droit sacré des
Américains de conquérir les territoires occupés par les indigènes. D’emblée, la Providence
donne à la population blanche, la mission d’occuper et de faire fructifier la terre par des
millions d’individus. La référence biblique est constante et entérine l’idée que la conquête du
continent [américain] se fait selon un plan prédéterminé par le Très-Haut. […] La Destinée
manifeste postule que le peuple américain est élu par le Tout-Puissant pour accomplir ses
desseins. Elle puise au creuset de l’exceptionnalisme américain, lui-même hérité du
puritanisme qui faisait des premiers colons l’assemblée des Saints élue par Dieu pour ériger la
Cité idéale dans le désert américain. […] Distincte de la colonisation européenne subie par les
Américains, elle promeut le bien-être en faisant partager aux peuples conquis les bienfaits
d’une société fondée sur les droits de l’homme. […]
Cette conquête du continent, liée à la fierté d’être américaine, obéit à une logique
d’agrandissement du pays [ou de son influence].
Source : Dictionnaire des Etats-Unis, 2011
Document 3 : La politique du « gros bâton »
Tous les instruments d'une politique d'expansion se trouvent ainsi réunis à l'aube du XXe
siècle. […] La justification d'éventuelles interventions militaires opérées par les marines est
purement et simplement rattachée à la doctrine Monroe à laquelle Theodore Roosevelt
1901-1909 donne une formulation élargie fondée sur de vagues alibis humanitaires : les
Américains se réservent le droit exclusif de protéger la sécurité et les biens des étrangers dans
les pays dont le régime instable pourrait rendre cette intervention nécessaire.
Citant un proverbe africain, Theodore Roosevelt lance en avril 1903 une formule qui va servir
à caractériser durablement la politique de Washington en Amérique centrale : « Parlez
doucement et portez un gros bâton [ big stick] ; vous irez loin. »
C'est à propos de la Chine, […] qu'est formulée en 1900 l'autre doctrine qui va, pendant
plusieurs décennies, constituer l'un des fils conducteurs de la politique américaine : celle de la
« porte ouverte ». […] L'Amérique [ici au sens des Etats-Unis] s'érige […] donc en
championne de l'anticolonialisme et d'autre part en arbitre des intérêts rivaux dans les pays
qu'elle entend maintenir ouverts à tous les investisseurs commerciaux.
Attitude parfaitement conforme aux intérêts des États-Unis, auxquels la puissance et le
dynamisme de leur économie confèrent dès cette période, en l'absence d'entraves douanières,
un avantage considérable sur les concurrents européens. Mais aussi moyen pour l'Amérique
de se réconcilier avec elle-même et avec son histoire, en affichant l'image restaurée de la
patrie des droits de l'homme et de l'autodétermination des peuples dans un monde auquel elle
s'offre en modèle.
Se trouvent ainsi rassemblés à la veille du premier conflit mondial la plupart des ingrédients
qui vont nourrir, pendant plus d'un demi-siècle, le consensus de politique étrangère : refus du
colonialisme, respect proclamé de la souveraineté nationale, rejet de toute ambition
territoriale, volonté de diffuser une technologie de pointe vecteur du modèle américain. Telle
est la mission que la providence a assignée aux États-Unis : promouvoir par l'exemple — et
non par l'engagement direct dans les affaires du monde — la Pax americana. Le
déclenchement de la guerre européenne en août 1914 remet brusquement en question cette
vision.
Source : P. Milza, Pax Americana, Les collections de l’histoire n° 7, p. 42-43

Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale
à nos jours
Chapitre 4 : Les chemins de la puissance
3
Questions :
1. Quels sont les héritages de la politique extérieure des Etats-Unis lorsque ceux-ci entrent
en guerre en 1917 ?
En 1917, les Etats-Unis s’appuient sur trois héritages en termes de politique extérieure :
- La doctrine Monroe. Selon la doctrine énoncée en 1823 par le président James Monroe, les
États-Unis n'interfèrent pas dans les affaires européennes, mais s'opposent à toute
intervention européenne sur le continent américain - c'est le principe de l'Amérique aux
Américains. En 1903, y a été adjointe la « politique du gros bâton » Expression lancée par
le président Theodore Roosevelt citant un proverbe africain, en 1903, « Parlez doucement
et portez un gros bâton [big stick] ; vous irez loin. » La formule sert à caractériser la
politique de Washington en Amérique latine, considérée comme la chasse gardée des
États-Unis.
- La « Destinée manifeste ». L'expression a été forgée au milieu du XIXe siècle par John Lee
O'Sullivan : la « destinée manifeste » des États-Unis est de se « répandre à travers tout le
continent pour assurer le libre épanouissement de millions de personnes ». Elle recouvre la
conviction que les États-Unis ont vocation à répandre le progrès dans le monde. Cela a
aussi des sous-entendus messianiques, faisant de la nation américaine, la nation élue pour
amener le progrès au monde.
- La politique de la « porte ouverte », soit la doctrine économique qui exige le droit pour
tous les pays à commercer librement avec les colonies ou les pays dépendants des
puissances coloniales.
2. Quels sont les fondements diplomatiques de leur puissance jusqu’alors ?
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les Etats-Unis se refusent à intervenir dans les affaires
européennes, sauf si leurs intérêts propres sont menacés ou si les événements concernent leur
chasse gardée l’Amérique latine. Les Etats-Unis sont donc particulièrement isolationnistes
sur le plan politique. L’idée durant cette période est de se faire le chantre de
l’anticolonialisme, de rejeter toute ambition territoriale et de diffuser les nouvelles techniques
dans le monde. Il s’agit donc de promouvoir par l’exemple et non de prétendre à une
extension territoriale.
3. Pourquoi entrent-ils en guerre alors que la doctrine Monroe va à l’encontre de cette
intervention ?
Dans les faits, les Etats-Unis entrent en guerre en raison de la doctrine Monroe car leurs
intérêts sont menacés. Trois événements poussent Wilson à faire entrer son pays dans la
guerre età rompre avec ce comportement attentiste :
- le refus allemand de respecter la « liberté des mers » en coulant des navires neutres
porteurs de marchandises destinées aux Alliés et en pratiquant, à partir de janvier 1917, la
« guerre sous-marine à outrance »
- la révélation des intrigues de la Wilhelmstrasse visant à pousser le Mexique dans une
guerre contre sa voisine du Nord
- la révolution de mars 1917 en Russie qui, en éliminant l'autocratie tsariste, donnait à
l'action conjuguée des pays de l'Entente l'allure d'une croisade des démocraties.
A cela s'ajoute, bien sûr, le poids des intérêts économiques directs comme les emprunts
massifs consentis par les banques américaines aux alliés occidentaux et préférence exclusive
accordée aux mêmes puissances en matière commerciale.
B. L’échec de l’interventionnisme wilsonien après la Première Guerre mondiale :
Documents à utiliser : document 2 p. 224, documents 3 et 5 p. 225, la new diplomacy
wilsonienne (L. V. Smith, Wilson était-il un idéaliste, Les collections de l’histoire, n° 56, p.
16-18), document 4 p. 223.

Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale
à nos jours
Chapitre 4 : Les chemins de la puissance
4
Document 1 : La new diplomacy wilsonienne
Aux yeux de ses détracteurs, le « wilsonisme » constituait un amalgame incohérent de
principes flous. Le problème de ce système n'était pourtant pas son incohérence, mais son
radicalisme. Wilson poussa le libéralisme anglo-américain du XIXe siècle vers sa conclusion
logique, et fit de l'individu rationnel et responsable le lieu même de la souveraineté.
L'individu souverain constituait la composante élémentaire de toutes les configurations
politiques, du local à l'international en passant par la nation. C'était le sujet nécessaire à l'idée
même d'auto-détermination, le « self-government ». Le concept du « droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes » émergea en grande partie en réponse aux efforts déployés par les
bolcheviques pour saper les empires européens. […]
Pour Wilson, c'était l'existence de pactes illégitimes, liant les nations d'Europe à des intérêts
égoïstes, qui avait mené à la guerre en 1914. Aussi considérait-il qu'un pacte nouveau,
légitime et universel, mettrait fin non seulement à la Grande Guerre, mais aussi à quelque
guerre que ce soit, et ce pour toujours.
Un monde lié par des pactes planétaires révolutionnerait les relations internationales. La
doctrine wilsonienne cherchait à ôter la régulation du système des mains des États pour la
confier au vrai souverain : une communauté transnationale composée d'individus
politiquement semblables. […]
Paradoxalement, le wilsonisme comportait aussi une théorie de la puissance de l'État en
général, et de la notion de grande puissance en particulier. Wilson ne considérait pas que la
concentration des pouvoirs soit un problème en soi, qu'elle se manifeste entre les nations ou
au sein de ces dernières.
Selon lui, la difficulté résidait davantage dans l'utilisation du pouvoir. […] De même, il était
légitime d’établir une paix reconnaissant la primauté des grandes puissances. […]Un groupe
restreint d'individus puissants pouvait donc modeler la paix, à condition qu'il le fasse en
accord avec la volonté présumée de la communauté mondiale.
Assurément, Wilson considérait la SDN comme une entité supérieure à la somme des
souverainetés nationales qu'elle comprenait. […]
Source : L. V. Smith, Wilson était-il un idéaliste, Les collections de l’histoire, n° 56, p. 16-18
Questions :
1. Sur quels fondements repose la new diplomacy wilsonienne ?
La new diplomacy wilsonienne repose d’abord sur l’importance de la souveraineté des
individus et ce, quel que soit le niveau politique auquel il est fait référence : du local à
l’international.
Elle se fonde également sur le principe de la sécurité collective, fondée sur le droit, le respect
des peuples et le refus de rendre coupable de la guerre l’un plutôt que l’autre des pays
d’Europe comme le souligne le discours du président américain Woodrow Wilson – thème
qu’il reprend en janvier 1918 dans les 14 points Wilson visant à assurer une paix sans bouc
émissaire, rendant possible l’autodétermination des peuples. Cette organisaiton à vocation
universelle engage ses Etats membres « à respecter et à maintenir contre toute agression
l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les membres de la Société ». Cela
s’oppose à la politique de « l’équilibre européen » qui, selon lui, a précipité l’Europe dans la
1GM.
Il s’appuie également sur l’idée de la mise en place d’une organisation visant à gérer la paix
mondiale.
2. Quelle est la vision de la paix mondiale mise en place par Wilson et sur quel organisme
repose-t-elle ?

Thème 3 : Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale
à nos jours
Chapitre 4 : Les chemins de la puissance
5
Wilson a une vision précise de la paix mondiale. Elle repose sur l’entente entre les différentes
populations au sein d’une organisation de coopération et de maintien de la paix, qui n’est
autre que la SDN. Il estime également que celle-ci peut être dominée par des grandes
puissances qui en infléchissent la politique.
3. Quelles sont les raisons qui expliquent que les Etats-Unis n’aient pas appliqué la politique
wilsonienne ? Quelle était la principale crainte des opposants au projet de Wilson ?
La raison principale qui explique que les Etats-Unis n’aient pas appliqué le wilsonisme après
1919 est que le Sénat américain, majoritairement républicain, refuse de s’impliquer davantage
dans les affaires européennes. En 1920, le Sénat refuse de ratifier le traité créant la SDN ce
qui la rend relativement impuissante. Les Etats-Unis préfèrent repartir sur les bases de la
doctrine Monroe et souhaitent refermer la parenthèse de l’intervention européenne.
4. La politique isolationniste menée par les Etats-Unis depuis 1920 persiste jusqu’à l’ère de
F. D. Roosevelt, montrez de quelle manière (aidez-vous aussi du document 3 p. 223)
La crise économique des années 1930, et surtout, la montée en puissance des Etats totalitaires
en Europe ne poussent pas les Etats-Unis à intervenir davantage en Europe, même si
Roosevelt, président depuis 1933, est tout à fait conscient des enjeux européens.
Le Congrès américain élève des barrières pour éviter, selon leurs propres dires, de « tomber
encore une fois dans le piège de l’intervention en Europe ». Ces barrières concernent
essentiellement les prêts financiers et les ventes d’armes :
- Le Congrès demande à ce que les prêtes ne soient consentis qu’aux pays qui ont remboursé
leurs dettes de la 1GM
- les lois de neutralité de la période 1935-1937 instaurent un embargo sur les armes et les
articles militaires aux Etats en guerre.
- Enfin, en 1937, est ajoutée à ces lois de neutralité la close cash and carry (dernier
paragraphe du document 3 p. 223) selon lequel la vente d’armes et d’articles militaires est
possible mais à la seule et unique condition que les Etats payent comptant et viennent prendre
eux-mêmes livraison de leurs commande dans les ports américains.
Le président Roosevelt met aussi en place à partir de 1937 la politique de la « quarantaine »,
après l’invasion de la Chine par le Japon. Cependant, si cela veut dire ne pas aider les
puissances prédatrices, cela ne veut pas pour autant dire intervenir dans la guerre comme
Roosevelt le dit « nous sommes déterminés à rester en dehors de la guerre ».
C. L’économie, l’absence d’isolationnisme américain :
Documents à utiliser : l’expansionnisme économique dans les années 1920 (Cl. Folhen,
Canada et Etats-Unis depuis 1780, p. 415-416), document 3 p. 223 (loi Cash and Carry).
Document 1 : L’expansionnisme économique dans les années 1920
[…] Dans le domaine économique, les Etats-Unis ne se retranchent pas dans un
isolationnisme frileux. Ayant échangé leur statut de débiteur pour celui de créancier net à la
faveur de la Première Guerre mondiale, les Américains participent activement aux
négociations internationales qui tente de trouver une solution viable à l’épineuse question des
dettes alliées et des réparations allemandes. […] Pour réduire les tensions, le gouvernement de
Washington agit par l’intermédiaire de banquiers privés chargés de diriger les emprunts à
New York afin d’amorcer un cercle vertueux. […] D’une manière générale, les
investissements directs et les crédits à court terme américains facilitent le bon fonctionnement
des marchés financier et monétaire international entre 1924 et 1929. Les grandes
corporations exploitent des mines, des plantations, des usines sur tous les continents, aussi
bien dans les pays industrialisés […] que dans les régions sous-développées et même en
URSS […]. L’historienne Akira Iriye signale que « la pénétration des marchés mondiaux par
les capitaux, la technologie et les marchandises américaines a fourni une base, le fondement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%