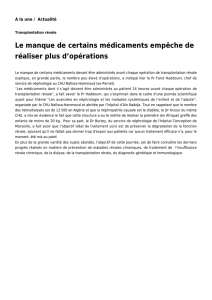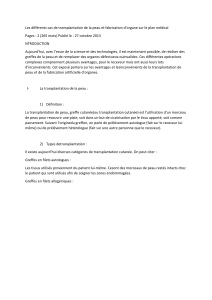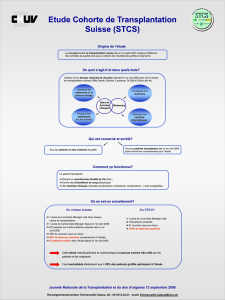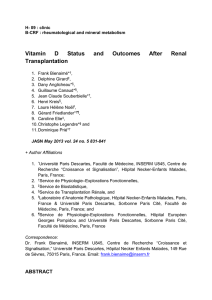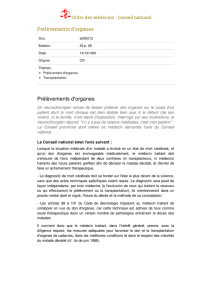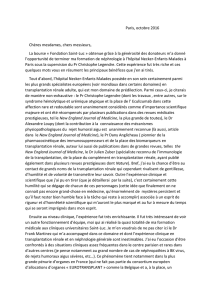Infections bactériennes et fongiques après transplantation

160 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012
MISE AU POINT
Infections bactériennes
et fongiques après
transplantation rénale
Bacterial and fungal infections after kidney transplantation
M.F. Mamzer-Bruneel*
* Service de transplantation et de
soins intensifs néphrologiques, hôpital
Necker, Paris.
L
es pathologies infectieuses sont les complica-
tions les plus fréquentes après transplantation
rénale. Les micro-organismes susceptibles d’être
en cause sont innombrables, et même si la fièvre est
très fréquente, les tableaux cliniques sont souvent
tronqués et peu spécifiques (1). L’enquête étiolo-
gique est guidée par les données épidémiologiques
spécifiques à cette population de malades et par une
analyse rigoureuse des facteurs de risque individuels.
La nature du risque infectieux évolue en fonction
du délai écoulé depuis la transplantation ; ce risque
prédomine au cours du premier mois (figure) [2].
Les autres déterminants du risque infectieux sont
le degré d’immunodépression et les expositions aux
agents pathogènes, incluant celles qui ont concerné
le donneur, en raison du risque d’infections trans-
mises par le greffon (3). Le dépistage soigneux des
antécédents infectieux des donneurs comme des
receveurs est donc un préalable indispensable à la
greffe, permettant notamment de rechercher une
contre-indication formelle au prélèvement (tableau).
La plupart des infections transmises par le greffon
s’exprimeront au cours du premier mois qui suit
la greffe, sachant que durant cette période, les
infections bactériennes nosocomiales, notamment
urinaires (4, 5), prédominent. La deuxième période,
du deuxième au sixième mois qui suivent la greffe,
est historiquement celle des premières infections
opportunistes et des réactivations d’infections virales,
qu’elles soient latentes chez le donneur ou chez le
receveur. Ce risque est aujourd’hui très fortement
diminué par la prescription de prophylaxies anti-
infectieuses ciblées. Après le sixième mois, le poids
de l’immunosuppression diminue, et les transplantés
rénaux sont surtout exposés au risque d’infections
Tableau. Infections du donneur contre-indiquant le prélève-
ment d’organes en vue d’une greffe.
Avec documentation microbiologique
- Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
- Hépatite B active
- Infection par le virus West Nile
- Encéphalite à virus Herpes Simplex (HSV)
- Infection par le virus de la chorioméningite lymphocytaire
- Infection par le virus Chikungunya en cas de PCR positive
- Paludisme lorsqu’il est la cause du décès
- Tuberculose disséminée
- Infection fongique disséminée
- Rage
- Infections dues à des bactéries multirésistantes
en l’absence d’antibiogramme permettant d’ajuster
le traitement ou si aucun traitement adapté n’a été donné
- Maladie de Chagas lorsqu’elle est la cause du décès
- Leishmaniose lorsqu’elle est la cause du décès
Sans nécessité de documentation microbiologique
formelle
- Encéphalite de cause indéterminée
- Rage
- Défaillance multiviscérale liée à un sepsis non déterminé
- Maladie de Creutzfeldt-Jakob
Transplantation
Infections
dérivées
du donneur
Infections
nosocomiales Infections opportunistes, rechutes,
réactivations
Influence des traitements prophylactiques
Infections
communautaires
Infections
opportunistes
1 mois 6-12 mois Long cours
Figure. Évolution de la nature du risque infectieux après transplantation rénale (2).

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012 | 161
Points forts
»Les infections sont les complications les plus fréquentes après transplantation rénale.
»La nature du risque évolue en fonction du délai écoulé après la greffe.
»
La plupart d’entre elles sont bactériennes et les 2 localisations les plus fréquentes sont urinaires
et respiratoires.
»Malgré de nouveaux traitements, les infections fongiques, plus rares, restent graves.
»
Les greffons sont une source potentielle d’infection bactérienne ou fongique héritée du donneur,
qui justifie une vigilance particulière.
Mots-clés
Transplantation rénale
Infections
bactériennes
Infections fongiques
systémiques
Infections transmises
par le greffon
Highlights
»
Infectious diseases are the
most common complications
in renal transplant recipients.
»
Type and risk of infectious
diseases change with time.
»
Bacterial urinary tract and
respiratory tract infections
remain the most frequent.
»
Despite new treatments,
systemic fungal infections,
although rare, remains
severe.
»
The risk of graft trans-
mitted infections, both
bacterial or fungal, requires
special attention.
Keywords
Renal transplant recipients
Bacterial infectious diseases
Systemic fungal infectious
diseases
Graft transmitted infections
communautaires courantes, bien que le risque d’infec-
tions opportunistes reste réel en cas d’exposition
massive, ou à l’occasion d’un état d’immunodépres-
sion plus intense lié au traitement d’un rejet ou à une
insuffisance rénale avancée, par exemple (6, 7). Les
taux d’incidence de chaque type d’infection ne sont
pas définis formellement, et sont soumis à une grande
variabilité épidémiologique, notamment géogra-
phique, qui s’oppose à l’établissement de taux d’inci-
dence universels pour la plupart de ces infections. Par
ailleurs, les patients transplantés rénaux usent volon-
tiers de leur autonomie pour voyager et sont donc
régulièrement exposés aux infections endémiques
dans les régions qu’ils visitent. Il est néanmoins
établi que les infections les plus fréquentes après
la transplantation rénale sont d’origine bactérienne
chez l’adulte, suivies par les infections virales (plus
fréquentes en revanche chez les enfants), puis par
les infections fongiques (8). L’incidence globale des
infections après la greffe est maximale au cours du
premier mois, pour décroître ensuite rapidement (7).
Les infections opportunistes, qui sont numériquement
“anecdotiques”, sont malgré tout préoccupantes, car
elles peuvent engager le pronostic vital.
Infections bactériennes
après transplantation rénale
Les infections bactériennes sont les plus fréquentes
des complications infectieuses de l’adulte après
transplantation rénale. Leurs caractéristiques épidé-
miologiques sont variables dans le temps (9, 10),
leur incidence globale étant maximale au cours du
premier mois qui suit la greffe, période dominée
par le risque d’infections nosocomiales (7). Les
germes en cause sont surtout des germes patho-
gènes, mais le risque d’infection à germes non
pathogènes est réel, que ce soit à partir de la flore
endogène commensale ou à partir de bactéries
opportunistes environnementales. Tous les organes
ou tissus peuvent être infectés, et les présentations
cliniques sont volontiers peu spécifiques, voire
atypiques. Les prélèvements microbiologiques
sont souvent difficiles à interpréter lorsqu’ils sont
négatifs, lorsqu’ils isolent une bactérie de la flore
commensale, ou lorsque le site prélevé est suscep-
tible d’être colonisé (vessie, cavité buccale, voies
aériennes supérieures). La première difficulté est
donc diagnostique, en particulier lorsque le tableau
clinique est celui d’une fièvre nue ; la deuxième réside
dans la décision et le choix d’une antibiothérapie.
En effet, les interactions pharmacologiques avec les
traitements immunosuppresseurs, la toxicité rénale
ou le risque, aujourd’hui sous-estimé, de sélectionner
une flore résistante chez ces patients soumis à une
forte pression antibiotique tout au long de leur exis-
tence représentent autant de difficultés pratiques.
Les indications d’antibiothérapie chez les patients
transplantés rénaux doivent donc être pesées, et les
traitements ciblés.
Épidémiologie des infections bactériennes
après transplantation rénale
◆Infections bactériennes nosocomiales
Les sources d’infections bactériennes après trans-
plantation sont très nombreuses et incluent le
greffon, la flore endogène, l’environnement et les
personnes-contact. Le risque d’infection nosocomiale
est conditionné par la nature et le nombre des procé-
dures invasives, l’exposition aux agents pathogènes
(incluant les colonisations ou infections antérieures)
et la durée d’exposition à ces risques. La rupture des
barrières naturelles par les sondes urinaires, les
abords vasculaires et la chirurgie de transplantation
favorisent la survenue des infections bactériennes,
qui peuvent se développer soit à partir de la flore
endogène du patient, soit par transmission inter-
humaine, le plus souvent manuportée. Les patients
hospitalisés sont alors exposés à des transmissions
épidémiques, souvent croisées, de bactéries multi-
résistantes (BMR) telles que les bacilles à Gram
négatif sécréteurs de bêtalactamases à spectre élargi
(BLSE), voire totorésistants, les entérocoques résis-
tants à la vancomycine (ERV), ou encore les Staphy-
lococcus aureus résistants à la méticilline (SARM).
La description récente de telles épidémies, dans le
contexte de la transplantation rénale, plaide pour
l’application stricte des règles d’hygiène hospitalière
et pour le développement systématique de politiques
de maîtrise de l’antibiothérapie, bien que la prévalence
des colonisations de la flore endogène des patients

162 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012
Infections bactériennes et fongiques après transplantation rénale
MISE AU POINT
transplantés rénaux par ces BMR soit mal connue. Des
données récentes suggèrent que le pic d’incidence
des septicémies à bacilles à Gram négatif se situe au
cours du premier mois qui suit la greffe, que ces septi-
cémies sont majoritairement de nature nosocomiale
et que les voies urinaires sont à l’origine de 70 % de
ces infections (11). C’est aussi durant cette période
que les épisodes de colites à Clostridium difficile, une
des principales causes de diarrhée bactérienne après
transplantation rénale, sont les plus fréquents (12),
favorisés par l’exposition aux antibiotiques ou par le
contact avec un patient infecté.
◆Infections bactériennes communautaires
à germes pathogènes
Après le premier mois, la fréquence des infections
nosocomiales diminue au profit des infections
communautaires, qui peuvent se déclarer chez
les patients transplantés rénaux ambulatoires et
concerner tous les tissus et organes, y compris le
système nerveux central, la peau et le tube digestif.
Ce sont néanmoins encore les infections urinaires
qui restent les plus fréquentes, talonnées de près
par les infections des voies respiratoires.
Une attention toute particulière doit être portée
aux infections tuberculeuses, dont la fréquence est
plus élevée que dans la population générale, avec
une prévalence variant de 1,2 à 15,0 %, selon le
niveau d’endémie du pays considéré (13). Le délai
de survenue par rapport à la transplantation est
variable, mais les deux tiers des cas surviennent
au cours de la première année, avec une médiane
autour du neuvième mois. Dans la plupart des cas, il
s’agit de la réactivation d’un foyer latent méconnu.
Les difficultés du diagnostic sont nombreuses, car
les tableaux cliniques sont atypiques, et les tests
diagnostiques particulièrement peu sensibles sur ce
terrain (test de réaction cutanée à la tuberculine ou
examen direct des crachats). Les atteintes pulmo-
naires excavées classiques sont exceptionnelles dans
ce contexte où les formes disséminées ou extra-
pulmonaires sont largement majoritaires (14). Les
nouveaux tests diagnostiques fondés sur la libération
spécifique d’interféron gamma par les lymphocytes T
mémoire spécifiques de Mycobacterium tuberculosis
(QuantiFERON®, T-Spot® TB) semblent intéressants
dans le bilan prétransplantation (15). Leur positivité
signe un contact préalable avec M. tuberculosis, sans
permettre de distinguer une tuberculose ancienne
guérie d’une tuberculose latente ou active. Le traite-
ment antituberculeux est désormais bien défini (14),
mais son maniement difficile plaide contre les traite-
ments “d’épreuve”, qui doivent rester exceptionnels
dans les pays de faible endémie où la probabilité du
diagnostic est faible. En effet, la toxicité, notamment
hépatique, de l’isoniazide, combinée aux interfé-
rences entre les antituberculeux (en particulier la
rifampicine, très fortement inductrice du cytochrome
P450 CYP3A4), et les traitements immunosuppres-
seurs qui en sont le substrat exposent au rejet de
greffe et justifient une restriction de ces traitements
aux indications formelles.
◆Infections bactériennes opportunistes
La rareté des infections bactériennes opportunistes
chez les patients transplantés rénaux contraste
avec la multitude des germes susceptibles d’être
incriminés et la variabilité de leur délai de survenue
après transplantation. Plus rares que les infections
virales ou fongiques opportunistes, ces infections ne
bénéficient d’aucune mesure prophylactique médi-
camenteuse spécifique. Leur gravité repose autant
sur les difficultés du diagnostic que sur celles de
leur traitement. Leur survenue témoigne souvent
d’un niveau d’immunodépression particulièrement
intense, et il n’est pas rare d’avoir à diminuer le
traitement immunosuppresseur pour contrôler ces
infections. Il s’agit volontiers de bactéries environ-
nementales, voire saprophytes, ce qui contribue à
la variabilité géographique des espèces rencontrées.
Parmi les bactéries le plus fréquemment isolées dans
nos régions, citons les mycobactéries atypiques mais
aussi les Nocardia sp. et les Listeria sp.
Aspects cliniques des infections
bactériennes après transplantation
Les manifestations cliniques des infections bacté-
riennes après transplantation rénale sont dénuées
de toute spécificité et laissent généralement peu
de place à l’examen clinique pour le diagnostic
étiologique.
◆Infections urinaires
Ce sont les plus fréquentes des infections bactériennes
après transplantation rénale, notamment au cours
de la première année (10), juste avant les pneumo-
pathies (8). Les bactéries à Gram négatif représentent
plus de 70 % de ces infections, qui sont très souvent
dues à des Escherichia coli uropathogènes et associées
à un risque important d’insuffisance rénale aiguë.
Plus rarement, elles sont en rapport avec d’autres
souches bactériennes comme Pseudomonas sp.,
Klebsiella sp. ou des germes sécrétant l’uréase comme
Proteus mirabilis (qui peut être associé à des lithiases

La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012 | 163
MISE AU POINT
phospho-ammoniaco-magnésiennes). La résistance
aux antibiotiques est fréquente, en particulier chez les
malades ayant des infections urinaires à répétition.
Les signes fonctionnels associés sont inconstants,
mais peuvent être évocateurs d’une cystite, d’une
pyélonéphrite du transplant ou des reins natifs, voire
d’une prostatite. La pyélonéphrite aiguë du greffon se
manifeste typiquement par des frissons, de la fièvre,
éventuellement une hématurie. Une sensibilité en
regard du greffon est possible, et le rein peut être
augmenté de taille et douloureux.
◆Infections respiratoires bactériennes
après transplantation rénale
Environ 1 patient transplanté rénal sur 10 nécessi-
tera une hospitalisation pour un épisode d’infection
respiratoire basse grave, d’origine bactérienne dans
plus de la moitié des cas, et dont la précocité du trai-
tement conditionnera le pronostic. Le risque après
transplantation rénale est durable, et les germes
responsables sont habituellement ceux des pneumo-
pathies communautaires : pyogènes (pneumocoque,
Haemophilus), germes atypiques (Mycoplasma,
Chlamydia, légionnelle), bien que les infections à
Gram négatif (Pseudomonas, entérobactéries) ou à
staphylocoque représentent de 10 à 85 % des cas.
La tuberculose pulmonaire se différencie de celle du
sujet immunocompétent par une présentation radio-
logique volontiers atypique, une fréquence accrue
des atteintes disséminées et extrathoraciques, et une
mortalité attribuable à l’infection significative. Les
infections à mycobactérie atypique (Myco bacterium
xenopi, Mycobacterium kansasii, Mycobacterium
avium) sont rares. Les infections bactériennes à crois-
sance lente sont encore plus rares et semblent liées
à l’intensité du déficit immunitaire : les nocardioses
sont les plus fréquentes, souvent associées à une
atteinte cérébrale, puis viennent les infections à
Rhodococcus et, plus exceptionnellement, les acti-
nomycoses. Leur recherche doit être spécifiée lors
des prélèvements microbiologiques ou anatomo-
pathologiques.
◆Autres sièges d’infections bactériennes
Tous les organes ou tissus peuvent être concernés,
notamment la peau, le tube digestif et le système
nerveux central. La conduite à tenir devant une fièvre
chez un patient transplanté rénal est dominée par
la recherche d’arguments en faveur d’une infection
bactérienne susceptible de mettre en jeu rapi-
dement le pronostic vital. En cas d’état de choc,
de sepsis sévère ou de détresse respiratoire aiguë,
l’hospitalisation est indispensable. La pauvreté de
l’examen clinique rend le plus souvent indispensable
le recours à des examens complémentaires, incluant
des examens biologiques usuels, des examens d’ima-
gerie et des examens à visée microbiologique. Le
recours à la radiographie du thorax à la recherche
d’un foyer pulmonaire cliniquement muet doit être
large. Très souvent, d’autres examens d’imagerie
sont nécessaires afin d’orienter ou de préciser le
diagnostic et, le cas échéant, de diriger des prélève-
ments à visée étiologique. La technique d’imagerie
la plus appropriée (échographie, examen tomoden-
sitométrique ou examen en résonance magnétique
nucléaire) est choisie selon le site exploré en fonction
de sa sensibilité et de sa spécificité, mais aussi en
tenant compte de ses risques (allergique et toxique,
notamment rénal). La numération formule sanguine
peut orienter vers une infection bactérienne en cas
d’hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles.
Les dosages des marqueurs d’inflammation systé-
miques tels que la protéine C réactive (CRP) ou la
procalcitonine, utiles dans la population générale
hospitalisée, n’ont pas démontré leur intérêt pour
différencier les infections bactériennes des infec-
tions virales ou des autres états inflammatoires
chez les transplantés rénaux (16, 17). La documen-
tation microbiologique préalable à l’antibiothérapie,
toujours souhaitable, est indispensable en contexte
nosocomial, ou lorsqu’il existe des signes de gravité
qui justifient la prescription rapide d’une antibio-
thérapie empirique. Ce sont ces prélèvements qui
permettront, s’ils sont positifs, d’ajuster ensuite
l’antibiothérapie. Ils comportent un examen cyto-
bactériologique des urines (ECBU), des hémocul-
tures, et des coprocultures en cas de diarrhée. Des
prélèvements aux sites profonds suspects d’infection
peuvent être nécessaires ; le cas échéant, ils seront
effectués par des techniques invasives (ponctions ou
bio psies sous échographie, scannographie, endos-
copie, cœlioscopie, voire abord chirurgical direct).
Dans certains cas d’infections rares ou torpides,
telles que les tuberculoses extrapulmonaires, ou
encore certaines mycobactérioses atypiques, le
diagnostic n’est obtenu que par l’examen anato-
mopathologique et la culture des biopsies tissulaires.
Infections fongiques
après transplantation rénale
Il est classique de distinguer 2 types d’infections
fongiques systémiques : les mycoses liées à des
micro-organismes pathogènes, dont la distribution
géographique est limitée et endémique (telles les

164 | La Lettre de l’Infectiologue • Tome XXVII - n° 4 - juillet-août 2012
Infections bactériennes et fongiques après transplantation rénale
MISE AU POINT
histoplasmoses, les coccidioïdomycoses, les blas-
tomycoses ou les pénicillioses), et les mycoses
opportunistes, bien plus fréquentes après transplan-
tation rénale, et qui regroupent essentiellement les
candidoses, les cryptococcoses, les aspergilloses et
les pneumocystoses, mais aussi les mucormycoses
et les infections à Fusarium, à Scedosporium ou à
Alternaria. La prise en charge de ces mycoses oppor-
tunistes est particulièrement délicate, car leurs mani-
festations cliniques, protéiformes et non spécifiques,
ne permettent pas de les distinguer facilement des
infections non fongiques, notamment bactériennes,
plus fréquentes. Évoquées de principe sur un faisceau
d’arguments cliniques, biologiques et épidémiolo-
giques, elles doivent être rapidement documentées,
car tout retard de traitement augmente le risque de
dissémination.
Candidoses après transplantation rénale
Les infections à Candida comptent pour environ 2 %
des infections après transplantation rénale. L’espèce
le plus fréquemment responsable des candidoses
profondes après transplantation rénale reste C. albi-
cans, mais d’autres espèces émergent (C. tropicalis,
et surtout C. glabrata et C. krusei). L’infection du
liquide de transport du greffon par un Candida sp.
peut être à l’origine d’infections chez le receveur,
allant de l’infection simple de la loge de transplan-
tation jusqu’à l’artérite intimale destructrice de
l’artère du greffon (18). Cette infection justifie une
prise en charge précoce et rationnalisée des patients
concernés, associant un traitement antifongique
préemptif et la recherche d’une contamination de
la loge de transplantation (19).
Aspergillose après transplantation rénale
La forme la plus préoccupante est l’aspergillose
pulmonaire invasive, qui complique entre 0,7 et
4,0 % des transplantations rénales. L’espèce le plus
fréquemment responsable est Aspergillus fumigatus.
La dissémination passe par l’invasion de la paroi des
vaisseaux à l’origine des 3 caractéristiques de cette
infection : infarctus tissulaire, foyers hémorragiques
et métastases septiques par voie hématogène.
Les facteurs de risque associés sont l’intensité du
traitement immunosuppresseur, la prise prolongée
de fortes doses de stéroïdes, ainsi que la défaillance
du greffon requérant l’hémodialyse. La mortalité
associée est voisine aujourd’hui de 35 % (20). La
présentation clinique est celle d’une pneumonie
aiguë d’aspect radiologique non spécifique, dont
le diagnostic étiologique est délicat, compte tenu
des faibles spécificité et sensibilité des cultures
d’échantillons respiratoires. Les signes cliniques,
principalement fièvre, toux et dyspnée, ou plus
tardivement hémoptysie, sont tout aussi peu spéci-
fiques. Ces difficultés diagnostiques, associées au
pronostic catastrophique, ont conduit à l’applica-
tion des stratégies de prise en charge validées chez
les patients d’onco-hématologie, fondées sur une
classification répartissant les tableaux clinico-biolo-
giques compatibles avec le diagnostic d’aspergillose
en 3 catégories : aspergillose prouvée, probable ou
possible. Le traitement doit être instauré dès lors
que l’aspergillose est probable (21). L’imagerie de
choix est le scanner thoracique, plus sensible que
la radiographie du thorax pour objectiver le ou les
foyers, volontiers nodulaires et pouvant évoluer vers
une excavation et des images d’infarctus segmen-
taires. La détection d’antigènes constitutifs de la
paroi cellulaire du champignon dans le sérum des
patients (galactomannane, ou les β-D-glucanes)
a une bonne valeur diagnostique. Le traitement de
première intention est désormais le voriconazole,
plus efficace et moins toxique que l’amphotéricine B,
dont la toxicité rénale limite encore la tolérance
après transplantation rénale. En cas de résistance au
voriconazole, l’amphotéricine B liposomale, mieux
tolérée que l’amphotéricine B conventionnelle, peut
être intéressante, de même que la caspofungine (21).
À côté de ces formes invasives, il existe des atteintes
nécrosantes chroniques (aspergilloses semi-invasives)
et des formes “saprophytes” (aspergillomes pulmo-
naires ou sinusiens) dont la prise en charge peut être
délicate, et repose autant sur les antifongiques que
sur la chirurgie d’exérèse en cas d’aspergillome.
Cryptococcose après transplantation
rénale
Les cryptococcoses peuvent être transmises par le
greffon ou acquises après la transplantation, mais il
s’agit le plus souvent de la réactivation d’une infec-
tion latente ancienne (22). Elles sont dues à un cham-
pignon ubiquitaire, Cryptococcus neoformans, dont la
voie de pénétration dans l’organisme est respiratoire.
La dissémination se fait à partir du poumon vers le
sang et de nombreux organes périphériques : peau,
système ostéoarticulaire, appareil urinaire, et surtout
système nerveux central. Entre un tiers et la moitié des
patients atteints de cryptococcose développent une
 6
6
1
/
6
100%