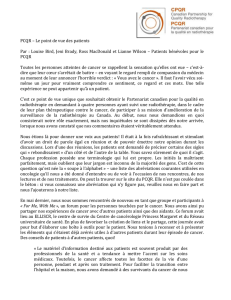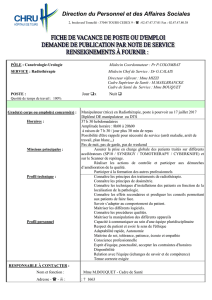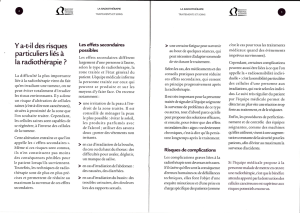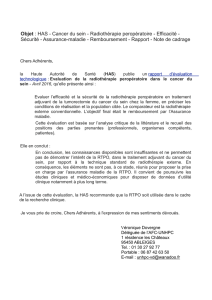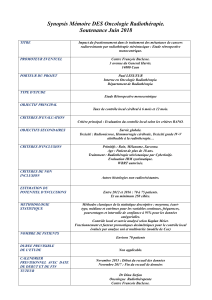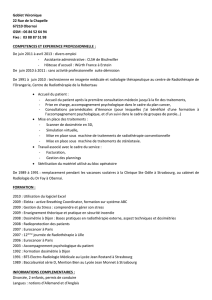La radiothérapie du sujet âgé

La radiothérapie du sujet âgé
T. Pignon, J.-B. Paoli et P. Scalliet
Introduction
La prise en charge initiale de la plupart des cancers est avant tout chirurgicale.
Pour la majorité des tumeurs (sein, poumon, prostate, rectum, vessie), une
radiothérapie est souvent nécessaire pour compléter le traitement locorégional
afin de limiter le risque de récidive, voire d’allonger la survie. Cependant,
lorsque la chirurgie est contre-indiquée pour des raisons médicales, les malades
sont souvent confiés aux radiothérapeutes. Ainsi, cette situation relativement
fréquente chez la personne âgée, fait que la moyenne d’âge des patients en
cours de radiothérapie a tendance à être supérieure de cinq à dix ans à celle
observée habituellement dans les services de chirurgie ou même d’oncologie
médicale (1, 2). La distribution de l’âge des malades dans les services de radio-
thérapie est montrée dans le tableau I.
Dans un futur proche, l’âge moyen de survenue des cancers sera plus élevé,
et même si ces patients bénéficient vraisemblablement beaucoup plus de la
chirurgie, il est peu probable que la différence d’âge entre les malades traités
par chirurgie ou chimiothérapie et ceux traités par radiothérapie change énor-
mément. Les départements de radiothérapie se sont toujours occupé de
malades plus âgés que ceux des autres spécialités et continueront à le faire. Si
les radiothérapeutes ont souvent une appréciation intuitive correcte des possi-
bilités de la radiothérapie chez le sujet âgé, l’attitude des médecins et des
ÂGE (ans) FRÉQUENCE (%)
> 60
> 65
> 70
> 75
> 85
60
40
25
15
3
Tableau I – Distribution de l’âge des malades dans un service de radiothérapie.

acteurs de la santé est habituellement influencée par la croyance que ce traite-
ment est moins bien toléré dans cette population et que l’évolution du cancer
y est moins agressive.
Cette difficulté d’appréciation des possibilités de la radiothérapie chez les
personnes âgées provient du manque de données objectives sur le sujet. Cela
résulte de l’exclusion des plus vieux de nos patients de la plupart des essais
cliniques et de l’échec des précédentes tentatives de corréler l’âge avec les diffé-
rents effets secondaires de la radiothérapie (1).
L’âge limite habituellement retenu dans les études est 70 ans. Les justifica-
tions pour exclure les patients plus âgés sont multiples : le taux important de
morts intercurrentes n’autoriserait pas une analyse correcte des résultats, la plus
grande fréquence des comorbidités biaiserait l’analyse de la tolérance et l’espé-
rance de vie trop courte rend inutile de tester des méthodes thérapeutiques
modernes plus efficaces. Ainsi, les modalités et les stratégies thérapeutiques
sont-elles habituellement validées par la recherche clinique sur une population
plus jeune que celle à laquelle elles sont plus largement destinées. Elles ne sont
donc pas obligatoirement valables dans le segment le plus âgé de la popula-
tion (1).
L’absence de données spécifiques concernant le pronostic réel du cancer et
la tolérance de la radiothérapie dans ce groupe d’âge conduit à un traitement
sub-optimal dans un nombre important de cas, bien que cette conduite ne soit
basée sur aucune preuve clinique ou scientifique. En pratique clinique, l’âge
avancé fait courir au malade le risque d’être sous-traité, même s’il n’est porteur
d’aucune autre pathologie ou ne souffre d’aucun handicap (3, 4). Cependant,
quelques études sont disponibles ; aucune n’indique qu’il faille traiter les
personnes âgées de manière moins agressive que les plus jeunes (5, 6).
Données radiobiologiques
Les études radiobiologiques ayant trait à la tolérance des tissus normaux irra-
diés chez les animaux âgés sont rares. En général, cette recherche pose de
nombreux problèmes biologiques et logistiques qui expliquent cette absence de
données. Travailler avec des souris ou des rats âgés, près de la fin de leur vie, ne
permet pas d’apprécier correctement les effets de l’irradiation en général et ses
effets tardifs en particulier, puisque le délai de survenue de ces derniers excède
largement la durée de vie de ces animaux.
Quelques études in vitro concernent l’âge des cultures cellulaires. Les fibro-
blastes humains ont des paramètres de survie semblables quel que soit l’âge du
donneur (entre 11 et 78 ans) (7), bien que le potentiel prolifératif de ces
cultures diminue avec l’âge (8). À l’inverse, le taux de réparation des lésions de
l’ADN diminue avec l’âge de la peau du rat (9), mais cette observation n’a pas
de contrepartie évidente en clinique (7, 10, 11, 12).
76 Cancer du sujet âgé

Enfin, les études radiocliniques chez les malades recevant une irradiation
post-mastectomie n’ont pas montré d’impact majeur de l’âge avancé sur la tolé-
rance du tissu normal. La diminution des mouvements de l’épaule a été le seul
facteur qui diffère significativement chez la femme âgée. Le développement des
télangiectasies, de la fibrose sous-cutanée, de l’œdème du bras ou de la fibrose
pulmonaire est équivalent quel que soit l’âge de la patiente (13). Ces données
suggèrent qu’il n’y a pas de relation entre l’âge des patients et le comportement
du tissu normal vis-à-vis des rayons.
Paramètres de la radiothérapie
La tolérance de la radiothérapie fait intervenir différents paramètres comme la
dose totale distribuée, l’étalement, le fractionnement, la dose par fraction, la
taille des champs et le volume de tissu sain compris dans le faisceau d’irradia-
tion. Chacun d’eux intervient à des degrés divers dans la survenue des
complications aiguës ou tardives de l’irradiation.
Les champs d’irradiation pelviens incluent généralement la peau, le gros
intestin distal, les anses grêles et le tractus uro-génital. Au niveau thoracique,
l’œsophage, le poumon et le cœur sont compris dans les faisceaux, tandis que,
lors du traitement des tumeurs de la tête et du cou, ce sont surtout la peau, les
muqueuses, les glandes salivaires et la moelle épinière. Tous ces sites peuvent
être l’objet de complications aiguës ou tardives.
Les effets aigus de la radiothérapie apparaissent habituellement à la fin de la
deuxième semaine de traitement qui correspond à une dose délivrée de 20 Gy
en étalement et fractionnement classique (2 Gy par jour, 5 fractions par
semaine) et peuvent être observés chez presque tous les malades qui ont reçu
une dose de plus de 40 Gy. Bien que très fréquentes et souvent limitantes dans
l’application des traitements, elles sont réversibles et sont contenues par les trai-
tements symptomatiques. Ce sont ces effets qui sont habituellement pris en
compte pour moduler la radiothérapie chez les personnes âgées, généralement
dans le sens d’une réduction de la dose totale ou d’un hypofractionnement. Le
but est de préserver la qualité de vie immédiate des malades, malheureusement
au détriment de la qualité du traitement et de son efficacité, car en apportant
une dose insuffisante au niveau de la tumeur on compromet les chances de la
contrôler. De même, il est parfois préconisé de prévoir deux jours de repos
supplémentaires chaque semaine durant la radiothérapie, ce qui invariablement
prolonge sa durée totale avec pour conséquence un effet délétère sur son effi-
cience dans certaines situations.
Les manifestations tardives sont d’installation plus insidieuse. Les premiers
symptômes apparaissent typiquement trois à quatre mois après la fin de la
radiothérapie, mais peuvent survenir pendant plusieurs années. Ils se stabilisent
habituellement avec le temps mais sont irréversibles. Le facteur principal de ces
La radiothérapie du sujet âgé 77

effets à long terme est une dose par fraction supérieure à 2 Gy, modalité
souvent proposée chez les personnes âgées pour raccourcir la durée totale du
traitement et offrir des jours de repos supplémentaires dans la semaine. Une
telle méthode fait courir un risque accru d’effets tardifs et devrait être seule-
ment envisagée si l’option thérapeutique palliative a été préalablement choisie.
Leur prévention réside dans la rigueur mise dans la définition, la préparation
et la réalisation du plan thérapeutique. Lorsqu’elles s’installent, ces séquelles
peuvent compromettre la qualité de vie des malades beaucoup plus significati-
vement que la majorité des effets aigus du traitement, alors qu’elles sont
régulièrement négligées chez les personnes âgées.
Il y a cependant un manque de données concernant ces effets tardifs,
puisque la proportion de morts intercurrentes avant d’être exposé au risque de
complication augmente bien entendu avec l’âge. Ce domaine d’étude est
encore partiellement en friche. Mais le contrôle locorégional et la survie de
malades traités par radiothérapie pour cancer de la tête et du cou, du thorax ou
du pelvis ne dépend pas de l’âge (14, 15, 16), ce qui expose potentiellement les
personnes âgées aux mêmes risques de complication tardive que les plus jeunes.
Effets des comorbidités sur la tolérance des tissus sains
Les comorbidités comme les maladies inflammatoires pelviennes, l’hyperten-
sion artérielle, le diabète peuvent compliquer le déroulement de la
radiothérapie. Cependant, si les modifications des fonctions vitales sont plus
fréquentes chez les personnes âgées, elles ne sont pas une caractéristique intrin-
sèquement liée à l’âge. Ces pathologies sont également observées chez les sujets
jeunes, où elles sont alors prises en compte pour appliquer le traitement dans
des conditions acceptables. D’une manière générale, on connaît mal l’impact
réel des comorbidités sur la tolérance de la radiothérapie et le pronostic de la
maladie cancéreuse. Les pathologies qui influencent la mortalité, l’état fonc-
tionnel ou la tolérance du traitement ne sont pas obligatoirement les mêmes.
Les outils utilisés pour mesurer l’effet des maladies associées sur l’espérance de
vie des patients sont peu adaptés à la cancérologie (17) et n’ont pas été testés
sur des patients recevant spécifiquement une radiothérapie.
Conditions techniques
La délivrance optimale de la radiothérapie nécessite une immobilisation
parfaite du malade, généralement en décubitus, qui est obtenue par un haut
degré de collaboration entre le malade et le médecin. L’immobilité parfaite
requise peut être un problème pour les personnes âgées souffrant d’une arthrite
78 Cancer du sujet âgé

chronique, d’une insuffisance respiratoire ou cardiaque. En général, si le repé-
rage et la simulation sont faisables sans problème, alors le traitement pourra
avoir lieu sans inconvénient, chaque séance ne durant que quelques minutes.
Le refus du patient devant un inconfort lié aux impératifs techniques de l’ir-
radiation est inhabituel. L’utilisation d’accessoires de contention confortables
et efficaces pour obtenir et maintenir la position nécessaire lors du traitement
doit réduire les impossibilités de réalisation de la radiothérapie chez les
personnes âgées. D’une manière générale, la non-compliance dans les services
de radiothérapie est estimée à environ 1 % (1).
Données socio-économiques
L’écueil majeur pour les personnes âgées est de venir à l’hôpital cinq fois par
semaine pour recevoir leur traitement. Le transport dépend parfois de la famille
ou d’un conjoint, de la prise en charge par l’assurance-maladie ou de la disponi-
bilité des transports publics. Dans une enquête épidémiologique hollandaise, une
distance de plus de trente-cinq kilomètres entre la résidence du malade et le service
de radiothérapie n’affecte pas l’utilisation de la radiothérapie dans l’arsenal théra-
peutique, excepté pour les patients âgés porteurs d’un cancer du poumon. Le
pourcentage de ces derniers recevant une radiothérapie diminue de 48 à 28 % en
fonction de l’âge (18). La distance du centre de radiothérapie n’est pas nécessaire-
ment un facteur de sélection pour d’autres régions ou d’autres pays, mais cette
étude illustre comment le choix des stratégies thérapeutiques peut se faire en fonc-
tion de paramètres qui ne sont pas reliés à la tumeur elle-même.
Les patients fragiles voient fréquemment leur mobilité limitée par des patho-
logies associées qui peuvent compromettre la réalisation de la radiothérapie. Un
bon entourage familial, une prise en charge sociale et médicale adaptée doit
permettre un traitement actif de ces maladies intercurrentes. Les soins à domicile
et la rééducation sont indispensables pour que les gênes et les handicaps modérés
ne soient plus des freins pour le bon déroulement du traitement.
Le repos du week-end régulièrement proposé aux malades en cours de radio-
thérapie est souvent insuffisant pour les plus vieux, parce que les week-ends sont
fréquemment dédiés à la visite de la famille et à d’autres activités sociales qui fati-
guent autant, sinon plus, que la radiothérapie. L’hospitalisation n’est probablement
pas d’une aide réelle parce qu’elle prive le malade de son environnement familier
avec les risques de désorientation et de dépression que cela fait courir.
Du fait de l’hétérogénéité de cette population, il est difficile d’y appliquer
des régles prédéfinies. Il faut donc, au cas par cas, trouver le compromis accep-
table entre un traitement facilement réalisable et l’objectif carcinologique que
l’on s’est fixé. Lorsque les problèmes d’ordre gériatrique sont importants, il ne
faut pas hésiter à prendre l’avis des gériatres pour aider à définir une option
thérapeutique raisonnable.
La radiothérapie du sujet âgé 79
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%