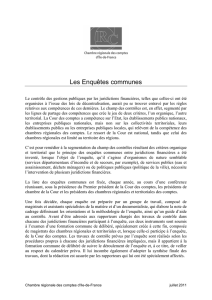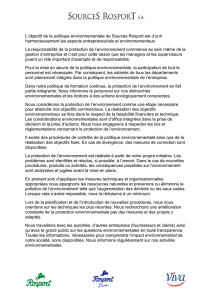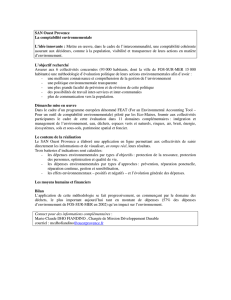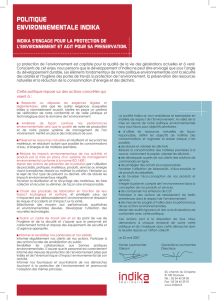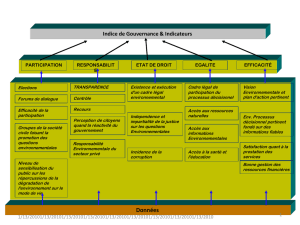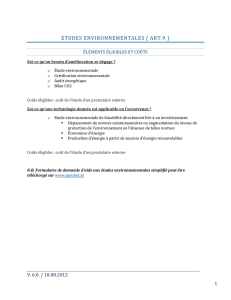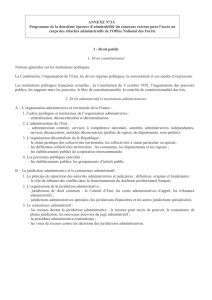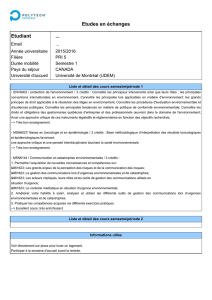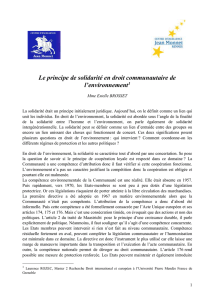la mise en œuvre du droit de l`environnement

LA MISE EN ŒUVRE DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT,
DÉFI EUROPÉEN (*)
La mise en œuvre du droit de l’environnement est un défi pour l’Europe. Le sujet est particulièrement
sensible. Il touche au droit pénal et à la procédure civile, des domaines longtemps considérés comme
relevant de la seule compétence des États, au travers de procédures de décision intergouvernementale,
assez peu différentes de la négociation de conventions internationales.
Un tel équilibre institutionnel n’était pas favorable à la mise en œuvre effective du droit de
l’environnement. Pourtant, la législation communautaire dans ce domaine est, pour ce qui concerne le
droit substantiel, parvenue à maturité. Qu’il s’agisse des déchets, des installations polluantes, des
produits chimiques, de la qualité de l’eau, de la protection des espèces menacées d’extinction, ou du
contrôle des organismes génétiquement modifiés, il n’y a plus guère, en effet, d’aspect de cette matière
qui ne fasse l’objet de directives ou de règlements. Ce sont les sanctions qui font encore défaut et sans
doute les particuliers, les associations, les opérateurs économiques peuvent-ils dénoncer à la
Commission le laxisme des États. C’est principalement de cette dimension comparatiste, à l’aune des
textes européens, que Francis Jacob, ancien avocat général à la Cou de justice des Communautés
européennes a traité lors d’une conférence qu’il a donnée à la Cour de cassation le 25 juin 2007 dans le
cadre du cycle consacré au droit européen.
C’est avec un immense plaisir et un grand honneur que j’ai accepté
l’invitation à participer à cette conférence du cycle de droit euro-
péen lancé par le premier président Canivet. Je suis d’autant plus
ravi qu’il m’a été demandé d’intervenir sur le droit de l’environne-
ment, un sujet dont l’importance et l’intérêt augmentent de jour en
jour. C’est d’ailleurs un domaine dans lequel l’Union européenne a
un rôle de première importance à jouer. En effet, même ceux qui ne
font pas toujours preuve d’un enthousiasme marqué à l’égard du
plan d’intégration européenne — dont on sait qu’il y en a aussi bien
en Angleterre qu’en France — semblent concéder que les problè-
mes liés à l’environnement dépassent largement les frontières na-
tionales, et ce faisant, requièrent une action communautaire. Un
ministre anglais a même parlé, dernièrement, de « l’UE » comme fai-
sant référence non à l’Union européenne mais à l’Union
environnementale. Il y déjà une quantité importante de règles euro-
péennes en vigueur traitant de l’environnement, mais ce qui nous
retiendra aujourd’hui portera d’avantage sur leur mise en œuvre en
tant que telle. Plus précisément, comment garantir que ce droit est
bien transposé et bien exécuté ? Quelles méthodes le droit rend
disponibles à cette fin ? Le sujet est large. Dans le peu de temps qui
m’est imparti, je vais tenter de vous fournir quelques indications,
quelques indices, et de mettre en évidence certains des défauts et
des difficultés auxquels nous sommes confrontés. J’espère et je sou-
haite de tout cœur que nous pourrons tous ensemble, pendant le
débat, réfléchir aux voies menant au progrès.
I. Méthodes d’application du droit communautaire
de l’environnement
A. L’action de la Commission contre les États membres
auprès de la CJCE
C’est là la principale méthode offerte par le Traité UE pour garantir
l’exécution de leurs obligations par les États membres. Elle est va-
lable pour l’ensemble de la matière que constitue le droit
communautaire de l’environnement. En effet, il y a déjà un nombre
considérable d’affaires liées à l’environnement, soulignant la fai-
blesse dont souffre ce droit au niveau de sa mise en œuvre. Cette
mise en œuvre peut recouvrir différents aspects : au niveau légis-
latif, un défaut de transposition ou une mauvaise transposition des
directives communautaires dans le droit national, en violation de
l’article 249 du Traité UE ; le défaut de conception des programmes
d’action environnementale, comme le prévoit la législation
environnementale européenne, le défaut d’exécution de la législa-
tion transposée (...), etc.
En règle générale, la procédure est efficace : les États membres se
plient aux exigences posées, soit pendant la phase précontentieuse
soit pendant la phase contentieuse, à partir du moment où la Cour
trouve quelque violation que ce soit. Ce n’est qu’occasionnellement
que la poursuite de la phase contentieuse s’avère nécessaire. En
général, il s’agit alors du refus de se conformer à un jugement ayant
conclu à une infraction. La procédure pour infraction est mainte-
nant renforcée par des sanctions punissant le défaut de mise en
conformité avec arrêts de la CJCE concluant justement à une infrac-
tion initiale. Au terme des amendements du Traité UE, l’État mem-
bre ainsi fautif peut se voir imposé des amendes. La première ap-
plication de cette procédure, dans le cadre environnemental, re-
monte à l’affaire opposant la Grèce à la Commission, et au terme de
laquelle la Grèce s’est vue infligée une amende pour défaut de
protection d’un site en Crète. Cependant, l’exemple le plus signifi-
catif est sûrement celui de la France, qui s’est vue condamnée à
payer une importante amende assortie d’astreintes pour défaut per-
sistant de mise en conformité des zones de limitation de pêche.
L’inconvénient des recours en manquement contre un État membre
introduits par la Commission, au moins du point de vue des parti-
culiers et des ONG environnementales, réside dans le fait que cette
dernière conserve entièrement et à sa seule discrétion le fait d’in-
troduire ou non un tel recours, de maintenir ou de couper court aux
(*) Le style oral a été conservé.
DOCTRINE
DROIT
EUROPÉEN
En ligne sur Lextenso.fr Petites affiches - PLACARD 05/09(08H50) - N
o
pa178094.sgm - 1

poursuites. En aucun cas, elle ne saurait être forcée d’agir. De plus,
les individus et les ONG intéressés sont complètement exclus de la
procédure sans compter que la procédure en elle-même est relati-
vement lente. Pour ces raisons, quand bien même ils conservent
toujours la possibilité d’agir auprès de la CJCE, par l’intermédiaire de
la Commission, ces derniers préfèrent agir, dans la mesure des pos-
sibilités offertes par le droit et par la pratique, contre les autorités
nationales, directement auprès des juridictions nationales.
B. Les poursuites civiles ou pénales auprès des juridictions
nationales
1. Les poursuites pénales
En général, les poursuites au pénal, visent non pas les autorités
publiques, mais les industries accusées de violation du droit de l’en-
vironnement. En général, les personnes privées ont un rôle très
limité en demande : certains systèmes permettent, sous certaines
conditions, les actions pénales d’origine privée, alors que d’autres,
comme c’est notamment le cas en France, autorisent les parties à se
joindre aux poursuites en tant que « partie civile ».
Il convient également de noter que, bien que l’Union européenne
n’ait pas de juridiction d’ordre pénal, le droit communautaire de
l’environnement peut exiger des États membres de prévoir des pour-
suites criminelles en cas de violation dudit droit. À cet égard, je vous
renvoie au très controversé, mais non moins juste, arrêt de la CJCE
d’octobre 2005.
2. Les poursuites civiles
Le thème sur lequel je voudrais me concentrer particulièrement dans
cette conférence a trait au traitement des recours fondés sur le droit
communautaire environnemental, à travers les actions civiles intro-
duites auprès des juridictions nationales.
Plus précisément, quelle est l’efficacité des procédures juridictionnelles
nationales à l’égard des actions fondées sur le droit européen de
l’environnement introduites par des demandeurs particuliers (par-
ticulièrement les individus ou les organisations environnementales
comme Greenpeace) cherchant à mener des actions fondées sur le
droit communautaire de l’environnement auprès des juridictions na-
tionales ?
Un tel thème renferme plusieurs aspects, tels que :
1. La question de la place des individus et des organisations : jusqu’à
quel point les juridictions sont-elles prêtes à accueillir des actions
dans lesquelles l’habituel intérêt à agir fait défaut, mais est relayé,
dans un certain sens, par l’intérêt public ?
2. Jusqu’à quel point les juridictions nationales sont-elles prêtes à
appliquer le droit communautaire de l’environnement, avec ou sans
le filet de l’article 234 TCE ?
3. La question des voies de recours.
4. La question du coût des actions et de l’accès à une aide juridique,
revêtant la forme d’une assistance financière à l’égard de ce coût,
pourraient aussi être pertinents.
Bien sûr, je ne peux pas prétendre à une étude exhaustive. Encore
une fois, je vais essayer de tracer une route, en me limitant à vous
fournir quelques éléments, tels que des exemples d’affaires intéres-
santes, ou les différences procédurales observées dans les États mem-
bres. Au cours des débats, il sera opportun de s’interroger sur les
moyens d’améliorer les faiblesses ainsi mises en lumière.
C. L’intérêt à agir
Commençons par étudier la question de l’intérêt à agir.
En examinant la position des droits nationaux sur la question de
l’intérêt à agir, sans encore s’intéresser à la question particulière du
droit de l’environnement, on peut déjà remarquer que les divergen-
ces entre les différents systèmes sont relativement importantes.
Le droit anglais est très libéral à cet égard. Brièvement, on peut dire
que, contrairement à d’autres systèmes, et peut être d’une manière
plus logique, la question de savoir si un justiciable a un intérêt à agir
n’est pas considérée comme une condition préalable à l’examen du
dossier par la cour, mais est intégrée dans l’examen général de l’af-
faire.
Sur la scène environnementale également, une approche relative-
ment large a été dégagée sur cette question de l’intérêt à agir. Ainsi,
par exemple, Greenpeace s’est vu reconnaître un intérêt à agir, pour
attaquer la décision autorisant le générateur nucléaire.
Peut-être pourrait-on considérer que le système européen présen-
tant l’approche la plus restrictive de la question de l’intérêt à agir est
le système communautaire lui-même. Bien sûr, il s’agit alors de l’in-
térêt à agir contre les mesures communautaires, et non nationales.
Mais, d’aucun sait que la Cour de justice des communautés euro-
péennes a toujours adopté une approche assez restrictive sur la
question de la capacité, tant pour les personnes physiques que pour
les personnes morales, à contester en justice les mesures
communautaires.
La même tendance se retrouve à l’égard des mesures communautaires
en matière environnementale. Notons dès à présent qu’il est ici plus
question de mesures anti-environnementales, portant atteinte à l’en-
vironnement, que de mesures littéralement environnementales. Ainsi
en est-il de la décision de la Commission allouant des fonds à la
construction d’une installation nucléaire. Dans ces cas là, il sera sou-
vent impossible de remplir la condition exigeant que la mesure soit
d’effet direct et personnel, telle qu’interprétée par la CJCE, tout sim-
plement en raison de la nature même de telles mesures, et qui sont
justement critiquées du fait de leur impact général sur l’environne-
ment. La jurisprudence laisse le principe intact et n’admet aucune
exception tenant compte du caractère particulier de ces recours.
La tendance, dans les autres systèmes nationaux européens, semble
favoriser une approche relativement libérale de la question de l’in-
térêt à agir, particulièrement quand il s’agit de questions
environnementales.
DOCTRINE
DROIT EUROPÉEN
2- Petites affiches - PLACARD 05/09(08H50) - N
O
PA178094.SGM En ligne sur Lextenso.fr

Au Danemark, les juridictions ont, ces dernières années, adopté une
position libérale, de telle sorte que, dans une affaire majeure (opé-
rant un revirement de jurisprudence des cours danoises), elles ont
admis que Greenpeace avait un intérêt à agir contre le grand projet
de construction du nouveau pont reliant le Danemark et la Suède
— en partie au motif qu’il ne répondait pas aux exigences posées
par la directive européenne relative à l’évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l’environnement (Impact
Assessment Directive).
J’ai remarqué que dans d’autres pays également (en Grèce, au
Portugal, mais aussi devant le Conseil d’État français), les juridictions
ont adopté une acception beaucoup plus large de la notion d’intérêt
à agir. En effet, les cours sont susceptibles d’accueillir une actio
popularis, là où le requérant n’est pas tenu de démontrer qu’il a un
intérêt à agir autre que celui que constitue l’intérêt public. En d’autres
termes, contrairement aux exigences normales, et par une démons-
tration quelque peu paradoxale de la nature très particulière des
actions portant sur l’environnement, le requérant pourrait être amené
à démontrer qu’il n’agit pas dans son propre intérêt.
La question de l’intérêt à agir revêt une importance toute particu-
lière dans la Convention d’Aarhus, datant de 1998, ratifiée par la
plupart des États membres de l’Union européenne, et qui devrait
jouer un rôle de premier ordre dans la promotion de l’accès effectif
aux tribunaux. Cette convention sur l’accès à l’information, la par-
ticipation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice
en matière de droit de l’environnement, part de l’idée, exprimée
dans le préambule, selon laquelle des mécanismes juridictionnels
effectifs devraient être mis à disposition du public dans les cas por-
tant sur les questions environnementales, de telle sorte que ses in-
térêts légitimes soient protégés, et que la loi soit appliquée.
L’article 9 est particulièrement pertinent pour le sujet qui nous re-
tient aujourd’hui. Plus particulièrement, l’article 9-2 institue un droit
d’accès devant une juridiction ou tout autre organe impartial ou
indépendant dans le but de faire examiner la légalité, tant formelle
que substantielle de la décision (au regard des dispositions de la
convention). L’article 9-4 vise à assurer que de telles procédures
proposent des recours adéquats et effectifs d’une part, et qu’elles
sont justes, équitables et ne sont pas l’objet de coûts exorbitants,
d’autre part. L’article 9-5 impose l’ obligation d’envisager la mise en
place de mécanismes d’assistance appropriés afin d’atténuer, voire
d’éliminer les obstacles financiers et de toute autre nature freinant
l’accès à la justice.
II. Le fond
Tournons-nous maintenant vers le fond des demandes introduites
devant les juridictions nationales, au sujet des questions
environnementales.
Dans les États membres de l’Union européenne, il semble qu’il y ait
eu peu d’efforts visant à instituer de nouveaux recours pour traiter
des questions environnementales en général. Au contraire, il a été
davantage question de savoir comment on pouvait adapter les re-
cours existants aux besoins spécifiques de la protection de l’envi-
ronnement. Mais les systèmes juridiques nationaux varient consi-
dérablement, et l’adaptation de ce que l’histoire a forgé, au fil des
événements comme un tout à des considérations spécifiques peut
facilement aboutir à des incohérences.
Si l’on prend l’exemple du droit anglais, on trouve plusieurs sortes
de torts (dans les autres systèmes, on recourt au terme de « délit »)
qui pourraient illustrer pertinemment mon propos. Je ferai état, très
brièvement, de trois types de responsabilités délictuelles.
Tout d’abord, ilyaletort d’ordre général, dit de négligence, qui
n’est pas sans présenter quelques analogies avec les dispositions
générales du Code civil. Il exige du demandeur qu’il établisse :
(i) qu’il pesait un devoir de prudence sur le défendeur ;
(ii) que le défendeur n’a pas honoré ce devoir ;
(iii) que le dommage subi par le demandeur est le résultat du non-
respect du devoir de prudence du défendeur.
Cependant le tort de négligence a de nombreux désavantages quand
il est utilisé dans le cadre de recours pour atteinte à l’environne-
ment. Tout d’abord, et surtout, il est fondé sur la faute, alors que les
autres torts ne recherchent pas la commission d’une faute. Ensuite,
le dommage doit avoir été raisonnablement prévisible — ce qui ne
peut pas toujours être le cas pour les atteintes à l’environnement, et
qui, peu importe le contexte, donne souvent lieu à de réelles dif-
ficultés. Enfin, le dommage, dans le cadre du tort de négligence,
implique qu’il y ait un véritable dommage à la propriété ou un
dommage corporel, de telle sorte que le tort de négligence ne peut
être utilisé si les demandes en réparation portent sur d’autres formes
de dommages, comme le désagrément, le stress, ou des symptômes
physiques d’un dommage corporel — comme cela pourrait être le
cas, par exemple avec les nuisances sonores. Pour ces formes de
dommages, il pourrait être nécessaire de se fonder sur d’autres torts,
telles que les nuisances ou la règle tirée de l’arrêt Rylands v. Fletcher,
que je me dois d’évoquer.
Le terme de nuisance qualifiant le tort du même nom couvre da-
vantage l’acception française de « source de préjudice », que le sens
moderne qu’on lui prête parfois et qui se définit par l’expression
anglaise « a pain in the neck » (un agacement). Le droit des nuisances
implique différentes notions non juridiques, ayant trait à l’usage d’une
terre par son propriétaire, ou des droits ou intérêts en rapport avec
cetteterre.Maisilyaplusieurs torts au sein de cette catégorie :
nuisances privées, nuisances publiques, statutory nuisance ; et un
tort complètement à part dégagé dans l’arrêt Rylands v. Fletcher,
selon lequel « la personne qui, de son propre chef, amène sur sa
terre, y entrepose et y conserve quelque chose susceptible de créer
un préjudice si celle-ci s’en échappe, est réputée le conserver à ses
propres risques, de telle sorte que si un dommage est causé, il sera
tenu responsable de tous les dommages se rattachant à ladite échap-
pée ». Pour ces torts, au contraire de la négligence, la responsabilité
doit être stricte, c’est-à-dire sans lien nécessaire avec la notion de
faute. Cependant de tels recours ne sont ouverts que dans une série
de circonstances limitées aux intérêts de la terre.
En ligne sur Lextenso.fr Petites affiches - PLACARD 05/09(08H50) - N
o
pa178094.sgm - 3

Une troisième grande catégorie de responsabilité civile est la vio-
lation d’un devoir légal. Dans ce contexte, le demandeur argue du
fait que le défendeur a violé l’obligation qui lui incombait, au terme
d’une loi , et qu’il en a résulté une perte pour le demandeur. La
responsabilité serait objective et pourrait donc être retenue sans qu’il
y soit besoin d’établir une faute ; mais l’accès à un tel recours est
admis de manière restrictive : les cours ont retenu qu’on peut l’in-
voquer dès lors que l’on peut montrer que le Parlement a cherché
à offrir au demandeur un recours civil. Il doit être aussi démontré
que la loi concernée visait une catégorie de personnes en particu-
lier, et nullement l’ensemble de la population. Il est donc peu pro-
bable qu’un tel recours trouve à s’appliquer dans des domaines où
les législations sont plutôt d’ordre général, comme c’est le cas en
matière de contrôle de la pollution, dès lors que l’acte parlementaire
confère un minimum de discrétion à l’égard des autorités publiques,
ou alors qu’il prévoit que les violations du droit concerné seront
sanctionnées par le droit pénal. Ainsi, il est peu probable de dis-
poser d’un tel recours, dans la mesure où la législation cherche à
protéger des intérêts d’ordre public, comme cela est souvent le cas
en matière environnementale.
De plus, il n’y a aucune indication de la part des juridictions an-
glaises cherchant pourtant à faire preuve de créativité dans leur
application de la common law, pour développer les catégories dans
une telle matière. Au contraire, en général, les higher courts n’ont
pas cherché à développer la common law dans un sens de pro-
motion des recours. Ainsi, elles se sont par exemple montrés par-
ticulièrement réticentes à l’accueil des demandes en réparation de
préjudices.
Il y a cependant des domaines particuliers dans lesquels la législa-
tion offre justement des recours de droit civil. Trois exemples peu-
vent être cités à cet égard : le préjudice causé par une contamination
radioactive (Nuclear Installations Act, 1965), les préjudices résultant
de marées noires (Merchant Shipping Act, 1995), et les dommages
dus à des rejets illicites (Environmental Protection Act, 1990). Dans
certains cas cependant, tant la création que la portée des règles
spéciales de responsabilité dans de tels secteurs découlent simple-
ment d’obligations conventionnelles : cela pourrait donc être un do-
maine au sein duquel des règles communes prévaudraient dans les
différents systèmes nationaux.
Qu’en est-il de la position anglaise comparée aux autres systèmes
européens ? Et particulièrement vis-à-vis des droits français et alle-
mand ? Où le système français se place-t-il dans ce tableau ? Il serait
particulièrement incongru de ma part de prétendre résumer l’état du
droit français, dans les murs mêmes de la Cour de cassation. Ce-
pendant, mon impression d’ensemble est que le droit français, tout
comme le droit anglais, ne contient aucune disposition générale de
responsabilité en matière d’environnement. Cependant, une diffé-
rence importante réside dans le fait que les juridictions françaises, et
particulièrement la Cour de cassation, plus que les juridictions an-
glaises, ont développé un droit de l’environnement sur la base du
droit commun. Pour ce qui est du droit français, cela est particuliè-
rement vrai à l’égard des règles du Code civil, et notamment de la
notion de faute de l’article 1382, et de la responsabilité du fait des
choses issue de l’article 1384, alinéa 1. Par exemple, et pour me
limiter à un seul exemple, dans l’espèce de la Malterie, en 1993, la
Cour de cassation a développé, sur le fondement de ces règles, le
principe du « pollueur payeur ».
Postulant toujours que j’ai bien compris la teneur du droit français
à cet égard, il me semble que ce dernier a mis en place quelques
innovations majeures à l’égard des demandes en matière d’environ-
nement, telles que :
— un régime spécial pour les associations environnementales
agréées, qui peuvent agir en tant que partie civile, au terme de
l’article L 142-2 du Code de l’environnement ;
— des recours développés, y compris des procédures de référé, et
un recours permettant la « restauration », c’est-à-dire pouvoir exiger
la restitution de la chose dans son état initial ;
— un éventail élargi de dommages-intérêts qui peuvent être al-
loués, notamment :
(i) les coûts de remise en l’état ;
(ii) une grille d’évaluation des atteintes à l’environnement devant
être réparés en termes d’unités de pollution ;
(iii) les coûts supportés par l’association.
Je vais essayer de brièvement faire part de la conception allemande
sur la question, qui, telle que je l’ai perçue, offre un contraste à
l’égard tant du droit français que du droit anglais. Le droit allemand
comporte — contrairement aux droits français et anglais — des
dispositions d’ordre général sur la responsabilité en matière
environnementale. D’ailleurs, la loi sur la responsabilité
environnementale (Umwelthaftungsgestez), qui est entrée en vi-
gueur en 1991, vise à protéger un large champ de questions
environnementales et à combattre la pollution sous ses diverses
formes. La perte sèche, cependant, ne peut trouver réparation. En
général, la violation du droit environnemental donne lieu à la mise
en cause de la responsabilité. Il en est ainsi, au terme des disposi-
tions générales contenues dans l’article 328-II du Code civil alle-
mand (BGB). Toutefois, ladite violation doit être intentionnelle ou
résulter de la négligence du responsable.
Il n’en reste pas moins que certaines dispositions spécifiques, ré-
gissant des secteurs eux aussi spécifiques, instituent un régime de
responsabilité sans faute. C’est le cas en matière de pollution ma-
ritime.
Ainsi, le système juridique national, en matière environnementale,
fait figure de patchwork. Serait-il souhaitable de chercher à réfor-
mer le système national pour reconnaître un principe général de
responsabilité pour les dommages environnementaux ? Au moins
un système semble avoir pris cette direction. Je sais que le droit grec
a développé la notion de droit à la personnalité — que l’on retrouve
également en droit constitutionnel allemand, mais qui n’a pas servi
de base pour développer les recours environnementaux. Ce droit à
la personnalité s’est montré particulièrement utile en Grèce, afin
DOCTRINE
DROIT EUROPÉEN
4- Petites affiches - PLACARD 05/09(08H50) - N
O
PA178094.SGM En ligne sur Lextenso.fr

d’obtenir des injonctions prévenant les atteintes à l’environnement
— qui est probablement le recours le plus important en vigueur. Les
juridictions ont ainsi offert un recours rapide, efficace et peu coû-
teux. La réparation des dommages, reste cependant relativement
rare.
Examinons maintenant les demandes environnementales introdui-
tes auprès des juridictions nationales et fondées sur le droit
communautaire.
Permettez moi, au préalable, de rappeler quelques points essentiels
du droit communautaire.
Tout d’abord, l’effet direct. Il n’est sûrement pas nécessaire de s’éten-
dre sur cette notion fondamentale du droit communautaire. Dans
l’absolu, cette notion est très importante en ce qu’elle confère aux
personnes privées des droits directement applicables par les juri-
dictions nationales. Cependant, un tel avantage se trouve restreint
dans des domaines tels que le droit de l’environnement, dans la
mesure où de tels droits ne sont opposables que contre des États,
et non contre les autres pollueurs, dans les situations où ces der-
niers ne sont pas des organes de l’État. De plus, cette notion d’effet
direct trouve toute sa raison d’être dans les hypothèses dans les-
quelles les États membres n’ont pas procédé à la transposition de la
directive concernée. Or, en matière environnementale, le problème,
généralement, vient non pas d’une mauvaise transposition, mais de
l’application elle-même.
Deuxièmement, dans tous les cas introduits devant des juridictions
nationales et portant sur le droit communautaire de l’environne-
ment, la CJCE a compétence pour statuer sur toute question
préjudicielle. La Communauté européenne est essentiellement un
système décentralisé dans lequel les mesures de droit communautaire
exigent souvent d’être insérées dans le droit en vigueur, appliquées,
ou mises à exécution, au sein des États membres, par les autorités
nationales, et notamment les juridictions nationales qui sont en prin-
cipe les « juridictions communautaires de droit commun ». Afin de
garantir que le droit communautaire soit appliqué de manière uni-
forme au sein des États membres — à défaut de quoi, il ne pourrait
y avoir de communauté de droit — les juridictions nationales sont
investies du droit de poser une question préjudicielle à la CJCE, et
les juridictions statuant en dernier ressort sont tenues d’y procéder ;
étant entendu que le principe ou l’interprétation ainsi dégagé par la
CJCE lie toutes les autres juridictions nationales. Cependant, encore
une fois, ce mécanisme perd peut-être de son intérêt en matière de
droit de l’environnement, où le problème d’exécution est plus une
question d’ouverture des recours que d’interprétation correcte et
uniforme.
Il n’en reste pas moins que dans l’exercice de ses compétences, la
CJCE a développé certains principes d’une importance fondamen-
tale dans la matière que nous sommes en train d’étudier. Ainsi, dès
qu’il y a une question d’intérêt à agir, de règle processuelle ou de
recours, il ne peut y avoir de discriminations entre l’exécution du
droit national et celle du droit communautaire. Dès lors, toutes les
règles et tous les recours développés dans le cadre du droit national
doivent donc également recevoir application lorsqu’il s’agit d’une
question de droit communautaire.
C’est un principe très important et très utile, bien qu’il mette éga-
lement en lumière les disparités existant entre les différents systè-
mes nationaux. Contrairement à la recherche d’une certaine unité
substantielle du droit communautaire, ce principe n’est pas un ins-
trument servant la cause de l’harmonisation du droit en Europe.
Sûrement plus utile à cet égard, la CJCE a développé le principe au
terme duquel les juridictions nationales doivent mettre à disposition
des recours effectifs en matière de droit communautaire. Cela im-
plique, qu’afin de garantir l’application du droit communautaire, les
juridictions nationales, de manière exceptionnelle, peuvent être ame-
nées à aller au-delà de ce qu’elles auraient fait pour des demandes
similaires fondées sur le droit national. Ainsi, dans le cas Factortame,
la CJCE a retenu que les dispositions nationales empêchant la pro-
nonciation d’une injonction doivent être écartées dès lors que la
protection effective des droits communautaires serait compromise.
Un tel principe peut trouver une pleine signification dans le contexte
du droit de l’environnement.
Enfin, au terme du principe dégagé dans l’arrêt Francovich, les per-
sonnes privées devraient être capables de percevoir des dommages
intérêts des États membres qui n’auraient pas été en mesure de
protéger les droits communautaires de manière appropriée. En ma-
tière environnementale, il n’y a eu pour l’instant que peu d’exem-
ples à cet égard. Dans l’arrêt Bowden, la High Court a rejeté une
demande en réparation d’un pécheur de moules, dont l’activité avait
cessé suite à la pollution de ses eaux de pêche, et qui arguait d’un
défaut de transposition de toute une série de directives
communautaires par le Royaume-Uni. En appel, cependant, la Cour
d’appel a retenu que l’une de ces directives, the Shellfish Waters
Directive, octroyait des droits aux pêcheurs, dont un droit à com-
pensation dans les cas où la directive n’avait pas été correctement
transposée.
Au niveau comunautaire, il convient de souligner l’adoption, en
2004, de la directive sur la responsabilité en matière environnementale
(directive n
o
2004/35/EC), qui prévoit des droits à compensation
pour les atteintes à l’environnement contre les États. Cette directive,
était censée être transposée par les États membres avant le 30 avril
2007, mais il semble que peu d’États membres se soient préoccupés
de cette échéance. À ce jour, seuls trois États l’ont transposée : l’Ita-
lie, la Lettonie, et la Lituanie.
III. Les coûts
Après avoir fait état du droit substantiel, permettez-moi de faire men-
tion de l’organisation de nos systèmes juridiques. Il importe peu de
jouir de droits, ou de disposer de recours, si vous n’avez pas les
moyens d’aller devant le juge. Et il s’agit ici de moyens financiers.
Les coûts juridictionnels constituent un obstacle plus ou moins grand
selon les systèmes juridiques. Peut-être est-ce en Angleterre (et je
parle en connaissance de cause, en Irlande) que cela pose le plus
de problèmes. On dit parfois que la justice coûte si cher qu’elle est
En ligne sur Lextenso.fr Petites affiches - PLACARD 05/09(08H50) - N
o
pa178094.sgm - 5
 6
6
1
/
6
100%