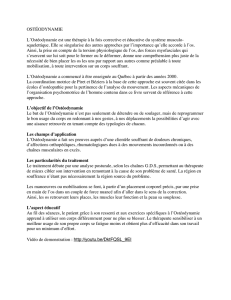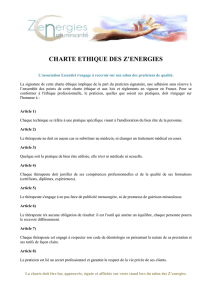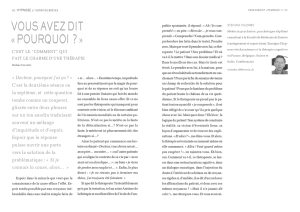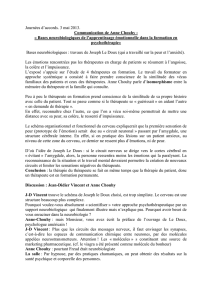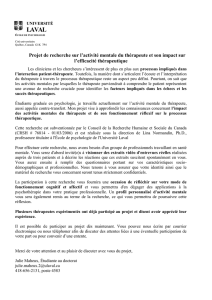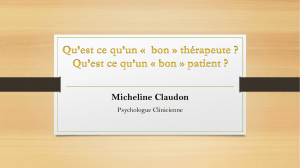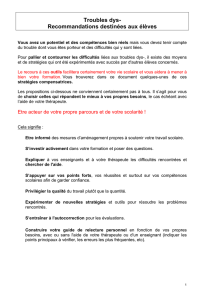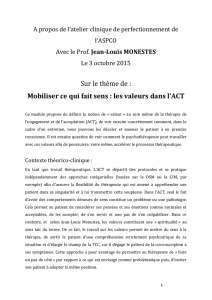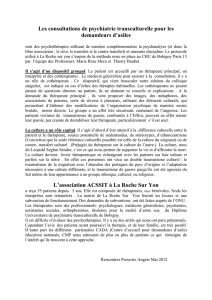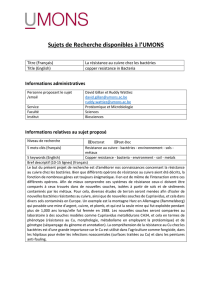Résistance ou persistance?

Interactions Vol. 6, no 1, printemps 2002
Résistance ou persistance?
Lise Roquet-St-Arnaud
Ste-Catherine de Hatley
RÉSUMÉ
À la suite du survol de la littérature psychologique, la diversité des significations de la
notion de résistance et des façons de la gérer est mise en évidence, tout particulièrement
quand on se demande quelle en est la source. Les quatre parties de l’article regroupent les
définitions proposées en fonction de cette caractéristique. Lorsque le client est la source de
la résistance, la définition de celle-ci varie selon les auteurs, soit comme
une désobéissance thérapeutique ou un mécanisme autoprotecteur de l’intégrité
personnelle. Les auteurs qui considèrent que le thérapeute est la source de la résistance
affirment que c’est à lui de saisir la façon de percevoir du client et de s’y ajuster. Lorsque
la source de la résistance est dans la relation, on définit des facteurs qui interfèrent dans le
processus thérapeutique. Enfin, des auteurs affirment que la résistance n’existe pas, que
cette notion est inutile. On suggère alors de remplacer le mot résistance par celui de
persistance.
Introduction
La résistance est un concept qui apparaît dans la majorité des écoles de pensée en
psychothérapie, mais la façon d’utiliser ce concept est très variable, surtout
lorsqu’on cherche à en situer la source. Pour les uns, elle vient du client; pour
d’autres, du thérapeute; pour d’autres encore, elle se situe dans la relation. Une
seule approche en psychothérapie a célébré la mort de la résistance (Shazer, 1984)
pour éliminer ce construit de ses visions théoriques. En effet, certains auteurs en
sont venus à croire que la notion de résistance n’est pas nécessaire à leur pratique.
Dans ce qui suit, nous ferons un survol de la littérature psychologique sur la
notion de résistance, afin de présenter les définitions différentes selon les auteurs
et les écoles de pensée qui attribuent la source de la résistance au client, ceux qui
l’attribuent au thérapeute, ceux qui l’attribuent à la relation et ceux qui
considèrent que la résistance n’existe pas ou qu’elle est inutile. Nous aborderons
ces différentes conceptions de la résistance, tout en traitant des méthodes qui leur
sont associées pour la gérer.

50 Résistance ou
persistance
Interactions Vol. 6, no 1, printemps 2002
Le client est la source de la résistance
Dès le 19e siècle, même si Charcot et Janet (voir Ellis, 1995) signalaient
l’existence de la résistance dans leur pratique, Freud est celui qui, au début du 20e
siècle (1912 à 1965), en a fait une notion centrale dans sa théorie et son approche
psychanalytique. Selon cette approche, la résistance ne se produit pas de façon
périodique; c’est le tracé continu d’un conflit du client par rapport au changement;
conflit entre son désir sincère de changement et les peurs qu’il suscite (Wachtel,
1982). Dans les premières années de l’exercice de la psychanalyse, la résistance
du patient était perçue comme une fonction mentale qui faisait obstacle au rappel
du matériel sexuel inconscient. On présumait alors que la résistance était une
expression d’opposition à l’analyste et au traitement. À cette époque, la résistance
était un obstacle à éliminer ou à surmonter (Dewald, 1982). Plus tard, on constata
que les manifestations de résistance se produisaient souvent à l’insu du patient.
Freud (1926 à 1959, cité par Dewald, 1982) décrivait cinq sortes de résistances :
trois résistances de l’ego, soit le refoulement, le transfert et le gain secondaire; la
résistance du id qui prend la forme d’une répétition-compulsion; la résistance du
superego qui se traduit dans un sentiment de culpabilité.
Selon Dewald (1982), différentes méthodes sont utilisées pour gérer la résistance
dont la source est le client : 1) reconnaître ses manifestations et ses significations
et être vigilant par rapport à son contre-transfert; 2) intégrer la résistance dans le
contexte thérapeutique du moment et évaluer la pertinence de la signaler ou non
au patient; 3) approcher le travail sur la résistance de façon progressive, par
étapes; 4) l’interpréter; 5) adopter une attitude thérapeutique neutre et intéressée;
6) utiliser la répétition; 7) éviter de renforcer la résistance; 8) être à l’affût et
vérifier au fur et à mesure la pertinence de continuer le travail. Dans ce sens, le
signe du succès thérapeutique est la capacité du patient de reconnaître et de
surmonter ses propres résistances.
Dans ses premiers écrits, Freud considérait que la résistance n’était pas un
problème interpersonnel entre le thérapeute et le patient, mais qu’elle était un
problème intrapsychique qui émergeait telle une lutte sur la ligne de front du
traitement. Le transfert thérapeutique motivait le patient qui refusait
d’expérimenter la souffrance liée à l’exploration de son problème. Il l’amenait à
projeter ses peurs, ses désirs, ses relations passées sur son thérapeute dans l’espoir
de se restructurer d’une façon harmonieuse. Envisagés de ce point de vue, « le
transfert et la résistance sont les deux côtés d’une même médaille
développementale » (Basch, 1982, p. 5).

Résistance ou persistance 51
Interactions Vol. 6, no 1, printemps 2002
À ce sujet, Kemper (1994) cite quelques définitions qui se recoupent. La
résistance est l’opposition du client à faire émerger l’inconscient (Lego, 1984); la
résistance est le moyen par lequel l’ego se protège de l’invasion d’éléments
indésirables de l’inconscient (Freud, 1920). La résistance empêche l’expression
de matériel qui pourrait menacer l’équilibre émotionnel (Menninger, 1958).
Sullivan (1953) soulignait également la fonction stabilisante de la résistance dans
le maintien du bien-être du patient; elle permet, en effet, d’éviter l’angoisse, la
culpabilité, la honte et d’autres sentiments pénibles. En général, pour les
intervenants, la résistance correspond à « tout comportement du patient qui
s’oppose à ce que le thérapeute veut faire et à ce qu’il souhaite (Schlesinger,1982,
p. 26). Elle indique que quelque chose vient d’arriver au client qui crée une
menace. Que fait-on alors de cette résistance ? Tout comme pour la douleur qui
apparaît lors d’un examen physique, on s’intéresse aux raisons pour lesquelles le
patient résiste. C’est ce qu’on appelle « aller dans le sens de la résistance »
(Schlesinger, p. 27). Kemper, pour sa part, retient quatre principes généraux pour
gérer les résistances, principes que l’on retrouve également chez Altshul (1993) et
Harris (1996) : 1) établir la confiance; 2) rendre le client conscient de la
résistance; 3) l’aider à explorer le sens de la résistance; 4) mettre l’accent sur
la vérité à laquelle le client résiste.
Certains auteurs gestaltistes (Cole, 1994; Breshgold, 1989) parlent du phénomène
en termes de résistance à la prise de contact d’éléments du self et de résistance au
contact avec les autres. Leur approche consiste à amplifier la résistance à la prise
de conscience (awareness) en vue d’aider le client à devenir de plus en plus
conscient de ses polarités. À ce sujet, Cole (1994) explique que « le thérapeute
accepte la validité subjective de la résistance du client et aide celui-ci à se
concentrer sur elle pour permettre qu’elle sorte de l’ombre » (p. 76).
Un auteur gestaltiste se dissocie cependant de cette vision de la résistance. En
effet, pour Wheeler (1991), il n’y a pas de résistance au contact; il peut y avoir
une résistance à la prise de conscience (awareness), mais celle-ci est alors vue
comme une forme de contact. De ce point de vue, cela n’a aucun sens de parler de
contact sans référer à la résistance et à la confluence qui sont les deux pôles du
contact. En d’autres termes, il n’y a pas de contact pur et platonique qui serait
terni par des résistances. Le contact thérapeutique implique l’exercice de tous les
mécanismes en jeu (confluence, projection, introjection, déflection, etc.) à la
frontière entre la personne et son environnement à travers ses fonctions de
contact.
Le concept de résistance n’existait à peu près pas dans la littérature sur la thérapie
behaviorale à ses débuts. « C’est à la suite d’exemples de non-soumission (non-

52 Résistance ou
persistance
Interactions Vol. 6, no 1, printemps 2002
compliance) thérapeutique que le sujet de la résistance est devenu important dans
la thérapie behaviorale » (Goldfried, 1982, p. 95). En ce sens, elle était associée à
la désobéissance thérapeutique qui était perçue lorsque le patient ne faisait pas le
devoir qui lui avait été prescrit. Pour prévenir la résistance et y remédier, quelques
stratégies ont été proposées par Goldfried (1982) ainsi que par Meichenbaum et
Gilmore (1982). En voici quelques exemples : 1) la phase éducationnelle initiale
de ce type de thérapie est vue comme un moment clé dans la prévention de
résistances inutiles du client. En effet, un but central du traitement est d’amener le
client à traduire ses symptômes en difficultés qui peuvent être cernées et vues
comme des problèmes spécifiques plutôt que comme des problèmes vagues et
insurmontables; 2) en graduant le processus de changement en étapes et en
structurant les interventions thérapeutiques de manière à en maximiser le succès à
chaque étape, le thérapeute réduit encore plus la possibilité de résistance du client.
Pour Newman (1994), les thérapeutes peuvent aider à modifier les comportements
résistants en se posant, à chaque cas, huit questions d’évaluation face à la
résistance, par exemple : Quelle est la fonction de la résistances du client ? Quel
rapport y a-t-il entre la résistance actuelle et son pattern de résistance dans son
développement et son histoire ? Quelles sont les croyances qui nourrissent la
résistance de ce client ?
Pour leur part, les praticiens de l’approche émotivo-rationnelle tentent d’aider les
clients à faire un changement majeur pour adopter une philosophie personnelle de
vie qui les pousse à développer la confiance et à coopérer à leur changement
personnel. Ellis (1995), qui en est le fondateur, identifie un certain nombre de
caractéristiques propres aux résistances. Les croyances irrationnelles qui sous-
tendent les résistances des clients sont : 1) en partie implicites et inconscientes;
2) très ancrées; 3) maintenues avec des sentiments intenses et des habitudes
ancrées; 4) partagées par presque tous les clients; 5) difficiles à modifier;
6) susceptibles de réapparaître après avoir été temporairement écartées. Ellis
propose 13 principales formes de résistance du point de vue de la thérapie
émotivo-rationnelle dont la résistance reliée à la peur et à la honte de se révéler, la
résistance émergeant des problèmes relationnels du thérapeute comme
l’antipathie, le manque de sensibilité et d’empathie et enfin, la résistance motivée
par la peur du changement ou la peur du succès. Il précise d’où elles surgissent et
suggère une vingtaine de méthodes pour les surmonter. Celles-ci incluent des
méthodes cognitives pour enrayer, confronter, critiquer et changer les croyances
irrationnelles qui sous-tendent les résistances autosabotantes des clients. Faire
émerger les cognitions associées à la résistance et soumettre les croyances
irrationnelles à la critique scientifique pour déboucher sur une philosophie de vie
effective, réaliste et équilibrée, en sont des exemples spécifiques.

Résistance ou persistance 53
Interactions Vol. 6, no 1, printemps 2002
Les thérapies existentielles-humanistes et les approches intégratives s’intéressent
surtout aux fonctions autoprotectrices de la résistance qui s’expliquent
ainsi : l’être humain ne pouvant demeurer ouvert à toutes les sollicitations
intérieures ou extérieures, il lui faut filtrer l’information, de manière à se protéger
pour s’assurer un minimum de stabilité. De telle sorte que la résistance désigne
tous les moyens que l’aidé prend pour éviter de ressentir et d’exprimer les
souvenirs ou les idées qui le menacent et, en conséquence, pour éviter ou ralentir
les prises de conscience douloureuses sur son vécu (Hétu, 1990). À ce sujet,
Jourard, May et ses collègues voient la résistance comme un mécanisme de
défense contre la croissance personnelle ou une hésitation à être et à devenir,
allant jusqu’à une auto-aliénation (Hétu). Celui-ci conclut qu’ « on peut donc
concevoir la résistance à la fois comme la préoccupation de ne pas avancer trop
vite et de sauvegarder sa cohésion interne d’une part, et comme une invitation à
réassumer la décision d’avancer dans sa croissance, d’autre part. Dans ces
perspectives, la résistance demande à la fois à être respectée et à être surmontée »
(p. 160). Que la résistance soit causée par une atteinte à l’image de soi et à
l’estime de soi ou par l’opposition à une erreur de l’aidant, Hétu propose quelques
pistes pour y faire face dont voici quelques illustrations : 1) offrir des supports
légers tels des reflets simples (« Ce n’est pas facile d’aborder ce sujet, n’est-ce
pas ? » ou « Tu n’as pas trop le goût de parler de ça ? »); 2) accepter ou provoquer
des diversions temporaires; par exemple, l’aidant peut accepter que l’aidé change
de sujet ou il peut orienter l’exploration vers un sujet moins menaçant.
Bugental et Sterling (1995) vont aussi dans le sens de l’autoprotection : le client
maintient la façon de se percevoir et de concevoir le monde, il maintient la
structure même de vie essentielle à son existence. Tenter de changer ses façons
d’être et sa conception du monde implique pour lui de remettre en question son
centre d’équilibre. Mahoney (1985) abonde dans le même sens lorsqu’il tente de
gérer la résistance de manière à « réduire le besoin de retranchement, à
reconnaître divers schèmes de développement ou divers styles de fonctionnement
et à canaliser cette même énergie protectrice au service d’un changement
progressif des paradigmes personnels » (p. 35).
Il est légitime de penser que tous les systèmes vivants manifestent de la résistance
au changement parce que le maintien de l’intégrité organismique est un impératif
fondamental (Mahoney,1991). En fait, la signification existentielle d’une
résistance peut être présentée comme un asile, un refuge permettant de faire
évoluer une relation ambivalente vers des possibilités plus authentiques d’être
dans le monde (Craig, 1995). Également convaincus de l’importance de la
résistance dans le maintien de la stabilité, Lipshitz, Friedman et Omer (1989)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%