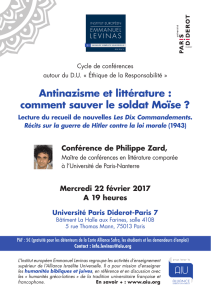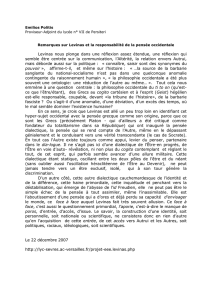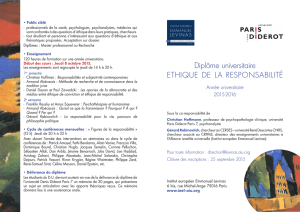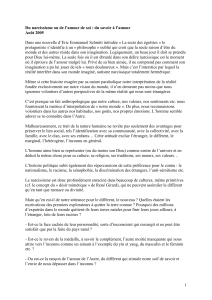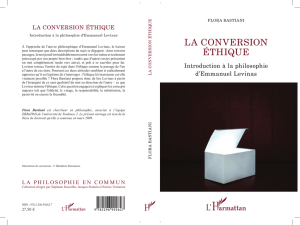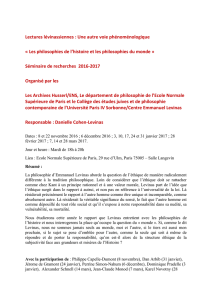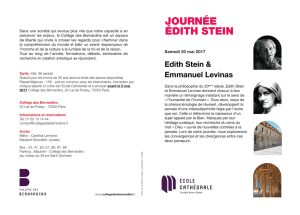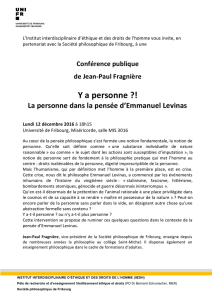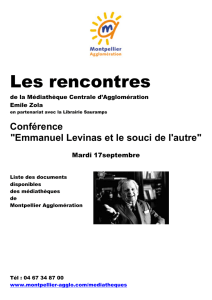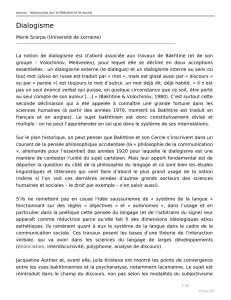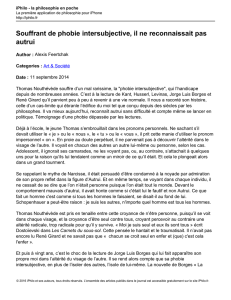L`Écriture et l`autre: Technologie d`acquisition de l`avenir (sur la

437
L’É ’: T
’ ’
( ’
M B E L)
Canadian Review of Comparative Literature / Revue Canadienne de Littérature Comparée
crcl december 2009 décembre rclc
0319–051x/09/36.4/437 © Canadian Comparative Literature Association
Nadezda Vashkevich
Sorbonne Nouvelle (Paris III)
Mikhaïl Bakhtine et Emmanuel Levinas, issus tous deux de l’empire russe et apparte-
nant à la même génération, ont connu des parcours diérents, côtoyé des cultures
diverses et ont été inuencés par des penseurs peu similaires. Mais réunis dans leurs
origines ils se retrouvent ultérieurement sur l’idée de l’altérité en tant que source
d’éthique et méthodologie principale de la philosophie moderne.
Pour ces deux auteurs tout commence par l’étonnement devant l’autre, devant
la possibilité d’une position qui, par son autonomie et son objectivité, ne cesse pas
d’armer l’autonomie et la subjectivité du moi. L’inquiétude qui provient de la situa-
tion de rencontre inspire le dialogue. Et là, il se produit la métamorphose de l’étranger
en autrui.
La nature de l’autre est ambivalente. Il est un autre qui par son altérité justie
l’existence du moi. Il est une altérité qui cherche à se dévoiler et dont la méconnais-
sance même est révélatrice.
La rencontre entre moi et autrui transforme l’existence. Le parti-pris de l’individu
cède la place à l’ambivalence du moi-autrui qui s’avère le site de la lucidité philos-
ophique. La vision, où la position de l’autre apparaît comme la plus compétente,
redénit l’être, l’existence, l’éthique.
Dans son développement de l’idée de l’autre, Mikhaïl Bakhtine part de la tradition
apophatique. C’est dans le mystère de la comparution de deux hypostases devant la
Troisième que l’existence regagne son sens et se transforme en existence consciente.

crcl december 2009 décembre rclc
438
Sa gnoséologie est celle du non-savoir optimiste, où on ne prétend plus connaître
mais on laisse le sujet se dévoiler.
“La dimension du divin s’ouvre à partir du visage humain,” dit Levinas, en enten-
dant qu’une expérience fondamentale, celle du “dénuement et extrême vulnérabilité
d’un visage,” détermine la conception du sujet et du rapport au monde. Mais il est
loin de traiter l’autrui en termes phénoménologiques. Autrui est “visage”, non pas
dans le sens d’un visage “vu”, d’un visage pouvant se xer sur une photographie ou
dans la mémoire, mais expression, discours (Explorations Talmudiques).
L’important c’est que l’approche apothatique de Mikhaïl Bakhtine et celle post-
phénoménologique d’Emmanuel Levinas débouchent sur les mêmes fondements et
principes de l’éthique. Ce principe philosophique élucide les rapports entre la con-
science morale et la liberté devant l’acte et l’éthique sociale.
La reconnaissance de l’autre exige d’un individu un acte de volonté qui consiste
à franchir les limites de soi-même pour faire un pas vers la non-existence de soi et
l’existence de l’autre. Cet acte aussi dicile est à la fois une armation de soi, car il
permet d’envisager soi-même comme autrui et justie la vie de l’individu et sa liberté
dans ses propres yeux. Il est également une armation de la dignité de l’homme, sa
réhabilitation, au sens symbolique, après la Chute et, donc, accomplissement de sa
mission antropourgique.
La conscience active qui se dénit à partir de la reconnaissance de l’autre, acqui-
ert la puissance de franchir la barrière du temps et de la mort, car l’autre, la mort et
l’avenir sont semblables dans le fait qu’ils mettent des limites à soi et impliquent un
renoncement à soi en faveur de l’inconnu.
La cohésion entre la parole et l’altérité représente un autre prisme optique commun
pour les deux auteurs. “L’homme est là où il y a la parole, la parole est là où il y a le dia-
logue, le dialogue est là où il y a la littérature” (Bibler 79-80)—tels sont les points de
départ de la réexion de Bakhtine sur l’écriture. L’autre, selon Levinas, est d’emblée
et tout à la fois parole, demande, supplication, commandement, enseignement.
L’écriture apparaît comme un acte volontaire de transformation du soi en autre.
Elle se révèle comme une mise en œuvre des notions de l’éthique, la dominante de
l’existence responsable de la personnalité, l’auto-façonnement de la conscience ‘par
les yeux de l’autre’. La création verbale se fait une relation avec autrui, une “technolo-
gie d’acquisition de l’avenir” (Issoupov 13).
En décrivant l’éros, Levinas révèle qu’il n’est ni une lutte, ni une fusion, ni une
connaissance, mais, une relation avec la “dimension même de l’altérité” (Le Temps
et l’Autre 81). N’est-ce pas ce qu’est l’écriture? Elle, qui ne cherche ni à connaître,
ni à saisir, ni à dominer le sujet? Le texte, n’est il pas, tout comme l’autre, “l’absence
dans un horizon d’avenir” (Le Temps et l’Autre 83). L’écriture n’est elle pas comme la
caresse, qui “ne sait pas ce qu’elle cherche” (Le Temps et l’Autre 82), qui est un “ne pas
savoir” (Le Temps et l’Autre 82) apophatique.
Si on envisage le texte comme autrui ou l’écriture comme éros, probablement,
en s’inspirant du caractère de ces grandes données, on devinera—sans chercher à

Nadezda VashkeVich | L’Écriture et L’autre
439
connaître—un peu plus sur le texte, son auteur, son lecteur, sur l’écriture, sur la lit-
térature, sur les littératures.
O
Aeschlimann, Jean-Christophe, éd. Répondre d’autrui, autour d’un entretien avec
Emmanuel Levinas. Boudry-Neuchâtel: Éditions de la Baconnière, 1989.
Bakhtin, Mikhaïl. “ .” Философия и социология науки и
техники. 1984-1985. Moscou, 1986. Pour une philosophie de l’acte. S. Bocharov et
S. Averintsev, éds; Ghislaine Capogna Barget, tr. Paris: L’Age de l’Homme, 2003.
___. “ ” [“L’Homme devant le miroir”]. Œuvres complètes, vol. 5,
1940-1960. Moscou: Rousskiye slovari,1997.
___. Проблемы поэтики Достоевского [Problèmes de la poétique de Dostoevskiy].
Moscou: Khoudojestvennaya literatoura, 1972.
___. Эстетика словесного творчества [L’Esthétique de la création verbale].
Moscou: Iskousstvo, 1986.
, B.C. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры [Bibler, V.S.
Mikhaïl Bakhtine, ou la Poétique de la culture]. Moscou: 1991.
Emerson, Caryl. e First Hundred Years of Mikhaïl Bakhtin. Princeton: Princeton
UP, 1997.
Emmanuel Levinas, L’Éthique comme philosophie première, actes du colloque de
Cerisy-la-Salle 23 août–2 septembre 1986. Dir. Jean Greisch et Jacques Rolland.
Paris: Les Éditions du cerf, 1993.
Explorations Talmudiques: Emmanuel Levinas. http://ghansel.free.fr/WebTalmud/
levinas.htm
, .. “ . . .” М. М. Бахтин: pro et contra. Личность
и творчество М. М. Бахтина в оценке русской и мировой гуманитарной
мысли. [Issoupov, K.G. “Les Leçons de Mikhaïl Bakhtine.” Mikhaïl Bakhtine: pro
et contra. Personnalité et œuvre de Mikhaïl Bakhtine dans la pensée humanitaire
russe et mondiale], Vol. I. éd. K. G. Issoupov. St. Pétersbourg: RHGI, 2001. 7-44.
Levinas, Emmanuel. Altérité et transcendance. Paris: Fata Morgana, 1975.
___. Entre nous, essais sur le penser—l’autre. Grasset et Fasquelle, 1991.
___. Éthique et inni. Arthème Fayard et Radio-France, 1982.
___. Humanisme de l’autre homme. Paris: Fata Morgana, 1972.
___. Liberté et commandement. Paris: Fata Morgana, 1994.
___. Le Temps et l’autre. Paris: PUF, 1983.

crcl december 2009 décembre rclc
440
___. Le visage de l’autre. Paris: Éditions du Seuil, 2001.
Todorov, Tzvetan. Mikhaïl Bakhtine: le principe dialogique, suivi de Écrits du cercle
de Bakhtine. Paris: Éditions du Seuil, 1981.
1
/
4
100%