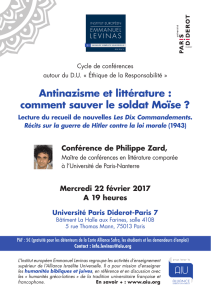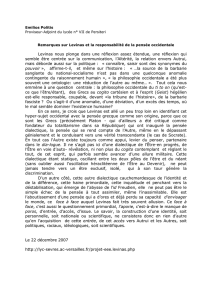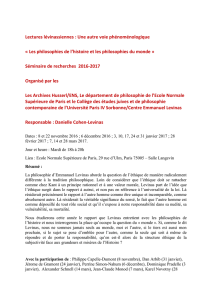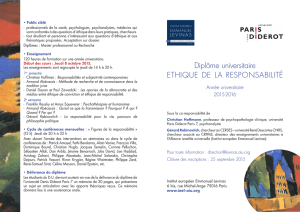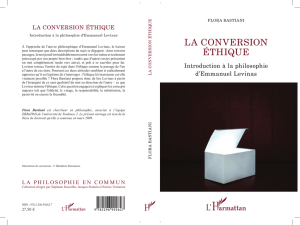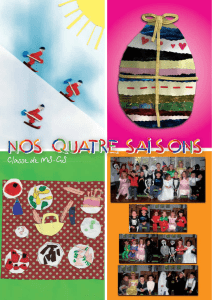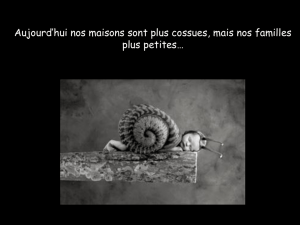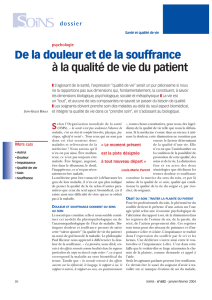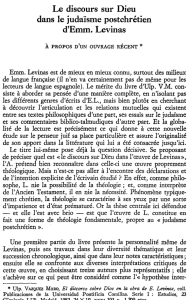Du narcissisme ou de l`amour de soi : du savoir à l

1
Du narcissisme ou de l’amour de soi : du savoir à l’amour
Août 2005
Dans une nouvelle d’Eric Emmanuel Schmitt intitulée « La secte des égoïstes » le
protagoniste s’identifie à un « philosophe » oublié qui croit que la seule raison d’être du
monde et des autres réside dans son imagination. Logiquement, un beau jour il doit se prendre
pour Dieu lui-même. La seule fois où il est ébranlé dans son délire narcissique est le moment
où il éprouve de l’amour malgré lui. Privé de sa bien aimée, il ne comprend pas comment son
imagination a pu lui jouer de tels « tours douloureux ». Mais c’est l’interstice par lequel la
réalité interfère dans son monde imaginé, autisme narcissique totalement hermétique.
Même si cette histoire exagère par sa nature parabolique notre interprétation de la réalité
fondée exclusivement sur notre vision du monde, il n’en demeure pas moins que nous
ignorons volontiers d’autres perspectives de la même réalité qui nous sont étrangères.
C’est presque un fait anthropologique que notre culture, nos valeurs, nos sentiments etc. nous
fournissent la matrice d’interprétation de « notre monde ». De plus, nous reconnaissons
volontiers dans les autres nos habitudes, nos goûts, nos propres émotions. L’homme semble
adorer se re-connaître dans l’Autre.
Malheureusement, ce trait de la nature humaine ne revête pas seulement des avantages pour
préserver le lien social, tels l’identification avec sa communauté, avec la collectivité, avec la
famille, avec le clan, avec ses enfants… Cette attitude exclue l’étranger, le différent, le
marginal, l’hétérogène, l’inconnu en général.
L’homme aime bien se représenter (ou du moins son Dieu) comme centre de l’univers et en
déduit la même chose pour sa culture, sa religion, ses traditions, ses mœurs, ses valeurs…
L’histoire politique subit également des répercussions de cette préférence pour le connu : le
nationalisme, le racisme, la xénophobie, la discrimination des étrangers, l’anti-sémitisme etc.
Le narcissisme est donc profondément enraciné dans beaucoup de cultures, même primitives
(cf. le concept du « désir mimétique » de René Girard), qui ne peuvent assimiler le différent
qu’en tant que menace ou divinité.
Main qu’en est-il de notre attirance pour le différent, le nouveau ? Quelles étaient les
motivations des premiers explorateurs à quitter la terre connue ? Pourquoi des millions
d’expatriés dans le monde quittent-ils leurs terres natales pour finir leurs jours ailleurs, à
l’étranger, loin de leurs racines ?
- Est-ce la face cachée de leur personnalité, sorte d’inconscient qui ressurgit et ne peut être
satisfait que par la fuite du pays natal ?
- Est-ce le revers de la médaille, à savoir le complément, l’autre moitié manquante qui nous
attire vers l’inconnu comme un aimant à l’exemple du yin et yang, du masculin et le féminin
etc. ?
- Ou est-ce la rançon de l’amour de l’Autre, du différent qui stimule notre soif de savoir et
l’envie de nous dépasser dans l’inconnu ?

2
Je crois qu’il y une partie de vérité dans chacune des trois explications, mais j’aimerais
davantage approfondir la troisième, car :
Plus nous connaissons une personne, un art, un paysage une culture etc., plus nous l’aimons.
C’est notre savoir de fin connaisseur qui nous fait apprécier un met, un objet d’art, un ami etc.
Mais les différents objets ou sujets de notre amour ne se trouvent pas sur le même plan et on
ne peut pas parler d’infidélité lorsque nous aimons à la fois une peinture, la femme y
représentée et le peintre en tant qu’ami. C’est pourquoi existent autant d’états d’amour
que de registres de valeurs.
L’amour commence par la simple curiosité, par la sympathie, par l’amour platonique, par
l’amour passionnel jusqu’à l’amour pour l’enfant ou pour ses parents. Ces derniers types
d’amour qui incluent souvent aussi le partenaire sont les plus forts, parce que s’y mêle à part
la passion, sa propre origine biologique, sociale et psychologique avec la transmission de
celles-ci.
Ou encore, nous aimons nous reconnaître dans l’Autre, comme nous aimons façonner l’Autre
à notre propre image – tentation souvent vaine et souvent fatale pour les couples. Mais qu’en
est-il des couples très hétérogènes : pourquoi s’aiment-ils ? Ou plutôt, pourquoi aspirons-nous
à apprendre à aimer des choses qui nous étaient jusqu’ici inconnues ? (par exemple : connaître
une nouvelle langue, pratiquer un nouveau hobby, vivre dans un nouveau pays, voire tomber
amoureux d’une personne dont nous savons pas grand chose)
Donc il semble que nous avons une curiosité naturelle qui tend à transcender notre
narcissisme. Cependant, cela demande souvent un effort pour surmonter notre aversion
contre l’inconnu, contre des valeurs que nous ne partageons pas etc. Comment faisons-
nous pour surmonter nos angoisses, notre répulsion, notre aversion ?
Peut-être s’agit-il ici de notre recherche perpétuelle (et inconsciente) de parfaire notre identité
par des contenus, des expériences, des traits de caractère refoulés.
Lorsque nous sommes à la fois attirés et repoussés par une culture (étrangère) nous sommes à
la recherche des parties de notre personne qui n’ont pas pu s’épanouir (dans notre culture
d’origine) :
- soit parce que nous n’étions mentalement et socialement pas suffisamment « équipé »
pour les assumer
- soit puisque nous sommes orienté en biais (mal dit)par rapport à notre culture
d’origine dans laquelle nous nous sentons toujours un peu à contre courant.
Par exemple, je suis personnellement attiré par la curiosité intellectuelle et l’esprit libertaire
qui règne en France, même au-delà des milieux intellectuels. Cet esprit implique une certaine
infidélité à l’égard du passé, des autres, des règles convenues. Cependant, j’ai horreur des
situations sociales quotidiennes (travail, transports, organisation de la vie quotidienne) qui ne
sont pas transparentes ou les acteurs sont infidèles, traîtres, lunatiques, irresponsables,
dangereux etc.
Est-ce que je fais ce rejet parce que ces défauts ne correspondent pas à mes valeurs
personnelles ou est-ce que je n’ai pas vécu assez de situations où cette « ouverture au
changement » aurait impliquée des conséquences positives ? Plus clairement, ai-je été
traumatisé par l’infidélité de mes parents, de mes professeurs, des personnes que j’ai aimées ?

3
Il me semble que la critique culturelle avérée (et d’autant plus s’il s’agit de la critique de ses
propres racines) traduit – paradoxalement - une envie bloquée de se réapproprier
« positivement » la diversité culturelle qui nous entoure. Par cette critique, on insiste sur son
identité quelque peu ébranlée par la variété des personnalités que l’on croise dans la vie
sociale. Mais au lieu de s’affirmer face au différent, l’identité ébranlée tente d’ériger en loi
« supérieure » le bien fondé de son propre fonctionnement. Seulement lorsque nous sommes
sûr de notre propre identité nous pouvons aussi supporter la médiocrité morale, la violence à
l’égard d’autrui qui nous entoure, car c’est humain. Attention, supporter ne voudrait pas dire
accepter, mais la lutte pour l’amélioration des mœurs n’est plus « existentielle », elle devient
une affaire philosophique ou religieuse.
Qu’est-ce qui m’empêche de tolérer le conservatisme communautariste si répandu en
Allemagne ou l’infidélité individualiste plus populaire en France ? Ici seulement la
philosophie ou la religion peuvent procurer du réconfort. Ne faut-il pas selon leurs préceptes
aimer l’Autrui dans sa totalité, dans son intégrité avec ses vertus et ses défauts ?
Puisque je me sens plus à l’aise avec la philosophie qu’avec la religion, je me tourne vers elle.
Emmanuel Levinas Prétend que l’Autre était notre « prophète », notre miroir pour
comprendre notre existence. Nous sommes responsables pour lui, pour notre propre éthique.
C’est pourquoi il ne faut pas délaisser le dialogue avec lui pour essayer de l’améliorer comme
nous-mêmes.
L’autre est en quelque sorte notre conscience d’être dans ce monde qui est omniprésente et
qui peut surgir à tout moment de toute part. Ainsi, pour Levinas nous sommes même
« prisonnier » d’Autrui. Mais si l’Autre nous parait étranger, alors il faut aller à sa rencontre
pour mieux le connaître, pour en savoir plus sur lui. C’est là où la curiosité du savoir naît. Le
repli sur soi est toujours une impasse pour l’homme, il ne peut s’épanouir dans l’apprentissage
perpétuel dans la « co-naissance » selon Giordano Bruno. Cette naissance du savoir ne peut se
faire qu’en présence de l’Autre et comme processus infini et non comme révélation
idéologique définitive de la vérité absolue.
Pour illustrer cette idée Giordano Bruno cite le mythe d’Actéon qui avec ses chiens poursuit
Diane, l’objet de son désir qu’il a vu nue dans son bain. Mais la chasse pour posséder l’objet
de sa convoitise (pour obtenir le pouvoir sur elle) transforme le chasseur (sujet) en cerf
(objet). Actéon devient lui-même l’objectif de sa chasse et est déchiquetée par les crocs de ses
propres chiens (pensées). Le penseur étant transpercé par ses propres idées se dilue dans son
objet de connaissance qui est en fin de compte toujours Autrui.
1
L’autre conscience est toujours la plus mystérieuse qui puisse exister. Pourquoi tant de
romanciers scrutent de tout temps les profondeurs du mystère de l’amour
2
, pourquoi tant de
psychologues sont à la recherche de leur propre mémoire perdue (identité), pourquoi tant de
sociologues veulent expliquer pourquoi nous sommes capables et condamnés à vivre en
société…
1
René Girard commenterait que le penseur (bouc émissaire) devient sa propre victime du désir mimétique et
libère ainsi par son acte de martyre le sacré remède contre la violence entre les hommes.
2
Base des recherches de René Girard : Mensonge romantique et vérité romantique (à partir des romans du 19ème
siècle)

4
Nous nous (re-)connaissons dans l’Autre, connaissance qu’il faut toujours améliorer. Mais
aussi l’objet de notre quête du savoir est un processus infini qui évolue, qui change et qui n’a
pas de nature définitive.
La « Loi » a pour Levinas une double fonction/forme : scripturale (nominale) et
herméneutique (réel). Elle est exposée à l’intentionnalité des hommes, donc à leur
interprétation et à leur application réelle. L’Etat comme la démocratie sont pour Levinas
soumis à une éternelle amélioration de la Loi. A l’Etat hobbesien (pourvoir absolu pour
détenir le monopole de violence) Levinas oppose notre responsabilité pour l’Autre qui
s’affine dans l’amélioration de la Loi. (La France hésite entre la tradition anglo-saxonne,
rapport de force politique, et la tradition continentale, code juridique.)
1
/
4
100%