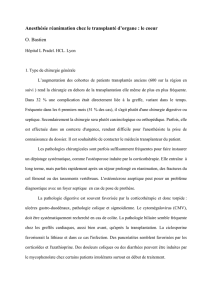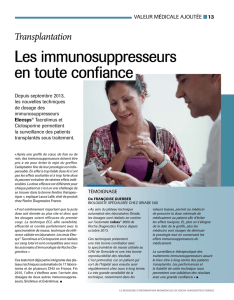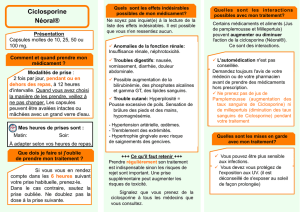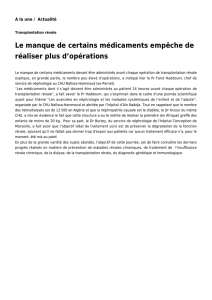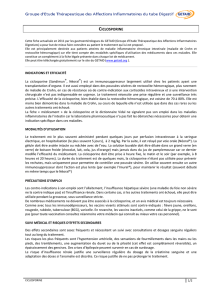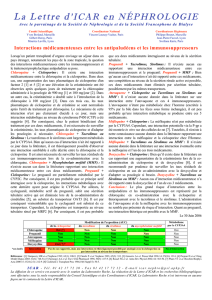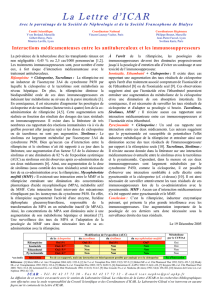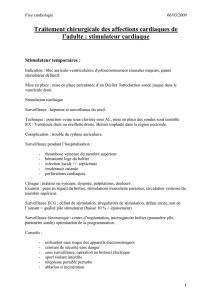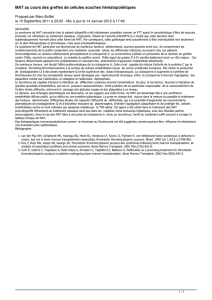La transplantation rénale et les immunosuppresseurs

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am
Pour citer cet article : Skalli S, Nouvel M, Faudel A, Fougère S, Parat S, Pouteil-Noble C, Rioufol C. La transplantation rénale et les immunosuppresseurs :
place du pharmacien clinicien dans la prise en charge thérapeutique. J Pharm Clin 2013 ; 32(4) : 201-18 doi:10.1684/jpc.2013.0266 201
Synthèse
J Pharm Clin 2013 ; 32 (4) : 201-18
La transplantation rénale
et les immunosuppresseurs :
place du pharmacien clinicien
dans la prise en charge thérapeutique
Renal transplantation and immunosuppressive drugs:
part of the clinical pharmacist in the therapeutic management
Saadia Skalli 1, Marion Nouvel 1, Amélie Faudel 1, Sandra Fougère 1, Stéphanie Parat 1,
Claire Pouteil-Noble 2, Catherine Rioufol 13
1Département de pharmacie clinique et médicaments, Centre hospitalier Lyon Sud, Hospices civils de Lyon,
Pierre-Bénite, France
2Service de transplantation-néphrologie, Groupement hospitalier Edouard Herriot, Hospices civils de Lyon,
Lyon, France
3Université Claude Bernard Lyon 1, EMR 3738, Lyon, France
Résumé. La prise en charge thérapeutique du patient transplanté rénal est le plus souvent complexe et expose
à un risque d’évènements iatrogènes médicamenteux. Les patients sont confrontés, d’une part, à des médica-
ments à marge thérapeutique étroite avec notamment les immunosuppresseurs et, d’autre part, à de nombreuses
comorbidités associées. Celles-ci favorisent une polymédication, générant ainsi des interactions médicamenteuses
et augmentant le risque d’apparition d’effets indésirables. Des comportements à risques tels que la mauvaise adhé-
sion au traitement sont également à prendre en compte. Ce travail présenté sous la forme d’une synthèse de
la littérature médicale, abordera le profil physiopathologique et thérapeutique du patient transplanté rénal ainsi
que les problèmes reliés à la pharmacothérapie générés par les thérapeutiques immunosuppressives. Pour définir
la place du pharmacien clinicien et l’intégration des soins pharmaceutiques, nous présenterons une revue de la
littérature médicale sur les missions potentielles du pharmacien clinicien visant à optimiser la prise en charge
thérapeutique du patient transplanté rénal.
Mots clés : transplantation rénale, immunosuppresseurs, pharmacien clinicien, intervention pharmaceutique,
consultation pharmaceutique, interactions médicamenteuses, adhésion médicamenteuse, médicaments génériques
Abstract. The therapeutic management of renal transplant patient is often complex and exposed to a risk of
occurrence of iatrogenic drug events. Patients are treated by drugs with a narrow therapeutic range including
immunosuppressants, and have many comorbidities. These promote polymedication, generating drug interactions
and increasing the risk of developing side effects. Risk behaviours such as poor adherence to treatment are also
taken into account. This medical literature review discusses the pathophysiology and therapeutic profiles of renal
transplant patients as well as drug-related problems generated by immunosuppressive therapy. To define the role
of the clinical pharmacist and the integration of pharmaceutical care, we present a review of the potential missions
of clinical pharmacist to optimize the therapeutic management of renal transplant patients.
Key words: renal transplantation, immunosuppressive drugs, clinical pharmacist, pharmaceutical intervention,
pharmaceutical consultation, drug interactions, medication adherence, generic drugs
Tirés à part : S. Skalli
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am
202 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013
S. Skalli, et al.
Le patient transplanté rénal :
état actuel des connaissances
Données épidémiologiques
Le nombre de transplantations d’organes réalisées en
France a augmenté de près de 16 % ces dernières années
selon les données de l’Agence de la biomédecine [1, 2].
On note pour 2012, 5 023 transplantations d’organes,
le rein représente 60,6 % (3 044) des transplantations
[1, 2]
Quels sont les risques
et les complications potentielles
de la transplantation rénale ?
Le patient transplanté rénal encourt suite à sa greffe de
nombreux risques de complications et d’apparition ou
d’aggravation de comorbidités.
Risque de rejet
Le rejet correspond à l’induction d’une réponse immu-
nitaire du receveur contre l’organe transplanté. Cette
réaction de rejet met en jeu une activation des
cellules du receveur (lymphocytes T et B, cellules
mononucléées...) activées par les allo-antigènes du
donneur qui appartiennent surtout au groupe human
leucocyte antigens (HLA) et qui constituent le complexe
majeur d’histocompatibilité (CMH). Le rejet engendre une
destruction plus ou moins rapide de l’organe transplanté
en l’absence de traitement immunosuppresseur.
On distingue quatre types de rejets : le rejet hyper-
aigu, le rejet aigu qui peut être humoral ou cellulaire
et le rejet chronique. Ceux-ci posent des problématiques
diagnostiques et thérapeutiques très complexes et parfois
intriquées [3].
Rejet hyperaigu
Le rejet hyperaigu survient en général dans les 24
premières heures suivant la transplantation. Il est lié
essentiellement à la présence, dans le sérum du receveur
dit «immunisé », d’anticorps anti-HLA lymphocy-
totoxiques, produits en réponse à des transfusions
sanguines, à des grossesses ou à des transplantations anté-
rieures. Ces anticorps sont dirigés contre les antigènes
HLA du donneur et se fixent lors de la revascularisa-
tion du greffon sur l’endothélium de ce dernier. On
observe alors sa destruction et la thrombose des artères
puis une nécrose hémorragique du greffon. Le seul trai-
tement de ce rejet est préventif et repose sur la recherche
d’anticorps anti-HLA ainsi qu’un cross-match (test de cyto-
toxicité entre les lymphocytes d’un ganglion du donneur
et le sérum du receveur) chez les patients sur la liste
d’attente avant la transplantation afin d’étudier la compa-
tibilité donneur-receveur. En cas de diagnostic du rejet
hyperaigu, la transplantectomie d’urgence constitue la
principale option thérapeutique [3].
Rejet aigu cellulaire
Le rejet aigu met plusieurs jours à survenir car il néces-
site une immunisation, et se produit en général dans les
huit jours à trois mois suivant la transplantation. Près
de 90 % des épisodes de rejet aigu sont principalement
médiés par un mécanisme cellulaire. Outre la recherche
d’anticorps dirigés spécifiquement contre des antigènes
HLA du donneur, la détermination du type de rejet passe
par la réalisation d’une biopsie du greffon. Le rôle des
lymphocytes CD4+ a été suggéré dans l’initiation du pro-
cessus de rejet, et celui des CD8+ dans celui des étapes
ultérieures. Un retard de prise en charge peut conduire
à des lésions irréversibles du greffon et à sa destruction
[3, 4].
Rejet aigu humoral
Le rejet aigu humoral se produit principalement entre
la première et la troisième semaine post-transplantation,
mais il peut également survenir de fac¸on plus tardive.
Ce type de rejet est dû à l’apparition d’anticorps anti-
HLA et non anti-HLA dirigés spécifiquement contre des
déterminants antigéniques du donneur. Le diagnostic est
à évoquer en présence soit d’une reprise retardée de la
fonction rénale, soit devant une insuffisance rénale aiguë
précoce. Généralement, le rejet aigu humoral est de moins
bon pronostic que le rejet aigu cellulaire [3, 4].
Rejet chronique
Le rejet chronique est une des causes principales de perte
du greffon au long cours. Il s’intègre dans une entité nom-
mée dysfonction chronique de greffon dans la mesure où
la perte de fonction est très souvent multifactorielle liée
à des phénomènes immunologiques (épisodes de rejet
aigu, rejet chronique) et non immunologiques (lésions
héritées du donneur, néphrotoxicité des immunosuppres-
seurs, lésions post-ischémiques, infections, hypertension,
diabète, récidive de la maladie initiale sur le greffon,
sénescence du greffon, etc.) [3, 4].
Risque infectieux
Le transplanté rénal est un patient à haut risque de sur-
venue d’infections du fait des trois facteurs suivants :
l’immunosuppression, la nature et le nombre de procé-
dures invasives auxquelles il est soumis et l’exposition à
des germes communautaires ou nosocomiaux [5]. Dans
ce contexte, l’apparition d’une fièvre doit toujours être
considérée comme pouvant être l’expression d’une infec-
tion potentiellement grave et nécessitant un diagnostic et
un traitement rapides [3].
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am
J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 203
La transplantation rénale et les immunosuppresseurs
Au cours du premier mois, le risque infectieux est
dominé par les infections nosocomiales, par des infec-
tions provenant du donneur, ou par des infections
latentes et méconnues chez le receveur. C’est entre
le deuxième et le sixième mois que des réactivations
d’infections latentes et des premières infections oppor-
tunistes peuvent apparaître. À partir du sixième mois,
le niveau d’immunosuppression thérapeutique est moins
intense, les traitements prophylactiques sont générale-
ment interrompus, et les patients transplantés rénaux
sont surtout exposés aux risques infectieux du fait des
germes communautaires. Néanmoins, le risque d’infection
opportuniste reste réel. Ces infections peuvent être de
natures différentes [3, 5] :
- virales : infections à cytomégalovirus, virus hépatotropes
B et C, virus de l’Herpes Humain 8 et infection à BK virus ;
- fongiques : pneumopathie à Pneumocystis carinii,
aspergillose pulmonaire et infections invasives à Candida ;
- bactériennes : infections urinaires, pulmonaires et à
mycobactéries.
Les comorbidités
L’hypertension artérielle
L’hypertension artérielle est présente chez 50 à 60 %
des patients transplantés rénaux. Elle est définie par une
pression artérielle systolique supérieure à 130 mmHg, en
l’absence de médication antihypertensive [6-8]. Elle peut
être causée par la sténose de l’artère rénale du transplant,
la néphropathie chronique du greffon et/ou les traite-
ments immunosuppresseurs (corticoïdes, inhibiteurs de la
calcineurine).
La valeur cible de pression artérielle chez les
patients transplantés est de 130/80 mmHg en l’absence
d’hypotension [8]. Afin d’atteindre ces valeurs, plusieurs
classes médicamenteuses peuvent être proposées :
- les inhibiteurs calciques sont très largement utilisés chez
le patient insuffisant rénal chronique et transplanté rénal.
Ils exposent néanmoins au risque d’interactions médi-
camenteuses [6, 9]. Mise à part la nifédipine (Adalate®)
et l’isradipine (Icaz®), la plupart des inhibiteurs cal-
ciques notamment le diltiazem (Tildiem®), le vérapamil
(Isoptine®), la nicardipine (Loxen®) et l’amlodipine
(Amlor®) (à un moindre degré) interagissent avec la
ciclosporine, le tacrolimus, le sirolimus et l’évérolimus
[6, 9, 10]. Ils peuvent ainsi être à l’origine d’une
augmentation des concentrations plasmatiques en immu-
nosuppresseurs par inhibition de leurs métabolismes au
niveau du CYP 3A4 ;
- les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ou les
antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II)
présentent un effet néphroprotecteur. Néanmoins, leur
utilisation nécessite un suivi de la créatininémie ainsi que
de la kaliémie, surtout lorsqu’ils sont associés à d’autres
médicaments hyperkaliémiants : diurétiques hyperkalié-
miants (spironolactone, amiloride), ciclosporine, tacroli-
mus, sulfaméthoxazole-triméthoprime, héparine... [10] ;
- les bêtabloquants (notamment chez les patients coro-
nariens), les diurétiques et les antihypertenseurs centraux
peuvent constituer des options thérapeutiques [7, 11].
La dyslipidémie
Les dyslipidémies sont relativement fréquentes chez les
patients transplantés. Celles-ci peuvent se traduire par
une hypertriglycéridémie (>1,5 g/L) ou un LDL cho-
lestérol supérieur à 1 g/L [8]. Elles sont favorisées par
certains immunosuppresseurs comme les inhibiteurs de la
mTOR, les corticoïdes et les inhibiteurs de la calcineurine
[12].
Hypertriglycéridémies et prise en charge
thérapeutique
Les hypertriglycéridémies modérées peuvent être prises
en charge par l’ézétimibe (Ezetrol®) seul après échec
des règles hygiéno-diététiques suivies pendant 3 mois.
L’ézétimibe est à privilégier par rapport à un fibrate en
raison du risque d’interaction médicamenteuse de ce der-
nier avec la ciclosporine, ayant pour conséquence une
augmentation de la néphrotoxicité de la ciclosporine.
De plus, une augmentation possible de la créatininémie
est décrite sous fibrate. Près de 30 à 40 % des patients
transplantés traités par fibrate voient leur créatininémie
augmenter [13]. Dans cette classe, il semblerait que le
gemfibrozil (Lipur®) soit le fibrate exposant le moins au
risque d’augmentation de la créatininémie et aux interac-
tions médicamenteuses [14].
Hypercholestérolémie et objectif LDL
à atteindre chez le patient transplanté rénal
D’après les recommandations de la Haute autorité de
santé (HAS) de novembre 2007, le LDL cible doit être infé-
rieur à 1 g/L chez les patients transplantés rénaux [8]. La
prise en charge se fera dans un premier temps par des
règles hygiéno-diététiques associées à une statine. Ces
médicaments nécessitent un suivi clinique et une infor-
mation du patient des symptômes de rhabdomyolyse et
de cytolyse hépatique. La recherche d’interaction médica-
menteuse entre immunosuppresseur et statine, qu’elle soit
hydrophile ou lipophile, est de mise [15]. L’association à
l’ézétimibe peut être envisagée si la statine seule à dose
maximale n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif LDL
[12].
Synthèse de la prise en charge
thérapeutique
Le tableau 1 synthétise la prise en charge thérapeutique
du patient transplanté rénal.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am
204 J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013
S. Skalli, et al.
Tableau 1. Synthèse de la prise en charge thérapeutique du patient transplanté rénal.
Type de complications Objectifs thérapeutiques Prise en charge thérapeutique
Rejet chronique Prévenir le risque de rejet aigu et chronique
en limitant les effets indésirables
Inhibiteur de calcineurine + inhibiteurs de la prolifération lymphocytaire
(IMPDH) + corticoïdes
Infections Prévenir le risque d’infection à Pneumocystis carinii Sulfaméthoxazole-triméthoprime (Bactrim®)
Prévenir le risque d’infection à CMV Valganciclovir (Rovalcyte®)
HTA Maintenir une pression artérielle <130/80 mmHg 1re intention : inhibiteurs calciques +/- IEC ou ARA II +/-
2eintention : bêtabloquants +/- diurétiques +/- antihypertenseurs centraux
Dyslipidémie Maintenir les triglycérides <1,5 g/L Ezétimibe (Ezetrol®)
Maintenir le LDL cholestérol <1 g/L Statine +/- ézétimibe (Ezetrol®)
Rationnel d’un traitement
immunosuppresseur et
problématiques d’iatrogénie
médicamenteuse engendrées
Le principe de l’immunosuppression en transplantation
rénale est de prévenir le rejet aigu. Il repose sur :
- un traitement d’induction qui consiste à associer des
traitements immunosuppresseurs à des anticorps anti-
lymphocytaires polyclonaux (Thymoglobuline®)ouun
antagoniste des récepteurs de l’interleukine 2, basiliximab
(Simulect®);
- un traitement d’entretien qui est plus intense pendant les
trois premiers mois suivant la transplantation. Il sera modi-
fié progressivement par la suite afin de diminuer le risque
d’effets indésirables et d’améliorer la tolérance des immu-
nosuppresseurs utilisés au long cours sans pour autant
risquer un rejet du greffon [16, 17].
Le schéma d’immunosuppression d’entretien habituel
associe une trithérapie comportant un inhibiteur de la
calcineurine, un inhibiteur l’inosine 5’ monophosphate-
deshydrogénase (IMPDH) et des corticoïdes [16, 17].
Inhibiteurs de la calcineurine
Les inhibiteurs de la calcineurine ont révolutionné la
transplantation au début des années 1980 et constituent,
encore de nos jours, la base du traitement immunosup-
presseur en transplantation rénale [16, 17].
Ciclosporine [12, 18]
Point d’action immunologique : la ciclosporine se
fixe sur le récepteur intra-cytoplasmique, la cyclophiline
et bloque ainsi la voie d’activation calcineurine dépen-
dante et par conséquent la transcription et l’expression
génique des cytokines nécessaires à la réponse immuni-
taire (IL-2 et d’INF-␥et les récepteurs à l’IL-2).
Présentations : la ciclosporine est commercialisée
sous forme de Neoral®ou de Sandimmun®, solution
buvable dosée à 100 mg/mL (Neoral®est sous forme
de microémulsion à résorption orale améliorée), cap-
sules orales 10 mg, 25 mg, 50 mg ou 100 mg, ou de
Sandimmun®injectable 50 mg/mL ou 250 mg/5 mL.
Neoral®versus Sandimmun®: le Neoral®présente
une meilleure absorption digestive que le Sandimmun®,
sous forme de capsules. La forme micronisée rend le pro-
fil d’absorption de la ciclosporine peu dépendant des sels
biliaires, des enzymes pancréatiques et de l’absorption
des aliments.
Posologie et plan de prise : la posologie initiale par
voie orale est de 6 mg/kg/j à 15 mg/kg/j puis elle est
réduite progressivement jusqu’à 2 mg/kg/j à 6 mg/kg/j
en traitement d’entretien. En perfusion IV, la posologie est
de2à5mg/kg/j avec relais rapide per os. Il est important
d’éviter la prise du jus de pamplemousse.
Tacrolimus [12, 18]
Point d’action immunologique : le tacrolimus forme
un complexe avec une protéine cytosolique (FKBP12) qui
se lie et inhibe la calcineurine conduisant à une inhibition
du signal de transduction des lymphocytes T.
Présentations : Prograf®gélules 0,5 mg, 1 mg ou
5 mg, injectable 5 mg/mL ou Modigraf®, sachets poudre
orale 0,2 mg ou 1 mg, Advagraf®LP gélules 0,5 mg, 1 mg,
3mgou5mg.
Posologie et plan de prise : par voie orale, la
posologie initiale est de 0,1 mg/kg/j à 0,2 mg/kg/j
puis adaptation selon les dosages pharmacologiques.
L’Advagraf®LP est administré en une fois par jour et le
Prograf®ou Modigraf®en deux prises par jour, matin
et soir. Les gélules doivent être prises immédiatement
après avoir été sorties de la plaquette thermoformée (prin-
cipe actif photosensible). En général, afin d’optimiser
l’absorption, la prise doit se faire à jeun ou au moins 1
heure avant ou2à3heures après un repas et ne doit pas
être associée au jus de pamplemousse.
Si l’état clinique du patient ne permet pas
l’administration par voie orale, le médicament peut
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = JPC Article Identification = 0266 Date: December 7, 2013 Time: 11:1 am
J Pharm Clin, vol. 32 n◦4, décembre 2013 205
La transplantation rénale et les immunosuppresseurs
être administré par voie intraveineuse à la dose de 0,01 à
0,05 mg/kg/j en perfusion continue sur 24 heures.
Lors du relais de Prograf®vers Advagraf®, un suivi
des concentrations plasmatiques du tacrolimus est néces-
saire en raison du risque d’une diminution de l’exposition
systémique.
Cicloporine versus tacrolimus ?
Ces deux inhibiteurs de la calcineurine sont considérés
comme de puissance équivalente [17]. En effet, il n’a pas
été démontré de différence significative sur la durée de
survie du greffon après administration de l’une ou l’autre
des deux molécules [19]. Cependant, il semblerait que le
tacrolimus soit à privilégier en raison d’un taux de rejet
aigu plus faible [20]. Le choix sera guidé également par le
spectre de leurs effets indésirables métaboliques (dyslipi-
démie et diabète).
Inhibiteurs de la prolifération lymphocytaire
Azathioprine [12, 18]
Point d’action immunologique : l’azathioprine
libère la 6-mercaptopurine qui agit comme anti-métabolite
intervenant au niveau enzymatique du métabolisme des
purines. Elle empêche ainsi la prolifération de cellules
participant à la détermination et à l’amplification de
la réponse immunitaire. L’effet immunosuppresseur de
l’azathioprine peut n’apparaître qu’après plusieurs mois
de traitement.
Présentations : l’azathioprine est commercialisée
sous le nom de Imurel®ou génériques, comprimés à
25 mg, 50 mg ou injectable à 50 mg.
Posologie et plan de prise : la posologie est de 1
à 3 mg/kg/j (sans dépasser 150 mg/j) et doit être adap-
tée en fonction de la réponse clinique et de la tolérance
hématologique. Il est conseillé de prendre ce médicament
au cours des repas, afin d’éviter les troubles gastro-
intestinaux.
Mycophénolate mofétil [12, 18]
Point d’action immunologique : le mycophéno-
late mofétil est la prodrogue de l’acide mycophénolique
(MPA). Le MPA est un puissant inhibiteur sélectif, non
compétitif et réversible de l’IMPDH qui inhibe, sans être
incorporé à l’ADN, la synthèse de novo des nucléotides
à base de guanine. Il inhibe la prolifération des lympho-
cytes B et T.
Présentations : mycophénolate mofétil Cellcept®,
capsules à 500 mg ou gélules à 250 mg, poudre à
suspension buvable à 1 g/5 mL, injectable à 500 mg.
Mycophénolate sodique, sel de sodium de l’acide myco-
phénolique Myfortic®est disponible en comprimés à
180 mg et 360 mg.
Posologie et plan de prise : par voie orale, ce médi-
cament doit être initié dans les 72 heures suivant la
transplantation. La dose recommandée de Cellcept®chez
les transplantés rénaux est de 1 g deux fois par jour. Son
équivalent en Myfortic®est de 720 mg 2 fois par jour. La
prise du médicament peut se faire au cours ou en dehors
des repas. Afin de minimiser les fluctuations plasmatiques,
la prise doit se faire toujours de la même manière. Le
Cellcept®doit être conservé à l’abri de la lumière. Il est
recommandé que la suspension buvable de Cellcept®soit
reconstituée par un pharmacien avant d’être délivrée au
patient.
Cellcept®versus Myfortic®: le Myfortic®présente
une meilleure tolérance digestive en raison de la formu-
lation galénique des comprimés qui sont enrobés d’un
film gastro-résistant, permettant ainsi une libération du
principe actif uniquement dans l’intestin [12].
Mycophénolate versus azathioprine
Actuellement, le mycophénolate mofétil est plus utilisé
que l’azathioprine sur la base d’études montrant la supé-
riorité du mycophénolate dans la prévention du rejet aigu
lorsqu’ils sont associés à l’ancienne formulation de la
ciclosporine (Sandimmun®) [16]. Pourtant, Remuzzi et al.
ont conclu que l’acide mycophénolique ne présentait pas
de supériorité sur l’azathioprine en termes de préven-
tion du rejet aigu, lorsqu’il est associé à la ciclosporine
(Neoral®) [21].
Corticoïdes [12, 18]
Les corticoïdes ont été utilisés dès le début de
l’histoire de la transplantation rénale pour leur potentiel
d’immunomodulation. Les deux molécules les plus cou-
ramment prescrites pour la prévention du rejet chronique
sont la prednisone et la prednisolone [16].
Point d’action immunologique : les glucocorti-
coïdes exercent leurs effets immunosuppresseurs en
diminuant l’expression des gènes codant pour les cyto-
kines (IL-1, 2, 6, IFN␥, TNF␣). Il en résulte une
diminution de la prolifération des lymphoytes et une
diminution de l’activité cytotoxique des lymphocytes
CD8+, ainsi qu’une diminution de l’activité bactéricide du
macrophage.
Posologie et plan de prise : la prednisone est
prescrite en dose d’attaque à 1 mg/kg/j les 3 premiers
jours de transplantation puis diminuée progressivement à
20 mg la première semaine puis à raison de 5 mg/sem
jusqu’à la dose de 5 mg, un mois après la transplantation
rénale.
Présentations : prednisone (Cortancyl®), comprimés
à 1 mg, 5 mg et 20 mg ; prednisolone (Solupred®), compri-
mésà5mgou20mg,solution buvable 1 mg/mL et leurs
génériques.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%