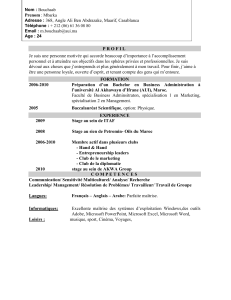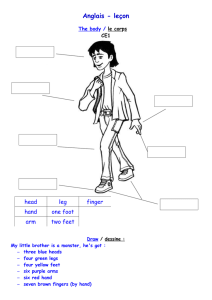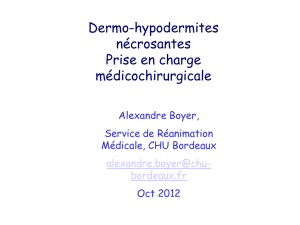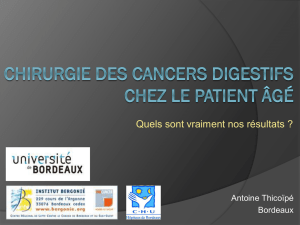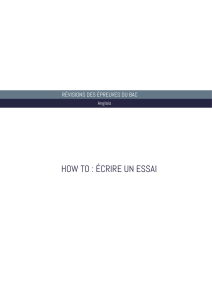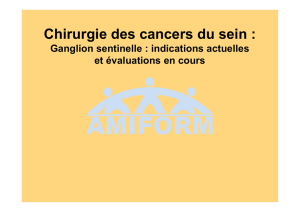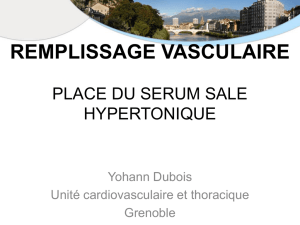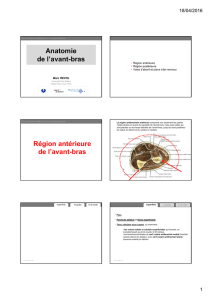Évolution de la prise en charge chirurgicale du membre supérieur

Analyse de la littérature
Évolution de la prise en charge chirurgicale du membre supérieur
tétraplégique depuis 50 ans
Functional surgery of upper limb in tetraplegics since 50 years
C. Fattal
a,
*, J. Teissier
b
, C. Leclercq
c
,M.Revol
d
, M. Enjalbert
a
a
Centre Dr Bouffard-Vercelli, Cap Peyrefite, 66290 Cerbère, France
b
Institut de la main et du membre supérieur, 15, avenue du Professeur-Grasset, 34000 Montpellier, France
c
Institut de la main, clinique Jouvenet, 6, square Jouvenet, 75016 Paris, France
d
Hôpital Saint-Louis, service de chirurgie plastique, 75475 Paris cedex 10, France
Reçu le 3 octobre 2002 ; accepté le 11 décembre 2002
Résumé
Objectifs.– Étude de l’évolution de la chirurgie fonctionnelle du membre supérieur tétraplégique depuis 1950.
Méthode.– La revue de la littérature a porté sur les publications en langue française et anglaise colligées dans 3 banques de données :
Medline, Pascal et Embase. Elle a aussi consisté en une lecture exhaustive des bibliographies de chacune des publications de telle sorte que des
publications non indexées ont aussi été consultées.
Résultats.– Les procédures chirurgicales sont codifiées et dans l’ensemble bien documentées. Elles sont dominées par 2 priorités : assurer
la sécurité du geste chirurgical et raccourcir les délais d’immobilisation. Par ailleurs, un intérêt croissant a été porté, ces dernières années, aux
tétraplégies hautes au travers de la neurostimulation électrique fonctionnelle.
Conclusion.– Les procédures chirurgicales sont suffisamment diversifiées pour que l’on puisse affirmer que peu de tétraplégiques sont
exclus de cette chirurgie certes exigeante mais toujours aussi utile. Une prise en charge en rééducation de qualité passe par la connaissance des
procédures chirurgicales.
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Objective.– Development of upper limb functional surgery in tetraplegics in the last 50 years.
Methods.– The literature review relating to the years 1950–2002 was carried out with 3 data bases: Medline, Pascal, Embase. This review
also involved a thorough study of non-indexed references.
Results.– A large number of surgical procedures are described. Two priorities are stressed by the authors: safety of these procedures and
duration of postoperative immobilization.
Conclusion.– This review of literature shows that the prospects for restoring upper limb function in tetraplegics are greater than ever,
offering a larger number of patients the possibility to increase their independence in daily life. Functional surgery remains, nevertheless,
demanding in terms of length of immobilization and presupposes requiring a multidisciplinary approach requiring rehabilitation teams to be
up to date with surgical procedures.
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS.All rights reserved.
Mots clés : Tétraplégie ; Chirurgie fonctionnelle ; Neurostimulation électrique ; Main ; Membre supérieur
Keywords: Tetraplegia; Functional surgery; Functional neuromuscular stimulation; Hand; Upper limb
*Auteur correspondant.
Adresse e-mail : [email protected] (C. Fattal).
Annales de réadaptation et de médecine physique 46 (2003) 144–155
www.elsevier.com/locate/annrmp
© 2003 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.
DOI:10.1016/S0168-6054(03)00014-X

1. Les principes
Il aura fallu attendre la 2
e
moitiédu XX
e
siècle pour que
l’augmentation de l’espérance de vie du tétraplégique, le
développementdes techniqueschirurgicalesetl’ouverturede
structures de rééducation spécialisée permettent d’envisager
des programmes de restauration chirurgicale des fonctions
motrices àvisée fonctionnelle.
La première publication sur le sujet émane d’un chirur-
gien de la Mayo Clinic, du nom de Lipscomb [73]. Mais, la
chirurgie fonctionnelle du membre supérieur, toutes patholo-
gies confondues, a puisédès 1948 chez Sterling Bunnel [16],
les premiers principes de ténodèse. Il s’agira longtemps
d’une chirurgie de reconstruction d’une pince et non d’une
chirurgie de la fonction fondée sur l’association de ténodèses
et de transferts tendineux. Les successeurs de Bunnel tels que
Lipscomb [73], Nickel [92] et Dolphin [20] ont eu le mérite
d’entretenir l’intérêt portéàcette chirurgie jusqu’à ce que
quatre grands chirurgiens, Lamb [66], Freehafer [33], Zan-
colli [115] et Möberg [87] décident, dans les années 1970, de
concentrer leurs efforts sur le sujet tétraplégique. Si des
différences d’approche chirurgicale se dessinent entre cha-
cun des quatre, il est d’emblée possible, au cours de la 1
re
conférence internationale sur la chirurgie fonctionnelle du
membre supérieur tétraplégique, àEdimbourg, en 1978, de
dégager quelques points consensuels :
•l’importance de la restauration de l’extension active du
coude et de la pince clépouce–index, dite key-grip,
bénéficiant d’un contact plus large, même si moins pré-
cis ;
•l’importance de la main comme instrument de préhen-
sion mais aussi de relation justifiant que la main reste
souple ;
•l’importance de la sensibilitédu revêtement cutanédes
doigts pour contrôler la position, la motricitéet la force
de la main.
En fait, 2 écoles se distinguent, l’une ambitieuse (Zan-
colli), l’autre pragmatique (Möberg). De leurs conceptions
parfois divergentes, parfois simplement différentes, naîtront
des compromis. Les grandes lignes sont résumées dans le
Tableau 1.
L’école française, autour d’Allieu [4], fera la synthèse en
rejoignant :
•Zancolli [114] pour réaliser une main intrinsèque asso-
ciéeàune stabilisation des articulations métacarpo-
phalangiennes. Il s’agit d’aller plus loin dans la restau-
ration d’une mobilitédes doigts chaque fois que cela est
possible pour obtenir des prises fortes ;
•Möberg [87] pour privilégier la pince termino-latérale
(key-grip) et imposer comme préalable la restauration
de l’extension active du coude et pour proposer de façon
générale, un programme simple ;
•Freehafer et House pour envisager la réanimation de
l’ouverture des doigts par transfert actif chaque fois que
cela est possible [51,114,115] sinon par ténodèse dor-
sale [32,46].
En 1978, une première version d’une classification du
membre supérieur est adoptéeàla 1
re
conférence internatio-
nale organiséeàla demande de Möberg, sous l’égide de
Lamb àEdimbourg [78,89]. Cette réunion avait une tonalité
confidentielle puisqu’elle a rassemblé18 participants. Le
consensus sur la classification sera définitivement trouvéàla
2
e
conférence internationale organisée en 1984, par E. Bé-
rard, àGiens (France), àl’initiative de Möberg [77]. Qua-
rante participants étaient au rendez-vous. Il s’agit de la clas-
sification dite de Giens qui répertorie les muscles présents
au-dessous du coude et restés actifs àune cotation d’au
moins 4 MRC (Medical Research Council). Ces muscles dits
«muscles-clés»sont susceptibles soit d’être transférés, soit
de stabiliser une articulation. Des informations sur les affé-
rences sensitives (cutaneous Cu+ou–) et visuelles (Ocular
O+ou–) sont associées.
Cette classification prétend permettre àtous les chirur-
giens de partir d’une même description du membre supérieur
pour envisager la stratégie chirurgicale. Il s’agit de 9 groupes
Tableau 1
Deux écoles de la chirurgie fonctionnelle du membre supérieur tétraplégique
ZANCOLLI 75,79 MOBERG 75,78
Restaurer d’autant plus de fonctions que le niveau est haut. La chirurgie se
veut d’autant plus complexe (arthrodèse + transferts tendineux) que le niveau
est haut, donc que les fonctions restantes sont pauvres.
Restaurer des fonctions simples lorsque le ni- veau est haut. Éviter au
maximum les arthrodèses. Favoriser les ténodèses. Conserver une main
souple, une main de «contact »et une main «sensitive »
Privilégier un transfert musculaire chaque fois que cela est possible. Privilégier une bonne ténodèse souvent plus forte et plus utile qu’un transfert
tendineux.
Privilégier une pince pouce–index termino- terminale pour les niveaux les
plus bas. Privilégier une pince pouce–index termino- latérale.
Améliorer l’ouverture de la main par des transferts tendineux sur les
extenseurs ou àdéfaut par une ténodèse dorsale. Restauration d’une ouverture de la main seulement sur des niveaux moyens.
Restaurer une flexion active des doigts tout en stabilisant l’hyperextension des
MP lorsqu’on réanime les muscles extrinsèques de la main. Restaurer une flexion active des doigts tout en évitant de générer des crochets
digitaux.
Garantir la réversibilitéde tous les procédés techniques en cas d’aggravation
fonctionnelle.
Une discrimination sensitive n’est pas indispensable àl’utilisation d’une
pince car le contrôle visuel permet une bonne suppléance. La discrimination sensitive est un paramètre incontournable.
La spasticitédoit faire adapter le programme chirurgical mais constitue
rarement une contre-indication. La spasticitédemeure une contre-indication relative. Seule une spasticité
légère, voire utile est tolérable.
145C. Fattal et al. / Annales de réadaptation et de médecine physique 46 (2003) 144–155

numérotésde1à9etprésentés dans le Tableau 2. Le groupe
10 rassemble les exceptions et les cas atypiques.
Par la suite, les conférences internationales successives
qui se tiendront tous les 3 à4 ans, préciseront les limites et les
contre-indications de cette chirurgie, verront se multiplier les
techniques et les variantes et se développer la stimulation
électrique implantéeàvisée fonctionnelle. Pour rappel, il
s’agit de :
•la 3
e
conférence : animée par Möberg lui-même àGöte-
borg (Suède) en 1988, elle réunira 78 participants [88].
Cette conférence a révéléla multitude des procédures, a
rendu compte des premiers résultats, notamment de
ceux de Möberg dont l’expérience fait déjàautoritéavec
une série de 100 transferts de réanimation du coude et
environ 200 interventions sur la main tétraplégique ;
•la 4
e
conférence, tenue àPalo-Alto (États-Unis) en 1991
[45]. Elle a regroupépour la première fois plus de 100
inscrits. Le souci de réduire les durées d’immobilisation
postopératoire est au cœur des discussions. Les procé-
dures d’origine font l’objet de variantes destinées à
assurer la sécuritédes transplants. La première grande
série de sujets, pour lesquels un neurostimulateur élec-
trique fonctionnel est implanté, est présentée. L’évalua-
tion reste encore sous-développée et peu consensuelle ;
•la 5
e
conférence animée par Sormann àMelbourne
(Australie) en 1995 évolue dans le même état d’esprit
que la précédente ;
•la 6
e
conférence de Cleveland (États-Unis) organisée
sous l’égide de Keith a consacrél’intégration de la
stimulation électrique fonctionnelle dans la stratégie
chirurgicale générale du membre supérieur tétraplégi-
que [56] ;
•la 7
e
conférence de Bologne (Italie) organisée par Landi
aétél’occasion d’une remise en cause de la classifica-
tion de Giens, eu égard aux nombreuses atypies et aux
muscles non pris en compte par la classification [68].
Les procédures chirurgicales demeurent globalement
inchangées. Peu de bouleversements sont relevésenla
matière. Aucun consensus n’aététrouvépour l’évalua-
tion des résultats. Deux tests ont étéretenus pour inté-
grer une étude de validation probablement confinée aux
États-Unis.
Au fil des conférences, l’approche sera de plus en plus
multidisciplinaire, associant le souci des chirurgiens de ren-
dre encore plus sûrl’acte chirurgical et celui des équipes de
rééducation de réduire les durées d’immobilisation postopé-
ratoire.
2. Les stratégies chirurgicales
2.1. Restauration de l’extension active du coude
Toutprogramme de chirurgiefonctionnelle débutepar une
restauration de l’extension active du coude chaque fois
qu’elle est nécessaire [14,15,19,21,43,86,87,96]. Il s’agit de
«l’intervention de base »[77]. Paul préconise d’associer,
dans un même temps chirurgical, la restauration de l’exten-
sion du coude et celle d’une key-grip [93]. Brys recommande
d’associer dans le même temps, tout transfert du brachio-
radialis àla restauration de l’extension du coude [15]. Il n’en
demeure pas moins que la gestion de la période postopéra-
toire est, dans ce cas, plus difficile. Freehafer [30] continue
de penser que la restauration de l’extension du coude est un
geste qui doit compléter la chirurgie de la main et estime
qu’aucune preuve n’a jamais étéfaite sur l’intérêtdedébuter
le programme par la chirurgie du coude [35,63]. Lo se place
aussi en faux par rapport àce choix, estimant que, d’un point
de vue fonctionnel, rien n’empêche que des patients se satis-
fassent d’une main opérée alors que le triceps est nul [74].
Pourtant, son intérêt est d’abord fonctionnel dans une
logique d’amélioration de l’approche proximo-distale de
l’objet et d’optimisation des préhensions. Il a étédémontré
que le triceps brachii est le déterminant principal qui sépare
deux groupes de tétraplégiques d’un point de vue fonctionnel
[111]. L’intérêt est aussi psychologique. Cette intervention
permet d’obtenir une indépendance rapidement et grande-
ment appréciée dans certains domaines tels que la propulsion
du fauteuil roulant [85,97]. L’intérêt est enfin physiologique.
De ce point de vue, il a étéclairement démontré,qu’une fois
le coude stabilisé,ilétait plus facile de transplanter sur le
poignet ou sur la main, le brachio-radialis mieux équilibré
par son antagoniste —le triceps brachii —puisque son
action est polyarticulaire [10,15,36,108]. L’absence d’exten-
sion du coude pourrait engendrer une rétraction du brachio-
radialis et par ce fait, une inefficacitépartielle ou totale du
transfert tendineux.
De façon plutôt anecdotique, une seule équipe, néo-
zélandaise, s’est risquée, pour 15 patients —en ce qui
concerne le coude —et pour 26 patients —en ce qui
concerne la main —àproposer une chirurgie bilatérale
simultanée [90]. Le taux de satisfaction est important.
La restauration de l’extension du coude concerne surtout
les groupes 1 à4 voire 5. Le noyau moteur du triceps étant
trèsétendu de C6 àD1, son atteinte est variable pour un
même niveau lésionnel. Le triceps brachii est cependant, en
règle, présent àpartir du groupe 5. Sa réanimation est envi-
sagée lorsqu’il est cotéàmoins de 3 [7].
Tableau 2
Classification internationale dite de Giens
Groupes Muscles actifs au dessous du coude (cotation d’au moins 4 MRC)
0 Aucun muscle au-dessous du coude
1 + BR (Brachio-radialis)
2 Groupe 1 + ERCL (extensor radialis carpi longus)
3 Groupe 2 + ECRB (extensor radialis carpi brevis)
4 Groupe 3 + PT (pronator teres)
5 Groupe 4 + FCR (flexor carpi radialis)
6 Groupe5+Extension des 4 derniers doigts
7 Groupe6+Extension du pouce
8 Groupe7+Flexion partielle des 4 derniers doigts
9 Groupe8+Flexion complète des 4 derniers doigts
10 Exceptions ouAtypies
146 C. Fattal et al. / Annales de réadaptation et de médecine physique 46 (2003) 144–155

L’intervention repose sur 2 techniques très différentes :
•le transfert du deltoïde scapularis (deltoïde postérieur)
sur l’insertion tendineuse du triceps brachii ou sur l’olé-
crane avec interposition d’un tendon prothétique ou
d’un tendon endogène. La technique d’origine a été
décrite en 1975 par Möberg qui a utilisécomme tendon
intermédiaire les tendons extenseurs des orteils. Le del-
toïde scapularis est considérécomme synergique du
triceps [86]. Cette technique sera utilisée par de nom-
breux chirurgiens [8,14,19,22,96]. Elle sera, par la suite,
modifiée par d’autres auteurs [32,63,90,93,100]. Ils in-
terposeront un tendon du tibialis antérieur. Hentz et
McDowell privilégieront la bandelette de fascia lata
[43,77]. Lamb citépar Möberg a rapportéde très bons
résultats avec l’utilisation de l’extensor carpi ulnaris
comme muscle et tendon intermédiaire [88]. C. Sierra
n’utilise aucune greffe d’interposition mais prélève une
bandelette tendineuse au centre du tendon tricipital qu’il
retourne pour l’attacher au tendon du deltoïde scapula-
ris [17]. De ce fait, l’épaule reste libre en période posto-
pératoire. Cette technique a étéutilisée avec succès par
VanDen-Berghe [107] pour quelques patients et par
Ejeskär [22] qui l’a, par la suite, abandonnée en raison
d’une succession d’échecs. Mennen s’en est inspiréen
utilisant une partie du tendon distal du triceps prélevé
avec de l’os olécranien, retournée vers le haut pour être
raccordéeaudeltoïde scapularis [80]. Il rapporte des
résultats analytiques satisfaisants. En 1988, Hentz dé-
cide aussi de ne plus utiliser de tendon intermédiaire et
raccorde directement le deltoïde postérieur àl’aponé-
vrose tricipitale. Aucun résultat n’est rapporté[44].
La multitude des variantes s’explique par le fait qu’aucun
matériau intermédiaire idéal n’aététrouvépour limiter le
risque de détente et réduire en même temps les durées d’im-
mobilisation postopératoire. En France, Allieu a réaliséun
compromis en interposant une seule tresse de Dacron dou-
bléedefascia lata [5,6]. Le dacron est considérécomme une
matière biocompatible, inextensible, susceptible de limiter
lesproblèmes de détente [48].D’autres équipes —Filipettiet
Teissier d’une part [24], Bottero et Revol d’autre part [9] —
utilisent un tendon intercalaire prothétique, synthétique en
polyester. Ils ont pu, grâce àce matériau, réduire nettement le
temps d’immobilisation stricte à3 semaines. Si le deltoïde
scapularis est jugétrop faible, un contingent du deltoïde
moyen est parfois associéau transfert [25].
Si le pectoralis major clavicularis (faisceau claviculaire
du grand pectoral) est aussi jugétrop faible, l’intervention
dite de Buntine est préconisée [54,55]. Elle consiste en une
médialisation du deltoïde antérieur prélevéavec la baguette
osseuse claviculaire en fixant le tout sur le tiers moyen-
interne de la clavicule. En pratique, l’intervention de Buntine
ne semble être véritablement utilisée que par les Français. La
littérature anglo-saxonne, en dehors de Johnstone, n’accorde
pas d’attention particulière àl’absence de faisceau clavicu-
laire du grand pectoral.
•la deuxième technique fait appel au transfert du biceps
brachii sur le tendon du triceps brachii. Cette technique
décrite par Friedenberg [38] a la préférence de Zancolli
qui préconise l’économie d’un tendon intermédiaire
pour limiter le risque de détente [114]. En effet, une
seule suture est, dans ce cas, réalisée. La procédure
repose sur la section de l’insertion distale du biceps et la
suture au tendon du triceps après un passage sous-
cutané.Lavoied’abord initialement décrite est latérale.
Zancolli n’utilise la technique de Möberg que s’il ne
peut utiliser le biceps brachii. Ejeskär en fait la procé-
dure de choix en cas de flexum du coude et lorsque le
patient n’a pas besoin d’une forte flexion du coude dans
ses activités journalières [22]. Pour peu que le patient
présente une attitude en supinatus associéeauflexum,
cette intervention résout les deux problèmes dans un
même temps opératoire. C’est, en effet, en raison du
risque de compromettre la flexion active du coude (perte
de 25 à50 % suivant les séries) que cette procédure a été
décriée par Freehafer [27]. Teissier l’a abandonnéeen
raison des difficultés«d’intégration corticale »du trans-
plant [106]. D’autres l’ont ignorée sans raison après une
trèsbrève expérience [65]. La flexion est, en effet, déter-
minante pour le tétraplégique dans son effort de stabili-
sation de fauteuil ou de soulèvement du lit en passant
l’avant-bras àtravers la poignée suspendue. En outre,
l’intégration du neotriceps et la dissociation avec les
autres muscles fléchisseurs qui conservent leur rôle sont
difficiles, ce d’autant plus qu’il existe souvent des co-
contractions brachial antérieur/biceps brachii. La réali-
sation de ce geste suppose la conservation du brachial
antérieur et surtout du court supinateur [83]. Pour Mö-
berg, c’est une condition indispensable au transfert du
biceps sur le triceps. Pour Zancolli, la supination de
l’avant-bras est toujours conservéesilaflexion dorsale
du poignet est présente [114]. Comme, de toute façon, le
testing du court supinateur est difficile, il est souvent
nécessaire de réaliser un bloc anesthésique du musculo-
cutané, qui permettra de révéler si, àlui seul, le court
supinateurestcapable d’assurer la supination de l’avant-
bras [114].
Allieu [2], Revol [98] et Kuz [62] réservent son indication
aux seuls cas oùil existe une attitude en supination de
l’avant-bras et surtout oùle faisceau claviculaire du grand
pectoral (major pectoralis) est absent. En effet, dans ce
dernier cas, le transfert du deltoïde scapularis est contre-
indiquécar, il serait peu efficace en absence de stabilisation
antérieure de l’épaule.
Ejeskär [22], Möberg [88], Revol [98] et Kuz [62] recom-
mandent vivement la voie médiale pour éviter le risque d’une
lésion du nerf radial qui serait fonctionnellement trèspréju-
diciable.
La voie médiale est plus directe et le risque d’adhérences
serait moins important [62]. Les 2 derniers auteurs ont décrit
en détail la procédure et sont les seuls àavoir fourni des
résultats tangibles, àl’appui de leur choix, la casuistique de
147C. Fattal et al. / Annales de réadaptation et de médecine physique 46 (2003) 144–155

Revol (8 patients, 13 coudes) étant supérieure àcelle de Kuz
et House (3 patients, 4 coudes).
2.2. Restauration de l’extension active du poignet
Le poignet est la cléde voûte de l’effet ténodèse d’ouver-
ture et de fermeture de la main, indispensable chez le tétra-
plégique. L’arthrodèse du poignet est, pour cette raison,
formellement contre-indiquée [83,89]. C’est une donnée qui
aététrèsprécocement consensuelle [26,78]. Les mains de
groupe 1 sont privées de prise ténodèse efficace en raison de
muscles radiaux faibles ou absents (groupe 1). La restaura-
tion d’une extension active du poignet s’impose de fait.
L’intervention de choix a étédécrite par Freehafer en
1966 [34], reprise par de nombreux chirurgiens
[14,44,48,52,61,69,91,97,99]. Le muscle donneur est le
brachio-radialis (BR) ou long supinateur àcondition que sa
cotation soit supérieure ou égale à4. Le transfert est réalisé
sur l’insertion terminale de l’extensor carpi radialis brevis
(ECRB) ou 2
e
radial, fournissant ainsi le trajet le plus direct
au transfert. Le réglage est réaliséen tension maximale,
poignet en flexion dorsale et coude à70 à90°de flexion
[36,53]. Dans une de ses dernières publications, Freehafer
proposait même d’associer l’extensor carpi radialis longus
(ECRL) ou 1
er
radial au BR lors du transfert de ce dernier sur
l’ECRB afin de renforcer l’extension du poignet et de réduire
la tendance àl’inclinaison radiale du poignet [36]. Waters
préconise de ne jamais associer dans le même temps la
restauration de l’extension du poignet et celle d’une key-grip
afin de concentrer toute la rééducation sur l’obtention d’une
flexion dorsale du poignet forte [108,109]. L’efficacitédu
transplant est directement liéeàla réanimation préalable de
l’extensionactiveducoude. Fautede quoi, lebrachio-radialis
a tendance àse rétracter et entraîner une raideur en flexion du
coude et en extension du poignet [10,51].
2.3. Restauration de l’ouverture et de la fermeture
des doigts
Il s’agit du corollaire ou de la finalitéde la chirurgie de
réhabilitation de l’extension active du coude et du poignet.
En pratique, dans la très grande majoritédes cas, inspirée des
recommandations de Lipscomb [73] et reprise par Zancolli
[114], Hentz [43] et House [52], cette partie du programme
chirurgical est fondée sur 2 temps successifs : un premier
temps d’ouverture (ténodèses ou transferts) associéàdes
gestes de stabilisation du pouce et/ou des autres doigts et un
deuxième temps de fermeture plus ou moins associéà
d’autres gestes de stabilisation.
Hentz a préconiséde pratiquer, pour les patients les plus
motivés, le temps d’ouverture et de fermeture en un seul
temps opératoire [44]. Il rapporte 4 bons cas dans sa publica-
tion. C’est un choix contre lequel Möberg a, dès 1980 mis en
garde [84]. Ce dernier mentionne, dans son rapport de syn-
thèse sur la conférence internationale de Göteborg en 1988,
le risque de débuter par le temps d’ouverture évoquépar
certains participants [82]. Ceux-ci ont avancéque la discré-
tion du bénéfice fonctionnel issu du temps d’ouverture pou-
vait démotiver certains patients quant àla poursuite du pro-
gramme chirurgical. C’est un constat que l’on ne retrouve
pas dans la littérature.
2.4. L’ouverture de la main (Tableau 3)
Pourune grande majoritéde chirurgiens,la restaurationde
l’ouverture de la main précède le temps de fermeture dans
une logique fonctionnelle qui vise àouvrir la main pour
approcher l’objet. Par ailleurs, l’activation de l’ouverture est
censée assurer un meilleur réglage du plancher de l’index
dans la pince pouce–index termino-latérale. Beasley [8] et
Ejeskär[22]ont préconiséle contraire afindes’assurer que le
temps de fermeture soit bien réglédans un premier temps et
que le réglage de l’ouverture se fasse par la suite. Par ailleurs,
l’activation de l’ouverture des doigts ne peut être possible
que si le poignet est bien stabilisépar un grand palmaire ou
flexor carpi radialis (FCR) actif àune cotation d’au moins 3.
En effet, l’absence de FCR ferait basculer le poignet en
flexion dorsale àchaque effort d’extension des doigts [51].
Autrement dit, seuls les groupes 4 avec un grand palmaire
moyen entre 3 et 4 et les groupes 5 sont concernés. Il s’agit,
ici aussi, d’une autre facette de l’évolution de la stratégie
d’amélioration de l’ouverture de la main tétraplégique. Au-
delàdu groupe 5, les extenseurs de doigts sont présents. La
question de l’ouverture ne se pose plus. De façon schémati-
que :
•pourlesgroupes 2, 3 et 4,enabsence de flexionactivedu
poignet, des ténodèses chirurgicales d’amélioration de
l’effet ténodèse spontanésont réalisées
[1,13,22,24,49,72]. Ces ténodèses sont pratiquées sur
l’extensor digitorum communis (EDC) au niveau du
retinaculum dorsal [104] ou sous un point osseux àla
face dorsale du radius [35], sur l’extensor pollicis lon-
gus (EPL) au tubercule de Lister et éventuellement sur
l’extensor digitorum minimi (EDM) et l’abductor pol-
licis longus (APL) [44,52,115]. Cette ténodèse vise à
amarrer les tendons extenseurs sous une languette os-
seuse sur la face dorsale du radius. L’ouverture du pre-
mier espace et des chaînes digitales est passive, toujours
initiée par flexion palmaire du poignet, c’est-à-dire par
effet ténodèse.
D’autres techniques ont étéproposées. Nous retiendrons
laplusrécente décrite par Ejeskär[22,23]. Il s’agit d’une
retente des bandelettes médianes et latérales de l’appa-
reil extenseur du 2
e
au 5
e
doigts associéeàune stabilisa-
tion des métacarpo-phalangiennes en flexion (àl’aide
d’un ligament artificiel) et des interphalangiennes proxi-
males en extension. Certains chirurgiens ont préconisé
pour les groupes 4 d’améliorer la ténodèse d’ouverture
des doigts, soit par un transfert du BR sur le FCR [104],
soit par un transfert du PT sur le FCR [55,115], soit par
une dorsalisation du flexor digitorum superficialis
(FDS) pour accentuer l’effet ténodèse sur l’ouverture
distale des doigts [22] et générer un effet de «cascade
148 C. Fattal et al. / Annales de réadaptation et de médecine physique 46 (2003) 144–155
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%