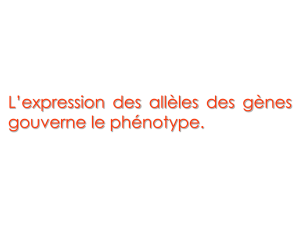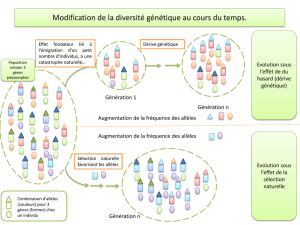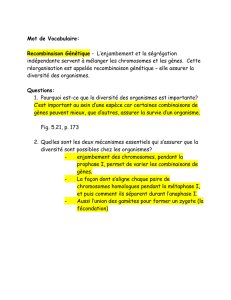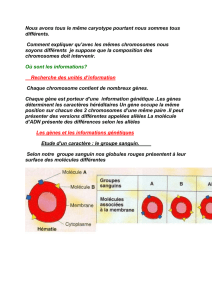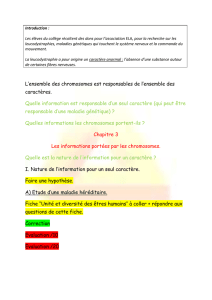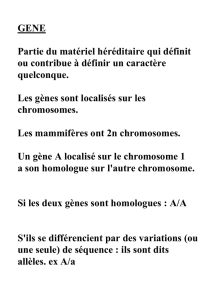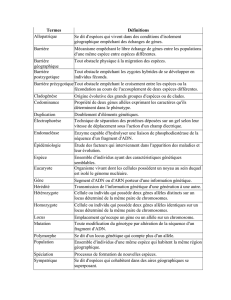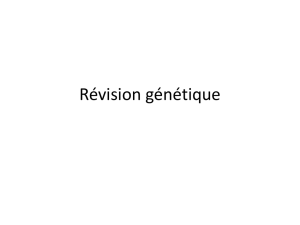Reproduction sexuée et brassage génétique. Unicité

Reproduction
sexuée et
brassage
génétique. Unicité génétique
des individus.
Un allèle fonctionnel gouverne la synthèse d’un polypeptide. Celui-ci
est lui-même responsable d’un caractère phénotypique c’est à dire un
caractère physiologique, biochimique ou morphologique observables
chez l’individu. Il existe donc une relation étroite entre le matériel
génétique : le génotype et la morphologie : le phénotype.
Cycle Haplobiontique
• Chez les organismes N, seule la cellule-œuf est 2N. Les spores de
Sordaria macrospora par ex, issues de la cellule-œuf par méiose
sont toutes N : un seul chromosome de chaque paire soit un seul
allèle par gène,soit un seul phénotype possible.
Cycle diplobiontique
• Chez les organismes 2N, chaque cellule présente 2 allèles de
chaque gène.
− si les 2 allèles sont identiques (individu homozygote) : une seule
version, un seul phénotype.
− si les 2 allèles sont différents (individu hétérozygote) le phénotype
est défini: soit par l’allèle “ dominant ”, l’autre étant “ récessif ; soit
par les 2 à la fois s’il y a codominance.
• Le brassage intrachromosomique : Il s’effectue lors de la prophase
de 1ère division méiotique et est le fait de crossing-over :il s’agit d’un
échange d’allèles entre chromosomes homologues !recombinaison
et nouvelles associations de gènes sur les chromosomes d’individus
hétérozygotes (si homozygotes : échange d’allèles identiques donc
pas de recombinaison.)
• Le brassage interchromosomique. Il a également lieu au cours de la
méiose : séparation des chromosomes homologues
indépendamment les uns des autres !nombre très important de
combinaisons de chromosomes, donc de gènes dans les cellules-
filles.
• Le hasard a un rôle important dans le brassage génétique :
répartition aléatoire des chromosomes puis des chromatides !
mélange des gènes.
A la fécondation : union de deux gamètes « pris au hasard »
!déduction d’un « échiquier de croisements » des gamètes
permettant de déterminer le pourcentage de chances de voir
apparaître tel ou tel caractère.
• Les recombinaisons génétiques sont multiples !unicité de chaque
individu avec conservation des caractères propres à l’espèce à
laquelle il appartient.
• Etablissement possible de la localisation chromosomique des
allèles : croisements entre souches « pures » et souches
« hybrides » = back-cross.
− si un individu hybride double hétérozygote, par ex. : 4 types de
gamètes équiprobables, soit 50% de gènes parentaux et 50% de
gènes recombinés !les couples d’allèles de ces gènes sont
indépendants, c’est à dire porté par des chromosomes différents.
− Au contraire, les gènes sont liés si on obtient une majorité de
gènes parentaux.
Memopage.com SA © / 2006 / Auteur : Alexandra Vivier des Vallons
1
/
1
100%