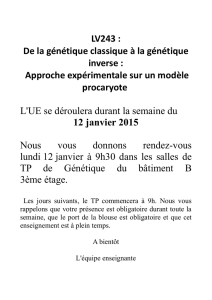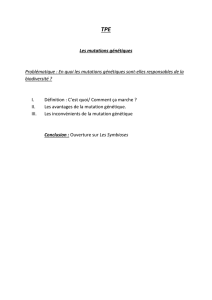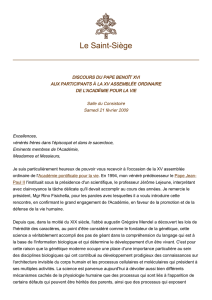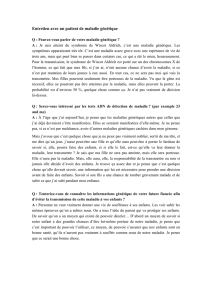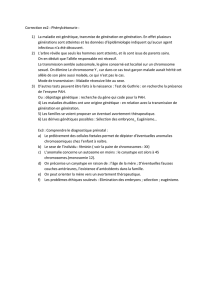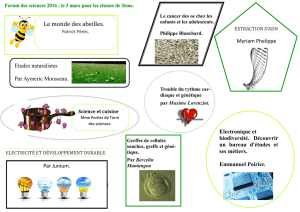Read the entire Dossier - Institut Européen de Bioéthique

1
Untestdiagnostiqueestunmoyentechniquepour
identifieruneconditionpathologique(ounon),poten‐
tielleouavérée,àpartird’indicesmatériels(marqueurs
anatomiques,physiologiques,cytologiques,moléculai‐
res)dontl’apparitionchezlesujetva
depairavecladitecondition.Ledia‐
gnosticestlerésultatpositifounégatif
(présenceouabsencedu
«marqueur»)découlantdecetest.
Onditquelemarqueurrecherchéest
«corrélé»àlasurvenuedelacondi‐
tionpathologique.Celatraduitlefait
quesaprésenceannonceuneforte
présomptiondel’étatpathologique,
sanstoutefoisenconstituerlapreuve
absolue.
Cetestestentachédedeuxni‐
veauxd’imprécision.D’unepart,sa
fiabilitétechniquepeutvarier.On
parledefauxpositifsoudefauxnégatifslorsque,pour
desraisonsaccidentelles,laréponseaffichéenecorres‐
pondpasàlaprésenceouàl’absenceeffectivedela
conditionpathologique.D’autrepart,lanaturedumar‐
queurdéterminelaforcedelacorrélation,suivantqu’il
estreliéàl’étatpathologiquepardesvoiesbiologiques
plusoumoinsdirectes.Undiagnosticpositifn’estdonc
pasl’imageconformedelaréalité,maislaprobabilité
d’êtreenprésenced’uneréalitésuspectée.
Lediagnosticprénatal(DPN)estpor‐
tésurl’embryonoulefœtusinutero.
Iln’intervientpasthéoriquementsur
lecoursdelagrossesse,mêmes’il
présentedefaiblesrisquessuivantla
techniquemiseenœuvre.
Lediagnosticpréimplantatoire(DPI)
consiste,danslecadred’une
fécondationinvitro,àanalyserdes
caractéristiquesgénétiques
d’embryonsinvitro,afinderecueillir
desinformationsquidoiventêtre
utiliséespourchoisirceuxquiseront
implantés.Suivantledegrédesévéri‐
tédelasélectionquidécouledes
résultatsdudiagnostic,lamèrepeutêtreamenéeàde‐
voirenvisager,lecaséchéant,undeuxièmecycledesti‐
mulationovarienne,dontlecoûtetlesrisquessontbien
réels.
LEDIAGNOSTICPRÉNATALET
PRÉ‐IMPLANTATOIREDPN)
Dossierdel’InstitutEuropéendeBioéthique
1.Définitions
L’essorrécentdelabiotechnologieapermisladé‐
couverted’unequantitétoujourscroissantede
«marqueurs»moléculaires,c’est‐à‐diredemolécules
spécifiquesdontlaprésencecoïncideaveclasurvenance
demaladiescaractérisées.Ledéveloppementdelagé‐
nétiquemoléculaireetdelagénomiqueaportél’atten‐
tionsurlesséquencesmoléculairesconstitutivesdenos
gènes,dontcertainesmutationsidentifiablespeuvent
entraînerl’installationdemaladiesgénétiques,oude
maladiesàdéterminismecomplexecomportantau
moinsunecomposantedeprédispositiongénétique.
Larecherchedécouvretouslesjoursdenouvelles
maladiesgénétiques,dontlenombredoitdépasserles
6000sil’ons’entientauxseulesmaladiesmonogéni‐
ques.Ilestadmisque10%d’unepopulationmoyenne
doiventêtreporteurs(asymptomatiques)d’aumoinsun
gèneliéàunemaladiegénétique.Parextrapolation,il
estpermisdepenserquelaplupartd’entrenoussont
desporteursdel’uneoul’autreanomaliegénétique.
Cetteévidenceremetenquestionlanotiondenor‐
malitégénétique,cequidevraitconduireàécartertoute
idéologiedéfinissantuneconditiongénétiqueoptimale,
commelanotiondepuretégénétiquedontabusentles
théoriesracistesetlespolitiqueseugénistes.
2.Engénétique,l’anormalitéesttoujourslanorme

2
L’eugénismeestuneconstructionmentalequiambi‐
tionned’améliorerlesqualitésgénétiquesd’unepopu‐
lationoud’unerace.Letermeaétéintroduitdansle
langagecourantparuncousindeCharlesDarwin,du
nomdeFrancisGalton.Cetteparentén’estpasquefa‐
miliale,elleestaussilelieud’unetransfusiondelapen‐
séeévolutionnistesurunterrainquiauraitdûluirester
étranger:celuideladémographie.
L’idéeavancéeparGaltonétaitquelessociétéshu‐
mainesdeplusenplustechniciennessesoustrayaientà
laloidelasélectionnaturelle,quiétaitjusque‐làgarante
delasurviedesgénérationsdanslanature.Sil’onvou‐
laitéviterquecerelâchementsélec‐
tifn’aboutisseàunaffaiblissement
dugenrehumain,ilparaissaitoppor‐
tundeluisubstituerunesélection
artificielleeugénique,capablede
revêtirdeuxaspects.
L’eugénismepouvaitêtrenégatif
s’ilconsistaitàréduiredanslapopu‐
lationlaproportiond’individusinfé‐
rieursauxnormes.
Ildevenaitpositifs’ilsefondait
surlareproductionpréférentielledes
individuslesplusaptes.Maisqu’est‐
cequelanorme,ouencorel’apti‐
tudeidéale,etàquidevraitrevenir
ledroitdelafixer?Lesrecherches
actuellesengénétiquemoléculaire
fontladémonstrationquec’estla
mutationquiestlanorme,etquela
variationgénétiqueestlebienleplusprécieuxd’une
populationconsidéréeapte.
L’eugénismeestunethéorieàlaquellelelégislateur
n’hésitepasàsefrotter.C’estenparticulierleurlourd
passénaziquipèseencoreaujourd’huisurlesloisalle‐
mandesouautrichiennes,lesplusdéterminéesenEu‐
ropeàprohibertouteinterventionsurlepatrimoine
génétiquehumain,etenparticulieraustadeembryon‐
naire.
Lelégislateurbelgeabordelaquestion,enparticulier
danssontextedeloirelatifàlaprocréationmédicale‐
mentassistée(PMA)du6juillet2007.Ilyestclairement
stipuléquelediagnosticpréimplantatoiredoitêtrein‐
terdits’ilrevêtuncaractèreeugéniqueausensdesar‐
ticles5‐4et5‐5delaloidu11mai2003relativeàla
recherchesurlesembryonsinvitro.Eneffet,cetteder‐
nièreloiécartetouttraitementàcaractèreeugénique,
c’est‐à‐direaxésurlasélectionoul’amplificationdeca‐
ractéristiquesgénétiquesnonpathologiques,ousurla
sélectiondusexe.Laloibelgen’adoncretenudela
théorieeugénistequelaformepositive,pourlaré‐
prouver;elleignore,enrevanche,lesimplicationsde
l’eugénismenégatif.
Surcepointévidemmentsensible,ilfautsereporter
àl’avisn°33duComitéConsultatifdeBioéthiquede
Belgique,relatifauxmodificationsgéniquessomatiques
etgerminalesàviséesthérapeutiqueset/ouaméliorati‐
ves,du7novembre2005.Cetavisproposeuneréécri‐
turedelathéorieeugénisteàlalu‐
mièreduprogrèstechnologique.Il
ajouteàladistinctionentreeugénis‐
mespositifetnégatifunedistinction
orthogonaleentreeugénismede
sociétéeteugénismeprivé.
Desaffirmationsplusradicalessont
alorsmisessurlecomptede
«certainsparmisesmembres»pour
éviterd’avoiràtrancher.L’eugé‐
nismenégatifestenvisagécomme
unesolutionàdesfardeauxconsidé‐
rablesauxquelssontsoumisesles
famillesetlasociététoutentière.
L’eugénismeprivéestdécritcomme
uneopportunitéquirelèveraiten
prioritédelasphèred’autonomiedu
sujet.Maisenmêmetempsilest
déclaréque:«dèsqu’unevaleurestadmiseparune
majoritédepersonnes,onconstateunetendanceàsui‐
vrelemouvement».Etlaconclusionarrivesouscette
forme:«Uneéthiqueresponsablen’excluraitpasqu’on
puissepromouvoir–avecprudenceetrespect–larecon‐
naissancedubien‐fondéd’uneattitudeeugénistes’agis‐
santdecasreconnuscommegraves.»
3.Lespectredel’eugénisme1
Le diagnostic génétique
pré-implantatoire est le moyen
grâce auquel l’eugénisme
pourra accéder à ses fins.
Jacques Testard
«
»

3
4.Labanalisationdesdiagnosticscytologiquesoumoléculaires
Lediagnosticcytologiqueoumoléculaireestune
technologieneutre:elleditsimplementcequiest.C’est
soninterprétationquipourraitsortirdelaneutralité.
Laprudenceinterprétatives’imposed’autantplusque
lesmarqueursbiomoléculairesnesontquestatistique‐
mentcorrélésàlasurvenued’unepathologieoud’une
conditionhéréditaire.Lacorrélationstatistiquen’auto‐
risequedesprésomptions,maisnedécritpas,saufcas
degénétiquemonofactorielle,unerelationdecausalité
directe.
Lediagnosticcytologiqueoumoléculairepermetde
pratiquerdestestsnoninvasifssurunenfantànaître.
Delàl’intérêtpourcesdiagnosticsprénatauxoupréim‐
plantatoiresavecunnombrede«marqueurs»significa‐
tifstoujourscroissant,surtoutceuxquisontimmédiate‐
mentassociésàdesmaladiesgraves.Celadit,lesdia‐
gnosticsmoléculairesdemandentàêtrecomplétéspar
d’autresdiagnosticsplusconventionnels,enparticulier
lesdiagnosticsanatomiqueetphysiologique,quitrou‐
ventenobstétriqueunesecondejeunesseavecl’avène‐
mentdel’échographieetdel’imageriemédicale.
Undiagnosticcytologiqueoumoléculairenefonc‐
tionnepasàl’aveuglepourtouteslesconditionspatho‐
logiquessusceptiblesdeseprésenter.Iln’esttechni‐
quementpossiblequederechercherlaprésenced’un
marqueurquiauraitétécibléàpartird’unesuspicion
préalable.Sil’ontestepourlamucoviscidose,onne
testepaspourlaprédispositionaucancerdusein,et
réciproquement.Ilyaunchoixàfaireavantdemettreà
jourtelleoutellealtérationconstitutive.Cechoixde‐
mandeàêtreéclairéparlesantécédentsfamiliaux,la
compatibilitégénétiquedesparents,oulepronostic
d’unbondéroulementdelagrossesse.Parailleurs,laloi
deplusieurspayss’opposeaudiagnostic«enbatterie»
pourtesterunesériedeconditions,nonpasquecette
dispositionsoittechniquementirréalisable,maisenver‐
tudesdérapagesqu’ellepourraitoccasionner.
5.Susauxmarqueursgénétiques:lachasseestouverte!
Lesprogrèsdelarechercheajoutentrégulièrement
denouveauxmarqueurschromosomiquesougénéti‐
quesàl’arsenaldelamédecineclinique.Nousnesom‐
mesplusdanslasituationoùseulesquelquesmaladies
chromosomiquesoumonogéniquesgravespouvaient
fairel’objetdediagnosticsprécoces,car,désormais,
nombreuxsontlesmarqueursdisponibles,ycompris
ceuxassociésàdesmaladiesàdéterminismecomplexe.
Entrentaussidanslechampdudiagnosticdiversesaf‐
fectionssévèresdontlasurvenanceestreportéeàun
âgeultérieur,tellesquelachoréedeHuntington,la
myopathieàrévélationtardive,lescancersfamiliauxdu
seinetducôlon,certainstypesdelamaladied’Alzhei‐
mer,lapolykystosedurein.
Est‐illégitime,aunomdudroitdesavoir,
desonderdesorganismesnés,ouencoreà
naître,pourleursprédispositionsàtelleou
telleévolutionpathologiquedifféréedansle
temps?Encoreplusdéroutant:viendrale
tempsoùl’onseraenmesuredediagnosti‐
querd’autresprédispositionsstatistique‐
mentétablies,commecertainesprédisposi‐
tionspsychiatriquesdontl’expressiondépend
pourpartieduterraingénétiqueetpourpar‐
tiedesstylesdevieouautrescirconstances
relationnellesdansuneexistencehumaine.
Quevadireledroit?Jusque‐là,n’étaient
considéréesquedesmaladiesgravesaffec‐
tantl’enfantànaîtredanssonprésentoudanssonfutur
prévisible.Quediredelacapacitédel’enfantànaître
detransmettreincognitoàlagénérationsuivanteun
gènerécessifsusceptibled’imposerlefardeaudela
maladieàsesdescendants?Quellepourraêtrel’atti‐
tudedesparentssicegènedevientdétectableinutero?
C’estlaquestionques’estposéeleComitéConsulta‐
tifdeBioéthiquedeBelgiquedanssonavisn°49du20
avril2009.Dansunesociétédeplusenplusréticenteà
accepterlerisquedanstoutessesdimensionssanitaires
etenvironnementales,ildevientinsupportableàbon
nombredeparentsdevivreavecl’idéequ’ilspuissent
concevoirunenfantsainporteurd’unemaladieinvali‐
danteetincurable.Lerisqueencouruparcetenfantest
derencontreràl’âgeadulteunconjointpor‐
teurparhasarddelamêmemutationréces‐
sive,cequiconduiraitlecoupleàconcevoir
pourlagénérationsuivantedesenfantsdé‐
clarantalorslamaladie.Aprèsavoirposéla
questiondelalégitimitéd’undiagnosticpor‐
tantsurdesmaladiesgravesdontl’appari‐
tionestdifféréedansletemps,vientdoncla
questiondelalégitimitéd’unestigmatisation
desporteursdemutationsrécessives,dont
laprobabilitéd’entreràlagénérationsui‐
vantedansunecombinaisongénétiquedéfa‐
vorablerestespéculative.L’accroissement
constantducataloguedesmarqueursgéné‐

4
Laquestiondel’inté‐
rêtdel’enfantest
l’unedesplusdélica‐
tesàtraitercar,au
momentoùlespa‐
rentssontfaceàla
décision,l’enfantà
naîtren’estévidem‐
mentpasenmesuredes’exprimer.Lesparents,quant
àeux,mêmebienentourés,sontinévitablementsous
l’effetd’unesidérationetleuravenirn’estpasécrit,si
noirsemble‐t‐ilêtre.
L’avortementthérapeutique,quis’apparenteàun
droitdanslaplupartdenospays,pourraitalorsêtreper‐
çucommeundevoir.Cen’estpascequeditlaloi,ce
n’estpascequeditlascience,c’estdudomainedela
perceptionindividuelle.L’avisn°33duComitéConsulta‐
tifdeBioéthiquedeBelgiquereconnaîtàlamère
(éventuellementaupère)ledroitdesefaireundevoir
deveilleràcequiseraitlemieuxpoursonenfantànaî‐
tre.
Ensomme,ledroitderéaliserlaperceptionintime
decequipourraitqualifieruneviedigne.Cedroitest
fondé,auxtermesdecetavis,surlareconnaissancedes
influencesconjuguéesdel’environnementculturelet
social,del’histoirefamiliale,desconvictionsreligieuses,
delaconceptionautonomed’unevievalable(sic).
EnFrance,lafamillePerruches’estprononcéecontre
lavaliditédelaviedeleurfilslourdementhandicapé,et
s’estportéepartiecivilecontrelemédecinetlelabora‐
toirequiauraientcommislafauteden’avoirpasrévélé
entempsutilel’anomaliedontlefœtusétaithélaspor‐
teur.Sicetterévélationavaitétéfaitecommelestechni‐
quesenvigueurl’auraientnormalementpermis,une
IMGauraitétépratiquéepouréviteràl’enfantunevie
préjudiciable.LefameuxarrêtPerruche(arrêtdela
Courdecassationdu17novembre2000)adonnéraison
auxparents,aumotifque«l’enfantatteintd’unhandi‐
cappeutdemanderréparationdupréjudicerésultantdu
handicapetcauséparlesfautes(dumédecinetdulabo‐
ratoire)».Iln’apasfalludeuxansavantquelelégisla‐
teurnes’interposecontrecetteconfusiond’undroitet
d’undevoir,etlasaisieparlesparentsdelaCoureuro‐
péennedesdroitsdel’hommesurlaviolationsupposée
del’Art.8delaConventioneuropéennedesdroitsde
l’hommes’estsoldéeparunrejet.
tiquesconduitàdevoirseposerlaquestiondelalégiti‐
mitéd’unrecoursàdesmoyensabortifs,quellequ’en
soitlalégalité,silebutviséestbiendefairedel’eugé‐
nismenégatifàgrandeéchelle.Iln’estpeut‐êtrepas
inutilederappelerquelesconditionsnormalementad‐
misespourautoriseruneIMGsontlagravitédelapa‐
thologie,l’absencedemoyensthérapeutiquesaumo‐
mentdudiagnostic,l’intérêtdel’enfantànaîtreetla
certitudedelasurvenancedelamaladie.Lescasénu‐
mérésci‐dessusrelèventtousducritèredegravité,mais
sontpourlemoinsdiscutablesdespointsdevuedel’in‐
térêtdel’enfant,delacertitudedudommageetdes
réponsesthérapeutiquesenévolutionrapide.
Ilnefautpasconfondrelediagnosticprénatalou
préimplantatoireaveccequ’ilestconvenud’appelerla
médecineprédictive.L’objectifdelamédecineprédic‐
tiveestdeprévoirlasusceptibilitébiologiquedesper‐
sonnesàlasurvenuedemaladiesnonencoredéclarées,
permettantalorsdemettreenœuvreunevéritablemé‐
decinepréventive.
Lestechniquesutiliséessontsouventlesmêmesque
cellesapplicablesauxdiagnosticsprénataletpréimplan‐
tatoire.
Lesujetestcependantsoumisàcestests,enfonction
desesantécédentsfamiliauxetdesesconditionsdevie,
àunstadedesonexistencequiprécèdeceluidel’appa‐
ritionprobabledespremierssymptômes,avecl’idée
pratiquequ’ilseraenmesured’adaptersonhygiènede
vieoud’avoirrecoursàdesmesurespréventivesappro‐
priées.
Entoutétatdecause,lesujetdanscecasestsoumis
auxtestsdesonpleingré,envertuduprincipedelibre
consentement.Lagrandedifférenceaveclesdiagnostics
prénataletpréimplantatoiretientaufaitquelaméde‐
cinepréventiveagitsurl’environnementdusujet,alors
quelesDPNetDPInepeuventconduirequ’àl’avorte‐
mentdusujetdanslepremiercas(IVGouIMGselonles
dispositionsvariablesdesdifférentesloisnationales),et
àlapratiqued’untrieugéniquedanslesecondcas.
6.Viepréjudiciable2
7.Avortementoupolitiquedeprévention?

5
8.Déontologieprofessionnelle
Lesdiagnosticsprénataletpréimplantatoireétantà
l’évidencelourdementchargésdeconsidérationséthi‐
ques,laplupartdesexpertsdespaysdisposantdela
technologiebiomoléculairesontarrivésàdesvuesàpeu
prèsconsensuellessurlesconditionsrequisespourpro‐
poserdetellespratiquesàdesparentsdansl’attente
d’unenfant.
Lesconditionssuivantessontlespluscouramment
invoquées:
• resteràl’écartdescircuitscommerciaux,
• nediagnostiquerquedesmaladiestrèsgraves,ou
justifiantuneinterventionraisonnableetréaliste,
• exclureduchampdudiagnostictoutemotivation
s’apparentantàunsoucideconvenanceperson‐
nelle,
• n’avoirrecoursqu’àdestestsdûmentvalidéspar
uneautoritécompétente,
• s’entourerd’uneéquipepluridisciplinaire,
• s’informercomplètementsurlesconséquences
d’undiagnosticpositif,
• fairelalumièresurl’accompagnementmédicalet
socialdesfamillesbénéficiairesdecestests.
Danslesconditionsprévuesparlaloi,lesbénéficiai‐
resdecespratiquesdoiventpouvoirs’entourerd’un
conseilgénétiquecompétent.Leproblèmenesepose
pasdanslesmêmestermesdanslecasdudiagnostic
prénataletdansceluidudiagnosticpréimplantatoire.
Alorsque,pourlesecond,laconsultationgénétique
doitfairepartieintégrantedelaprescriptionetdela
miseenœuvred’uneFIVETEtoutaulongduparcours,
danslepremiercasellepourraitaussibienêtreomise
avecladémédicalisationdeladémar‐che.
L’arrivéesurlemarché(enparticuliersurInternet)
detestprénatauxaccessiblesàtous,parfoispraticables
horsd’uncadremédical(testssanguins),nepeutque
renforcerlacrainted’undéfautd’encadrement.
Silerecoursàuneconsultationgénétiqueestune
obligation,seposeensuiteleproblèmedelaneutralité
duconseilprodigué.Lesprofessionnelstravaillenten‐
coreaujourd’huiàl’établissementd’unedéontologiedu
conseilgénétique,dontlespointsdedépartsontla
compétence,lapluridisciplinarité,laloyauté(terme
retenuparlaloibelge)etleprincipesacro‐saintdel’au‐
tonomiedelapersonneconsultante.
UnarticlerécentparuleJournalofMedicalEthics(6
avril2012)précisequelesinformationsdonnéesaux
couplesconcernantl'utilisationetlesconséquencesdu
diagnosticpréimplantatoireseraientinsuffisantes,carà
cejour,iln’estpasprouvéqueleDPIn'aitaucuneffet
surlasantédesbébésàlongterme;laprocédured'utili‐
sationdudiagnosticpourraitentraînerdesproblèmes
neurologiquespourcesderniers.Lesauteursdel’article
rappellentquelescliniquesontessentiellementadopté
latechnologieduDPIpour«éliminerlesembryonsdé‐
fectueuxsansapprécierlesrisquesencourus.Aforce
d'éliminerlesrisquesparl'utilisationduDPI,nouscréons
denouveauxrisquespeutêtremêmeplusimportantque
ceuxquenousessayonsd'éviter.»Parconséquent,cer‐
tainsmédecinsconsidèrentquelescliniquesspéciali‐
séesdanslestechniquesdefécondationinvitrodoivent
davantageinformerleurspatientssurlefaitqueleDPI
n'estpasunetechnologiesansdanger.C’estunique‐
mentàcetteconditionquelesparentsauraientlapos‐
sibilitédedonnerunconsentementéclairéàlaréalisa‐
tiondecediagnostic.
Entrentdoncenlignedecomptelareconnaissance
parlaprofessiond’uncodedebonnespratiquesassorti
decritèreséthiquesnonéquivoques(comptetenude
l’éthiquedelaprofessionetduprofessionnelconsulté),
lesoucidel’évitementdesdommages,lesoutienappor‐
téauxpersonnesdontlaresponsabilitéparentaleest
engagéetantdansleurréflexionprésentequedansleur
besoindeseprojeterdansleuravenirfamilial.
Le droit d’avoir l’enfant que l’on veut contre
la grandeur d’aimer l’enfant que l’on a.
Axel Kahn
«
»
 6
6
 7
7
1
/
7
100%