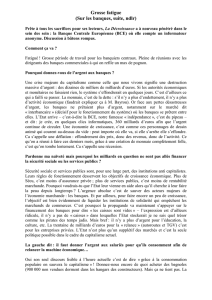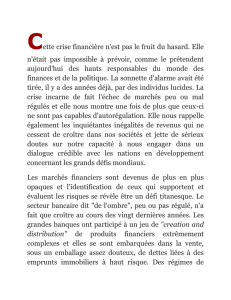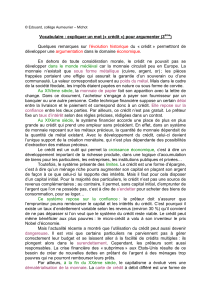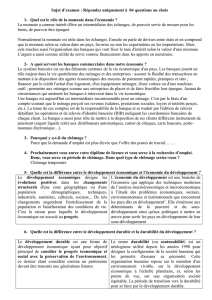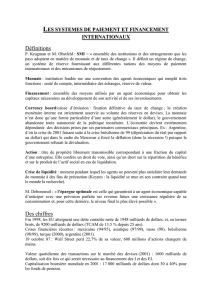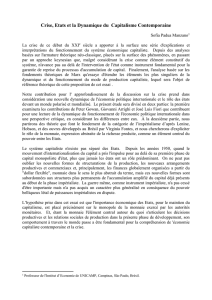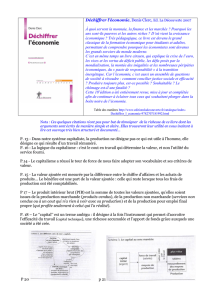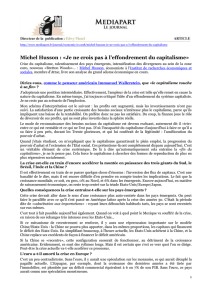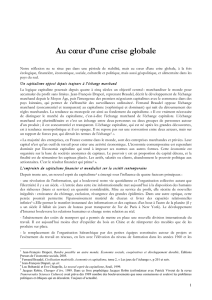A. Harfouche, De la naissance du capitalisation à la crise

1
De la naissance du capitalisme à la crise économique de 2009 : La
chute de l’empire et la fin du "Novus Ordo Seclorum"
1
?
Antoine HARFOUCHE - Chargé d’enseignement à la FGM
Entre le 1er Janvier et le 20 décembre 2008, l’indice CAC 40 a perdu plus de 42 % de
sa valeur et passe de 5614 points à 3226 avec un plus bas à 2839 atteint le 21
octobre 2008
2
. Sur cette même période, le Nasdaq a perdu également 41% de sa
valeur et passe à 1564. Le Dow Jones quant à lui perd 35% et clôture à 8579. Même
les actions dites ‘Blue Chips’
3
se sont effondrées. En moins de six mois, le prix du
baril de pétrole chute de 149 dollars US à 40 dollars US. Ces chiffres ne laissent
aucun doute quant à l’importance de la crise de 2008. Elle est aussi grave que la
crise de 1929
4
. Elle touche tous les actifs risqués, tous les agents économiques
(ménages, entreprises, banques…) et toutes les régions (Etats-Unis, Europe,
Asie…). On assiste en même temps à un Krach boursier, à une crise bancaire, à une
crise de liquidité (‘credit crunch’
5
), ainsi qu’à une récession économique classique en
Europe Occidentale et aux Etats-Unis d’Amérique. Les symptômes sont donc, à la
fois financiers, monétaires, économiques, alimentaires, énergétiques et écologiques.
Tout ceci nous laisse croire que les prochaines années seront des ‘Anni horribiles’
6
.
Si le proverbe ‘Errare humanum est, perseverare diabilicum’
7
est vrai, alors, pourquoi
répétons-nous les mêmes erreurs? Pourquoi sommes-nous incapables de tirer des
leçons du passé ?
Plusieurs causes directes et indirectes ont été citées par les spécialistes et les
économistes du monde entier comme étant la source de cette crise (Jorion 2008,
Doise 2008, Artus et al. 2008). Selon ces derniers, les subprimes
8
, la titrisation
9
, les
bonus en centaine de millions de dollars US accordés aux PDG des grandes
multinationales, l’abolition du Glass Steagall Act
10
et le manque de contrôle des
1
‘Novus Ordo Seclorum’ ou ‘le Nouvel Ordre mondial’ est le symbole du dollar US.
2
L’ensemble des chiffres de cet article peuvent être trouvés sur le site français http://www.boursier.com
3
Blue chips est le terme qui désigne les valeurs à forte capitalisation et réputées comme étant les plus sûres.
4
En 1929, il y a une crise économique et une crise financière. Les indices ont chuté comme jamais cela n’était
arrivé. Selon les spécialistes, à l’origine de cette crise, on trouve une spéculation forte et une recherche d’un
rendement maximal basé sur les crédits. Depuis, il n’y a pas eu de crise financière de cette ampleur. Pour nous,
la crise actuelle est aussi grave que la crise de 1929. Tout ceci sera détaillé dans la partie 2 de cet article.
5
Un ‘credit crunch’ est un resserrement du crédit ou une pénurie de crédit. Il s’agit donc d’un étranglement du
crédit, d’une limitation ou d’une raréfaction du crédit offert aux entreprises et aux particuliers. Ca peut
également correspondre à une forte hausse des coûts liés à l’endettement (hausse des taux d'emprunt, besoin de
fortes garanties pour obtenir un prêt, etc.).
6
‘Anni horribiles’, ou années horribles, est une expression créée par Jean-Pierre Robin, inspiré de la Reine
Elisabeth d’Angleterre, dans son article apparu au Figaro le Lundi 15 décembre 2008 (page 25).
7
L’erreur est humaine, mais sa répétition est diabolique.
8
Les subprimes sont des crédits hypothécaires accordés aux États-Unis à des clients peu solvables, sur la base
d'une majoration du taux d'intérêt censée compenser les risques pris par les prêteurs.
9
La titrisation est une technique financière qui consiste à transférer à des investisseurs des actifs financiers tels
que des créances en les transformant par le passage à une société ad hoc en titres financiers émis sur le marché
des capitaux.
10
‘Glass-Steagall Act’ est le ‘Banking Act’ des Etats-Unis de l’année 1933. A l’origine, il a été fait pour
distinguer entre banque de dépôts et banque d’investissement. L’objectif était de créer un système fédéral
d’assurance des dépôts bancaires et de plafonner les taux d’intérêts sur les dépôts bancaires par le moyen de la

2
‘hedge funds’
11
en sont les causes directes. Selon d’autres chercheurs, l’existence
de liquidité trop importante, investie dans des opérations à fort effet de levier est la
source lointaine de cette crise (CAE 2008, Sapir 2008).
Mais quoiqu’il en soit, les économistes chevronnés savent que les arbres ne
grimpent pas jusqu’au ciel. La crise actuelle ne les a pas vraiment surpris.
Kondratieff l’a bien présenté en 1926 dans son livre ‘cycle de longue durée’. Selon
lui, après chaque phase de croissance (phase A), il y a une crise (phase B). En
1942, dans son livre ‘Capitalisme, socialisme et démocratie’, Schumpeter (1983)
explique les raisons de l’existence des phases A et B. Selon lui, la diffusion d’une
innovation majeure assure la croissance économique. Ainsi, dans la phase A, les
entreprises investissent pour augmenter la production afin de satisfaire la demande
qui est en hausse. Peu à peu cette innovation atteint la maturité. La concurrence
devient de plus en plus rude. Ainsi, la phase B correspond à la période de déclin de
cette innovation qui se matérialise par la faillite et la fermeture d’usines. A ce
moment, le terrain se prépare pour une nouvelle innovation. Dans ce même
contexte, un premier courant s’est développé autour de l’idée que les crises
économiques sont inhérentes à la logique interne du capitalisme. Pour ce courant,
cette crise de 2008 ressemble donc à celles qui l’ont précédée. Elle annonce les
prémices d’une nouvelle innovation technologique.
Un autre courant voit dans cette crise de 2008 le début de la chute. Selon ces néo-
malthusiens, le système a depuis longtemps perdu toute forme de bon sens. Pour
eux, il s’agit d’un dysfonctionnement général du capitalisme lui-même, et la crise de
2008 n’est que la phase émergée de l’iceberg. Ils considèrent que la réalité est plus
profonde. L’empire est entrain de s’effondrer sous son propre poids. Ils annoncent
même la fin du dollar US, qui comme un trou noir, emportera tout ce qui l’entoure.
L’économiste Drancourt (2008), par exemple, n’hésite pas à annoncer le déclin et le
passage à un nouveau cycle dominé par les pays émergents et les contraintes
environnementales.
Tout ceci nous conduit à poser les questions suivantes : la crise de 2008, est-elle
une crise cyclique de type phase B de Kondratieff ou sommes-nous entrain de vivre
la fin du capitalisme lui-même ? Sommes-nous entrain de vivre la chute de l’empire
et la fin du ‘Novus Ordo Seclorum’ ?
Un grand nombre de chercheurs ont étudié les origines de la crise de 2008. Mais
elles restent rares les recherches qui comparent cette crise avec les cinq qui l’ont
précédée. Notre objectif est donc, d’essayer de comparer l’ensemble des crises du
capitalisme pour essayer de dégager des tendances générales. Toutefois, pour bien
Régulation Q. Mais comme il a été largement contourné par l'ensemble de la profession bancaire depuis le milieu
des années 70, il a finalement été abrogé le 12 novembre 1999 par le Financial Services Modernization Act, dit
Gramm-Leach-Bliley Act, juste à temps pour permettre la fusion constitutive de Citigroup.
11
Les ‘hedge funds’ ou les ‘fonds de couverture’ sont des fonds d’investissement se livrant à des placements de
protection contre les fluctuations des marchés. Ce sont de fonds particulièrement risqués car ils sont peu
réglementés. Ils utilisent massivement les techniques permettant de spéculer sur l’évolution des marchés, à la
baisse comme à la hausse. Ils sont peu transparents et souvent implantés dans les paradis fiscaux. Leurs gérants y
investissent une part de leur patrimoine et prélèvent des commissions très importantes en fonction de la
surperformance du fonds. Cela les incite à prendre des risques de marché importants. En général, les
investisseurs ayant déposé de l’argent sur ces fonds, ne peuvent pas réduire leur participation à n’importe quel
moment mais seulement à une certaine période prédéterminée.

3
réussir cet objectif, il convient d’appréhender correctement la nature de ces crises et
leurs causes réelles et lointaines. Ainsi, dans une première partie, nous exposerons
la naissance du capitalisme. Nous résumerons par la suite, en quelques pages,
l’évolution de la monnaie, des services financiers, des banques et des économies.
Dans une deuxième partie, nous présenterons la période de croissance du
capitalisme représentée par le passage de la proto-industrie à l’industrie. Cette
période est caractérisée par des cycles longs de Kondratieff. Dans la troisième
partie, nous évoquerons la période de maturité du capitalisme représentée par le
passage de l’industrie à la post-industrie. La quatrième et dernière partie, présentera
le passage de la société post-industrielle à la société de l’information et des
connaissances. Influencée par l’hyper-compétition (Aveni 1994) et la chrono-
compétition
12
(Stalk et Hout, 1990), cette période a connu, suite aux interventions
fréquentes des Etats, un passage de cycles longs de Kondratieff à des cycles plus
courts.
Ainsi, en quatre parties, nous avons essayerons de retracer le chemin du capitalisme
avec ses six phases A et six crises majeures, leurs causes et leurs conséquences.
Nous terminerons cet article par une conclusion qui répond aux deux questions
principales et qui confortent bien la raison d’être de cet article.
1. La naissance du capitalisme
13
1.1. D’une économie de prédation à une économie de la production
A l’époque de la Préhistoire
14
, les Hommes nomades
15
vivaient en clans et en tribus
de la cueillette, de la pêche et de la chasse. Ils exploitaient les ressources naturelles
disponibles sans pouvoir les maîtriser. Ils se contentaient d’assurer leur survie,
comme les animaux, en arrachant leur subsistance à la nature. Ainsi, il n’y a pas eu
lieu d’échanges importants durant cette longue période.
Avec le temps, le progrès de l’armement des chasseurs provoqua une raréfaction du
gibier. La nécessité poussa alors les Hommes chasseurs à découvrir l’agriculture et
la domestication des plantes et des animaux. Cette révolution qualifiée par les
historiens de révolution néolithique
16
(vers 9000 ans avant J.C) a permis le passage
12
Deux auteurs ont poussé à l’extrême cette logique de chrono-compétition : Stalk et Hout en 1990. L’un des facteurs de réussite est la
vitesse de mise en place sur le marché (time to market) d’un nouveau produit.
13
Le capitalisme a beaucoup de définition. Ces définitions se distinguent en général par le poids qu’elles
accordent aux cinq caractéristiques suivantes :
1. des moyens de productions privés,
2. la recherche de profit,
3. la concurrence économique basée sur la liberté des échanges,
4. l’importance du capital,
5. la possibilité d’échanger une quantité de travail par une quantité de capital.
14
La préhistoire se divise en trois périodes : la Paléolithique, l’Épipaléolithique et le Mésolithique. Elle s’étale
de 3,000,000 d’années et s’achève à 36,000 avant JC.
15
A l’époque, le monde était peuplé de petits groupes d’humain (150,000 individus) qui poursuivaient le gibier
et ramassaient des fruits.
16
Le Néolithique est une époque préhistorique marquée par de profondes mutations techniques et sociales, liées
à l’adoption par les groupes humains d’une économie de production basée sur l’agriculture et l’élevage, et
impliquant le plus souvent une sédentarisation. Les principales innovations techniques sont la généralisation de
l'outillage en pierre polie et de la poterie en céramique.

4
d’une économie de prédation à une économie de production
17
. L’Homme s’installa¸
alors¸ de façon permanente auprès des zones qu’il cultivait. Il devient un paysan
attaché à ses terres. Il commença à s’enrichir en modifiant de manière consciente
son environnement. L’explosion démographique qui s’en suivit a fait que les
Hommes se sont regroupés, au bord des fleuves et des lacs, dans de gros villages,
puis dans des bourgs. Ainsi sont nées les premiers Etats Primitifs, Proto-Etats ou
cités-Etats, qui ont par la suite formé le premier empire de l’histoire : Sumer.
Lors de cette période féconde, le progrès s’accélère grâce à la fabrication des objets
qui bouleversent les conditions de vie comme la poterie, les cordes, les filets de
pêche, les habits et les couvertures, la roue, la métallurgie du cuivre, l’alcool, la
fabrication des meubles et des ponts… Durant cette période, les hommes
échangeaient leurs surplus sur la base de troc. Cette technique d’échange supposait
l’instauration d’un compromis entre deux parties. Pour qu’il y ait échange, il fallait
évidemment que chacun des deux échangistes possédât une chose ou une
marchandise qui soit l’objet de désir de l’autre. Il fallait également qu’il y ait accord
sur la valeur perspective des lots échangés
18
.
Deux nouvelles classes d’individus ont prospéré durant cette période : les
commerçants et les guerriers chargés de protéger les champs de la communauté ou
de s’emparer de ceux des villages voisins.
1.2. L’apparition des premières monnaies et banques de l’Antiquité
Suite à l’invention de l’alphabet
19
par les Phéniciens apparaissent les premiers codes
de lois ainsi qu’une fondation de l’Etat. A ce moment surgit sur les terres d’Irak
d’aujourd’hui le premier grand empire de l’époque
20
. Cet empire était libéral et
décentralisé. Son économie était qualifiée de capitalisme précoce. C’est ainsi que les
premières banques de l’histoire sont apparues dans les temples de Babylone vers
2000 ans avant J.C. Ces banques ne prêtaient que des grains et des marchandises.
Peu après, l’or et l’argent sont devenus très attrayants. Comme ils étaient malléables
et faciles à travailler, certaines personnes sont devenues expertes dans ces métaux.
Ces orfèvres rendirent le commerce plus facile en fabriquant des pièces d’une unité
standard avec un poids et une pureté certifiés
21
. Ainsi sont apparues les premières
pièces de monnaies d'or frappées
22
de l’histoire. Par la suite les banquiers ont
17
Le réchauffement du climat et le progrès de l’armement des chasseurs ont provoqué une raréfaction du gibier.
La nécessité pousse les habitants du Moyen Orient à découvrir l’agriculture. Pour améliorer leurs ordinaires, les
quelques milliers de chasseurs qui peuplaient le Liban, la Palestine, la Syrie et l’Irak actuels commencent à se
nourrir de blé sauvage. Vers 8500 avant J-C, l’homme commença à planter lui même son blé.
18
Au Ve siècle avant J-C, raconte Hérodote, les phéniciens débarquaient leurs marchandises sur les côtes de
l’Afrique ou de l’Europe, les rangeaient en ordre sur le rivage, puis remontaient en bateau et faisaient de la
fumée. A sa vue, les indigènes arrivaient, puis apportaient de l’or et s’éloignaient des marchandises. Les
phéniciens revenaient sur le rivage, et si l’or leur paraît à la même valeur des marchandises, ils l’emportaient et
repartaient.
19
La première révolution culturelle commença avec l’invention de l’alphabet par les phéniciens vers 2200 avant
J.C.
20
Cet empire a été unifié par Sargon-d’Akkad en 2234 avant J-C.
21
La bonne renommée de l’orfèvre garantissait la qualité de son estampille.
22
Cette monnaie est appelée « la monnaie frappée », c’est-à-dire la monnaie garantie par une autorité politique
ou religieuse qui lui attribue une valeur fixe.

5
commencé à avancer de l’or aux commerçants à la place de la marchandise. Ainsi la
petite propriété agricole, le commerce et l’artisanat sont devenus accessibles à tous.
Afin de substituer la garantie privée des orfèvres et des commerçants, les
gouverneurs de l’époque qui étaient des ‘Dieu Roi’, ou des fils du ciel ou du soleil, et
qui détenaient entre leurs mains toutes les autorités ont commencé à imposer leur
propres monnaies comme la seule garantie publique (Gex 2001).
La diffusion de la monnaie s’est rapidement propagée vers des cités Etats de la
Grèce antique: Egine et l’Ionie en adoptent le principe vers 625 avant notre ère
(Picard 1978) ; Corinthe suit à partir de 610 puis Athènes vers 594 (Gerin et al.
2001).
Mais la monnaie a connu sa plus forte expansion avec la République Romaine (Bolin
1958). D’ailleurs, l’origine du terme ‘monnaie’ vient du nom de la déesse romaine
Juno Moneta, car c’est dans les dépendances de son temple que les Romains
avaient installé un atelier pour frapper leurs monnaies. Avec le temps, la république
se transforma en empire et César, omniscient, seul Dieu de l'empire, éclipsa le Sénat
et adopta une monnaie frappée à son effigie et en commémoration de ses victoires.
Le lancement de monnaies en cuivre et en bronze et l’ouverture de nouveaux ateliers
monétaires au troisième siècle conduisent à une hausse brutale des prix
accompagnée d’un effondrement monétaire. Ceci a été suivi, sous l’empereur
Dioclétien, d’une stabilisation sur les monnaies en or (l’aureus en 294) amorçant
ainsi l’évolution vers le monométallisme que parachèvera le solidus d’or de
l’empereur Constantin 1er en 312 (Christol & Nony 1974).
Avec la chute de Rome et la naissance de la Sainte église romaine catholique, le
monde connaîtra la fin de l’esclavagisme de l'Antiquité
23
et le début du féodalisme
24
du Moyen Âge qui dura jusqu’au XVe siècle. Durant toute cette époque, le pouvoir
reposait sur la monarchie
25
absolue du droit divin : le roi qui tenait son pouvoir
directement de Dieu.
1.3. L’apparition des billets et de la monnaie fiduciaire
Les opérations de prêts et de dépôts ont pris un nouvel essor avec l’apparition de la
monnaie en or frappée. L’apparition des trapézites et des argentarii a changé
également la nature de ces opérations qui se font de plus en plus dans un cadre laïc.
Tout ceci a commencé quand les commerçants et les orfèvres prêtèrent de l’or à des
particuliers en les faisant payer des intérêts. Pour protéger leurs ors qui
s’accumulaient, ils fabriquèrent des coffres forts bien protégés. Leurs concitoyens
23
Période qui s’étale de 400 avant J.C. jusqu’à 500 après J.C.
24
On nomme ainsi par féodalité un système légal, basé sur des contrats interpersonnels, né de l'envahissement et
de la conquête de l'empire romain par les Barbares, et qui consistait dans une sorte de confédération de seigneurs
investis chacun d'un pouvoir souverain dans leurs propres domaines, mais inégaux en puissance, subordonnés
entre eux, et ayant des devoirs et des droits réciproques. Ce système trouve son origine avec le capitulaire de
Quierzy-sur-Oise de 877 qui établit l'hérédité dans les domaines et les titres.
25
La monarchie (du grec mono « seul », archein « pouvoir » : « pouvoir non d'un seul, mais en un seul ») est un
système politique où l'unité du pouvoir est symbolisée en une seule personne, par un monarque héréditaire ou
élu, chef de l'État. Selon la définition de Montesquieu, une monarchie se définit par le gouvernement absolu d'un
seul. Mais selon ce dernier, ce pouvoir est limité par les lois.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%