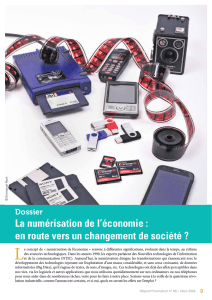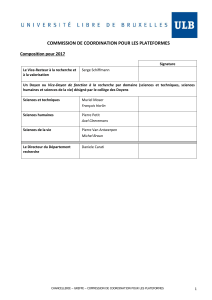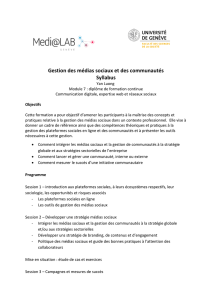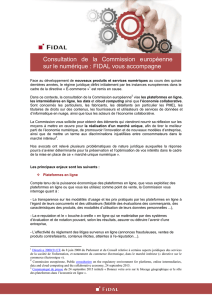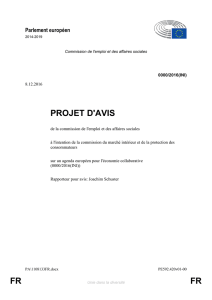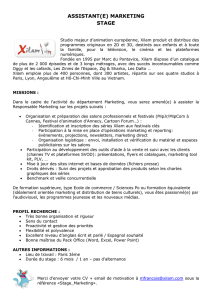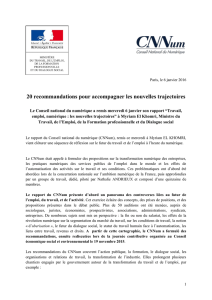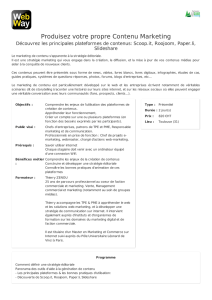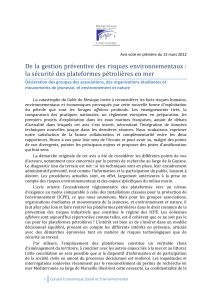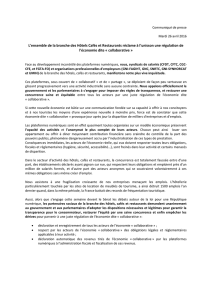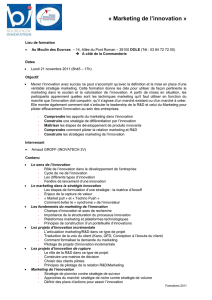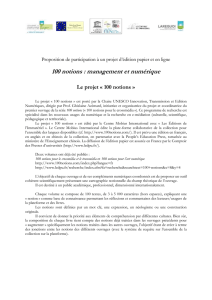les nouvelles trajectoires

-"
LES NOUVELLES
TRAJECTOIRES
_______
Janvier 2016

!
!
Janvier 2016

3
INTRODUCTION 6!
CARTOGRAPHIE DES CONTROVERSES 13!
RECOMMANDATIONS 82!
ANNEXES 187!

4
Saisine et groupe de travail
Le Conseil a été saisi en décembre 2014 par le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social pour formuler ses propositions sur trois
problématiques principales :
-!quels nouveaux métiers, quelles nouvelles compétences et comment conduire la
transformation numérique des entreprises ?
-!quelles sont les pratiques numériques des services publics de l’emploi dans le
monde ?
-!comment l’automatisation et la numérisation des activités agissent-elles sur le travail
et ses conditions ?
Le groupe de travail, piloté par Nathalie Andrieux, est composé de Benoît Thieulin, Président,
Christine Balagué et Valérie Peugeot, Vice-présidentes, Michel Briand, Nathalie Bloch-Pujo,
Virginia Cruz, Pascal Daloz, Francis Jutand, Daniel Kaplan, Laurence Le Ny, Bernard
Stiegler, Marc Tessier, Brigitte Vallée, membres du Conseil, Yann Bonnet, Secrétaire général,
Somalina Pa, Rapporteur général, Mathilde Bras, Judith Herzog et François Levin,
rapporteurs1. Ce groupe a initié ses travaux au mois de juin 2015, à l’issue de la concertation
nationale sur le numérique.
Méthodologie
Dès le départ, l’angle des travaux a été complexe à définir. Lors de la concertation nationale,
plusieurs consultations ont abordé les questions d’emploi, de dialogue social, de régulation
de l’économie collaborative, de transformation du modèle social. Le rapport Ambition
numérique comprend d’ailleurs quelques pistes sur lesquelles le groupe de travail a voulu se
baser pour construire ce présent rapport.
Pris isolément, le trio travail-emploi-numérique renvoie rapidement à une multiplicité
d’échelles - de l’individu à l’organisation du monde - à une infinie littérature, à une diversité
de disciplines et d’expertises, et à une actualité foisonnante d’idées, de débats, de postures,
et de rapports. Le débat est donc difficile à cerner en stabilité : comment éviter un nième
rapport ? Comment se positionner en complémentarité des récents travaux ? Quel niveau de
profondeur devons-nous adopter ? Très vite, nous avons oscillé entre une forme de
résignation, consistant à dire que nous n’avions aucune solution à apporter, et une
détermination à tout de même éclairer le débat, à notre manière.
1 Nous remercions également Julia Borel et Gaston Bricout, qui lors de leur stage au CNNum, ont
largement contribué à nos travaux.

5
Pour résoudre cette équation difficile, nous avons fait le choix d’assumer deux
partis pris :
-!Premier parti pris : assumer l’inconnu. Nous n’arbitrons pas entre tel ou tel scénario
prospectif sur le futur de l’emploi, le degré de disparition de l’emploi, etc. De nombreux
cabinets de conseil, chercheurs, prospectivistes s’y sont essayé. La diversité des analyses
proposées et des champs disciplinaires convoqués est “suffisante”. Cependant, nous nous
efforçons de les restituer et de cartographier de manière analytique les controverses qui
émergent de ces études. Nous avons donc réalisé un travail de lecture, d’auditions
d’experts - économistes, sociologues, juristes, prospectivistes, fonctionnaires - afin
d’embrasser le plus largement possible les positions de chacun. Une journée contributive
organisée le 19 novembre a permis de compléter cette cartographie en confrontant ces
expertises à l’expérience d’acteurs de terrain.
-!Second parti pris : le numérique. Malgré la difficulté du sujet, qui renvoie à des
problématiques plus systémiques, nous choisissons d’adopter une approche empreinte
de la vision que développe le Conseil national du numérique depuis le début de son
mandat : identifier les opportunités, pointer les risques que cette révolution peut
apporter, et surtout proposer des méthodes d’analyse des problèmes et de construction
d’intelligence collective. Les retours d’expériences partagés par les membres du Conseil,
les débats que nous avons pu avoir nous lors des auditions ont permis d’enrichir notre
vision.
Un rapport vivant
Notre rapport s’articule en deux parties principales :
-!Une cartographie des controverses : permettant d’éclairer les lecteurs sur l’état des
débats sur le futur de l’emploi, la transformation des concepts de travail, d’emploi,
d’activité à l’heure du numérique. Cette cartographie n’est pas exhaustive, elle se fonde
sur nos lectures, les auditions que nous avons menées, et les restitutions de la journée
contributive.
-!L’exposé des recommandations : proposant des pistes de méthodes à adopter pour
anticiper les effets de la révolution numérique sur notre modèle social. Les
recommandations se fondent sur ce que nous appelons des chantiers de stabilité, que
nous avons identifiés à l’issue du travail de cartographie. Malgré l’incertitude, ou plutôt
“dans” l’incertitude, certaines actions ont été identifiées comme devant “dans tous les
cas” être menées, pour accompagner des parcours professionnels en transition,
redynamiser la formation tout au long de la vie, reconstruire du lien collectif dans les
organisations, renforcer la redistributivité de notre modèle social, s’assurer du respect
des droits sociaux, etc.
Ce rapport clôt en quelque sorte la mandature du Conseil depuis son renouvellement en 2013.
Nous avons travaillé à ce qu’il reste en cohérence avec nos positions précédentes tout en
proposant des chemins nouveaux. C’est donc un rapport vivant que nous remettons, car si sa
vocation immédiate est d’enrichir plusieurs chantiers législatifs, il donnera sans doute à voir
à la future mandature et nourrira, nous l’espérons, de futurs débats.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
 166
166
 167
167
 168
168
 169
169
 170
170
 171
171
 172
172
 173
173
 174
174
 175
175
 176
176
 177
177
 178
178
 179
179
 180
180
 181
181
 182
182
 183
183
 184
184
 185
185
 186
186
 187
187
 188
188
 189
189
 190
190
 191
191
 192
192
 193
193
 194
194
 195
195
 196
196
 197
197
 198
198
 199
199
 200
200
 201
201
 202
202
 203
203
 204
204
 205
205
 206
206
 207
207
 208
208
 209
209
1
/
209
100%