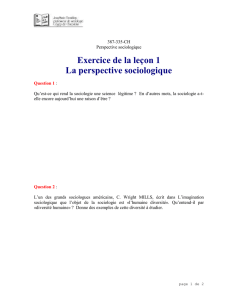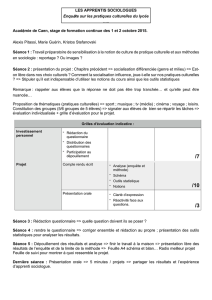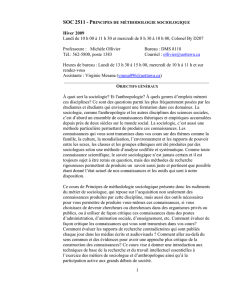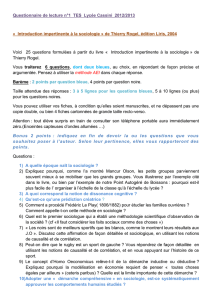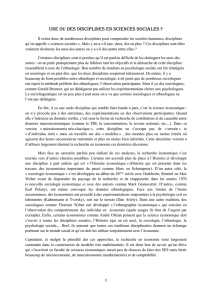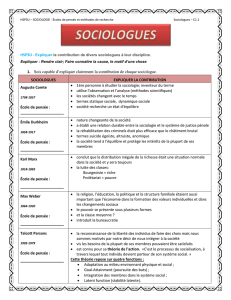Ce que (ne) font (pas) les sociologues. Petit essai d`épistémologie

deux registres : celui de la dénégation
réfutant l’accusation de développer une
conception relativiste des sciences et
revendiquant une épistémologie
« réaliste » de la science ; celui d’une
revendication pour un constructivisme
réaliste à propos de la science réalisée
mais relativiste à propos de la science en
réalisation. Cette défense du sociocons-
tructivisme s’accompagne d’une prise de
distance par rapport au relativisme
radical de Feyerabend et de Bloor.
Cependant, Michel Dubois constate que
des références appuyées aux thèses
centrales de ces deux auteurs sont
présentes et persistent dans les produc-
tions de Latour.
Et reprenant Boudon, il montre que les
constructions de Latour et Woolgar igno-
rent les objectifs à long terme qui structu-
rent le travail des chercheurs car elles se
fondent sur des observations limitées
dans le temps. Tentant de déchiffrer la
science telle qu’elle se fait à partir
« d’instantanés de laboratoire », les
sociologues constructivistes s’exposent
aux paradoxes de composition qui
conduisent à des conclusions inverses
selon que l’on raisonne sur le court, le
moyen ou le long terme. Par ailleurs, si le
parti pris culturaliste peut avoir une
valeur heuristique dans l’analyse des
différentes « rationalités scientifiques »,
cette pluralité n’a de sens que rapportée à
une attitude qui distingue l’activité scien-
tifique des autres occupations humaines.
Sinon comment pourrait-on expliquer les
découvertes simultanées et indépendantes
qui jalonnent l’histoire des sciences ?
Par son érudition et la richesse de ses
analyses, Michel Dubois pose, avec cet
ouvrage, un jalon important qui devrait
marquer le signal d’un renouveau de la
réflexion en sociologie des sciences.
Dominique Desbois
INRA – Économie
et Sociologie Rurales
Cuin (Charles-Henry). – Ce que
(ne) font (pas) les sociologues.
Petit essai d’épistémologie
critique.
Paris, Librairie Droz (Travaux de sciences
sociales, 187), 2000, 214 p., 34,30 €.
Il existe deux façons trop courantes
pour tout sociologue de douter de la
valeur et de la portée de sa discipline. La
première consiste à oublier que si la
sociologie remplit de multiples fonctions
– performative, philosophique, littéraire,
journalistique, etc. – ces dernières
demeurent secondaires au regard de sa
fonction proprement cognitive. La légiti-
mité scientifique de la sociologie n’est
pas à chercher ailleurs que dans sa capa-
cité, sous certaines conditions, à produire
une connaissance sur la réalité sociale. La
seconde consiste à juger de la validité de
ses résultats à l’aune de critères non pas
insuffisants, mais exorbitants. Adoptant
une vision trop absolue de la « Science »,
le sociologue condamne indirectement sa
discipline au statut de « proto-science »
au nom d’un idéal qu’ignorent pourtant
non seulement les autres sciences
humaines et sociales mais également les
diverses sciences de la matière de la vie.
Établi sur ce double constat du primat de
la fonction cognitive de la sociologie et
de la nécessaire reformulation d’une
vision « tempérée » de la scientificité,
l’ouvrage de C.-H. Cuin se présente
comme une invitation à la démarche
réflexive et critique. Le sociologue est-il
un scientifique comme un autre ? La
sociologie peut-elle prétendre au statut de
« science naturelle », et si oui selon
quelles modalités ? En s’appropriant ces
interrogations, l’auteur inscrit son « petit
essai » (mais dense par le contenu) dans
une tradition non pas simplement d’épis-
témologie des sciences sociales, mais
d’épistémologie au sens large. Et son but,
disons-le dès à présent, n’est pas
d’ajouter une voix à la sinistrose
ambiante – quoique partiellement
circonscrite – mais de donner des raisons
d’espérer. « Il n’est pas déraisonnable
620
Revue française de sociologie

[…], écrit-il (p. 18), d’imaginer que l’on
puisse parvenir en sociologie à des
connaissances et des savoirs ayant un
niveau de validité comparable à celui qui
caractérise dans les meilleurs cas celui
des sciences dites de la nature. »
L’ouvrage se divise, outre l’introduc-
tion et la conclusion, en deux grandes
parties. La première, intitulée « Les
sociologues et la sociologie ou ce que
font les sociologues », étudie la manière
dont les sociologues « pratiquent »
concrètement la sociologie et les diffi-
cultés qu’ils rencontrent. La seconde,
intitulée « La sociologie et les sociolo-
gues ou ce que ne font pas les sociolo-
gues », définit les orientations générales
susceptibles de contribuer à l’accroisse-
ment des « performances cognitives » de
la sociologie.
La première partie se structure autour
d’une distinction entre trois registres
constitutifs de l’activité sociologique :
empirique,interprétatif et théorique.
L’auteur se garde bien d’opposer un
registre à un autre (il affirme au contraire
l’existence d’un « continuum » entre ces
registres) mais utilise sa distinction
comme une voie analytique pour accéder
à la complexité de la pratique des socio-
logues.
La « vocation empirique » de la socio-
logie constitue son point de départ. C.-H.
Cuin ne se contente pas de rappeler la
manière dont de l’accumulation des
travaux destinés à mettre au jour des
« faits » a progressivement émergé un
ensemble de démarches instrumentées et
codifiées, mais il rend compte de la
diversité des enjeux propres à ce savoir-
faire. Les enjeux pratiques sont bien
connus : révéler des faits partiellement
connus ou totalement inconnus des
acteurs individuels ou institutionnels,
produire des ressources information-
nelles susceptibles d’aider ces derniers à
penser avec plus de rationalité l’élabora-
tion et la conduite de leurs projets. Si
cette recherche du fait et de l’information
a indéniablement contribué à accélérer la
reconnaissance de la sociologie, elle n’est
pour autant jamais sans risque de dérives.
Contrôlée, elle donne l’occasion au
sociologue de remplir une fonction épis-
témique émancipatrice en rectifiant les
connaissances inexactes à l’œuvre dans
les groupes sociaux. Elle suscite les
« questions » sans lesquelles aucune
connaissance ne pourrait exister et ce
faisant contribue à établir sur une base
positive, bien qu’instable parce que lour-
dement chargée d’historicité, les édifices
théoriques plus vastes. À l’inverse, livrée
à elle-même, elle transforme le socio-
logue en « sociographe » incapable
d’établir l’intelligence théorique des
produits de son activité comme de
réaliser l’autonomie de son discours par
rapport à celui des acteurs observés. De
ce point de vue, suggère l’auteur, si
nombre de sociologues contemporains
négligent la portée critique de leur
démarche, cela n’est pas sans rapport
avec « la vogue actuelle d’un programme
sociologique dont l’analyse des “repré-
sentations” sociales, voire des simples
“opinions”, constitue l’alpha et l’oméga
[…] » (p. 35).
Pour l’acteur comme pour le socio-
logue qui l’observe, il n’existe d’intelligi-
bilité de la réalité empirique sans inter-
prétation. Le chapitre 2 de l’ouvrage
propose l’analyse de ses deux formes
majeures en sociologie : explicative et
significative. C.-H. Cuin souligne,
concernant la première, la difficulté
rencontrée par certains sociologues pour
penser l’articulation des « schèmes inter-
prétatifs » et des « schèmes explicatifs ».
Les voies de l’interprétation sociologique
qui conduisent à la compréhension du
« pourquoi » d’un phénomène sont multi-
ples – et il n’y a rien à redire à une telle
pluralité. Qu’un phénomène soit inter-
prété selon un schème causal, fonc-
tionnel, structural, herméneutique, actan-
ciel ou encore dialectique « est
scientifiquement indifférent ». En
revanche le sociologue ne peut légitime-
ment se satisfaire de l’évidence subjec-
tive fournie par l’interprétation : il lui
621
Les livres

faut la transformer en évidence ration-
nelle en l’articulant avec un registre
proprement explicatif. La lecture critique
des travaux sociologiques classiques (il
faut ici signaler les commentaires très
informés des textes durkheimiens) et
contemporains (trop peu nombreux à
notre goût) à laquelle se livre l’auteur
révèle des cas fréquents d’interprétations
« sauvages » – signe à ses yeux de
l’« immaturité épistémologique relative »
de la discipline. Cette immaturité se
manifeste avec le plus d’éclat sans doute
dans l’usage par trop exclusif de l’une
des formes de l’interprétation significa-
tive : l’interprétation sémantique (par
opposition à l’interprétation sémiolo-
gique). L’auteur fustige avec vigueur les
« succès mondains » de ceux qui, postu-
lant que tout phénomène considéré
possède un « sens » intrinsèque, envisa-
gent toute réalité empirique à la manière
d’un « texte ». Leurs pratiques relevant
davantage de l’activité artistique que
scientifique, les produits qui en découlent
– « irrémédiablement infalsifiables et
indéfiniment invérifiables » – perdent,
sinon toute valeur d’échange, du moins
toute valeur cognitive. On pourra ici
toutefois regretter de voir l’auteur
engager sa critique de l’« intempérance
herméneutique » des sociologues, en ne
dissociant que trop tardivement le textua-
lisme à tonalité réaliste des uns du
recours purement méthodologique à une
« psychologie de convention » des autres.
Il faut attendre l’ultime note de chapitre
pour voir posée une distinction tranchée
entre « sociologie herméneutique »
comme méthode d’explication sans au-
delà probatoire d’un côté et « herméneu-
tique sociologique » comme démarche
d’invention en vue d’une compréhension
explicative de l’autre.
L’activité théorique des sociologues
(chapitre 3) passe tout autant par l’inven-
tion des concepts pour identifier les
phénomènes, celle de leur « mise en rela-
tion » explicative que par l’élaboration de
« cadres » généraux dans lesquels
concepts et relations s’intègrent. Ce
registre de l’activité sociologique appa-
raît sans doute comme le plus délicat. La
sociologie, rappelle C.-H. Cuin, a besoin
de concepts précis pour se réapproprier
tel ou tel aspect de la réalité. « Elle est en
mesure de répondre à des questions limi-
tées sur le monde empirique si l’on
accepte de la formaliser dans un langage
dont les rapports avec ce monde sont
intégralement déterminés par ses utilisa-
teurs. » (p. 192). Pour autant le socio-
logue doit-il, comme cela arrive parfois,
créer pour chaque étude un vocabulaire
inédit ? Faut-il plus encore qu’à cette
ardeur lexicale s’ajoute une sous-évalua-
tion de l’importance de l’opérationnalisa-
tion des concepts autrefois décrite par P.
Lazarsfeld ? Démultiplication inutile et
absence d’opérationnalisation entraînent
l’activité conceptuelle loin de sa vocation
de réduction de la diversité et de la
complexité du réel.
La tâche du sociologue consiste égale-
ment à produire des théories explicatives.
Dans certains domaines limités tels que
l’étude de la mobilité sociale, de la scola-
risation ou de l’action collective, il
obtient des résultats encourageants. Ces
domaines se caractérisent de fait par la
résolution positive d’un nombre croissant
d’énigmes ou encore l’élucidation
progressive de paradoxes théoriques.
Mais cette cumulativité ne parvient guère
à se généraliser. Trois raisons majeures
sont avancées par l’auteur pour expliquer
la faiblesse relative du progrès de la
connaissance sociologique : l’inadapta-
tion partielle d’un certain nombre de
domaines d’étude à la formalisation des
énoncés théoriques s’y rapportant ; la
confusion trop répandue entre théorie
explicative authentique et rationalisation
empirique à prétention théorique ; et pour
finir un goût immodéré d’un grand
nombre de sociologues pour un théori-
cisme les conduisant à concevoir l’élabo-
ration de « paradigmes » et « program-
mes de recherche » comme un but scien-
tifique plutôt que comme un simple
moyen en vue de produire des théories
de « niveau intermédiaire » selon
622
Revue française de sociologie

l’expression mertonienne.
Parvenu à ce stade de l’ouvrage, le
lecteur ne peut que s’interroger. Si le
constat établi durant la première partie
n’est pas purement négatif – un certain
nombre d’acquis paraissent indéniables –,
les faiblesses et dérives de la pratique
sociologique semblent avérées. D’où
vient dès lors l’optimisme affiché en
introduction par l’auteur quant au poten-
tiel scientifique de la sociologie ? Le
premier chapitre de la seconde partie
prend bien soin de préciser la nature de
ce potentiel. C.-H. Cuin y examine les
arguments généralement invoqués par les
sociologues pour démarquer la sociologie
des autres sciences : la complexité de son
objet, son historicité, le rapport épisté-
mique sujet-objet, etc. Il n’y a aucune
raison, affirme-t-il en substance, de
séparer la sociologie des autres sciences
au nom d’une conception illusoire de la
scientificité. Les sciences de la matière et
de la vie procèdent par réduction de la
complexité en substituant aux objets
empiriques des objets théoriques. Elles
subsument l’irrégularité du monde vécu
dans un certain nombre de principes
d’unité et de régularité. Elles réunissent
les conditions de décentration nécessaires
à l’appréhension scientifique de leurs
objets. Ce faisant elles ne font rien de
bien différent de ce dont est capable dans
le meilleur des cas la sociologie. Seul
pourra douter de cette évidence celui qui
confond tout à la fois objet empirique et
objet théorique, démarche sociologique
(orientée vers l’étude du général) et
démarche historiographique (orientée
vers l’étude du singulier) et néglige
l’explicitation des tenants axiologique de
l’entreprise sociologique autrefois décrite
par Weber sous le terme générique de
« rapports aux valeurs ».
Si le potentiel est bien là, quels sont
dès lors les obstacles à lever pour accé-
lérer la maturation épistémologique de la
sociologie et contribuer à étendre ces
« îlots de positivité » décrits dans la
première partie de l’ouvrage ? La réponse
de l’auteur tient en une phrase : les socio-
logues doivent s’affranchir tant de leur
« inhibition nomothétique » (chapitre 5)
que de leur « obsession compréhensive »
(chapitre 6). Commençons par ce dernier
point. Les sociologues développent
fréquemment leurs travaux à partir d’une
ontologie à la fois continuiste et réaliste
du social. Ils s’astreignent ce faisant à la
recherche de formulations théoriques
« totales » en vue de rendre compréhen-
sible, dans une perspective holiste ou
individualiste, l’essence même du social.
De telles recherches sur les « causes
ultimes » de la réalité ont été depuis long-
temps sinon abandonnées du moins relé-
guées par les sciences de la matière et de
la vie à un au-delà métaphysique. Les
sociologues feraient un grand pas en
avant s’ils substituaient à cette quête de
l’idéal une recherche plus « limitée »
certes, mais réalisable. Non seulement ils
ne feraient en cela rien de différent de
leurs collègues physiciens ou biologistes
mais se doteraient d’une vision plus
adéquate de la nature de l’entreprise
scientifique. Ceci nous conduit au second
point – l’inhibition nomothétique –
fondamental selon l’auteur. Le malen-
tendu autour de la notion de « loi » scien-
tifique constitue l’obstacle le plus direct à
la normalisation scientifique de la socio-
logie. La critique du « préjugé nomolo-
gique » (celle proposée notamment par
R. Boudon, La place du désordre) a été
de fait en grande partie intégrée par les
sociologues contemporains (notamment
en raison de ses implications déterministe
et naturaliste). Pourtant, et c’est là toute
la difficulté du problème, s’ils désirent
s’affranchir de l’« indexation de tout
résultat sur la spécificité irréductible d’un
phénomène singulier », ils n’ont d’autre
solution que d’élaborer des « régularités
empiriques » qui leur permettront de
« féconder » des matériaux empiriques.
L’auteur se livre ainsi à une relecture de
travaux sociologiques qualifiés de
« solides » pour mettre au jour la manière
dont les sociologues ont, en dépit de leurs
dénégations apparentes, renouvelé leur
conceptualisation des « régularités empi-
623
Les livres

riques ». Il accorde de ce point de vue
une place toute particulière aux succès
scientifiques de l’individualisme métho-
dologique et à son usage de la modélisa-
tion. Son argument est simple : il n’y a de
« gouffre épistémologique » entre notion
de « loi » et de « modèle » que si l’on
oublie qu’un modèle suppose une axio-
matique, c’est-à-dire un ensemble de
propositions qui, en permettant de
déduire certaines conséquences, « jouent
le rôle d’autant de lois relatives » (p. 138).
On perçoit dès lors la stratégie générale
de l’auteur pour « sauver » le principe de
légalité : d’une part prémunir la notion de
« loi » de toute interprétation réaliste afin
de s’affranchir de tout risque de dérive
déterministe et naturaliste, d’autre part
étendre considérablement son acception
ordinaire afin de réunir dans un même
« espace » épistémologique des régula-
rités conditionnelles de nature très
variées (contextualiste, possibiliste,
probabiliste, axiomatique, etc.). On
pourra toutefois ici s’étonner de ne
trouver une caractérisation précise de
cette acception « faible » de la « loi »
scientifique que dans les toutes dernières
pages de l’ouvrage, tout comme on
pourra regretter l’absence de discussion
des possibles conséquences d’un tel
« élargissement » de la légalité scienti-
fique sur l’appréhension de la spécificité
de la démarche sociologique au regard
des autres sciences.
Que ce soit au final par la finesse de
ses distinctions analytiques, la précision
de ses commentaires sur les textes classi-
ques de la sociologie, l’importance de sa
critique de l’ontologie réaliste-conti-
nuiste du social et de son plaidoyer en
faveur d’une sociologie cognitive, la
valeur de ce « petit essai » d’épistémo-
logie critique paraît établie. C.-H. Cuin
ne se contente pas de dresser le bilan
critique d’une discipline, de ses réussites
et de ses échecs – ce qui aurait déjà pu
être un objectif en soi. Il invite le lecteur
par ses propositions à ne pas se résigner à
assumer le statut de « minorité scienti-
fique » d’une discipline parfois trop
oublieuse de ses fonctions premières, et
ce faisant à venir à raison grossir les
rangs de ceux qui, comme lui,
« refuse[nt] que quiconque puisse en
appeler à la science pour justifier des
valeurs […] tout en étant convaincu[s]
que l’on ne “sert” bien que guidé par la
Raison ».
Michel Dubois
Gemas – CNRS – Université Paris IV
624
Revue française de sociologie
1
/
5
100%