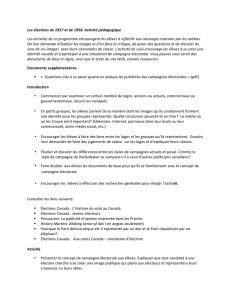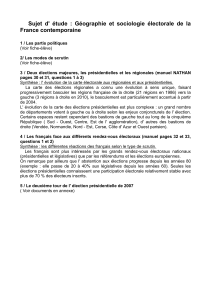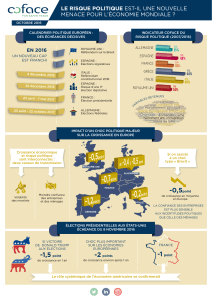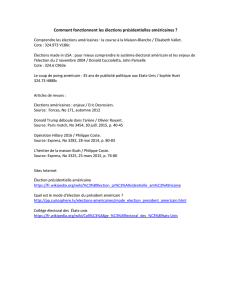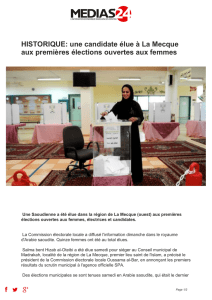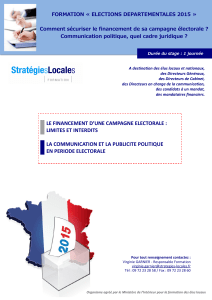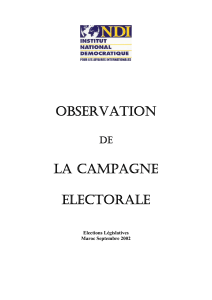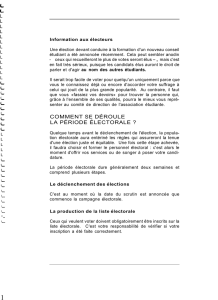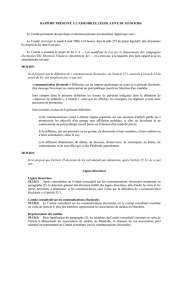Énoncé de politique L`aspect économique des élections

Énoncé de politique
Introduction
La Chambre de commerce du Canada favorise
l’établissement d’un environnement commercial
solide, concurrentiel et productif qui profi te
à tous les Canadiens. Ce document fait partie
d’une série d’études techniques indépendantes
portant sur les “principales questions de politique
gouvernementale auxquelles le Canada est confronté
à l’heure actuelle.
Nous espérons que cette analyse sensibilisera le
public à ces questions et aidera les décideurs à
faire des choix éclairés. Les études ne visent pas à
recommander des solutions politiques particulières,
mais plutôt à stimuler les discussions et les débats
publics sur les enjeux du pays.
Série sur la politique
économique commandité par:
1 Harris/Decima. « Canadians Say It’s Time for a Majority Government ». Le 12 juillet 2009.
Les Canadiens sont allés aux urnes trois fois
dans une élection fédérale générale depuis 2004
et, chaque fois, ils ont élu un gouvernement
minoritaire. «Les gouvernements minoritaires
des cinq dernières années semblent avoir incité
les gens à vouloir retourner aux gouvernements
majoritaires.»1 Dans un récent sondage de Harris/
Decima, 64 % des Canadiens préféraient l’option
majoritaire, tandis que 24 % favorisaient l’élection
d’un gouvernement minoritaire la prochaine
fois. Les Canadiens semblent fatigués d’aller
aux urnes.
Seulement 58,8 % des électeurs canadiens
admissibles ont voté lors de l’élection du 14
octobre 2008, le pourcentage le plus bas de
l’histoire. Lors de l’élection générale du 23
janvier 2006, 64,7 % des électeurs inscrits avaient
participé. La participation au scrutin a diminué
considérablement depuis 1988 après avoir atteint
environ 75 % entre 1945 et 1988 (voir le tableau
1). Le Canada n’est pas seul pays à affi cher cette
tendance. La participation électorale est en baisse
dans de nombreux pays industrialisés.
« La démocratie est fondée sur le droit des
citoyens de participer à la prise des décisions
qui les concernent et à la formulation des règles
Série sur la politique économique – Septembre 2009
L’aspect économique
des élections

2
La Chambre de Commerce du Canada
50
55
60
65
70
75
80
85
1867
1872
1874
1878
1882
1887
1891
1896
1900
1904
1908
1911
1917
1921
1925
1926
1930
1935
1940
1945
1949
1953
1957
1958
1962
1963
1965
1968
1972
1974
1979
1980
1984
1988
1993
1997
2000
2004
2006
2008
(%)
sociales auxquelles ils se soumettent. Ces droits
fondamentaux ne prennent tout leur sens que
lorsque les citoyens participent, le plus activement
possible, à la vie publique. Le vote est une
manifestation essentielle d’un tel engagement. »2
La baisse de la participation à des élections
successives est inquiétante pour la santé du système
politique démocratique – « pour le caractère
démocratique du mandat des gouvernements,
le type de candidats élus et même le type
d’enjeux examinés. »3
Ce document examine les forces qui éperonnent
la participation électorale – institutionnelles,
socioéconomiques et démographiques. À défaut
de comprendre ces facteurs, « le problème [de
la baisse de la participation électorale] pourrait
accabler le système politique pendant de longues
années. »4 Ce document explique aussi comment
les élections sont fi nancées au Canada.
Tableau 1 : Participation électorale aux élections générales fédérales
1867-2008
Source : Élections Canada; La Chambre de commerce du Canada
2 Élections Canada. « Les jeunes et les élections ». Perspectives électorales. Vol. 5, no 2 . Juillet 2003.
3 Élections Canada. « La problématique du déclin de la participation électorale chez les jeunes ». Perspectives électorales.
Vol. 5, no 2. Juillet 2003.
4 Idem.

3
La Chambre de Commerce du Canada
5 Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale-Appui institutionnel. www.idea.int
6 Voir, par exemple, Jackman (1987); Blais et Carty (1990); Blais et Dobrzynska (1998); Franklin (1996 et 2004); et Blais et
Aarts (2005).
7 Institut international pour la démocratie et l’assistance électorale. www.idea.int
8 L’Australian Electoral Commission écrit à tous les non-votants apparents leur demandant de donner la raison pour
laquelle ils n’ont pas voté ou de payer une amende de 20 dollars. Si dans les 21 jours suivants le non-votant apparent n’a
pas donné de raison valide et suffisante ou refuse de payer l’amende, des poursuites judiciaires peuvent être intentées. Si
l’affaire est traitée devant un tribunal et que la personne est déclarée coupable, on peut lui imposer une amende maximale
de 50 dollars, frais judiciaires en sus.
9 Howe, Paul et David Northrup. « Strengthening Canadian Democracy: The Views of Canadians ». Enjeux publics vol. 1, noo
5. Institut de recherche en politiques publiques. Juillet 2000.
10 Par contraste, le Canada a un système à majorité relative ou scrutin majoritaire uninominal ou circonscription majoritaire.
Le candidat qui obtient le plus de votes dans chaque circonscription électorale remporte un siège dans la Chambre
des communes.
La participation électorale varie considérablement
d’un pays à l’autre. En Australie, en Belgique, à
Chypre et à Singapour, par exemple, elle atteint
plus de 90 % en moyenne. Les pays d’Amérique
du Sud affi chent également des taux de
participation électorale relativement élevés – par
exemple, le Brésil 83,2 % (2006), le Chili 84,4 %
(2006), l’Argentine 73,1 % (2007) et le Pérou 88,7
% (2006). En Europe de l’Ouest, la participation
électorale est relativement faible – par exemple,
en France elle atteint 40,6 % (2009), en Allemagne
43,3 % (2009), au Royaume-Uni 61,4 % (2005) et
en Italie 65,1 % (2009)5. Aux États-Unis, on estime
que 61,6 % des électeurs inscrits ont déposé un
bulletin de vote lors de l’élection présidentielle
de 2008; ce pourcentage est semblable aux taux de
participation récents au Canada (58,8 % en 2008)
et au Mexique (58,9 % en 2006).
Un des principaux facteurs qui expliquent les
différences en matière de participation électorale à
l’échelle internationale est la votation obligatoire.
On estime que celle ci a augmenté la participation
électorale de 10 à 15 points de pourcentage et son
impact dépend de la mise à exécution.6
Le vote obligatoire existe dans 32 pays, dont 16
le mettent à exécution. Ce sont, notamment,
l’Australie, l’Argentine, la Belgique, le Brésil,
le Chili, Chypre, Singapour et la Turquie. Neuf
des 30 membres de l’OCDE ont mis en œuvre la
votation obligatoire7.
En Australie, par exemple, l’inscription obligatoire
des électeurs pour les élections fédérales a été mise
en œuvre en 1911. La Commonwealth Electoral Act
1918 énonce que tout électeur a le devoir de voter
à chaque élection. Par conséquent, la participation
électorale en Australie n’a jamais été inférieure à
90 %. En fait, elle a atteint 95,2 % lors de l’élection
générale de 20078.
Dans un sondage mené au Canada en 2000 par
l’Institut de recherche en politiques publiques, on
a demandé aux répondants ce qu’ils pensaient de
l’adoption d’une loi qui obligerait les citoyens à
voter sous peine d’une faible amende. La majorité
des Canadiens (73 %) a indiqué qu’elle s’opposait
à l’idée9.
Il est intéressant de constater que des recherches
empiriques ont constaté qu’il n’y a pas de
corrélation statistique entre la participation
électorale et le niveau d’alphabétisation, la
richesse (mesurée selon le PIB) ou la taille de la
population d’un pays.
Certaines études ont révélé que les pays ayant
un système de représentation proportionnelle
(RP) affi chent une participation électorale plus
élevée10. En vertu de la RP, la répartition des sièges
des assemblées législatives est proportionnelle à
la répartition des voix. Par exemple, si un parti
obtient 40 % du vote, il obtient 40 % des sièges.
Étant donné que presque chaque vote aide un
Différences de comportement électoral à
l’échelle internationale

4
La Chambre de Commerce du Canada
parti à gagner plus de sièges, les électeurs sont
plus encouragés à participer et les partis sont
incités à mobiliser leurs partisans11. En outre,
les nations ayant un système de RP tendent à
avoir une multitude de partis; plus le choix est
grand, plus les électeurs s’identifi ent à la plate
forme électorale d’un parti politique particulier.
Cependant, le système de RP accroît l’éventualité
de gouvernements de coalition. Il s’ensuit que les
électeurs participent peu à la composition fi nale
du gouvernement et peuvent être moins enclins
à voter. Ces deux effets contradictoires de la RP
s’équilibrent et l’impact net global de la RP sur la
congruence est nul12.
La fatigue des électeurs peut diminuer la
participation s’il y a plusieurs élections rapprochées
car le public sera fatigué de participer.
D’autre part, comme les enjeux et l’importance
de l’élection augmentent, plus de personnes sont
aptes à voter.13 Un bon exemple est l’élection
présidentielle américaine 2008. Dans un sondage
Gallup conduit juste avant le jour de l’élection,
74 % des Américains ont dit que le résultat de
l’élection 2008 leur a importé plus que dans les
années précédentes. L’investissement personnel
des électeurs dans le résultat a été souligné par les
résultats qui ont montré que 92 % des électeurs
enregistrés étaient d’accord avec le rapport
«les interest dans cette élection sont plus hauts
que dans des années precedents.»14 L’élection
présidentielle du novembre 2008 avait le plus
haut taux de participation dans 40 ans.
Enfi n, des facteurs liés au temps et au moment
de l’élection peuvent affecter la participation
électorale. Durant les fi ns de semaine et les
mois d’été, les gens s’intéressent moins au vote
ou s’absentent. Les nations qui ont des dates
d’élection fi xes ont tendance à tenir celles-ci au
milieu de la semaine au printemps ou à l’automne
pour maximiser la participation.
Les politicologues, les économistes et les
psychologues ont élaboré de nombreuses
théories à ce sujet. Un sens de devoir civique, une
préoccupation à l’égard du bien être des autres,
l’identifi cation solide à un parti et l’importance
perçue d’une élection infl uencent la décision
de participer.
Les facteurs socioéconomiques affectent
considérablement la participation électorale. Le
plus important de ceux-ci est le niveau de scolarité:
plus une personne est scolarisée, plus elle est apte
à voter. Les gens à l’aise fi nancièrement tendent
à voter, peu importe leur niveau de scolarité.
L’âge est également un important indicateur
prévisionnel de la participation électorale. Les
citoyens âgés sont beaucoup plus portés à voter
que les jeunes. En outre, les personnes mariées sont
plus aptes à voter que les célibataires. Les facteurs
comme l’ethnie, la race et le sexe semblent avoir
peu d’incidence sur la participation électorale
dans les démocraties de l’Ouest. L’occupation
Pourquoi les gens votent ils? –
Différences de comportement électoral
au niveau individuel
11 Richie, Robert et Steven Hill. « The Case for Proportional Representation ». Boston Review. Février mars 1998.
12 Blais, André et Marc André Bodet. « Does Proportional Representation Foster Closer Congruence Between Citizens and
Policymakers? » Université de Montréal. 2005.
13 Edlin, Aaron, Andrew Gelman et Noah Kaplan. « Voting as a Rational Choice: Why and How People Vote to Improve the
Well-being of Others. » Département de statistique. Université Columbia. Le 21 septembre 2005.
14 Gallup. « Voters Have High Personal Investment in Election Outcome. » Le 4 novembre 2008.

5
La Chambre de Commerce du Canada
15 Sigelman, Lee, Philip W. Roeder, Malcolm E. Jewell et Michael E. Baer. «Voting and Non-Voting: A Multi-Election
Perspective ». American Journal of Political Science, vol. 29, no 4. Pages 749-765. Novembre 1985.
16 Idem.
17 Fowler, James H. « Altruism and Turnout ». Journal of Politics. Vol. 68, noo 3. Pages 674–683. Août 2006.
18 Pammett, Jon H. et Lawrence LeDuc. « Explaining the Turnout Decline in Canadian Federal Elections: A New Survey of
Non-voters ». Élections Canada. Mars 2003.
a peu d’effet sur la participation; cependant, les
employés du secteur public sont plus portés à
voter que les travailleurs du secteur privé15.
Les personnes qui s’intéressent à la politique et
aux affaires publiques, et celles qui s’identifi ent
plus étroitement à un parti politique, sont plus
aptes à voter. Enfi n, les gens qui ont facilement
accès à un bureau de scrutin sont plus portés à
déposer un bulletin de vote16.
C’est l’interaction de ces deux facteurs qui
contribue fortement à la participation électorale17.
En 2003, Élections Canada a publié une étude18
fondée sur un sondage mené par Decima Research
pour découvrir pourquoi un nombre important
de Canadiens n’ont pas voté à l’élection fédérale
de 2000. L’agrégat des répondants a mentionné
les raisons suivantes : désintérêt, désengagement
et/ou apathie. Certains non-votants ne trouvaient
pas les candidats, les partis et/ou les questions
intéressants, tandis que d’autres ne faisaient
pas confi ance aux candidats, aux partis et/ou
aux questions.
Les non-participants plus jeunes, en particulier,
manifestaient un désintérêt ou indiquaient qu’ils
étaient trop occupés à cause de leur travail/
famille/études. Les non votants plus âgés
mentionnaient que des problèmes de santé et
l’éloignement de leur circonscription étaient les
principales raisons de leur non-participation;
venaient ensuite le manque de confi ance envers
les candidats, les partis et/ou les questions.
Ces constatations ont été confi rmées dans le
document « Report on the Evaluation of the 40th
General Election » publié par Élections Canada.
Dans un sondage qui a sous tendu ce rapport, les
Canadiens non-votants ont cité l’apathie (14%),
des vacances ou un voyage à l’extérieur de la
ville (16%), le fait d’être trop occupé (15 %) et une
aversion pour les candidats/partis politiques/
plate-formes (12%) comme leurs raisons
supérieures de ne pas participer à l’élection de
fédéral d’Octobre 2008.
Principaux motifs de non-participation
des Canadiens
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%