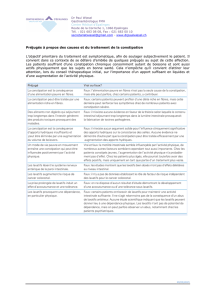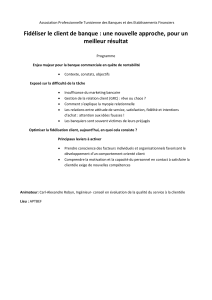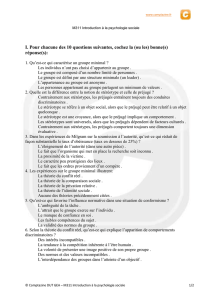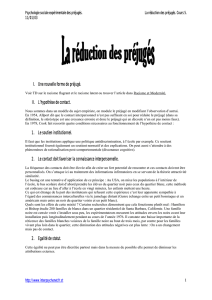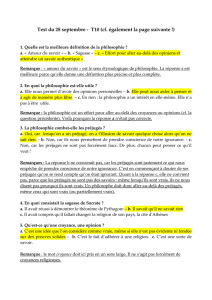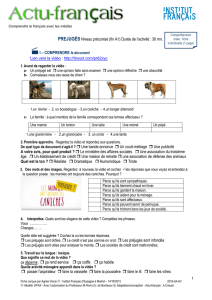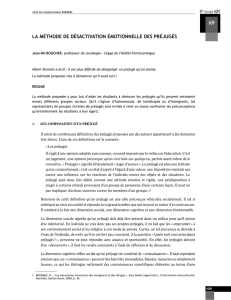Appartenance et distanciation dans la famille

1
Appartenance et distanciation
dans la famille
1
Mathieu Scraire
Mon point de départ sera le constat d’une certaine suspicion qui existe dans
l’espace public face à la capacité de la famille de former des individus tolérants et
ouverts aux autres, capable de « vivre-ensemble », constat qui me semble évident
lorsqu’on est le moindrement attentif aux débats en France comme au Québec au sujet
de l’enseignement de la morale à l’école. Ma question directrice sera la suivante : Doit-
on « arracher » l’enfant à ses « déterminismes familiaux » pour le « socialiser » ? En
d’autres termes, la condition concrète et déterminée de la famille doit-elle être
considérée comme un obstacle ou un frein à la vie sociale de l’enfant et, par
conséquent, au vivre-ensemble ? La nécessaire distanciation d’avec le terreau familial,
qui consiste en l’apprentissage de l’autonomie, est-elle de l’ordre de la rupture ou de
l’accomplissement ? Je commencerai par aborder un concept qui m’apparaît dominant
dans les débats, soit un certain idéal de « neutralité » dans la formation morale de
l’enfant, en l’opposant aux préjugés ou aux déterminismes reçus dans la famille, puis en
mettant en lumière une vision « positive » ou féconde des préjugés, pour enfin discuter
de la responsabilité de la famille à l’égard des préjugés qu’elle transmet
nécessairement. Donc le maître-concept sera ici celui du préjugé.
1
Communication donnée dans le cadre du IXe Colloque annuel de philosophie de la Communauté Saint-
Jean sous le thème « La famille et la culture de la rencontre », Terrebonne, Québec, le 09-02-15.

2
1. L’idéal de neutralité dans la formation morale de l’enfant
Une idée populaire chez les législateurs, en France comme au Québec, consiste à
dire que l’enseignement de l’éthique ou de la morale à l’école doit favoriser la liberté
par rapport aux « déterminismes » implantés dans le terreau familial. Si j’ai bien suivi, la
France s’apprête, si ce n’est déjà fait, à implanter un cours de « morale laïque », à raison
d’une heure par semaine
2
, ce qui serait une nouveauté par rapport au cours
d’instruction civique qui se donnait jusqu’à présent. Il s’agit plus ou moins du même
mouvement qui a vu naître ici le cours d’éthique et culture religieuse : on sent que les
finalités sont les mêmes.
L’ancien ministre de l’éducation nationale, M. Vincent Peillon, qui est agrégé de
philosophie, a fait couler beaucoup d’encre avec son mot fameux, dans L’Express du 2
septembre 2012, visant à expliquer ce qu’est la « morale laïque » : « [L]e but de la
morale laïque est d'arracher l'élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social,
intellectuel »
3
. Cet objectif est encore précisé dans son livre-programme Refondons
l’école (2013) :
Dans notre tradition républicaine, il appartient à l’école non seulement de produire un individu
libre, émancipé de toutes les tutelles – politiques, religieuses, familiales, sociales – capable de
construire ses choix par lui-même, autonome, épanoui et heureux, mais aussi d’éduquer le
citoyen éclairé d’une République démocratique, juste et fraternelle
4
.
2
Voir Libération du 22-04-13. En ligne. URL http ://www.liberation.fr/societe/2013/04/22/peillon-
confirme-des-cours-de-morale-laique-a-partir-de-2015_898019. Consulté le 07-02-2015.
3
L’Express du 02-09-2012. En ligne. URL <http://www.lexpress.fr/actualite/politique/vincent-peillon-pour-
l-enseignement-de-la-morale-laique_1155535.html>. Consulté le 07-02-15.
4
V. Peillon, Refondons l’école, Paris, Seuil, 2013, p. 12.

3
Je suis assez confiant que nous nous entendons pour dire qu’éduquer un enfant,
c’est en grande partie lui donner les ressources nécessaires pour qu’il devienne
éventuellement autonome. Or l’apprentissage de la liberté, ou de l’autonomie, suppose
ici une rupture forte avec les « déterminismes », voire les « tutelles », transmis
notamment dans la famille. Ce que le ministre appelle déterminisme ou tutelle, on peut
en un sens large l’appeler préjugé. C’est un terme fort, avec une connotation fortement
négative. C’est que les préjugés sont censés limiter et fermer notre compréhension ou
notre ouverture aux autres. Pour le montrer, commençons par définir le préjugé et voir
comment cette notion s’applique ici. La définition classique du préjugé est celle d’un
jugement préalable avant l’examen. On pourrait dire, un jugement porté avant d’avoir
en main tous les éléments pertinents nous permettant un jugement « définitif » et
éclairé sur telle ou telle question. S’en tenir à des préjugés, c’est en un sens être
prisonnier des idées reçues. Or si les préjugés ont un caractère négatif, c’est parce qu’on
leur attache la notion de préjudice au sens d’un tort, d’un dommage causé à quelqu’un.
Les critiques du profilage racial, par exemple, argumentent qu’un tort est causé à une
personne avant même de savoir si elle est coupable de quoi que ce soit, en raison d’un
jugement préalable porté sur son appartenance à une race. Les féministes argumentent
que certains contes, certaines coutumes (le bleu et le rose, les camions et les poupées…)
par exemple, perpétuent des stéréotypes sur les rôles masculins et féminins qui nous
enfermeraient dans un carcan trop serré en discréditant par avance certaines
expressions moins traditionnelles de ces rôles : le père qui se prévaut du congé parental
pour s’occuper des enfants alors que c’est la mère qui travaille, par exemple.

4
Or la famille n’est jamais sans transmettre de préjugés. Parce qu’elle transmet
un bagage culturel, moral, religieux, politique, elle transmet du coup des jugements
préalables dont la portée s’étend beaucoup trop profondément pour prétendre que
l’enfant se les approprie au moins d’un examen critique rigoureux. Et les préjugés ont ici
comme caractéristique qu’ils empêchent de reconnaître l’autre comme autre, donc qu’ils
empêchent ou entravent l’accueil bienveillant de l’autre. Or, comme la famille transmet
un bagage de préjugés, n’est-il pas juste de dire que la famille entrave, alors qu’elle
devrait plutôt favoriser, la capacité de l’enfant à faire preuve d’ouverture et de respect
des autres ? Donc que l’État, soucieux de favoriser l’éducation de citoyens libres et
ouverts aux autres, doive faire contrepoids aux déterminismes familiaux en favorisant
l’élimination des préjugés, c’est-à-dire de tout ce bagage que reçoit l’enfant dans sa
famille ? Dit simplement, l’État doit-il favoriser la rupture entre l’individu et son terreau
familial ?
2. Une autre perspective sur les préjugés
Or cette vision suppose un certain idéal de « neutralité », c’est-à-dire qu’une
certaine neutralité par rapport aux préjugés soit possible. Cet idéal est celui de la
philosophie des Lumières, qui imprègne encore fortement les esprits dans le débat qui
nous concerne. L’idéal serait de former des individus neutres par rapport à tout préjugé,
au sens où ils se seraient élevés au niveau d’une rationalité « transparente » et par là,
seraient alors en mesure de faire des choix éclairés. Mais une telle neutralité est-elle
seulement possible, voire souhaitable ? H.-G. Gadamer a un peu révolutionné la

5
philosophie au XXe siècle en proposant une vision « positive » des préjugés. Sa thèse à
cet égard est double : Tout d’abord, selon lui, nous ne serions jamais sans préjugés.
C’est ce que Gadamer appelle l’appartenance. Il a eu ce mot fameux : ce n’est pas
l’histoire qui nous appartient, c’est nous qui lui appartenons
5
. Ce qu’il veut dire, c’est
que les préjugés forment ce que nous sommes à un niveau que la réflexion consciente,
rationnelle, ne pourra jamais totalement élucider. Pour comprendre cela, il faut voir les
préjugés en un sens un peu plus large que le sens commun. Prenons le cas exemplaire
du langage : apprendre à parler, c’est apprendre une langue déterminée. Or une langue
est bien plus qu’un outil qui serait à notre disposition pour communiquer : parce que les
mots nous mettent en contact avec la réalité, la langue est à la fois l’expression et le
terreau où s’enracine notre compréhension du monde que nous cherchons à connaître
et où nous cherchons à nous y retrouver. Mais la langue est l’expression d’une culture;
elle est enracinée dans l’histoire; elle est modelée par des idées qui ont pris forme en
son sein et qui l’ont modifiée de l’intérieur; elle est fécondée et modifiée par l’histoire
de la philosophie, de la théologie, de la science, du droit, dont elle est imprégnée de
part en part, et par l’usage courant que des sociétés déterminées en font; elle est le
dépositaire de visions du monde. En un mot, la langue est en elle-même une
transmission de « préjugés », c’est-à-dire ici de couches de sens ancrés beaucoup trop
profondément pour qu’une conscience éclairée puisse prétendre les mettre au jour.
C’est ce que Gadamer appelle l’enracinement langagier de la compréhension.
5
Cf. Hans-Georg Gadamer, Vérité et méthode, Paris, Seuil, 1996, p. 298.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%