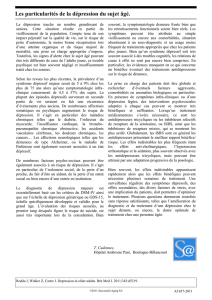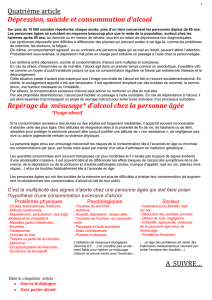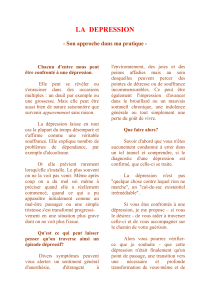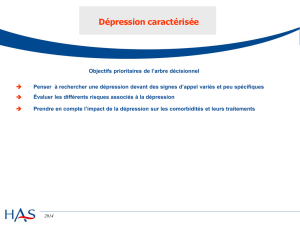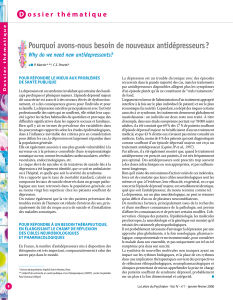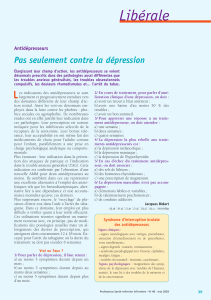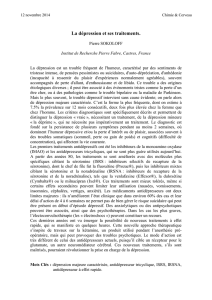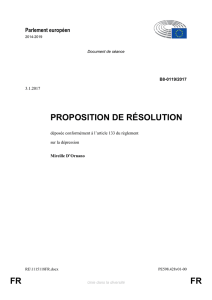Prise en charge de la dépression de la

La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°6
JUIN 2003
507
ENSEIGNEMENT
Prise en char
ge de la dépr
ession
de la personne âgée
Depr
ession management in the elderly adult
Michèle MICAS, Christophe ARBUS, Fati NOURHASHEMI, Bruno VELLAS
Médecine Inter
ne et Gér
ontologie Clinique
Ser
v
ice d
e
Ps
y
ch ia t ri
e
e
t
P s
y
c ho lo gi
e
Mé di
c
a
l
e , Hô pi
t
a l La Gra
v
e -
Casselar
dit, 170 avenue de Casselar
dit, 31059 T
oulouse Cedex 9, France.
Auteur corr
espondant : Michèle Micas, Service Inter
ne et Gér
ontologie
Clinique. Hôpital La Grave - Casselar
dit, 170 avenue de Casselar
dit, 31059
T
oulouse Cedex 9, France. E-mail: [email protected]
Article r
eçu le 14.04.2003 - Accepté le 25.04.2003.
L
e traitement de la dépr
ession de la personn
âgée r
elève des mêmes principes que celui des
adultes jeunes. T
outefois, comme il existe insuf
-
fisamment d'études sur l’ef
ficacité des antidépr
esseurs
ou des prises en char
ge non médicamenteuses dans
cette population d’âgés ou de vieux-vieux, ceci doit inci
-
ter au r
espect de règles de prudence, compte tenu des
spécificités et dans certains cas de la fragilité des per
-
sonnes âgées. D’autr
e part, la dépr
ession du sujet âgé
peut altér
er rapidement la qualité de vie et s’accompa
-
gner de morbidité plus élevée que d’autr
es pathologies
chr
oniques. Les conséquences sur l’autonomie peuvent
conduir
e vers un pr
onostic sévèr
e à court ter
me. Un
taux de réponses positives de 50 à 65% serait obtenu à
la suite d’un traitement par antidépr
esseur tandis que, si
la prise en char
ge est globale et adaptée, compr
enant
un traitement médicamenteux, un soutien psychothéra
-
pique et une adéquation du milieu de vie, les résultats
pourraient êtr
e sensiblement améliorés.
Un des challenges est d’identifier un état dépr
essif
c h e z
une personn
e
âgée, il est souvent très difficile
de ne ni
s o u s - e s t i m e r
, ni surestimer l’existence de sy
m
ptô
m
es
d é p r
essifs justifiant d’un traite
m
ent : Si la personne
âgée
verbalise peu sa souf
france morale, si les plaintes soma
-
tiques sont au pr
emier plan ou bien la dépr
ession est
concomitante d’autr
es pathologies, l'importance d’un
traitement peut ne pas êtr
e au pr
emier plan. Par ailleurs
le r
etentissement sur la qualité de vie peut êtr
e r
econnu
et même solutionné par les services sociaux sans que la
dépr
ession ne soit évoquée et traitée, avec le risque de
passage à un état chr
onique. Enfin un des pr
oblèmes les
plus dif
ficiles est celui du diagnostic concomitant de
démence et dépr
ession, où l’utilisation de critèr
es de
dépr
ession spécifiques à la Maladie d’Alzheimer pour
-
raient êtr
e importante (Olin).
Pour l’ensemble de ces raisons, il est r
econnu que seul
un tiers des patients déprimés r
ecevraient une prise en
char
ge adaptée. Un avis spécialisé est utile, quand le
diagnostic et la décision thérapeutique sont incertaines,
pour les patients ayant une maladie psychiatrique
concomitante, des idées suicidair
es et un risque de pas
-
sage à l’acte, un r
efus de soins et/ ou d’alimentation
une dépr
ession sévèr
e ou répondant mal aux antidé
-
pr
esseurs.
Le traite
m
ent se doit, com
m
e souvent en gériatrie d'être
utile, plus qu'efficace. Ceci implique une rapidité de déci-
sion thérapeutique, une coordination multidisciplinair
e ,
l'élaboration d'un projet d'aide global. Les thérapeutiques
c o m p r
ennent les traite
m
ents chimiques, l'électr
o c o n v u l
-
sivo
t
hérapie, les psychothérapies et la pri
se en char
ge

Mise en place d’un traitement antidépr
esseur
1-
Décider d’une pr
escription
Au ter
me d’une démar
che diagnostique cohér
ente, tous
les états dépr
essifs de la personne âgée devraient béné
-
ficier d’un traitement antidépr
esseur
. A
vant la pr
escrip
-
tion il importe de s’assur
er des contr
e-indications par
l’examen des fonctions rénale et hépatique et un bilan
car
diaque.
Par ailleurs il existe des tableaux diagnostiques com
-
plexes qui r
endent la décision de pr
escrire difficile :
- Chez le patient dément,
détecter un syndr
ome
dépr
essif au moment où le sujet pourrait bénéficier d’un
traitement antidépr
esseur peut ne pas êtr
e simple.
- Chez le patient vasculair
e :
devant une dépr
ession de
l’âgé le médecin doit évaluer les facteurs de risque vas
-
culair
es (hypertension, hyper
glycémie, hyper
cholestér
o-
lémie, tabagisme, inactivité physique. Le traitement de
la dépr
ession devra pr
endr
e en compte un contrôle
optimal de ces facteurs. En ef
fet les lésions micr
ovascu
-
lair
es de la substance blanche fr
ontale et sous-corticale
sont r
esponsables de symptômes dépr
essifs.
- Chez les aidants de patients Alzheimer :
Le risque
de dépr
ession par épuisement chez les aidants nécessi
-
te d’évaluer régulièr
ement les capacités à fair
e face et
les traitements éventuels à mettr
e en place.
- La dépr
ession de fin de vie des patients âgés.
La
détr
esse, le découragement, les idées de mort sont tel
-
lement explicables qu’elles ne sont pas toujours rappor
-
tées à un état dépr
essif et donc traitées. En phase ter
-
minale les IRSS peuvent participer du confort de vie,
l’accompagnement psychologique fait partie du pr
oces
-
sus de soin.
- La dépr
ession subsyndr
omique :
le pr
oblème de trai
-
ter ou pas se pose devant l’existence de quelques signes
dépr
essifs. L’ef
ficacité des antidépr
esseurs n’a pas été
suf
fisamment étudiée dans ce cadr
e là pour pouvoir éla
-
bor
er des conduites thérapeutiques. Certains travaux
montr
ent que ces patients sont à risque de développer
un authentique épisode dépr
essif, d’où l’importance de
régulièr
ement les suivr
e et évaluer leur état thymique,
les conseils sociaux et envir
onnementaux tr
ouvent là
toute leur place. L’indication d’une prise en char
ge
psychologique peut êtr
e pr
oposée.
2-
Infor
mer le patient et son entourage
La qualité de la r
elation médecin- patient est essentielle
dans la prise en char
ge d'un patient âgé déprimé.
L’alliance thérapeutique, base r
elationnelle indispensa
-
ble entr
e le sujet jeune et le médecin, doit êtr
e r
echer
-
chée. C'est sur cette notion d'accompagnement psycho
-
logique attentif de la pr
escription médicamenteuse qu'il
faut insister ; la voie est étr
oite pour le patient (et quel
-
quefois pour son médecin) entr
e une médicalisation
Prise en char
ge de la dépr
ession de la personne âgée
psychosociale. La dif
ficulté étant la poly médication des
patients âgés, le caractèr
e dépr
essogène de certaines
molécules et le risque augmenté d'interactions entr
e les
médicaments.
Les objectifs du traitement selon le National Institute on
Aging(1993),
(tableau 1)
sont de diminuer les symptô
-
mes de la dépr
ession, réduir
e le risque de r
echutes et de
récidives, amélior
er la qualité de vie, amélior
er l'état de
santé, diminuer les coûts de santé et la mortalité.
Plusieurs points sont à considér
er avant l’instauration du
traitement et pendant la période de suivi : Quels
patients traiter ? Quels examens préalables réaliser ?
Quelles contr
e-indications? Comment choisir et condui
-
r
e le traitement ? Comment en évaluer l’ef
ficacité ?
Sans oublier d’infor
mer le patient de son état et des trai
-
tements envisagés et des bénéfices escomptés, ce der
-
nier point r
elève de la dimension éthique de tout soin
gériatrique.
TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
______________
Classes phar
macologiques
La biologie de la dépr
ession majeur
e r
epose sur l’hypo
-
thèse, depuis longtemps étayée, d’une déplétion en
neur
otransmetteurs monoaminer
giques. Les axes de
r
echer
che pr
oposent d’autr
es mécanismes et en parti
-
culier des interactions très importantes avec les autr
es
systèmes neur
obiochimiques, ce qui pourrait êtr
e une
explication de la grande hétér
ogénéité clinique des
dépr
essions. Les molécules actuellement disponibles
sont les imipraminiques et appar
entés, les inhibiteurs
sélectifs de la r
ecaptur
e de la sér
otonine (ISRS), les inhi
-
biteurs sélectifs de la r
ecaptur
e de la sér
otonine et de la
noradrénaline (ISRSNA). Citons également les inhibi
-
teurs de la mono-amine oxydase (IMAO) sélectifs ou
non et les autr
es antidépr
esseurs non imipraminiques -
non-IMAO.
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°6
JUIN 2003
508
T
ableau 1 : Les objectifs du traitement (NIA).
T
able 1 : The objectives of tr
eatment.
• Diminuer les synptômes de la dépr
ession
•
Réduir
e le risque de r
echutes et de récidives
•
Amélior
er la qualité de vie
•
Amélior
er l’état de santé

Prise en char
ge de la dépr
ession de la personne âgée
excessive de la dépr
ession et la banalisation de la prise
de psychotr
opes.
Cette infor
mation sur le traitement englobe les bénéfi
-
ces attendus du traitement, le délai d’action qui peut
êtr
e allongé au delà de quatr
e semaines compte tenu de
l’âge ainsi que les potentiels ef
fets indésirables; tous les
symptômes peuvent ne pas s'amender simultanément:
le patient peut subjectivement ne pas r
essentir une amé
-
lioration alors que dans un pr
emier temps, d’autr
es
symptômes tels que le sommeil, l’appétit, la r
eprise des
activités peuvent s’amélior
er
. Ceci souligne la nécessité
d’un rapport objectif par l’entourage.
3-
Initiation et surveillance d’un traitement antidé
-
pr
esseur
T
outes les classes d'antidépr
esseurs ayant démontrées
une ef
ficacité équivalente et ce dans 60% des cas, le
choix d'une molécule se fera selon des critèr
es de tolé
-
rance et de risque d'ef
fets délétèr
es minimum. En pr
e-
mièr
e intention que ce soit en ambulatoir
e, en service
gériatrique ou en milieu spécialisé, la pr
escription
d'IRSS ou IRSS/NA
(tableau 2)
est pertinente, en rai
-
son de leur faible car
diotoxicité, et de leur bonne mania
-
bilité, le choix devant tenir compte de la demi-vie et des
métabolites actifs
(tableau 2)
.
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°6
JUIN 2003
510
T
ableau 2 : Antidépr
esseurs IRSS IRSS/NA.
T
able 2 : The antidepr
essants : SSRI SSRI/NA.
D.C.I
spécialité
posologie(mg/j)
demi-vie
fluvoxamine
floxyfral
100 à 300
15h
par
oxétine
der
oxat
20 à 40
24h
sertraline
zoloft
50 à 200
26h
citalopram
ser
opram
20 à 60
33h
fluoxétine
pr
ozac
20 à 60
24 à 96h
mirtapazine
norset
30 à 45
30h
venlafaxine
ef
fexor
150 à 300
5h
milnacipram
ixel
50 à 100
8h
La posologie d’initiation peut êtr
e la même que chez l’a
-
dulte. Dans certains cas chez le sujet âgé fragile notam
-
ment il est concevable d’initier une dose minimale avec
une augmentation pr
ogr
essive guidée par la tolérance et
l’ef
ficacité ou selon les r
ecommandations du “PRO
-
SPECT Gr
oup” 0 : par exemple avec le citalopram
10mg le pr
emier jour puis 20mg les 6 jours suivants et
30mg à partir du huitième jour
.
Les antidépr
esseurs imipraminiques sont employés en
cas d’échec des autr
es traitements antidépr
esseurs ou
s’il s’agit d’une dépr
ession résistante ou de type mélan
-
colique. Ils ont également leur indication lors de traite
-
ment antérieur satisfaisant avec ces molécules et r
estent
les molécules de référ
ence en cas de dépr
ession sévèr
e.
Leur action anticholiner
gique doit fair
e r
edouter leurs
ef
fets sédatifs et car
dio-vasculair
es, le risque confusogè
-
ne, majeur surtout en cas de pathologie dégénérative de
type Alzheimer
. Leur pr
escription nécessite le plus sou
-
vent un avis spécialisé. Les inhibiteurs de la
m
onoa
m
ine
oxydase (IMAO) ont fait la pr
euve de leur ef
ficacité. Le
risque d’interaction alimentair
e et médicamenteuse est
considérablement réduit avec les IMAO-A.
Dans la majorité des cas, il va s’agir d’une monothéra
-
pie antidépressive, c
e
pendant si la composante anxieuse
est majeur
e ou si les tr
oubles du sommeil sont invali
-
dants une co-pr
escription symptomatique est justifiée.
Les ef
fets secondair
es sont moindr
es avec les IRSS et
les IRSS/NA qu’avec les antidépr
esseurs imiprami
-
niques. Ils peuvent êtr
e prévenus ou diminués en utili
-
sant la dose minimale et augmentant, si nécessair
e la
posologie après au moins deux semaines après la mise
en r
oute. Les IRSS, ayant peu d’af
finités pour les récep
-
teurs choliner
giques, ils ont peu d’ef
fets anticholiner
-
giques à l’exception de la par
oxétine ou le risque est
cependant modéré. Ces ef
fets secondair
es ne sont pas
négligeables :
1. Digestifs, à type de nausées, anor
exie, diarr
hée sont
particulièr
ement à surveiller chez la personne âgée à
risque de dénutrition; si ces ef
fets persistent après 4 à 5
jours le choix thérapeutique est à r
econsidér
er.
2. Les sensations d’irritabilité, les tr
emblements, l'agita
-
tion, l'insomnie sont également à surveiller
.
Le syndr
ome sér
otoniner
gique est rar
e mais doit êtr
e
bien connu: Il survient en cas de pr
escription concomi
-
tante de IMAO +TCA, de neur
oleptiques, de lithium,
de buspir
one, de ECT
. Il compr
end :
1. Des signes et symptômes psychologiques et compor
-
tementaux à type d’agitation, confusion, incoor
dina
-
tion, hypomanie, crises comitiales possibles, coma.
2. Des modifications du tonus musculair
e à type de
m
yoclonies, tre
m
ble
m
ent, frisson, rigidité, hyperré-
flexie.
3. Une dysrégulation du système autonome: hyperten
-
sion, hypotension, tachycar
die, sueurs, diarr
hée.
Le traitement du syndr
ome sér
otoniner
gique comporte
l’arrêt immédiat du pr
oduit en cause et deux actions de
prévention : prévenir l’hyperther
mie : (per
fusion, cou
-
vertur
es fr
oides, myor
elaxant majeur) prévenir les crises
comitiales (sédatifs, anticonvulsivants, assistance r
espi-
ratoir
e rar
ement).
- Les perturbations électr
olytiques: les IRS peuvent
entraîner une hyponatrémie, la prudence est r
ecom
-

mandée en cas d’administration concomitante de diuré
-
tique.
- Les cytochr
omes P450 assurant plus de 90% du
méta
bolis
m
e oxydatif des médicaments, leur action
i n d u c t r i c e
ou inhibitrice augmentent ou réduisent l’ef
fet
du traitement ; cependant les conséquences en clinique
sont très variables et mal connues. L’inhibition enzyma
-
tique hépatique entraîne un risque d’interactions avec
les tricycliques, les anticonvulsivants, les antipsycho
-
tiques, les benzodiazépines. La règle étant de réaliser
une fenêtr
e thérapeutique.
4-
Durée du traitement
La durée du traitement est identique quelle que soit la
molécule utilisée.
Classiquement il existe tr
ois phases dans un traitement
par antidépr
esseur
(tableau 3)
:
- Une phase de traitement
aigu qui corr
espond au
temps de rémission des symptômes. La pr
escription du
traitement antidépr
esseur
, s'il s'agit d'un pr
emier épiso
-
de, doit êtr
e maintenue au minimum 4 mois après l'ar
-
rêt de la symptomatologie.
- Une phase de consolidation
pour éviter un risque de
r
echutes. La durée théorique se situant entr
e six et
douze mois. S'il s'agit d'un pr
emier épisode la diminu
-
tion des doses avant l’arrêt définitif, va êtr
e pr
ogr
essive
sur tr
ois semaines envir
on.
- Une phase pr
ophylactique
une période de traite
-
ments préventif des récidives chez les patients à risques
( épisodes antérieurs,) S'il s'agit d’une for
me récurr
ente
ou d’une dysthymie le traitement doit êtr
e poursuivi
pendant une période plus longue. L’arrêt prématuré du
traitement expose à des taux de réponses positifs moins
importants et à des risques de r
echute. le but étant de
réduir
e le risque de r
echutes, la durée du traitement
peut êtr
e évaluée à la durée équivalente des deux cycles
antérieurs ; mais ces données sont valables chez l' adul
-
te et peu de travaux sont disponibles chez la personne
âgée. Un traitement au long cours peut s’envisager pour
les patients âgés ayant présenté plus de tr
ois épisodes
dépr
essifs et ce sans diminuer la dose d’ef
ficacité. Ces
traitements durables s’entendent pour un tr
ouble de
l’humeur authentifié et sont en moyenne de 2 à 4 ans.
En cas de décision de traiter un patient présentant une
dépr
ession subsyndr
omique ou dépr
ession légèr
e aucun
ar
gument ne vient étayer la justification et le bien-fondé
des traitements dans cette indication et a fortiori il
n’existe aucun consensus per
mettant de pr
oposer une
durée optimale de traitement.
5-
Evaluer les résultats
L’ef
ficacité d’un traitement antidépr
esseur s’apprécie
sur les dif
fér
ents symptômes présentés en début de trai
-
tement, sur la r
eprise des activités, la modification du
r
etentissement somatique (sommeil, nutrition). l’appré
-
ciation objective faite par l’entourage, le discours de la
personne âgée, l’entourage et - l’impr
ession clinique- du
médecin. Si une échelle de dépr
ession a été utilisée
avant la mise en place du traitement, l’ef
ficacité s’ap
-
précie en comparatif sur une baisse du scor
e de 50% en
moyenne par rapport au scor
e initial.
En pratique clinique les dosages plasmatiques sont peu
utiles pour apprécier l’ef
ficacité de la posologie.
Si une amélioration est constatée la question de la durée
du traitement se posera. Dans le cas contrair
e ou en
présence d’une aggravation, un changement de molé
-
cule peut s’envisager
, mais la décision d’une hospitali
-
sation doit êtr
e réfléchie, surtout en présence d’ idées
suicidair
es et en cas de conséquences somatiques (tr
ou-
bles nutritionnels par exemple)
(tableau 4)
.
Prise en char
ge de la dépr
ession de la personne âgée
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°6
JUIN 2003
511
Tabl
e
au
3
: Etats d
é
pr
e
ssifs de l’âg
é
: s ché
m
a théra
p
eu-
tique.
T
able 3 : Depr
essive states in the elderly adult : a therapeutic plan.
- phase aigue: 4 mois
- phase de consolidation: (maintenance)
1er épisode : pr
ogr
essive (6 à 12mois)
épisodes récurr
ents : - bipolair
e >1an
- dysthymique : pas de concensus
- phase pr
ophylactique :
durée équivalente à 2 cycles : pas de concensus
T
ableau 4 : Les indications de l’hospitalisation.
T
able 4 : Indications for hospitalisation.
•
Evaluation diagnostique
•
Prévenir les risques de dénutrition les complications sociales
•
En cas de risque suicidair
e
•
T
raitement par voie veineuse périphérique
•
Electr
oconvulsivothérapie
ELECTROCONVULSIVOTHÉRAPIE (ECT)
OU SISMOTHÉRAPIE
__________________________
La sismothérapie peut êtr
e indiquée en cas de dépr
es-
sion majeur
e (avec risque suicidair
e et/ou composante
psychotique), ou bien en cas de dépr
ession résistant aux
traitements phar
macologiques. Plus rar
ement, la déci
-
sion d’ECT peut êtr
e prise en pr
emièr
e intention s'il
existe un risque vital à court ter
me ou lorsque l'état de
santé d'un patient est incompatible avec l'utilisation tout

Prise en char
ge de la dépr
ession de la personne âgée
La Revue de Gériatrie, T
ome 28, N°6
JUIN 2003
512
autr
e thérapeutique. L’ef
ficacité de l’ECT est rapide
-
ment observée. La tolérance est bonne et son utilisation
comporte peu de risques chez la personne âgée, même
si le risque de syndr
ome confusionnel post critique sem
-
ble plus élevé que chez le sujet jeune. Une des indica
-
tions potentiellement intér
essante est la dépr
ession chez
le dément, mais il n'existe que des études sur un petit
nombr
e de cas qui ne per
mettent pas d’établir des
règles de conduite dans ce domaine. Le nombr
e de
séances d’ECT nécessair
es varie de 6 à 12 séances,
avec une fréquence moyenne de 3 fois par semaines.
AUTRES TYPES DE PRISE EN CHARGE
_______
Les traitements biologiques ne peuvent pas résoudr
e
toutes les composantes associées à la dépr
ession. T
out
un ensemble de stratégies d’aides psychosociales sont
nécessair
es et éventuellement des prises en char
ge
psychothérapiques. Même si le clinicien ne dispose pas
d’études contrôlées démontrant l’ef
ficacité, cet accom
-
pagnement r
elève de la dimension éthique du soin
gériatrique. T
outefois il peut exister une inadéquation
entr
e les attentes du patient âgé dépr
essif et les possibi
-
lités de réponses et par ailleurs, les psychothérapies ne
sont pas suf
fisamment accessibles aux patients âgés
déprimés.
Les prises en char
ge psychothérapiques
Les indications sont les mêmes que chez l'adulte : elles
sont à pr
oposer en cas d’échec du traitement chimio
-
thérapique, en cas de contr
e-indication de ces traite
-
ments, ou en cas d’ef
fets secondair
es tr
op importants.
Les indications préfér
entielles sont les états dépr
essifs
légers à modérés, cependant des études ont montré
qu'associées aux traitement chimique elles en amélio
-
raient le résultat, surtout en prévenant les récurr
ences.
Pour leur mise en place elles nécessitent l'adhésion de la
personne et quelquefois de son entourage familial. Les
techniques psychothérapiques les plus utilisées sont les
thérapies de soutien, qui sont basées sur une r
elation de
confiance à partir d 'une vision réaliste des objectifs à
atteindr
e et des possibilités mobilisables.
Elles sont surtout centrées sur "l'ici et maintenant" dans
un souci pragmatique et pour aider la personne à fair
e
face aux dif
ficultés actuelles. Cependant le thérapeute
doit r
e c h e r
cher les événe
m
ents déstabilisants, les
conflits r
elationnels, la r
eviviscence de souvenirs trau
-
matiques. Cette r
echer
che ne se limite pas à un simple
énoncé mais doit en intégr
er le sens dans la vie du sujet.
Il est important de donner des infor
mations sur le fonc
-
tionnement dépressif, d’ aider la personne à r
e c o n n a î t r
e
et accepter le fait doulour
eux. cette appr
oche peut aider
le patient à accepter la diminution de ses capacités liées
à l'âge. L'objectif étant la modification des symptômes
et des conduites
Il faut souligner l'intérêt des psychothérapies cognitives,
basées sur le principe des idées négatives que génèr
ent
la dépr
ession et qu' il est possible de modifier : idées
négatives vis à vis de soi-même, vis à vis du monde envi
-
r
onnant, vis à vis du futur ; le thérapeute identifie avec
l’aide du patient les situations qui entraînent pour lui des
sentiments négatifs et dépr
essifs et l' aide à y substituer
des pensées positives réalistes tout en r
econnaissant
l'authenticité de l'af
fect dépr
essif.
Les thérapies comportementales ont pour but un r
en
-
for
cement positif des comportements qui amélior
ent l’é
-
tat dépr
essif et un r
enfor
cement négatif des comporte
-
ments qui l’entr
etiennent.
Les appr
oches psychosociales
- Un étayage psychosocial, tels que la mise en place
d’aides à domicile, l’incitation à une participation sociale
familiale ou de voisinage (clubs du tr
oisième âge, activi
-
tés physiques etc...). L' ef
ficacité de ce type de sociali
-
sation a été évaluée en ter
mes de santé objective et sub
-
jective, mais insuf
fisamment en ce qui concer
ne spécifi
-
quement la dépr
ession, ce sont néanmoins les stratégies
que peut mettr
e en place tout praticien.
CONCLUSION
__________________________________
La prise en char
ge de la dépr
ession chez l’âgé comp
-
r
end la participation de la famille et de l’entourage pr
o-
fessionnel soignant. Les états dépr
essifs de l'âgé sont
des af
fections fréquentes, caractérisées par leur très
grande hétér
ogénéité clinique, ce qui explique les pièges
diagnostiques : le contexte dans lequel la dépr
ession
peut survenir est complexe où les dimensions sociales,
psychologiques, envir
onnementales et biologiques sont
intriquées. Jusqu'aux années 90 elle était souvent mal
r
econnue, banalisée, considérée comme un corrélât de
l'âge et de ce fait, insuf
fisamment traitée et sans prise en
char
ge cohér
ente. L'arrivée de nouvelles molécules plus
maniables chez la personne âgée explique que le dia
-
gnostic soit évoqué plus aisément. Des études chez la
population très âgée sont nécessair
es et sur bien des
points la médecine factuelle (Evidence Based Medecine)
n’a pas encor
e tr
ouvé ces fondements.
■
 6
6
1
/
6
100%