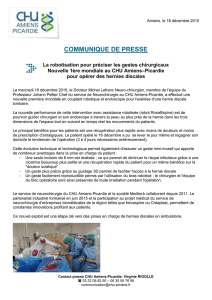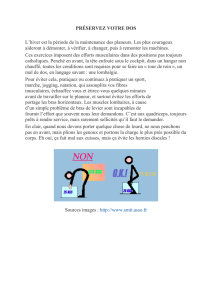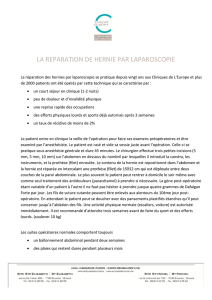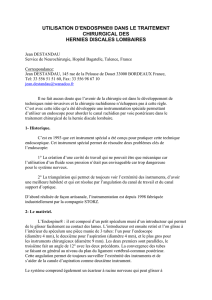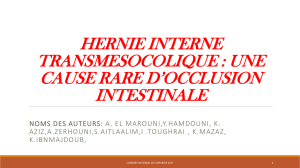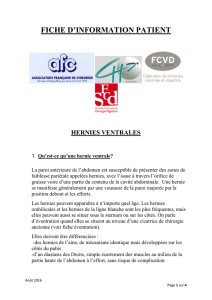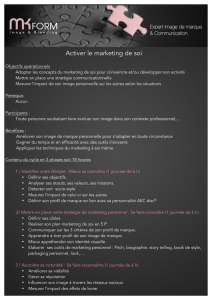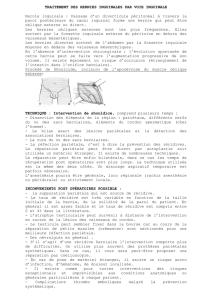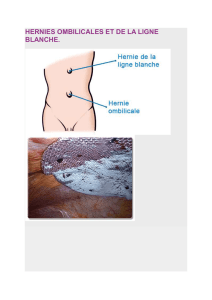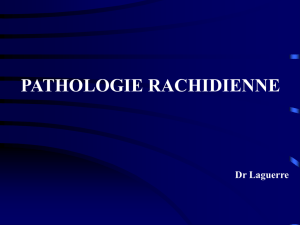la voie intra-osseuse dans l`abord postero-lateral des

Article original
LA VOIE INTRA-OSSEUSE DANS L’ABORD
POSTERO-LATERAL DES HERNIES DISCALES
THORACIQUES
DORSAL DISC HERNIATED. POSTERO-LATERAL
APPROACH
JP
.Chirossel, O. Palombi, E. Gay
Servie de Neurochirurgie - UF de Pathologie Vertébro-Médullaire et de la Base du Crâne - CHU
Laboratoire d’Anatomie - Faculté de Médecine. Université Joseph Fournier - Grenoble.
37
DOSSIER
RACHIS - Vol. 15, n°1, Février 2003.
Latechnique proposée est celle d’une approche
intra-osseuse conduite par évidement à la frai-
se des structures classiquement réséquées
(costo-transverso-pédiculectomie) dans l’abord posté-
ro-latéral des hernies discales thoraciques.
Cette méthode permet d’éviter toute dissection en
périphérie osseuse au contact des structures nobles qui
représentent les dangers de cette chirurgie (plèvre,
paquet inter-costal et surtout moelle et pédicule fora-
minal). Cette technique exploite de façon idéale la
topographie anatomique d’éléments osseux qui ainsi
évidés, forment un conduit guidant naturellement le
geste vers l’espace discal latéral.
The postero-lateral approach of the dorsal her-
niated disc is very interested. It’s an anatomi-
cal approach with very musch security.
Neverless an arteriography is necessary before the
surgery. The arthropediculo-processus and the proxi-
mal rib arethe two principal anatomic site for finding
the extradural space.Three nivels must be exposed, a
drill and the microscope are used for a good view of
the herniated disc.
Résumé Summary

Laconfrontation de matériels anatomiques radio-
logiques et opératoires permet de préciser cette
micro-anatomie des rapports intra-osseux. Deux
complexes anatomiques se partagent effectivement le
barrage postéro-latéral dans l’abord du disque : le com-
plexe arthro-pédiculo-transverse est le plus médial, il
surplombe en partie l’espace discal, et borde latérale-
ment le canal vertébral. Le second accolé en canon de
fusil au précédent, est formé par l’extrémité costale qui
aboutit par son articulation bi-corporéale sur l’aplomb
discal latéral conduisant donc directement à l’espace dis-
cal lui-même en longeant la cavité pleurale.
L’évidement successif intra-osseux de ces structures
conduit en toute sécurité en avant de la paroi antérieure
du canal vertébral. La hernie peut alors être abaissée
dans une sape creusée sous la face ventrale du canal. La
situation plus ou moins médiane de la lésion, son
enchassement variable dans l’axe neuro-méningé peu-
vent amener à une pénétration intra-canalaire complétée
ou non d’un contrôle intra-dural.
La voie postéro-latérale réalisée par abord intra-osseux
sous microscope opératoire, apparaît au total une procé-
dure de grande sécurité. Elle nécessite une exposition
unilatérale sur trois niveaux pour dégagement très latéral
des masses musculaires au-delà des extrémités costales.
Le repérage radiographique, pré et per-opératoire du
niveau, doit être d’une totale rigueur. L’artériographie est
pour nous une précaution pré-opératoire indispensable.
Technique
En matière de hernie discale thoracique, l’approche chi-
rurgicale latérale s’est imposée en fonction des barrages
anatomiques sagittaux, représentés en avant par les élé-
ments cardio-vasculaires et la moelle en arrière.
Effectivement, la laminectomie amontré ou son insuf-
fisance ou sa iatrogénie, qu’elle soit utilisée pour des
abords discaux par voie extra ou intra-durale, ou parfois
même pour simple décompression postérieure
(Singounas, 1977). La costo-transversectomie inaugu-
rée par Ménard (1900) et mise en valeur par Sédon
(1935), Alexander (1946) ou Capenner (1954), a été
adaptée à la hernie discale thoracique de façon plus
récente par Hulme (1980). L’introduction du microscope
opératoire dans ces gestes postéro-latéraux, a permis à
Carson (1971), Jefferson (1976) puis Patterson (1978),
de compléter en dehors la laminectomie par l’arthro-
pédiculectomie, étendue encore pour Lesoin (1984) à la
transversectomie.
38
JP. Chirossel, O. Palombi, E. Gay
RACHIS - Vol. 15, n°1, Février 2003.
La spécificité de la voie pstéro-latérale que nous avons
définie depuis 1987 sous le terme de voie intra-osseuse
ne tient pas tellement à l’identité des différentes structu-
res osseuses sacrifiées dans l’arc postérieur de la vertèb-
re, mais surtout dans la manière même de la faire, puis-
qu’il s’agit d’une approche intra-osseuse ou intra-périos-
tée réalisée par fraisage par l’intérieur des structures
ostéo-articulaires.
■Deux complexes anatomiques se partagent effective-
ment le barrage postéro-latéral ans l’abord du disque : le
complexe arthro-pédiculo-transverse est le plus médial,
il surplombe en partie l’espace discal, et borde latérale-
ment le canal vertébral. Le second accolé en canon de
fusil au précédent, est formé par l’extrémité costale qui
aboutit par son articulation bi-corporéale sur l’aplomb
discal latéral conduisant donc directement à l’espace dis-
cal lui-même en longeant la cavité pleurale.
●Le complexe arthro-pédiculo-transverse est évidé en
entonnoir par la fraise rotative, le spongieux étant élimi-
né en conservant la fine couche corticale. L’évidement
de ce complexe assure à la fois le surplomb foraminal et
discal, et jouxte par en dehors les formations discales
herniées. Cet évidement est conduit à la fois aux dépens
de l’articulaire crâniale, de la transverse creusée en “tuile
de toit”, et de la lame adjacente ; ce fraisage conduit
directement au spongieux pédiculaire dont l’évidement
lui-même guide vers la profondeur. Est formé ainsi un
entonnoir tri-folié qui affleure la paroi latérale du canal
vertébral et s’enfonce en profondeur au-delà de sa paroi
antérieure.
●L’évidement du complexe costo-disco-corporéal élar-
git l’entonnoir précédent aux dépens de l’extrémité
costale dont est conservée la corticale profonde, proté-
geant la plèvre. Ce canal costal conduit ainsi directement
sous la face antérieure du canal après qu’ait été exposée
la “triangulation fibreuse” de l’articulation costo-bi-cor-
poréale, centrée sur l’espace discal.
●L
’effondrement de la paroi antérieure ostéo-discale de
la paroi antérieure du canal vient ensuite. Le fraisage
progressivement conduit sous la face antérieure du
canal vertébral réalise ainsi une véritable “sape” dans
laquelle on pourra effondrer la fine pellicule corticale et
fibreuse supportant la base d’implantation souvent cal-
cifiée de la hernie. On s’aidera ici, de l’ablation de la
corticale antéro-latérale du canal qui permet le contrôle
prédural. Plus la hernie est latérale, plus elle est facile à

39
La voie intra-osseuse dans l’abord postéro-latéral des hernies discales thoraciques
RACHIS - Vol. 15, n°1, Février 2003.
atteindre, alors que pour des situations plus médianes,
une forte obliquité de l’outil sera nécessaire. Les contrô-
les tomodensitométriques en coupes axiales, ou en
reconstructions sagittales, permettent d’évaluer la qua-
lité de cette résection.
■Le passage intra-dural reste exceptionnel. Il permet de
refouler par l’intérieur du fourreau dural des hernies
proéminentes coiffées de dure-mère. Une telle situation
aété observée dans 4 cas, dans lesquels la dure-mère n’a
jamais été trouvée perforée spontanément. Ces manoeu-
vres sur une dure-mère très fragilisée par cette invagina-
tion herniaire peuvent provoquer une perforation qu’il
faudra s’attacher à colmater soigneusement. La hernie
coiffée de ce dôme dural peut être également fortement
enchassée à l’intérieur même de la moelle. I s’agit alors
dans ces cas d’un véritable geste de chirurgie intra-
médullaire. Ces manoeuvres délicates peuvent malgré
tout être effectuées par cette voie sans iatrogénie.
■L’approche ainsi réalisée des hernies discales thora-
ciques, doit soulever également le problème vasculaire.
L’artériographie pré-opératoire a été systématique dans
nos observations. Le danger artériel peut se présenter de
trois façons :
●Soit qu’une artère radiculo-médullaire, type artère
d’Adamriewicz, pénètre le foramen au niveau même du
disque hernié. Le cheminement intra-osseux protège en
principe du danger vasculaire dans cette conformation,
mais l’effraction de la corticale par la fraise ne doit mal-
gré tout entraîner aucune coagulation sur le contenu
foraminal. La sécurité acquise par la connaissance du
passage d’une telle artère est de toute façon considérable
pour la tranquillité du geste.
●Plus dangereuse peut être, est la naissance d’une artè-
re radiculo-médullaire au niveau sous-jacent à celui du
disque hernié, puisque la trajectoire ascendante de l’ar-
tère vient très latéralement se présenter derrière la barre
discale. Cette situation la plus risquée, doit être parfaite-
ment identifiée en pré-opératoire.
●Enfin, il faut reconnaître une déviation possible de
l’axe spinal antérieur lui-même, par le dôme de la hernie,
puisque dans certains cas les manipulations peuvent être
conduites, comme nous l’avons vu, à l’intérieur du four-
reau dural lui-même au contact de la moelle, et donc au
contact de cet axe spinal antérieur déplacé par le sommet
du dôme hernié.
Cette précaution d’étude artériographique pré-opératoi-
re, presque systématique dans nos cas, n’a entraîné aucu-
ne morbidité par elle-même et nous a permis de n’avoir
aucune aggravation neurologique post-opératoire.
La voie postéro-latérale réalisée par abord intra-osseux
sous microscope opératoire, apparaît au total une procé-
dure d’une grande sécurité. Elle nécessite une exposition
unilatérale sur 3 niveaux pour dégagement très latéral
des masses musculaires au-delà des extrémités costales.
Le repérage radiographique, pré et per-opératoire du
niveau, doit être d’une méticulosité extrême ; l’artério-
graphie est pour nous une précaution pré-opératoire
indispensable. La voie intra-durale peut être associée
pour faciliter le désengagement de la hernie.
Les limites à cette technique peuvent être trouvées dans
les cas de niveaux thoraciques inférieurs, où l’aplomb
costal se fait uniquement mono-corporéal, para-discal,
donnant une approche moins franche sur l’espace discal.
Dans ces niveaux inférieurs également la largeur plus
grande du canal rend moins aisé l’effondrement en tota-
lité des socles herniés calcifiés. Dans de tels cas, il est
possible de réaliser une voie d’abord bilatérale selon la
même technique, mais le risque de déstabilisation
implique une fixation greffe associée. L’alternative
d’une voie antérieure plus invasive pourrait ici être dis-
cutée.
Résultats et complications
De 1986 à 2000, 31patients dont 4 avec lésions multiples
ont été opérés par abord postéro-latéral intra-osseux.
L
’étude rétrospective des résultats et complications est
abordée sur cette série.
L’âge moyen est de 45 ans (30-66), le sex ratio est de 0,3
(7 H / 24 F). L’analyse des signes qui ont conduit à l’in-
tervention permet de retrouver l’expression d’une souf-
france médullaire dans 27 cas sur 31. Anévralgie inter-
costale est associée aux signes de myélopathie dans 12%
des cas et peut, de façon exceptionnelle, représenter à
elle seule, l’indication opératoire dans des formes parti-
culièrement hyper-algiques et chroniques (10% des cas).
Tous les patients ont bénéficié d’une artériographie
médullaire pré-opératoire.
Les caractères anatomiques en répartition de niveau ou
en position transversale de la hernie dans le canal ont été

JP. Chirossel, O. Palombi, E. Gay
40
étudiés ainsi qua la nature calcifiée (61 % des cas) ou
fibreuse des lésions.
Le recul moyen post-opératoire est de 5 ans. Le suivi
moyen est de 42 mois (3 à 99 mois). L’exérèse radicale
de la lésion a été constatée dans tous les cas.
Les résultats sont considérés comme :
-excellents s’il n’existe plus de symptômes,
-bons en cas d’amélioration partielle appréciée positive-
ment par le patient,
-moyens en cas d’amélioration faible modifiant peu le
statut fonctionnel du patient,
- et mauvais en l’absence d’amélioration ou en cas d’ag-
gravation.
Les patients ont été revus en consultation et/ou contactés
téléphoniquement. Aucune aggravation neurologique post-
opératoire n’a été à déplorer. L’efficacité de la technique a
été appréciée au plan neurologique par des résultats :
RACHIS - Vol. 15, n°1, Février 2003.
-excellents dans 54 % des cas
- bons dans 26 %
-moyens dans 20 %
-et mauvais dans 9 %.
Ces 3 mauvais résultats relèvent, en réalité d’une patho-
logie associée où la lésion discale n’était en fait qu’n élé-
ment contingent : sclérose en plaques dans 2 cas et
cyphose dorsale dans 1 cas. A noter la persistance pro-
longée (> 1 mois) de dorsalgies post-opératoires péni-
bles dans près de 22 % des cas.
On insiste particulièrement sur la nécessité d’un repéra-
ge méticuleux des niveaux vertébraux en pré et per-opé-
ratoire. ■
Bibliographie
Capener N. The evolution of lateral trachotomy. J
Bone Joint Surg 954 ; 36 : 173-179.
Carson J, Gumpert J, Jefferson A. Diagnosis and
treatment of thoracic intervertebral disc protrusions.
JNeurol NeurosurgPsychiatr 1971 ; 34 : 68-77.
Crafoord C, Hierton T, Lindblom K, Olsson SE.
Spinal cord compression caused byaprotruded tho-
racic disc. Report of a case treated with antero-late-
ral fenestration of the disc. Acta Orthop Scand 1958
; 28 : 103-107.
Fidler MW, Goedhart ZD. Excision of prolapse of
thoracic intervertebral disc. A transthoracic tech-
nique. JBone Joint Surg 1984 ; 66 : 518-522.
Hulme A. The surgical approach to thoracic inter-
vertebral disc protrusions. JNeurol Neurosurg
Psychiatr 1960 ; 23 : 133-137.
Jefferson A. The treatment of thoracic intervertebral
disc protrusions. Clin neurol Neurosurg1975 ; 78 : 1-9.
Lesoin F, Jomin M, Lozes G, Di Paola F, Viaud C,
Clarisse J. Voie d’abord postéro-latérale des hernies
discales dorsales par transverso-arthro-pédiculecto-
mie. Neurochirurgie 1984 ; 30 : 427-431.
Patterson RH, Arbit A. Surgical approach through
the pedicle to protruded thoracic discs. J Neurosurg
1978 ; 48 : 768-772.
Privat JM, Aboulker J, Bitoun JJ, Brunon J,
Caron JP, Chirossel JP, Comoy J, Lesoin F, de
Tribolet N.Les hernies discales dorsales acquisi-
tions récentes - aspects diagnostiques et thérapeu-
tiques actuels. Rachis 1989 ; 5 : 375-385.
Rosenthal D, Rosenthal R. Removal of a protruded
thoracic disc using microsurgical endoscopy. A new
technique. Spine 1994 ; 19 : 1087-1091.
Safdari H, Baker R. Microsurgical anatomyand
related techniques to an anterolateral transthoracic
approach to thoracic disc herniations. Surg Neurol
1985 ; 23 : 589-593.
Seddon HJ - Pott’s paraplegia : prognosis and treat-
ment. Br J Surg 88 : 769-799.
Tribolet (de) N, Schnyder P, Livio JJ, Boumghar
M. L’abord transthoracique des hernies discales dor-
sales. Neurochirurgie 1982 ; 28 : 187-193.
1
/
4
100%