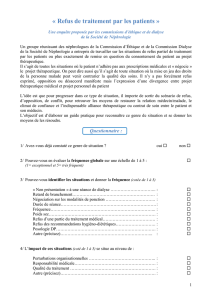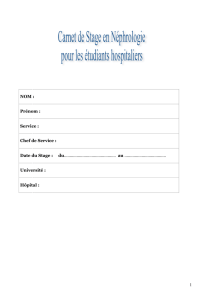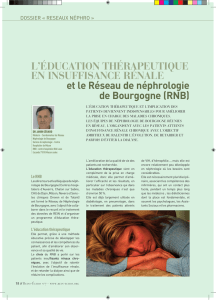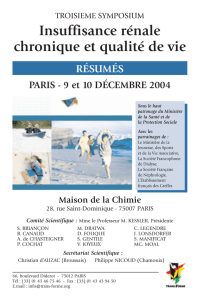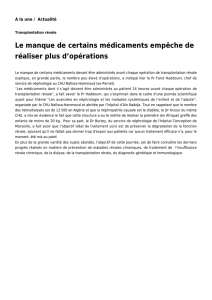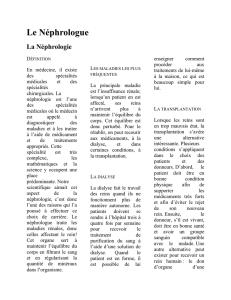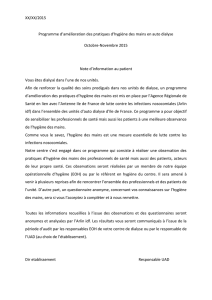LA NEPHROLOGIE Les premiers pas d`une spécialité

LA NEPHROLOGIE
Les premiers pas d’une
spécialité
par Charles van
Ypersele de
Strihou (1933 - professeur émérite 1998)
interviewé par Yves
Pirson
1. Comment êtes-vous arrivé à la médecine ?
Voilà une question bien difficile ! Certainement pas par tradition puisque ma famille
n’a jamais compté de médecin. Revenant au passé, je retrouve le plaisir que j’ai
toujours éprouvé devant les merveilles de la nature. J’y ai
regoûté en retrouvant
récemment dans le grenier le livre favori de mes 12 ans, « l’Essai de Calendrier
Nature en Belgique » de Louis
Debot. Il énumère au fil des saisons, le temps, les
plantes et les fleurs, les insectes et les animaux du moment. Quelques années plus
tard, un petit microscope me fait découvrir un monde nouveau, fascinant, avec
entre
autres l’inoubliable observation de globules rouges roulant dans les vaisseaux
palmaires d’une grenouille. À cette époque s’impose à moi l’évidence que je
deviendrais
médecin. Ce n’est que bien plus tard que je découvrirai le besoin d’être
utile à mon prochain.

2. Et à la néphrologie ?
En bref, du fait des circonstances !
À la fin de mes études de médecine, je découvre que je n’ai aucun des talents
pratiques requis pour devenir chirurgien, mon choix initial. L’alternative la plus
attrayante en 1956 est la médecine interne. Avec l’aide de G.
Bogdanowicz, je
choisis d’être interne dans cette spécialité pendant les douze mois du 4
e doctorat. J’y
rencontre mon premier mentor véritable, le Pr J.
Arcq. Il est alors chef de service
adjoint du Pr J.P.
Hoet. Il est mon premier maître de stage : il le restera pendant 2
ans, en salle IV à l’hôpital Saint-Pierre.
Le Pr J.
Arcq est un homme exigeant, un clinicien superbe capable d’une anamnèse
exhaustive, d’un examen clinique approfondi et d’une synthèse précise et lumineuse
du problème posé par le malade. Je ne peux m’empêcher de comparer ses
diagnostics pénétrants, presque toujours justes avec les discussions parfois poussives
de nos médecins d’aujourd’hui, noyés dans une mer de résultats de laboratoire et
d’imagerie. Plus importante, l’empathie du
Pr J. Arcq avec son patient est un
modèle pour toute notre génération. Aujourd’hui encore, près de 45 ans plus tard, je
continue à détailler anamnèse et examen clinique dans mes dossiers de consultation,
mu par le souci « et si M.
Arcq lisait mon dossier… »
D’emblée notre relation est chaleureuse, confiante. Je m’appuierai sur elle quand les
temps deviennent incertains. Ma première orientation a donc été la médecine interne
générale.
Premières prémisses de la néphrologie, un mineur de 60 ans est admis en 1957 pour
insuffisance rénale majeure. Une urémie sévère équivalait alors à un verdict de mort.
À quelques centaines de mètres de l’hôpital Saint-Pierre, le département flamand de
médecine dispose depuis peu d’un rein artificiel de
Kolff offert par la firme
Christiaens. Personne chez nous n’en pense grand chose, mais personne ne s’oppose
à ma suggestion, un peu naïve, d’y recourir pour notre patient. Quelle aventure !
Une dizaine de personnes tourne autour de l’appareil qu’une noria de laborantines
ou d’infirmières relie au laboratoire clinique de Frédéric Stein. Chaque chute de
pression artérielle, la moindre nausée ou vomissement provoque l’anxiété. Le patient
survécut ! Comme son histoire évoquait un cas de néphrite avec perte de sel publié
récemment dans le New
England Journal of
Medicine
, j’entreprends en salle une
étude métabolique et montre comment un régime pauvre en sel élève le taux d’urée
et réduit le poids tandis qu’un apport massif de sel et de bicarbonate a l’effet inverse.
Faut-il rappeler qu’il n’y avait pas encore de comité d’éthique ?

Avec l’aide d’un autre assistant, Louis
Molineau, j’entre dans le monde confus de
l’eau et des électrolytes avec, comme seule bible, le livre de
Gamble « The
extracellular
fluid ». Nous découvrons un nouveau langage d’anions et de cations,
d’acidose et d’alcalose… Au pays des aveugles, les borgnes deviennent des experts !
Quelques mois plus tard, L. Brasseur, un élève de F.
Lavenne, le professeur de
cardiologie, me propose une étude sur les effets du
dichlorphenamide, un inhibiteur
de l’
anhydrase carbonique, sur la ventilation de sujets atteints d’insuffisance
respiratoire sévère. Je crois qu’il m’a choisi parce que j’avais démontré ma capacité
d’obtenir des récoltes urinaires complètes et peut-être aussi parce que, célibataire
logeant à l’hôpital, je suis disponible jour et nuit ! Ce défi me familiarise avec le
domaine de l’équilibre acido-basique et surtout avec les travaux publiés à la même
époque, dans le
Journal of Clinical Investigation
, par deux chercheurs américains :
W.B. Schwartz et A.S.
Relman.
Insuffisance rénale, eau et électrolytes : mon intérêt pour la néphrologie est éveillé.
Interrogé sur l’avenir d’une telle orientation, le
Pr J. Arcq me décourage : « Les
aspects des maladies rénales qui ne relèvent pas de l’urologie, font nécessairement
partie de la médecine interne générale ». La prévalence de ces désordres dans sa
pratique personnelle est bien trop faible pour alimenter un jour un spécialiste !
J’avais pris trop de plaisir au cours de cette dernière année pour renoncer. Je prends
donc rendez-vous chez le
Pr P. Lambin, un hématologue qui dirige l’autre service de
médecine interne. Surpris, il me demande quels pourraient bien être les outils
propres à une telle spécialité ? Il me conseille, si je persévère, de m’entraîner à faire
des cystoscopies : puisque la bronchoscopie fonde l’identité du pneumologue,
pourquoi pas la cystoscopie si je m’intéresse au rein ? Persévérant, je décide de
passer un an chez l’expert incontesté des maladies rénales en Europe, le
Pr J.
Hamburger.
Une recherche réalisée sur le placenta de rat dans le laboratoire du
Pr J.P. Hoet
m’avait valu une bourse de voyage du Gouvernement belge : j’arrive donc à
l’hôpital Necker, à Paris en septembre 1959.
Le trait qui me frappe le plus quand je reviens à cette époque est mon inconscience.
J’en conclus que l’enthousiasme, même si ses fondations sont fragiles, est peut-être
plus important quand on cherche sa voie qu’une analyse rationnelle soigneuse. Qui
aurait pu suspecter, en 1959, le développement de la néphrologie au cours de la
décennie suivante ? Quoiqu’il en soit, j’étais en route pour la Néphrologie.
3. Quelles ont été vos expériences initiales ?

Le
Pr J. Hamburger était déjà le Nestor de la pathologie rénale européenne.
L’élégance de ses présentations, le raffinement de sa pensée et sa courtoisie
inaltérable sont impressionnants. Joints à une intelligence scientifique hors pair, ils le
conduiront aux sommets de la médecine française : l’Académie des Sciences et,
enfin, à l’Académie française. À la fin des années 50, J. Hamburger est un des rares
patrons parisiens qui perçoit que l’anglais devient le véhicule principal de la science.
À 50 ans, il décide d’apprendre l’anglais : près de deux ans plus tard je suis le
témoin de ses premiers pas à Boston; ils sont surprenants : J. Hamburger domine
déjà les subtilités de l’anglais non seulement parlé mais aussi écrit.
À la fin des années 50, Necker est une ruche bourdonnante d’activités. Chaque
semaine comporte un colloque
anatomoclinique fondé sur la biopsie rénale. Celle-ci
est encore pratiquée à ciel ouvert par un chirurgien. Les anatomopathologistes,
Hyacinthe de Montera et
Nenette Habib, discutent vivement avec J.Hamburger et les
autres cliniciens. On commence à démembrer les différentes formes de
glomérulonéphrite. Sans en avoir conscience, j’assiste à l’émergence d’une nouvelle
science même si j’ai parfois l’impression de retourner à mes premières amours, la
botanique !
Les patients affluent de toute la France et de son empire colonial pour traitement de
l’insuffisance rénale aiguë. Etre averti des nouvelles entrées, dépend de mes rapports
avec l’infirmière chef, une personnalité dominante dans les hôpitaux publics français.
L’apport régulier de pralines belges m’aide énormément. Dans les deux mois je suis
appelé dès qu’un patient est admis. L’expérience dramatique de l’hémodialyse aiguë
vécue à Louvain se transforme rapidement en une routine qui reste exigeante.
La formation clinique se prodigue pendant le tour de salle du Professeur. Trois fois
par semaine, suivi d’une procession de collègues étrangers en visite, d’internes et
d’externes, entouré par les infirmières, J. Hamburger ou un de ses adjoints écoute la
présentation du cas par l’externe, son commentaire par l’interne, puis examine le
patient, discute le diagnostic et arrête le traitement. Je me rappelle « la visite » dans
une petite chambre où venait d’être admis Jacques Duchamp dit Villon, un peintre et
graveur célèbre, compagnon de Picasso au Bateau Lavoir. Il n’est pas très malade.
Majestueux, J. Hamburger s’incline devant ce vieillard frêle « Mon cher Maître, je
vous offre ce que la médecine a de mieux : vous quittez tout de suite l’hôpital avant
d’y contracter une affection plus sévère ».
La participation à la consultation du Patron est aussi une expérience ! Une douzaine
de visiteurs est assise le long des murs d’une grande pièce. Le Professeur, derrière
un bureau, écoute l’interne qui lit l’histoire clinique et les résultats des examens

biologiques réalisés la semaine précédente. Il examine ensuite le patient, pose
quelques questions complémentaires puis commente le cas et son traitement et finit
en dictant une lettre pour le médecin traitant.
Ce fut là toute l’expérience clinique sur laquelle j’allais devoir m’appuyer quelques
années plus tard, à mon retour à Louvain : je n’en avais pas conscience… Il n’y avait
pas de traités, seulement une expérience clinique transmise au lit du patient.
La matinée étant consacrée à la clinique, l’après-midi reste disponible pour la
recherche clinique. Le service dispose d’une excellente bibliothèque, mais l’aide la
plus stimulante me vient d’un ancien collaborateur de J. Hamburger : Gabriel Richet,
qui dirige une policlinique à Necker. G. Richet a un sentiment extraordinaire de
responsabilité vis-à-vis des plus jeunes et en particulier des étrangers de passage à
Necker. Très rapidement il ne me ménage pas son temps. Mon sujet de recherche
étant le Milk Alkali syndrome
dont deux cas venaient d’être admis, je me mets à lire
sous sa tutelle tout ce qui se publie sur le métabolisme calcique dans l’
American
Journal of Physiology ou le Journal of Clinical Investigation
, les revues phares de
l’époque. G. Richet relit les premières versions du manuscrit, pose des questions,
débat avec vivacité. Heures inoubliables qui suscitèrent une amitié profonde encore
bien vivante aujourd’hui. G. Richet devient ainsi mon second mentor. Il intervient
auprès de Bill Schwartz, un de ses amis, qui en janvier 1960 m’informe qu’il
m’attend au début de l’été.
À mon départ de Paris, à la fin du printemps 60, je sais ce qu’est la néphrologie
même si je perçois tout le chemin qui me reste à parcourir pour atteindre un niveau
de compétence raisonnable. Ce n’est que bien plus tard que je réaliserai que ce
niveau est mythique et restera toujours hors de ma portée ! J’avais noué plusieurs
amitiés durables qui s’avéreront, sur le plan personnel, aussi importantes que le
bagage clinique acquis à Paris.
Le souvenir de ma première rencontre avec Bill Schwartz, WBS, reste aussi vif
qu’au moment même. Arrivé dans son bureau, au début de juillet 1960, j’avais
annoncé à la secrétaire dans mon anglais vacillant, que j’étais le nouveau «
fellow »
et que je souhaitais voir le Professeur Schwartz. J’attends, assis sur une petite chaise.
En vain. Il y a bien un jeune type, en chaussures de tennis, habillé sportivement qui
vient me parler sans que je le comprenne bien. Je lui répète donc que je suis là pour
rencontrer le Professeur Schwartz. Il m’a fallu plusieurs minutes pour réaliser qu’en
fait ce jeune homme, si peu académique, n’est autre que WBS lui-même ! Mon
paradigme de la médecine académique en fut bouleversé !
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%