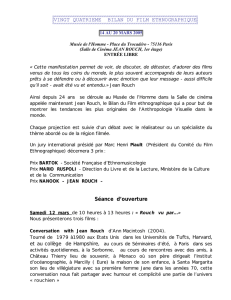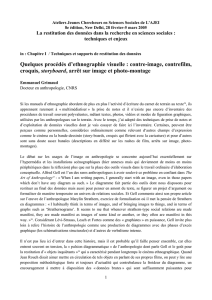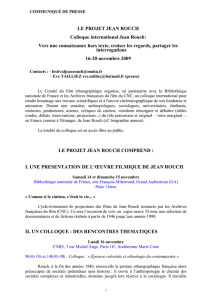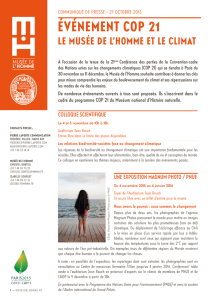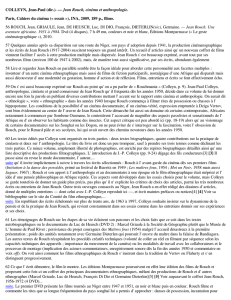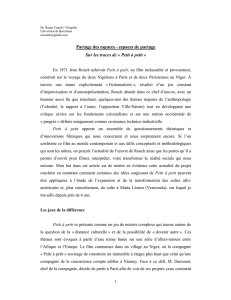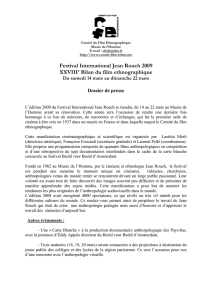ROUCH ET LE DILEMME DE LA CULTURE Simona Bealcovschi

ROUCH ET LE DILEMME DE LA CULTURE
Simona Bealcovschi, Ph.D.
anthropologue-cinéaste, chercheuse
INRS et Université de Montréal, Canada
If « culture » is not an object to be described, neither is it a unified corpus of symbols and meanings that
can be definitively interpreted. Culture is contested, temporal, and emergent. Representation and
explanation-both by insiders and outsiders-is implicated in this emergence.
James Clifford
Je serai un acteur comme Marlon Brando et Dorothy Lamour sera ma femme.
Oumarou Ganda alias Edward.G.Robinson
Le sujet ethnographique, incontournable dans la gestion des représentations culturelles, a
longtemps été muet, supprimé et remplacé par celui qui était devenu le traducteur des cultures, le médiateur
entre cultures, l’ethnologue et son autorité monophonique. Cette pratique avait inspiré l’idée de
« translation » d’une culture à l’autre (Talal Asad, 1986), généralement d’une culture subalterne à une
culture dominante, occidentale, le plus souvent celle du public académique, ou bien d’un public
métropolitain consommateur d’exotisme. Autrement dit, l’ethnographie avait commencé par
décrire/enregistrer des sociétés prétendument figées dans l’atemporalité, et le projet anthropologique a suivi
cette voie pendant des décennies. L’ère des revendications pour le droit de parler est venue plus tard,
comme une entreprise exploratoire et iconoclaste de certains pionniers innovateurs, et Rouch en est un. Il
ne s’intéressera plus à la vision canonique d’une ethnographie descriptive et ethnocentrique, mais à celle du
dialogue interculturel et du partage. Dans cette nouvelle vision, il a livré au public l’autre visage de la
culture étudiée, celui intersubjectif celui-là et animé par de sujets ethnographiques qui s’expriment, qui
nous impliquent et qui partagent avec nous leurs vécus et leurs pensées intimes.
Quelques décennies plus tard, les postmodernes nord-américains préoccupés par les pratiques de la
production textuelle vont remettre eux aussi en question les perspectives ankylosées sur l’Autre, contestant
les pratiques ethnographiques ethnocentristes et l’usage des dichotomies. Déjà en 1974, l’ouvrage de Dell
Hymes au titre évocateur Reinventing Anthropology se distanciait du positivisme des premiers travaux de la
discipline. Plus ou moins durant la même période, Geertz jetait les bases de son analyse interprétative,
préparant le terrain pour ceux qui, par leurs écrits et leurs critiques, sont entrés dans l’arène de la nouvelle
ethnographie, comme le groupe de Santa Fé (1980) ou les postmodernes. Les Nord-Américains, vont
proposer de nouvelles stratégies dans la représentation des cultures, stratégies qui renvoient à plusieurs

grands paradigmes, dont la reconnaissance de la présence de la subjectivité lors de la rencontre et son
exploitation dans de toute production textuelle (comme, le récit à la première personne, l’exploration de
l’imaginaire), le recours au paradigme dialogique et au paradigme polyphonique (v.g. l’interculturalité et
l’heteroglossia), la critique de toute hiérarchie, etc.
Mon intervention, se référant spécifiquement au discours rouchien d’une l’anthropologie partagée, explore
succinctement quelques chevauchements conceptuels apparus autant dans l’ethnocinéma, dans
l’ethnographie contemporaine que dans la critique postmoderne nord-américaine. Mon argument est que la
production rouchienne, descendante autant de la tradition de l’École ethnologique française que du
surréalisme et de l'avant-garde parisienne des années 1920-1930, avait anticipé, bien avant l’heure, divers
positionnements postmodernes consolidés dans les années 80-90. Visionnaire et iconoclaste, Rouch a
devancé ses contemporaines par sa perspective, ses approches, par la représentation du sujet et de son
identité, et par sa méthodologie de terrain (l’utilisation de l’effet feed-back, de l’intersubjectivité, de la
multivocalité, de la ciné-transe, du tournage en temps réel). En fait, par son cinéma-vérité et l’alliance entre
l’ethnographie et le surréalisme, il a préfiguré les postmodernes nord-américains.
Sa pratique relationnelle de construire le récit à la première personne inaugure une technologie « avant la
lettre » et une méthode d’appréhender le réel à travers l’exploration du rapport dialogique (« anthropologie
partagée » M.H. Piault 2000), qui est à la base de l’enquête de terrain contemporain. Appartenant à une
« race rare de cinéastes », Rouch est un iconoclaste, mais surtout un intuitif, car ses expérimentations
cinématographiques et anthropologiques lui valent de représenter le premier ethnographe libre.
Cependant, comme Jay Ruby le notait, presque avec condescendance, Rouch a été un postmoderne
précoce avec ses films surnommés films de fiction ethnographique, mais les pionniers américains du
postmodernisme semblent l'avoir ignoré.
Même si une tentative d’établir des parallèles entre les technologies de représentation rouchiennes
et celles promues par les critiques et les anthropologues postmodernes pourrait paraître osée, elle part
néanmoins d’une série de ressemblances qui devraient nous signaler les pièges que les sciences nous
tendent si souvent. Cette perspective nous montre à quel point il serait impossible d’avoir un discours
unique et consensuel sur les systèmes de connaissance. En égale mesure, elle nous montre que les discours

théoriques œuvrent dans un environnement restreint de production intellectuelle qui ignore les autres
discours et environnement. En dépit de leurs prétentions d’universalité, ces discours finissent par être
autoréférentiels. En fait, c’est plutôt le silence des postmodernes qui met en relief ce parallélisme
conceptuel et qui m’a conduit à ces formulations.
Rouch l’innovateur, Rouch l’iconoclaste
« Griaule fait voir aux Français des années trente, encore largement colonialistes, des Africains
vivant au fin fond d’un pays complètement coupé du reste du monde, que l’on considère pour cette raison
comme primitifs ou arriérés, et qui ont pourtant reçu en héritage une grande œuvre de la pensée humaine.
Car, oui, veut affirmer Griaule, pour la première fois : “on pense” sur la falaise de Bandiagara, des
Africains pensent d’une manière savante et sophistiquée » (Scheinfeigel, 2008 :21).
Cette nouvelle perspective de l’Autre sera continuée et portée même plus loin par Rouch avec d’autres
outils que l’écriture, le cinéma et le « récit filmique » qu’il développe et approfondit.
Quels sont les aspects novateurs de son travail ?
1. D’abord, il autorise l’ethnographie à glisser vers « l’ethno-fiction », phénomène déjà perceptible dans
des documents des débuts, tels que « Bataille sur le grand fleuve » (1951) et un peu plus tard « Les Maîtres
fous » ( 1954), et qui s’avère pleinement dans « Moi, un noir » ( 1957-58) et « La Pyramide humaine »
(1961). Rouch nous montre ainsi que la vérité n’est plus absolue.
2. Ensuite, il amène l’exotique en ville et détruit l’image monolithique d’une Afrique folklorique composé
de rituels primitifs, etc., tel que démontré par des films comme
« Moi, un noir » (1957), « La Pyramide humaine » ( 1961), « Petit à petit » (1971), pour en citer juste
quelques-uns.
3. Enfin, il s’emploie à présenter un sujet ethnographique moderne, celui qui ne soit pas uniquement une
construction d’un discours académique objectif. Il revendique ainsi l’autorité de la subjectivité, comme
technologie de la connaissance dans la rencontre de l’autre et surtout comme technologie de représentation
de l’autre. Quelques décennies plus tard, Fabian (1983) se demandera rhétoriquement : « le style objectif,
réaliste aurait-il déformé les représentations de l'autre ? ». Rouch y avait déjà répondu.

La subjectivité devient une source de connaissances, une façon de connaitre l’autre et de l’intégrer
dans le réel. Pour y accéder, Rouch utilisera pleinement la technique du « feed-back » qu’il avait tellement
apprécié dans le travail de Flaherty et qui était en fait au centre du projet rouchien, « celui de rendre la
caméra participante » afin d’en arriver à une anthropologie partagée. La caméra vivante serait, « la seule
attitude moralement et scientifiquement convenable à adopter en anthropologie aujourd’hui (...) et la
vérité cinématographique ne peut éclore que grâce au contact entre le cinéaste et les filmés » (Proulx
1999:26). Cette conviction va se refléter dans son choix d’objectif, un grand-angle, et dans son mépris pour
le zoom et le trépied, aux dépens du travelling. Comme Rouch ne considère non plus que le film doive
produire « une réalité en miroir », sa caméra sera provocatrice. Mais si la caméra est provocatrice et
incitative, comme Marc Piault le note, c’est précisément dû à la présence de Rouch en tant que personne et
« non pas à celle de la caméra comme regard neutre ou simple présence étrangère » que ce cadre
exceptionnel de la rencontre de l’autre qui tourne autour du partage émotionnel va se réaliser. Et pour
reprendre Piault, ce partage a été possible « parce que Rouch a trouvé en Afrique la possibilité de vivre une
affectivité distanciée et pudique au milieu d’une fratrie choisie, que les informateurs sont devenus les héros
puis les complices d’aventures - fictions, où se révèle ce qu’il y a de plus intime dans l’imaginaire des
hommes » (Piault 2000 : 250). Beaucoup d’entre eux sont devenus ses copains. Et ce n’est pas rare non plus
d’avoir l’impression que Damouré serait un alter ego de Rouch. Il est aussi certain que sans avoir utilisé
son fameux « feed-back », et donc, sans connaitre ce que ses protagonistes-copains-collaborateurs africains
pensent, et sans sa perspective sur la vérité filmique, Rouch n’aurait jamais réussi à persuader Damouré de
se promener seul dans les rues de Paris, d’arrêter des personnes inconnues et de leur demander « Est-ce que
je peux voir vos dents ? ». Cela nous rappelle bien le commentaire de Rouch à propos de Marceline :
« Jamais Marceline n’aurait marché en parlant toute seule dans la ville s’il n’y avait pas eu la caméra, si
elle n’avait pas eu un micro-cravate, si elle n’avait pas eu une sacoche magnétophone. C’était de la
provocation. (Rouch 1981 :11)
Mais l’anthropologie partagée que Rouch nous propose ne se réduit pas à un partage de vécu avec ses
sujets; elle ne se réduit pas non plus « à une méthode de la participation affective » ( Piault 2000 : 212) car
elle est censée nous impliquer dans ce triangle du partage qui incorpore réalisateur, protagoniste et
spectateur.

Rouch et ses personnages Damouré Zika, Lam Ibrahim Dia, Oumarou Ganda, mettent en question
l’autorité culturelle des mondes coloniaux et introduisent sur la scène ethnographique une Afrique
périphérique et centrale, en mouvement et figée dans des structures archaïques et acculturées. Les héros de
Rouch sont à leur façon des Africains « cosmopolites vernaculaires», pour reprendre une expression de
Bhabha, qui se glissent entre les traditions locales et la nouvelle dimension occidentale, ayant toujours la
référence d’un Occident lointain et central, mettant ensemble autant les formes authentiques d’agir et de
penser que des formes hybrides, récemment acquises. « On est comme des Américains. Pour nous les
voitures ne durent plus qu’un mois », dira Oumarou Ganda, le jeune protagoniste-narrateur du film Moi, un
noir,(1957) dont le pseudonyme est bien celui de l’acteur américain Edward G. Robinson, renommé pour
avoir interprété des iconoclastes et des rebelles.
C’est justement cette hybridation culturelle que l’œil de la caméra nous montre, tout en nous
rappelant que le monde et les cultures sont dans un mouvement continuel : il y a des rues à Treichville qui
s’appellent Chicago, des bars nommés « l’Esperance Bar-Dancing » ou « Mexico Salon » dont la publicité
et les noms renvoient au Far West américain, l’éternel symbole du rêve d’enrichissement de tout immigrant
– dans ce cas, de l’immigrant local, car Oumarou en est un.
Un autre axe qui a marqué l’imaginaire de la production rouchienne place au centre la
spatialisation et la nouvelle représentation de l’Afrique ethnographique. Déplaçant l’exotique du village
traditionnel vers la ville « moderne », Rouch inaugure toute une nouvelle thématique et approche. D’une
part, elle est centrée sur le rapport individu – lieu, et d’autre part, elle se recentre sur l’acte
d’interculturalité. Le rapport de l’individu au lieu « africain » est peut-être une des innovations le plus
intéressantes de Rouch, car il s’oppose à la vision ethnographique clichée du continent noir figé dans
l’atemporalité statique. En conséquence, Rouch propose le lieu africain comme un espace dynamique,
antistatique, et surtout transculturel. Il suffit de penser à « Jaguar » (1967), aux « Maîtres fous » (1954), à
« Moi, un noir » (1957), et surtout à « Petit à petit » (1970) qui lui donnent toute sa consistance. Cette
perspective nous renvoie au concept de « ré-spatialisation » défini quelques décennies plus tard par un autre
contestateur, Homi Bhabha, qui lui aussi, va se montrer sensible au rapport lieu – culture. Le lieu,
l’Afrique, apparait ainsi comme une nouvelle construction « d’entre-cultures » en continuel mouvement et
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%