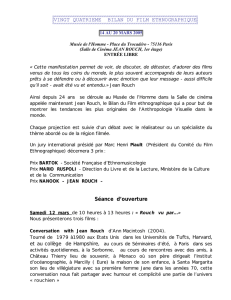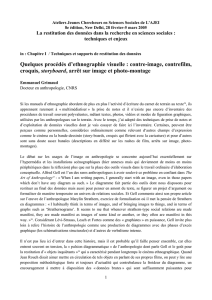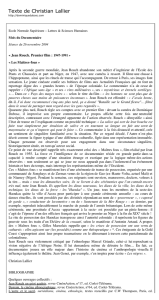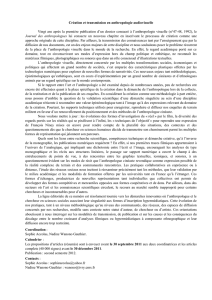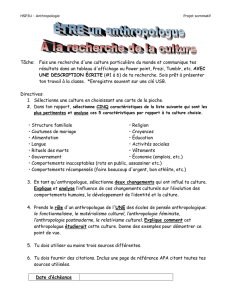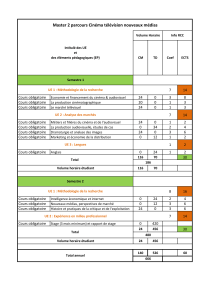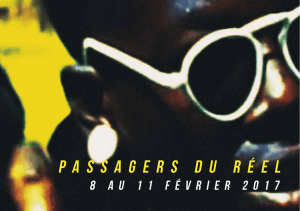I - Université Paris 1 Panthéon

1
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE PROJET JEAN ROUCH
Colloque international Jean Rouch:
Vers une connaissance hors texte, croiser les regards, partager les
interrogations
16-20 novembre 2009
Contacts : - [email protected]
Le Comité du film ethnographique organise, en partenariat avec la Bibliothèque
nationale de France et les Archives françaises du film du CNC, un colloque international pour
rendre hommage aux travaux scientifiques et à l'œuvre cinématographique de son fondateur et
animateur. Durant une semaine, anthropologues, sociologues, universitaires, étudiants,
cinéastes, producteurs, acteurs, critiques de cinéma, viendront témoigner et débattre (tables
rondes, débats, interventions, projections...) du rôle précurseur et original – voire marginal –,
en France comme à l'étranger, de Jean Rouch (cf. biographie annexe).
La totalité du colloque est en accès libre au public.
LE PROJET JEAN ROUCH COMPREND :
I. UNE PRESENTATION DE L’ŒUVRE FILMIQUE DE JEAN ROUCH
Samedi 14 et dimanche 15 novembre
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Grand Auditorium (GA)
Paris 13ème
« Comme si le cinéma, c’était la vie... »
Cycle-événement de projections des films de Jean Rouch restaurés par les Archives
françaises du film (CNC). Ce sera l’occasion de voir, en copie neuve 35 mm, une sélection de
documentaires et de fictions réalisés à partir de 1946 jusqu’aux années 1990.
II. UN COLLOQUE : DES RENCONTRES THEMATIQUES
Lundi 16 novembre
CNRS, 3 rue Michel Ange, Paris 16e, Auditorium Marie Curie
9h30-13h et 14h30-19h Colloque : « Épreuve coloniale et ethnologie du contemporain »
Rouch, à la fin des années 1940, renouvelle la posture ethnographique française alors
préoccupée de sociétés prétendues sans histoire : il ouvre à l’anthropologie le chemin des
sociétés complexes et industrielles, domaine jusqu'à lors réservé à la sociologie. Il travaille

2
dans le contemporain et ses travaux sur les migrations, comme la plupart de ses films des
années 1950, portent sur une Afrique en pleine transformation économique et politique. « Les
Maîtres fous », réalisé en 1957, est un des films-cultes du cinéma et de l’anthropologie.
19h30-21h30 Lundi de l’INA
Autour de la parution de l’ouvrage Jean Rouch, cinéma et anthropologie, discussion
animée par Emmanuel Laurentin (France Culture).
MARDI 17 NOVEMBRE
CNRS, 3 rue Michel Ange, Paris 16e, Auditorium Marie Curie
10h-13h et 14h30-19h Colloque : « Une anthropologie partagée »
En regardant-filmant, Rouch expose sa démarche à la fois à ceux chez qui il travaille
et aux spectateurs-questionneurs de l'altérité que nous sommes. C’est une « anthropologie
partagée » qui permet de rendre compte de l'insurmontable paradoxe de l'altérité qu'elle
assume : montrer et saisir la différence sans la rendre irréductible ni la réduire à l'identique.
C'est l'une des plus fortes propositions du film « Moi, un Noir » : les acteurs non seulement
disent eux-mêmes leur vie et leurs rêves, mais aussi regardent au-delà de l'écran vers le
spectateur futur. L'Autre « ethnologisé » est désormais reconnu comme sujet, il peut enfin
s'adresser à ceux qui le regardent !
Mercredi 18 novembre
CNRS, 3 rue Michel Ange, Paris 16e, Auditorium Marie Curie
`
10h-13h et 14h30-19h Colloque : « Une anthropologie nouvelle, une anthropologie
du vivant »
L'anthropologie partagée contextualise l'anthropologue dont la démarche s'inclut dans
le questionnement : elle est mise en perspective. L'enquête anthropologique produit une
situation concrète : la rencontre de personnes se questionnant ouvertement et mutuellement
sur leurs appartenances, leurs désirs, leurs plaisirs et leurs obligations. Enquêteur et enquêtés
sont englobés dans une situation qui leur échappe à mesure qu'ils la définissent.
La perception, selon Rouch, doit retrouver sa capacité de surprise, d'étonnement, et
donc d'interrogation intime, celle qui se met en cause elle-même, avant de questionner la
légitimité de l'autre.
Jeudi 19 novembre
BnF, Belvédère, site François-Mitterrand, Paris 13ème
9h45-13h et 14h30-20h Colloque : « Cinéma direct et construction du réel »
Jean Rouch, au travers de son œuvre, n'a cessé d'inventer l'Afrique. N'aurait-il pas
aussi inventé l'anthropologie en faisant son cinéma ? « Chronique d'un été » mené en
collaboration avec Edgar Morin n'est pas seulement l'avènement du cinéma direct en France,
mais c'est aussi un véritable film-action où se nouent des situations et des relations réelles
entre protagonistes réunis de manière plus ou moins artificielle. L'intelligence de Rouch et de
Morin est d'avoir fait suivre au spectateur les méandres d'implication des acteurs et des
réalisateurs les uns avec les autres : c’est une anthropologie dynamique d'un groupe en
formation. Le sens du film appartient en définitive au spectateur et se renouvelle ainsi de
visionnement en visionnement.
Vendredi 20 novembre
Bibliothèque Publique d’Information, Centre Pompidou, Cinéma 1

3
10h-13h et 14h30-19h30 Colloque : « L’imaginaire est réel, la fiction dit le monde »
Le cinéma est une élaboration spécifique du réel, prenant en compte notamment
l'expression et l'interprétation des sentiments. Si « La Pyramide humaine » est la mise en
scène d'un sociodrame arrangé, c'est également un film où Rouch oriente son regard, choisit
ses interlocuteurs et invente un scénario qui pourrait bien être « un jeu de la vérité ». Les
rencontres proposées se jouent sous les yeux des spectateurs mais, avant tout, dans le regard
de Rouch. Comme Homère, il met en scène des hommes et des dieux en interaction.
« Dyonisos », étonnant pied de nez à toute forme connue de réalisation, restera un de ces
objets inclassables, inachevés, hybrides, et par lesquels les surréalistes espéraient questionner
l'ordre et l'évidence du monde. Sans doute est-ce le film où, malgré les masques, Jean Rouch
aura mis le plus de lui-même.
20h Projection de clôture : Folie ordinaire d’une fille de Cham (1987).
PERSONNALITES PARAINNANT L’EVENEMENT
Georges BALANDIER (France) - Anthropologue et sociologue, Professeur émérite de la
Sorbonne (Université René-Descartes, Paris-V), Directeur d'études à l'École des hautes études
en sciences sociales (EHESS).
Jean-Pierre BEAUVIALA (France) - Cinéaste, Président-directeur général d'Aaton.
Michel BRAULT (Canada) – Producteur, Cinéaste.
Jean-Louis COMOLLI (France) - Cinéaste.
Raymond DEPARDON (France) - Photographe, Cinéaste.
Idrissa DIABATE (Côte d'Ivoire) - Cinéaste, enseignant à l'Institut national supérieur des arts
et de l'action culturelle (INSAAC) et chercheur associé à l'université d'Abidjan.
Marie-Pierre DUHAMEL MULLER (France) - Programmatrice et traductrice cinéma,
membre du comité de sélection de la Mostra Cinéma de la Biennale de Venise (2008).
Ian DUNLOP (Australie) - Cinéaste.
Faye GINSBURG (USA) - Directrice du Center for Media, Culture and History du
département d’anthropologie de l'université de New York.
Luc DE HEUSCH (Belgique) - Anthropologue, Cinéaste, Professeur émérite à l'Université
libre de Bruxelles.
Richard LEACOCK (USA) - Cinéaste.
David MACDOUGALL (Australie) - Anthropologue, cinéaste, directeur du Program in Visual
Research Across Cultures de l'université nationale australienne de Canberra.
Edgar MORIN (France) - Sociologue, Directeur de recherche émérite, CNRS.
François NINEY (France) - Philosophe, enseignant en cinéma (École normale supérieure de
Saint-Cloud, à la Fémis et à l'université de la Sorbonne nouvelle – Paris-III).

4
Yasuhiro OMORI (Japon) - Anthropologue, cinéaste, professeur à l'université de Ritsumeikan,
Kyoto.
René PREDAL (France) - Professeur émérite d'études cinématographiques à l'université de
Caen.
Claire SIMON (France) - Cinéaste.
Paul STOLLER (USA) - Anthropologue, professeur à l’université de West Chester en
Pennsylvanie et à l'université du Texas, à Austin.
Sergio TOFFETI (Italie) - Directeur de la Cinémathèque nationale de Rome.
COMITE D’ORGANISATION
Responsables de la manifestation
Marc Henri PIAULT, Président du Comité du film ethnographique, Directeur de Recherche
(honoraire) CNRS
Jean Paul COLLEYN, Administrateur du Comité du film ethnographique, Directeur d’études
et Chargé de la division audiovisuelle à l’EHESS
PARTENAIRES
Bibliothèque Publique d’Information (Centre Pompidou)
Centre culturel franco nigérien – Jean Rouch (Niamey)
CERIMES
CNRS INSHS
CNRS Images
Culturesfrance
Editions Montparnasse
EHESS
Fête de la Science
Images en Bibliothèque
Institut National de l’Audiovisuel
Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche
Museum national d’histoire naturelle
Région Île-de-France
Société civile des auteurs multimedia
Programme complet du colloque consultable sur bnf.fr et comite-film-ethno.net

5
ANNEXE REPERES BIOGRAPHIQUES
Jean Rouch (1917 - 2004):
1941 : Diplôme d’ingénieur civil des Ponts et Chaussées
Premier voyage au Niger
.
1942-1945 :
Premières enquêtes ethnographiques sur les rituels de possession songhay (Niger-
Mali)
1947 : « Au Pays des mages noirs » (Niger)
1948 : Il entre au CNRS comme attaché de recherche.
Il deviendra Chargé de recherche en 1953, puis Maître de recherche en 1959 et enfin
Directeur de recherche de classe exceptionnelle en 1975.
1949 : « Initiation à la danse des possédés » primé au festival du film maudit de Biarritz,
présidé par Jean Cocteau.
1953 : Il crée le Comité du film ethnographique avec Claude Lévi Strauss, André Leroi-
Gourhan, Henri Langlois, Enrico Fulchignoni, et Marcel Griaule .
1955 : Il réalise le film « Les Maîtres fous » primé en 1957 « meilleur film ethnographique
de la Mostra internationale d’art cinématographique de Venise » (Biennale).
1959-1965 :
« Moi, un noir » , prix Louis-Delluc en 1959
« Chronique d’été », prix de la critique international au festival de Cannes
« Rose et Landry » co-réalisé avec Michel Brault, Lion d’or de Saint-Marc « meilleur
documentaire de la vie contemporaine et de la documentation sociale » , Mostra
internationale d’art cinématographique de Venise
« La Chasse au lion à l’arc », Lion d’or de Saint-Marc « meilleur documentaire
ethnographique », XXVIe Mostra Internationale d'art cinématographique de
Venise,1965
Création du « Cinéma direct » à la fois dans sa philosophie et dans ses outils
1965 : Collaboration avec Claude Chabrol, Jean Douchet, Jean-Luc Godard, Jean-Daniel
Pollet et Éric Rohmer : il tourne « Gare du Nord », sketch du film « Paris vu par ».
1966 : Début du tournage, avec Germaine Dieterlen, des cérémonies soixantenaires du Sigui,
chez les Dogon du Mali (1966-1973)
Création avec cette dernière et Claude Lévi-Strauss du laboratoire audiovisuel en
sciences religieuses de l'École pratique des hautes études (Sorbonne)
1977 : Membre fondateur du festival du Cinéma du Réel au Centre Georges-Pompidou
1979 : Reçoit le Grand Prix international du Forum Architecture Communication Territoire.
Présentation intégrale de son œuvre cinématographique au Centre Georges-
Pompidou, à Paris, et dans quarante-six autres pays.
1981-1985 :
Visiting Professor à l'université de Harvard
1983 : Élection au poste de vice-président du Conseil international du cinéma et de la
télévision (UNESCO)
 6
6
1
/
6
100%