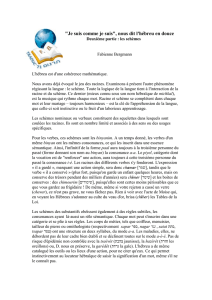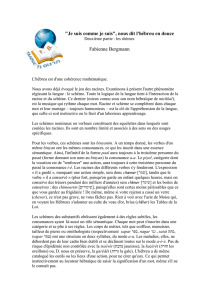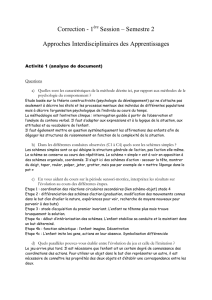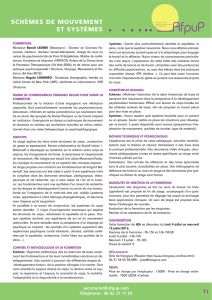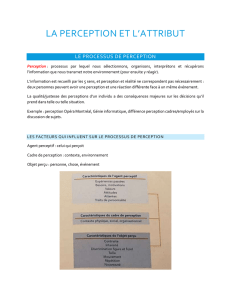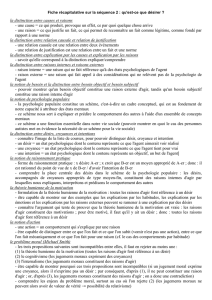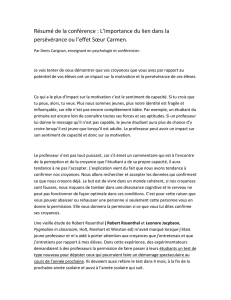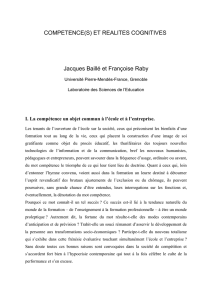competences collectives,savoirs et croyances sociales - LEST-cnrs

COMPETENCESCOLLECTIVES,SAVOIRSET
CROYANCESSOCIALES:SAISIRLECOGNITIFAUN
NIVEAUSTRATEGIQUEGRACEALACARTE
COGNITIVENEGOCIEE
Lesorganisationsprennentdesdécisions.Lescollectifsprennentdesdécisions.Onparleausside
stratégiescollectivesetorganisationnelles,voirede«vision»communeoupartagée.Pourtant,les
organisationsetlescollectifsnepensentpas.Cesontlesindividusquipensent.Celienentrepensée
individuelleetcollectiveestuneambiguïtélargementdébattueengestion(Halbwachs2002;
Schwartz,SARAZIN,andLAMBRICS2006;Islam2014).Sil’onveutcomprendreladécisionauniveau
del’organisationoud’uncollectif,ilsembledoncessentieldetranchersurcettequestiondu
mécanismesouterraindel’actioncollective.
Jeproposeicid’approcherlesujetparlebiaisdesreprésentations.Enanalysantenprofondeurles
«penséesd’ungroupe»,jesouhaitemontrerqu’ilexistebeletbienunevisioncollective,supérieure
àlasommedesindividusquicomposentlegroupe,etautonomeàuncertaindegré.
Eneffet,lefaitd’aborderl’organisationselonuneperspectivecognitivisteoffredeséclairages
profitables,commecelaadéjàétéétabli(Orléan2002;Cossette2004;LarocheetNioche2006),au
niveaudeladécisionindividuelle.Ilexisteégalementplusieursétudesquiontconstruitdescartes
collectivesenagrégeantlescartesmentalesdesmembresdel’organisation(WeicketBougon1986;
Eden1993).Mapropositionestd’allerau‐delàdecesoutilsetdesaisirlesélémentsquisontpropres
augroupeetdépassentlasommedespenséesindividuelles.
Ils’agiradoncicidefaireunpointsurlesélémentscognitifsquipermettentauxindividusdedécider
collectivement,pourcomprendrecequiestdel’ordredela«visionstratégique»dugroupe.Siles
compétencesetlesconnaissancesbénéficientd’uneabondantelittérature,lescroyances,pourtant
toutaussiutilespouragir,sontquantàellesplussouventoubliéescommemoteurcognitifde
l’action.Celavientsansdoutedel’héritageéconomistedelagestion,qui,commeleditOrléan(2002,
p.718),s’appuiesurl’idéeque«l’homoeconomicusnecroitenrien».Ilsembledoncimportantde
discuterlesrapportsqu’entretiennentcesdifférentstypesdereprésentations,etlerôlequ’elles
jouentdansladécisionetl’action.Lamobilisationdelaconceptdeschème(Allard‐Poesi1996;
Verstraete1998;Cossette2004;Vergnaud2007;Coulet2011;Coulet2013b),issuedelapsychologie
cognitive,s’avèrepertinente,àmonsens,pourétudierlafaçondontfonctionnentles
représentations,nonseulementauniveauindividuel,maisaussiauniveaucollectif.
Ainsi,l’analysedessavoirs(connaissancesuniversellementpartagées),descompétencescollectives
etdescroyancessociales(cequechacuncroitquetouslesautrescroient)donneunecompréhension
clairedecequepeutêtre«l’espritdegroupe»(groupmind,Islam2014)oulapenséecollective,et
desonautonomieparrapportàlapenséeindividuelle.Parailleurs,celaapporteunéclairage
intéressantsurlerôleessentieldesinteractions,etenparticulierdudébat,danslaconstructiondes

stratégies.
Apartirdeceraisonnement,noussouhaitonsmontrerquel’usaged’unecartecognitivecollective
négociéepeutêtreefficacepoursaisirlesschèmescollectifsàtraverslesinteractionsentrepensée
individuelleetcollective.Cettecartecognitiveestdite«négociée»carelleavocationàêtre
construitecollectivement,dansledébat,afindesaisirnonpasl’agrégationdespenséesindividuelles,
maisbienuneimagedesreprésentationssuffisammentpartagéesparlegroupepourservirdeguide
pourl’action,voiredesreprésentationsquisontpropresaugroupeetdiffèrentdel’agrégationdes
penséesindividuelles.
Aprèsavoirprésentélesfondamentauxdelaperspectivecognitiviste,nousdévelopperonsles
thèmesdecetteapprochequipermettrontdemieuxappréhenderlafaçondontfonctionnel’esprit
humain:schèmes,croyances,connaissancesetcompétencesserontclarifiés,ainsiquelesrelations
quiexistententretouscesconcepts.
Nouseffectueronsalorsunsautdel’individuelaucollectif.Pourcomprendrelesstratégiesdes
organisations,ilnousfauteneffetenvisagerlesschèmesauniveaudugroupe.Celanousamèneraà
nousinterrogersurlapertinenced’unenotionde«penséecollective»etàdéfinirplusendétailce
quesontlessavoirs,lescroyancessocialesetlescompétencescollectives.
Ils’agiraalorsdemontrerdansquellemesurelacartecognitivenégociéepeutsaisirles
connaissances,croyancesetcompétencesducollectif.Aprèsavoirdéfinicequesontlescartes
cognitives,nousdévelopperonslesspécificitésdecetoutil.
Nousnousappuieronsalorssurunexempledansunecollectivitélocalepourdonnerdesexemples
desavoirs,decompétencescollectivesetdecroyancessocialessaisissablesparlebiaisdecemodèle.
Nousprésenteronsd’abordlecontextespécifiquedecetteorganisation,avantdedécrireplus
précisémentladécisionétudiée,pourfinalementdonnerquelquesexemplesd’élémentscognitifs
collectifsautonomes.
L’INTERETD’UNEAPPROCHECOGNITIVEDESORGANISATIONS
L’utilitéd’uneapprochecognitivedesorganisationsaétélargementdémontréeparlepassé(Munier
etOrléan1993;Weick1995;Orléan2002;Orléan2004;Cossette2004;LarocheetNioche2006).En
particulier,encequiconcerneladécision,denombreusescritiquesdumodèlerationaliste
traditionnel,séquentieletcalculatoire,ontétablilesinsuffisancesintrinsèquesquilecaractérisaient.
Quecesoitenmettantenavantlespréférencesinstablesetleslimitescalculatoireset
informationnellesdesindividus(MarchetSimon1958;Simon1979),enintroduisantlehasardau
cœurdelamécaniquedechoix(Cohen,March,etOlsen1972;Huault2009),enredonnantleurplace
auxreprésentationsetauxcroyances(Munier1994;Cossette2004;LarocheetNioche2006)ou
encoreeninsistantsurlerôleprégnantducontexte,desnormessociales,desconventions,des
interactionsetdesstructuresdecoalitionsinternesauxorganisations(Cohen,March,etOlsen1972;
Weick1995;Orléan2002;Cossette2004;LarocheetNioche2006),cesauteursontrendu
incontournablelapriseencomptedelacognitionaucœurdelaréflexionsurlesstratégies
individuellesetcollectives.

Nouspouvonssynthétiserl’apportdecesrecherchesenmettantenavanttroisargumentsmajeurs
enfaveurd’uneapprochecognitivistedeladécision.
Enpremierlieu,cetteperspectiveprendencomptelacapacitédejugementdesdécideurs,plutôt
quedelesréduireàdesimplesmachinescalculatoiresetpurementrationnelles.Enétudiantlafaçon
dontlesindividuspensent,nouslesreplaçonsaucentreduprocessusdécisionnel(Cossette2004;
LarocheetNioche2006).
Etudiercequisepassedansl’espritdesacteurspermetdemieuxcomprendrecommentilsfontleurs
choix.Parexemple,s’intéresseràleurscroyances(Munier1994;Weick1995),àleursintuitions
(BertoluccietPinzon2015),àleurspréférences,àleursmotivationsouencoreauxbiaisquipeuvent
influencerleursdécisions(Schwenk1984;LarocheetNioche2006)permettradesaisirlanature
complexeduprocessusdécisionnel.
Lesecondintérêtquenousvoyonsàcechampdelarechercheestqu’ilconsidèreavecintérêtles
interactionsentrelesindividus.Lesgenspensentetagissentaussienfonctiondecequ’ilscroient
quelesautrescroient(cequeOrléan,2002,appellelacroyancesociale).SimonetMarch,quifurent
despionniersdel’introductionducognitifdansl’analysedeladécision,mirentenavantcerôle
essentieldesrelationsaucœurduprocessus(Simon1979;MarchetSimon1958;Cohen,March,et
Olsen1972;Huault2009).Marchprésentaitd’ailleursl’organisationcommeunespacepolitique,un
élémentessentielpourcomprendrecommentfonctionnentlescollectifsetcommentsont
construiteslesstratégies.Parailleurs,plusieurspsychologuesspécialistesdudéveloppementde
l’enfant,maisaussidifférentschercheursengestion,ontmontrédansquellemesurel’espritse
structureetapprendàtraversl’interactionavecautrui(Vygotski1929;Weick1995;Jovchelovitch
2006;Vergnaud2007;Piaget2013).Cetteanalysepermetd’appréhenderlafaçondontnospropres
penséespeuventêtreinfluencéesparnotreenvironnementsocial,parlesnormes,lesrègles,les
institutionsouencorelesconventions(Orléan2002;Orléan2004),quidéterminentcequenous
considéronscommeacceptableounondepenser.Aunerationalitépureetinstrumentale,la
perspectivecognitivisteopposedoncunerationalitécognitive(Munier1994),quiconsisteà
s’appuyersurlesopinionsquenousobservonschezautruipourconstruirenotrepropre
raisonnementetargumentation.PiagetetVygotski(Piaget2013;Vygotski1929),deuxpsychologues
dudéveloppementdel’enfant,ontd’ailleursmontréquelalogiqueestdenaturefondamentalement
sociale.Lalogiquedesenfantsseconstruitaucontactdeleurenvironnement,sestructure
progressivement.Lasociétéparticipeactivementàdéterminerainsilafaçonqu’aurontlesenfantsde
connaître.
Enfin,lesrecherchescognitivistes,souventconçuessuruneépistémologieconstructiviste,
considèrentquel’environnementestfondamentalementcomplexe(LeMoigne1990;Weick1995;
Cossette2004;LarocheetNioche2006;Vergnaud2007).Lesindividus,pouragir,ontdoncbesoinde
lesimplifier,del’ordonnerselondesschèmes(desstructuresmentales)pourluidonnerunsenset
éviterdesombrerdanslechaos.Laréalitétellequenouslapercevonsn’estdoncpasunedonnée
extérieureausujetmaisuneconstructiondel’espritLathéoriedel’enaction(Weick1995),en
particulier,expliquecommentnousconstruisonsl’environnementenagissantsurlui,etcomment,
enretour,ilnouscontraint.
Nousallonsdoncnousattacheràprésentàdécrireetàexpliquercesschèmes.Pourcela,ilnousfaut
commencerpardéfinirlesreprésentations,quisontdesensemblesdeschèmes,pour,petitàpetit,
entrerplusfinementdanslastructuremêmedecetobjetcognitif.

DESREPRESENTATIONSINDIVIDUELLES
Vergnaud(2007)définitlesreprésentationscommeunfluxdeconscience,unmouvementcontinude
notrepensée,grâceauquelnousconstruisonslaréalité.Cesreprésentationsorganisentl’action,et
sontenmêmetempsleproduitdenosactions.
Lesreprésentationssontdoncuneconstruction(Jovchelovitch2006;Vergnaud2007).Ellesse
constituentautraversd’uneffortdecommunicationetd’action.L’interactionestainsiaucœurde
leurémergence.Plusprécisément,c’estàtraversleprocessusd’enaction(Weick1995)quenos
représentationsseforment.Ennousconfrontantàl’environnement,nousagissonssurlui,ilagitsur
nousenretour,etc’estdecettefaçonquenouspouvonsélaborerdusens(sensemaking)et
fabriquerdesconnaissances.Lesreprésentationslientdoncchaquesujetauxautresetaumonde
objectif(Jovchelovitch2006).
Lesreprésentations,plusprécisément,sontunsystèmedeconceptsgrâceauquelnouspensonsle
réel(Vergnaud2007).Ellesprennentainsilaformederéseauxdeconceptsreliéslesunsauxautres,
etquel’onappellegénéralementdesschèmes(Verstraete1996;Allard‐Poesi1996;Cossette2004;
Vergnaud2007),maisquecertainsnommentstructuresmentales(Weick1995).Cesdiversschèmes
répondentàunbesoinnaturel:rendrelemondeintelligible,afindepouvoiragirsurlui.Nos
schèmesnouspermettentplusprécisémentdeuxchoses:ilsserventdecadreànosactionsetles
guident,etilsserventensuiteàdonnerdusensànosdécisionspassées.Lesschèmesnousdonnent
ainsilesentimentquenouspouvonscontrôlerlesévènements,parexempleenlesprédisant.
CONTENUETCARACTERISTIQUESDESSCHEMES
Leschèmeestunconstituantdelareprésentation.Safonctionestd’engendrerl’activitéensituation,
aufuretàmesure(Coulet2011;Coulet2013).Leschèmeestainsiune«totalitédynamique
fonctionnelle.»(Vergnaud2007).Cecisignifiequeleschèmeestuntout,etque,sil’onpeutanalyser
sescomposantes,ilnepeutpasfonctionners’ilnelesenglobepastoutes.Observerlacomposition
d’unschèmepermetcependantdecomprendrecequ’ilestetcommentilorganisel’activité.
Lesquatrecomposantesd’unschèmesontlesanticipations,lesrèglesd’action,lesinférencesetles
invariantsopératoire(Coulet2011;Coulet2013;Vergnaud2007).
Lapremièrecomposante,l’anticipation,correspondauxattentesderésultatliéesauschème.Cesont
sesbuts,voiresessous‐buts.Onpeutaussiparlerdel’intention,dudésir,dubesoin,dela
motivation.Ainsi,lesschèmessontintentionnalisés,anticipatifs.Ilssonttournésversunobjectif.
Sinon,ilsseraientvidesdesens.
Lesrèglesd’actionserventàorganiserl’activité,c’estàdirenonseulementl’actionelle‐mêmemais
égalementtoutcequiconcernelaprised’informationetlecontrôledecetteaction.Lesrègles
d’action,ces«composantesgénérativesduschème»(Vergnaud2007),engendrentdoncl’activitéau
furetàmesure.Elleslaconduisent.Onvoitlàlelienétroitentrereprésentationetactivité.
Lesinférencesconsistentenunajustementduschèmeselonlasituation(Coulet2011;Coulet2013).
Nouschoisissonslarègled’actionadaptée,pertinente,enfonctionducontexteprécis,actuelet

situé,danslequelnousévoluons.L’activitéhumainen’estdoncjamaisautomatique.Elleestrégulée
pardesadaptationslocales,desajustementsprogressifs.L’actionnesedéroulejamaisdefaçon
systématique,àpartird’unstimulus,maisesttoujoursinscritedansunenvironnementetun
maintenantbienprécis.Leschèmeadoncuncaractèrefondamentalementadaptable.
Enfin,lesschèmessecomposentd’invariantsopératoires,autrementditdeconceptualisations.Ils
sontinvariantscarilsontunaspectuniversel(ilss’appliquentàuneclassedesituations)et
opératoirescarilspermettentl’action(Coulet2011;Coulet2013).Cesélémentsduschèmeontpour
fonctiond’identifieretdereconnaîtrelesobjets,leurspropriétés,leursrelationsetleurs
transformations(Vergnaud2007).Lorsquecesinvariantsexistentdéjàchezlesujet,ilssontcombinés
ourecombinéspourinterpréterlasituation.Lorsqu’ilsn’existentpasencore,ilsémergenten
situationets’articulentauxinvariantsantérieurs(Coulet2011).Cesdeuxactivités(combinaisonet
émergenced’invariants)sontlesdeuxformesdelaconceptualisation.
Lesinvariantsopératoiresformentalorsdessystèmesdeconcepts,implicitesouexplicites,
conscientsounon.C’estparcebiaisquenousorganisonsetpensonsleréel.C’estpourquoi
Vergnaud(2007)considèrequ’elles«formentlapartielaplusdirectementépistémiquedu
schème.»C’estàceniveau‐làduschèmequel’onretrouvelesconnaissancesetlescroyancesqui
structurentnotremodedepensée.
Cesinvariantsopératoiressontdedeuxsortes:lesconcepts‐en‐acteetlesthéories‐en‐acte.Les
premiersserventàrepérerlesélémentspertinents(etnonpasvraisoufaux)àretenirdansnotre
environnementpouragir.Lessecondssontdespropositionstenuespourvraies.Onpeutdirequeles
théories‐en‐actepermettentdejustifiernotreaction,tandisquelesconcepts‐en‐actesélectionnent
lesélémentsdelasituationàprendreencomptepouragir(Coulet2011;Coulet2013).Ilsontdonc
deuxfonctionsdeconceptualisationdifférentes,maissontinextricablementliés.Lesconcepts‐en‐
actesontconstituésdethéories‐en‐acte.Lesthéories‐en‐acteformentlecontenudesconcepts‐en‐
acte.End’autrestermes,c’estdufaitquenoustenonscertainespropositionspourvraiesquenous
pouvonsdéterminerlesinformationspertinentesàretenirdansl’environnement.
Parlebiaisdesinvariantsopératoires,leschèmeaunecaractéristiquefondamentalementinvariante.
Puisquecesinvariantsconcernentuneclassedesituation,ilssontuniversels(Coulet2011;Coulet
2013).
Leschèmeestdoncàlafoisinvariantetadaptable.Ilad’uncôtéunaspectsystémiqueetunivoqueà
traverslesinvariantsopératoires,etàlafoisuncaractèrecontingentdufaitdesinférences.Ce
paradoxepermetdecomprendrecommentfonctionnel’activité,commentellesestructure:nous
sélectionnonslesinvariantsquinoussemblentêtrelesplusadaptésàl’analysedelasituation
présente.Onpeutdirequel’organisationdel’actionestinvariante,alorsquel’activitéelle‐mêmeest
adaptable.Lesschèmesontfinalementcetteforme:«Si…alors»(Vergnaud2007).Onpourraitle
développerainsi:«Sijemeretrouvedanstelleclassesituation,jepeuxmobilisertelschème.A
partirdecequej’observedelasituationactuelle,jepeuxchoisirleschèmeàmobiliseretl’adapterà
laspécificitéprésente.»OncomprendalorsladéfinitionqueproposeCoulet(2013,p.14)dece
schème:c’estuneformeinvarianted’organisationdel’activitéetdelaconduitepouruneclassede
situationsdéterminées.
Onpeutfinalementrésumerlafonctionduschèmedelafaçonsuivante:ilnoussertàpréleveret
sélectionnerlesinformationspertinentesdansl’environnement,àanticiperlesconséquences
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%