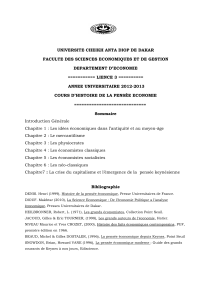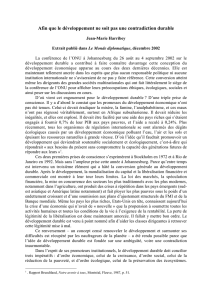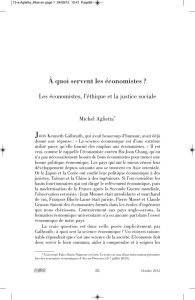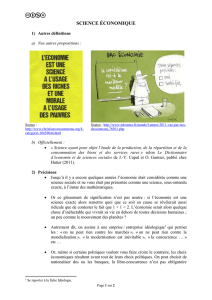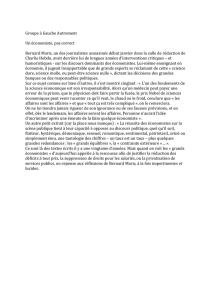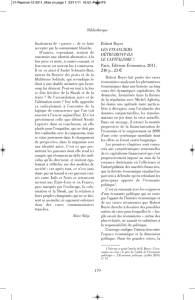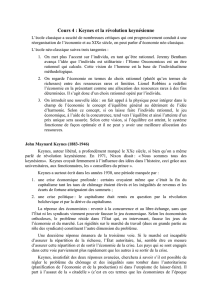la trahison des économistes


LA TRAHISON DES ÉCONOMISTES
Gre au-Trahison-eco.indd III 25/07/08 17:33:01

Gre au-Trahison-eco.indd IV 25/07/08 17:33:01

*%!.,5#'2³!5
,!42!()3/.
$%3
³#/./-)34%3
LEDÏBAT
'ALLIMARD
Gre au-Trahison-eco.indd V 25/07/08 17:33:03

© Éditions Gallimard, 2008.
Gre au-Trahison-eco.indd VI 25/07/08 17:33:04
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
1
/
22
100%