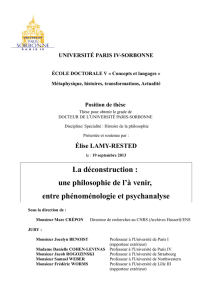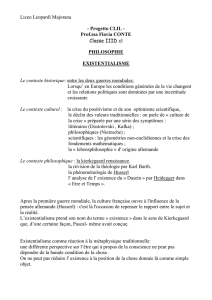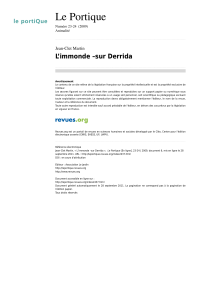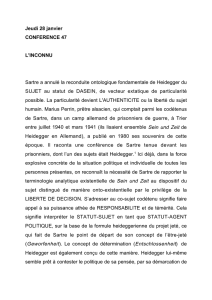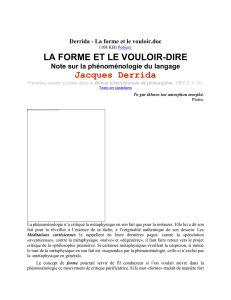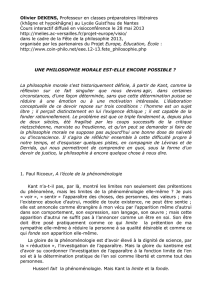Subjectivité et animalité. L`animal en question dans l`œuvre de

Subjectivité et animalité. L’animal en question dans
l’œuvre de Jacques Derrida
Mémoire
Jean-François Perrier
Maîtrise en philosophie
Maître ès arts (M.A.)
Québec, Canada
© Jean-François Perrier, 2016

Subjectivité et animalité. L’animal en question dans
l’œuvre de Jacques Derrida
Mémoire
Jean-François Perrier
Sous la direction de :
Sophie-Jan Arrien, directrice de recherche

iii
Résumé
Ce mémoire se donne pour objectif d’expliciter et d’interroger les dimensions
phénoménologique et éthique de la question animale à partir des écrits de Jacques Derrida.
Pour ce faire, en prenant pour fil directeur les intrications entre la subjectivité et l’animalité,
nous tenterons d’exhumer les moments dogmatiques au sein de la phénoménologie de Husserl
et de Heidegger quant à leur conception des animaux. Dans un premier temps, nous
expliciterons la position de Derrida à l’égard de la thèse heideggérienne qui oppose le Dasein et
ce qui ne serait que « seulement vivant ». Dans un second temps, nous nous intéresserons aux
écrits de Derrida sur la phénoménologie de Husserl afin de comprendre pour quelles raisons
Derrida n’adhère pas non plus à un continuisme entre les hommes et les animaux. Enfin, ne
souscrivant ni à la thèse discontinuiste de Heidegger, ni celle continuiste de Husserl, nous
aborderons les conséquences éthiques que Derrida dégage à partir de l’impossibilité de penser
autant le propre de l’homme que le tout autre qu’est l’animal, nous engageant par là dans sa
pensée de l’hospitalité et de la responsabilité au-delà de toute subjectivité.

iv
Table des matières
Table des matières
RESUME .................................................................................................................................... III
TABLE DES MATIERES ......................................................................................................... IV
REMERCIEMENTS ................................................................................................................. VI
INTRODUCTION. LA QUESTION DES QUESTIONS .......................................................... 1
CHAPITRE I. LE PROBLÈME DE LA MORT : LA DIFFÉR
A
NCE ENTRE L’HOMME
ET L’ANIMAL ..............................................................................................................................8
1.1 L’ANIMAL COMME « SEULEMENT VIVANT » DANS ÊTRE ET TEMPS ET LES CONCEPTS
FONDAMENTAUX DE LA METAPHYSIQUE ....................................................................................... 8
SECTION I ................................................................................................................................... 13
1.1.1 Clarification de l’« interprétation privative » de la vie dans Être et temps .............................................. 13
1.1.2 La conviction de Husserl dans la stratification de l’être animé ................................................................... 15
1.1.3 L’interprétation privative considérée comme une zoologie négative : l’animal-indicible chez Françoise Dastur
......................................................................................................................................................................... 16
1.1.4 Explicitation du mode d’être de l’animal .................................................................................................. 18
1.1.5 Outil (Zeug), organe, organisme.............................................................................................................. 19
1.1.6 L’organisme animal en tant qu’il n’est ni sujet ni objet ............................................................................. 22
1.1.7 Le se-comporter (Sichbehnemen) animal dans l’accaparement (Benommenheit) ................................ 25
1.1.8 Le singe sans main et le chien qui avale : une soustraction du Dasein à tout biologisme............................ 30
1.1.9 Décloisonnement de l’accaparement animal ............................................................................................... 33
1.1.10 La différance de la capacité .................................................................................................................... 34
1.1.11 Le comportement de curiosité .................................................................................................................. 36
SECTION II .................................................................................................................................. 42
1.2 LE PROPRE DE L’HOMME : LA MORT ......................................................................................... 42
1.2.1 L’être-pour-la-mort comme possibilité la plus propre du Dasein ................................................................ 43
1.2.2 Les différents types de finir : mourir (Sterben), décéder (ableben) et périr (verenden) ........................... 45
1.2.3 La mort comme possibilité de l’impossible ................................................................................................. 48
1.3 VERS UNE LIMITROPHIE ........................................................................................................... 53
CHAPITRE II. LE CORPS DE LA PAROLE : L’IMPOSSIBLE PHÉNOMÉNOLOGIE ..... 56

v
2.1 DE HEIDEGGER A HUSSERL : DE LA DISCONTINUITE A LA CONTINUITE DE L’HOMME AVEC
L’ANIMAL ....................................................................................................................................... 56
2.1 La constitution de l’animal dans les Ideen II ............................................................................................... 58
2.1.1 L’accès phénoménologique à l’animalité .................................................................................................... 59
2.1.2 L’auto-affection de la chair ....................................................................................................................... 61
2.1.3 La sortie de l’attitude solipsiste : le détour par l’intropathie (Einfühlung) .................................................. 65
2.1.4 L’humainisme de Husserl ........................................................................................................................ 69
2.2 L’IMPOSSIBILITE D’UNE EXPERIENCE SOLIPSISTE : UNE RADICALISATION DE
L’INTERSUBJECTIVITE .................................................................................................................... 73
2.3 LE PRESENT VIVANT ................................................................................................................ 77
2.3.1 La distinction essentielle entre expression et indication .............................................................................. 77
2.3.2 Le monologue intérieur ............................................................................................................................. 79
2.3.3 Le temps démantelé de la conscience .......................................................................................................... 82
2.3.4 La mort dans le présent vivant ................................................................................................................. 84
2.4 VERS UNE NOUVELLE RESPONSABILITE ................................................................................... 87
CHAPITRE III. DE LA PHÉNOMÉNOLOGIE À L’ÉTHIQUE ANIMALE ....................... 89
3.1 DE LA PHENOMENOLOGIE A L’ETHIQUE ................................................................................. 89
3.1.1 L’impossible : ouverture de l’éthique ......................................................................................................... 91
3.2 AU-DELA DE LA SUBJECTIVITE SOUVERAINE ........................................................................... 95
3.2.1 La structure sacrificielle (le sacrifice carnivore) et le carnophallogocentrisme ................................................ 99
3.3 L’HOSPITALITE ENVERS LES ANIMAUX ................................................................................... 103
3.4 LA RESPONSABILITE ENVERS LES ANIMAUX .......................................................................... 111
3.5 LA DISSYMETRIE .................................................................................................................... 114
CONCLUSION. LA DÉMOCRATIE À-VENIR .................................................................... 118
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................... 123
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
1
/
133
100%