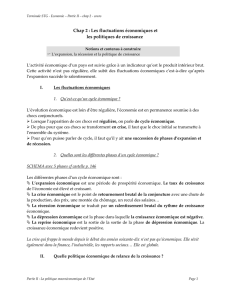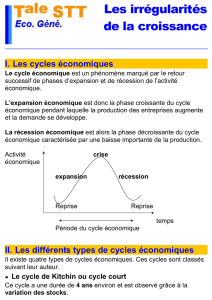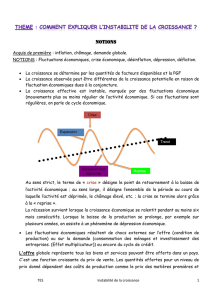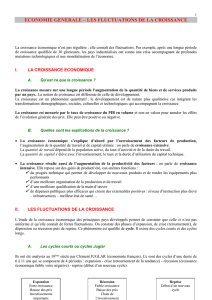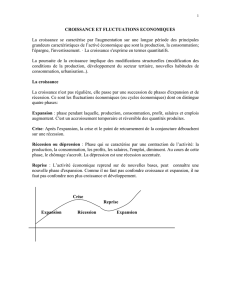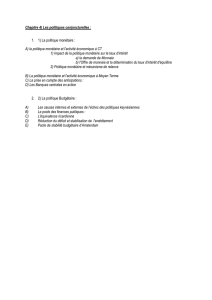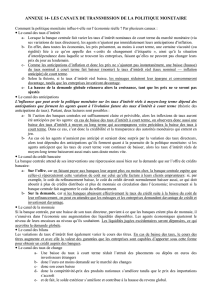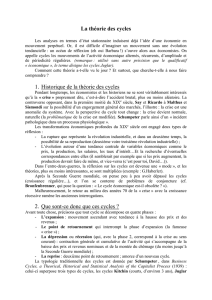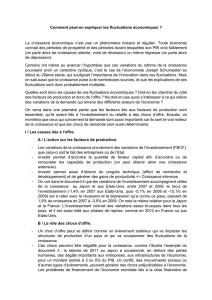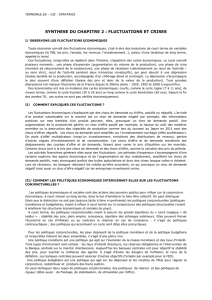Chapitre 2 Les constituants théoriques de la théorie

Chapitre 2 Les constituants théoriques de la théorie moderne des
fluctuations
« Avant le voyage, lire les cartes marines »
Cette introduction « théorique » consiste à établir la correspondance du modèle Océan
proposé plus loin avec les présentations les plus connues de la littérature des fluctuations et
des crises et de classer celles qui s’y intégrent complètement et celles qui ne s’y retrouvent
qu’en partie. La question posée est de savoir si le modèle Océan sera apte à tirer correctement
parti des enseignements délivrés par les économistes du passé ou contemporains. L’idée ayant
déjà été émise que les cycles s’expliquent par une variété de causes, ces enseignements
théoriques sont donc plus complémentaires que rivaux et un modèle général réaliste des
fluctuations se doit d’en accueillir la plupart ; rassemblées, elles en constituent l’essentiel
sinon la totalité. Suivons donc la route tracée par les explorateurs célèbres sans négliger de
rallier à « Océan » les bouquets de littérature et de faits suscités par la crise économique
récente.
Section 1 Les voies keynésiennes, toujours empruntées
Suivons la voie keynésienne, encore souvent les premières marches que gravissent les
étudiants. L’explication financière ou monétaire n’y est pas primordiale ; des facteurs
objectifs ou des anticipations portant sur des valeurs réelles sont au premier rang des raisons
fournies par l’amplificateur consommation-investissement. La ligne de départ est celle d’une
propension à investir instable, l’hypothèse marquante du scénario décrit par John Maynard
Keynes.
Keynes …
Keynes s’intéresse à un type particulier de mouvement cyclique : la dépression grave
et prolongée, caractérisée par un brusque retournement de la conjoncture à la baisse, un long
déclin et une reprise lente et graduelle. Ce schéma correspond bien aux réalités de l’entre-
deux guerres (Angleterre des années 20, Etats-Unis et bien d’autres pays dans les années 30).
Le brusque retournement est dénommé « crise ». Il vient d’une chute de l’ « efficacité
marginale du capital » causée par des facteurs psychologiques : les perspectives de rendement
de l’investissement. En fin d’essor économique il arrive toujours un moment où, à la suite

d’espoir exagérés et de mouvements spéculatifs sur le marché boursier, les entrepreneurs se
mettent à douter :
« Puisque les marchés financiers organisés sont soumis à l’influence d’acheteurs qui ignorent
pour la plupart ce qu’ils achètent et de spéculateurs qui s’intéressent plus à la prévision du prochain
changement de l’opinion boursière qu’à l’estimation rationnelle des rendements futurs des capitaux, il
est normal, lorsqu’une déception frappe un marché surévalué et trop optimiste, que les cours baissent
d’un mouvement soudain et même catastrophique ».
Cette citation rencontre pleinement une possibilité exprimée au chapitre précédent,
l’idée selon laquelle la séquence passée des prévisions, ici exagérément optimistes, se
retourne pratiquement sans autre raison que d’avoir trop duré ou à la merci d’une simple
déception. L’analyse de Keynes est donc d’emblée tournée vers la prise en compte des
anticipations.
Les anticipations portant sur la profitabilité de l’investissement sont hautement
volatiles. Les observations du passé ne sont pas d’un grand secours pour prévoir la suite. Le
monde de Keynes est un monde d’incertitude radicale. C’est la raison pour laquelle on
cherche plutôt à prédire les mouvements du marché boursier, eux-mêmes soumis à des
facteurs irrationnels. En conséquence, en cas de baisse des profits, la baisse des cours peut
être beaucoup plus brutale. Dès lors, les investisseurs se détournent encore plus des nouveaux
projets car s’ils réunissent des moyens, ils peuvent préférer acquérir les actifs existants dont la
valeur boursière a baissé plutôt qu’investir.
Le mouvement de récession peut être relayé et amplifié par la hausse de la préférence
pour la liquidité causée par l’incertitude face à l’avenir, le découragement et la baisse du taux
d’intérêt qui en résulte. Keynes insiste bien pourtant sur le fait que le phénomène premier est
la baisse de l’efficacité marginale du capital car la préférence pour la liquidité ne commence à
augmenter que lorsque l’efficacité marginale du capital s’est effondrée. C’est pourquoi, nous
dit Keynes : « il est difficile d’enrayer la baisse » (John Maynard Keynes 1936, page 329).
Certains commentateurs ont soutenu [voir Alan Coddington (1982)] que dans
l’analyse de Keynes, ce n’est pas l’incertitude en elle-même qui est essentielle mais plutôt la
manière dont les individus sont censés y faire face. De fait, imaginons que les décisions
d’investissement étant entourées d’une grande incertitude, les producteurs réagissent en
prenant autant que possible les mêmes décisions que par le passé et ceci parce que le résultat
de leurs actions passées sont les seules choses connues d’eux. Il n’en résulterait pas des

décisions hasardeuses ou désordonnées génératrices de fluctuations ; ce comportement
conduirait probablement à une plus grande stabilité que celui qui s’appuie sur des calculs
savants ou des prévisions soi-disant exactes. En elle-même, l’incertitude n’autorise donc pas
l’observateur à supposer une évolution capricieuse et plus désordonnée des variables
macroéconomiques. Ce point est néanmoins sans portée particulière si l’on admet que les
décisions dépendent des anticipations de façon complexe et non linéaire (moyenne,
dispersion, valeurs extrêmes) comme le fera le modèle général Océan. En bref, on ne peut à la
fois dire que les anticipations sont influentes pour les décisions des agents et le
fonctionnement de l’économie et dire ensuite qu’elles pourraient ne pas l’être s’il en était
autrement.
... une illustration du processus « impulsion-propagation » : l’oscillateur de Samuelson
Tous les bébés-économistes des générations d’après-guerre ont été bercés voire même un peu
secoués par l’oscillateur de Samuelson (1939) avant de se précipiter gaiement sur le « cheval
à bascule » de Knut Wicksell (1907). Celui-ci observait que des coups de bâton assénés de
haut en bas à un cheval à bascule se transforment en mouvements oscillatoires de plus en plus
amortis. Frapper l’économie de chocs semblables renouvelés peut néanmoins faire que le
mouvement d’oscillations ne s’arrête pas et lui fasse connaître des fluctuations récurrentes
d’intensité variable.
Dans la version de Samuelson, les chocs sont des chocs de demande : dépenses
gouvernementales, investissements ou autres dépenses « autonomes » tant positifs que
négatifs, le lien avec la pensée de Keynes étant la variabilité de la demande d’investissement
en point de départ du processus ; la demande globale est entraînée dans le même sens, ainsi
que la production Y et le revenu national, par le déroulement du multiplicateur keynésien
fondé sur la forte propension marginale à consommer le revenu courant. La variation des
débouchés suscite à son tour l’obligation d’adapter le capital productif selon le mécanisme de
l’accélérateur [Albert Aftalion (1913) et John Maurice Clark (1917)] avec une intensité qui
dépend du « coefficient de capital marginal » v soit : dK = v.dY. L’enchaînement combinant
les deux effets se poursuit en générant des fluctuations et aboutit à quatre cas typés selon
l’ampleur des réactions de l’investissement et de la consommation : convergence vers un
nouvel équilibre, oscillations amorties, oscillations aggravées et divergence explosive ; le tout
évidemment multiplié par deux en tenant compte des chocs négatifs ou positifs. Parmi ces
situations, certaines sont néanmoins plus probables que d’autres. On peut admettre par

exemple que des tendances haussières de forte intensité se heurteraient vite à la non-
disponibilité des facteurs de production et se trouvent donc limitées par elle.
Dans le cas des chocs négatifs, le risque de crise se produit surtout lorsque les
multiplicateurs et accélérateurs sont forts et peuvent précipiter l’économie dans les zones
d’oscillation ou de divergence aggravée. Pour parer à ce danger, une action toute keynésienne
s’impose : contrer ces chocs négatifs en alimentant la demande globale par des politiques de
déficit budgétaire.
Il ne s’agit pas de faire ici une longue analyse d’un modèle aussi célèbre qu’irréaliste ;
à vrai dire, on s’étonnerait plutôt qu’une mécanique aussi simpliste ait pu fasciner à ce point
les économistes d’une époque récente et continue d’être proposée sérieusement aux étudiants
actuels. Comme IS-LM, il s’agit sûrement d’un rite commode ! Mais pour ne pas jeter le bébé
avec l’eau du bain, on doit néanmoins saluer au passage une forme d’enchaînement qui s’en
rapproche et que le modèle général recherché peut formaliser.
Cette attache dynamique se lit à partir de trois équations (Annexe I) extraites du
modèle Océan : d’abord, la relation de détermination du produit ensuite les deux fonctions
d’anticipation commandant respectivement la consommation et l’investissement, celle du
produit futur et celle des profits futurs. On suggère dans le modèle général les mécanismes
s’inspirant de la pensée keynésienne et reproduisant tant bien que mal la dynamique (ici
baissière) de l’oscillateur de Samuelson : les débouchés futurs influencent les perspectives de
rentabilité des investissements ; l’équation de détermination du produit fixe la production ; les
perspectives de revenu futurs sont alors affectées ; la consommation est enfin touchée et le
processus se poursuit en s’amplifiant. Une spirale négative de récession est enclenchée et
conduit dans bien des cas à une position d’équilibre plus faible pour la production et l’emploi,
du moins lorsque les anticipations ne « dérapent » pas et qu’on peut éviter la
« transformation » du modèle en modèle de crise.
Bien sûr cet enchaînement est réversible, pour peu que les anticipations soient
d’emblée optimistes ou le redeviennent au moment des reprises. Bien sûr aussi les variables
soulignées ne sont pas les seules à réagir et c’est l’ensemble du modèle qui joue. Néanmoins,
les réactions privilégiées par l’analyse constituent les grandes rivières de la théorie
keynésienne d’amplification des fluctuations et les autres mécanismes y font seulement figure
de ruisseaux.

Hors du « corridor » ?
Pour que les évènements décrits conduisent à une crise profonde et durable, ils doivent
prendre une ampleur suffisante, tant du côté de la consommation que de celui des
investissements. Axel Leijonhufvud (1973), l’un des fondateurs de la » théorie du
déséquilibre » a résumé cette condition sous la forme d’une image, celle du « corridor ».
L’économie serait stable au voisinage de l’équilibre, les ajustements nécessaires prenant place
pour éliminer les sources d’instabilité grâce à la flexibilité relative des prix et salaires ; en
revanche, passées les limites du corridor, le retour à l’équilibre deviendrait plus
problématique et les déséquilibres auraient tendance à se renforcer et à s’accumuler selon un
processus que décrit en détail la théorie de l’équilibre général à prix fixes. La baisse durable
du revenu disponible se traduirait par un appauvrissement et une consommation limitée par
cet appauvrissement. Dans son analyse de la crise de 2008, Leijonhufvud (2009) y ajoute la
modification durable des comportements d’investissement liée à la baisse marquée des
perspectives de profit et donne en exemple la situation du Japon, pays dont le maintien en
crise après 1990 tient à la stagnation des profits attendus des investissements, combinée aux
difficultés de leur financement.
Ceci s’apparente à une « transformation », transformation qui s’opère lorsque se
produit la radicalisation des anticipations sur les valeurs extrêmes et qui vient ici d’une
accentuation du pessimisme relatif aux débouchés et revenus présents et futurs. Pourtant, telle
que la constate Leijonhufvud, la situation de 2008 est plutôt éloignée d’une mécanique
keynésienne à l’ancienne (de type oscillateur) parce que, si les ménages ont réduit leur
consommation, c’est moins en raison la baisse de leur revenu disponible qu’à cause de leur
désir d’épargne de précaution face aux incertitudes de leurs revenus futurs. Ce dernier point
met la réalité en accord plus évident avec une détermination du produit et sa genèse de
synthèse néoclassique. Peut-être d’ailleurs n’en-a-t-il pas été toujours ainsi, notamment à une
époque où les ménages étaient plus « keynésiens » que « classiques », leur consommation
suivant plus les variations de leur revenu disponible courant. En outre, les considérations de
crédit, négligées par l’analyse keynésienne traditionnelle, sont désormais prédominantes, dans
le cas du Japon comme dans celui de la crise économique et financière de 2008. C’est donc de
ce côté qu’il faudra désormais se tourner !
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
1
/
29
100%