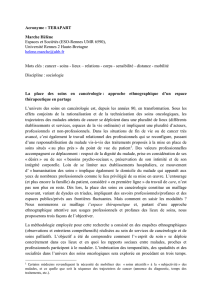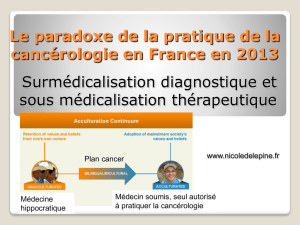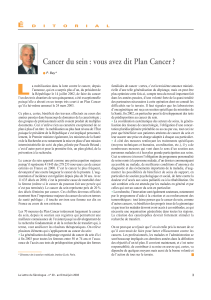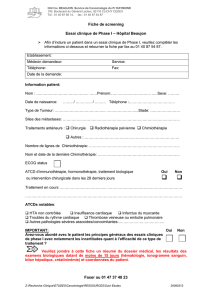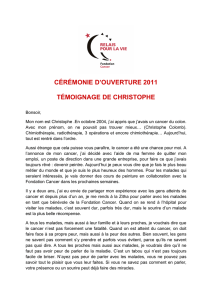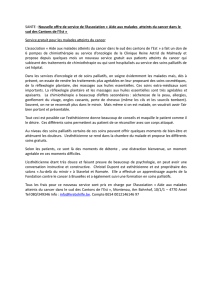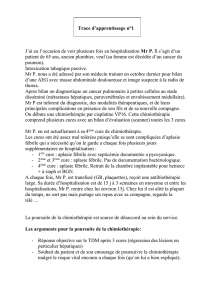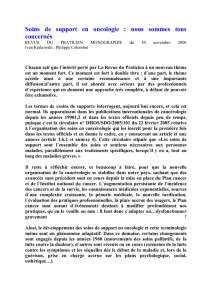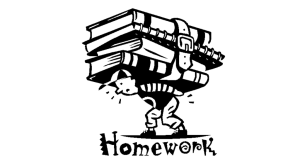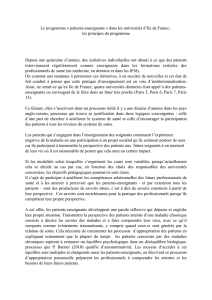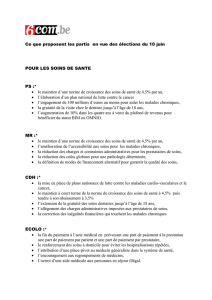Don et sacrifice en cancérologie

Don et sacrifice en cancérologie
Isabelle Marin*
LA LUTTE contre le cancer, devenue cause nationale, mobilise pres -
que tous les acteurs de santé et consomme des ressources considé-
rables. Les prévisions à moyen et long terme justifient ce souci : l’in-
cidence de nombreux cancers augmente (comme celle du cancer du
sein ou du colon), celle des cancers du poumon semble stabilisée
grâce à la prévention qui commence à porter ses fruits au moins dans
certaines couches de la population.
Mais, dans la mortalité générale, la proportion de morts due au
cancer ne cesse de croître. Nous nous inquiétons donc d’un destin qui
nous promet de mourir cancéreux ou de rejoindre la cohorte attendue
et redoutée des grands vieillards1. Les progrès en matière de traite-
ment sont certains : des protocoles bien conduits diminuent très signi-
ficativement le nombre de récidives, d’autres allongent la durée de
vie des malades ou améliorent leur qualité de vie. Il n’est donc pas
question de remettre en cause ni le chantier, ni ses succès. En marge
des données scientifiques et médicales, nous cherchons ici à réfléchir
à certains aspects anthropologiques que peuvent évoquer des modes
de traitement et d’organisation. Car le cancer occupe une position
bien particulière dans notre monde et dans les représentations collec-
tives comme, dans un autre temps, la tuberculose. Il est le symbole
même de la mort et de la souffrance, éclipsant les maladies cardio-
vasculaires qui pourtant le précèdent dans les statistiques de morta-
lité. Le « crabe », la « bête » qui ronge de l’intérieur, pousse et proli-
fère, renvoie à des fantasmes d’
alien
particulièrement terrifiants,
posant cette maladie comme paradigmatique du mal et de l’altérité de
Juillet 2007
1
* Auteur de
Allez donc mourir ailleurs! Un médecin, l’hôpital et la mort,
Paris, Buchet Chas-
tel, 2004. Voir ses précédents articles dans
Esprit
: « L’agonie ne sert à rien », juin 1998 ; « Trai-
ter l’agonie », janvier 1992 ; « La dignité humaine, un consensus ? », février 1991.
1. Et probablement des deux, car le cancer survient beaucoup plus fréquemment à mesure
que l’âge avance.
a-Marin:Mise en page 1 8/06/07 14:53 Page 1

la mort. Les institutions de lutte contre le cancer depuis des décen-
nies sont également parallèles au système de santé proprement dit,
comme l’était en son temps le système de lutte contre la tuberculose
avec ses sanatoriums, ses dispensaires et son corps de médecins spé-
cialistes. Les centres anticancéreux sont de puissants et riches orga-
nismes couvrant l’ensemble du territoire et disputant aux centres hos-
pitaliers universitaires renommée et clientèle. L’Institut national du
cancer récemment créé pour piloter l’ensemble du dispositif est tota-
lement indépendant. Certes, les techniques particulières nécessaires
au traitement du cancer (radiothérapie, curiethérapie et chimiothéra-
pie), l’implication de presque toutes les spécialités médicales et de
multiples professionnels, associée à la pénurie des cancérologues,
expliquent la nécessité d’une organisation propre qui constitue néan-
moins un signe politique et symbolique fort.
Comme pour la tuberculose, ce mode de prise en charge organise
un certain ostracisme des malades. L’exil des tuberculeux contagieux
à la montagne, dans les ghettos des sanatoriums, est remplacé par
l’isolement social des cancéreux marqués physiquement par les chi-
miothérapies (par leur teint, leur calvitie et leur amaigrissement), iso-
lement mal combattu par de récentes campagnes publicitaires. Plutôt
mal reçus aux urgences des hôpitaux, renvoyés des cabinets libéraux
vers l’hôpital, ils fréquentent des hôpitaux de jour qui leur sont réser-
vés pour subir ou bénéficier de la chimiothérapie, sont hospitalisés
dans des services spécifiques de cancérologie et sont ensuite pris en
charge par les réseaux de cancérologie et de soins palliatifs pour finir
leurs jours dans les unités de soins palliatifs2.
Pourquoi des traitements systématiques?
Si les dépenses de santé sont souvent stigmatisées, il n’est que
rarement fait mention du prix exorbitant des traitements du cancer
(chimiothérapie, monoclonaux et cothérapeutiques3) même si leur
efficience est assez médiocre. À titre d’exemple, en 2001, l’augmen-
tation annuelle des dépenses en médicaments de l’institut Curie, cor-
Don et sacrifice en cancérologie
2. L’ensemble du dispositif de soins palliatifs a été initialement mis en place pour les
malades de cancérologie, puis développé lors de la survenue de l’épidémie de sida. Il est
actuellement consacré de façon très majoritaire aux malades cancéreux : les unités de soins pal-
liatifs, services d’hospitalisation classiques, sont occupées par 80 à 90 % de malades cancé-
reux. On retrouve la même proportion de cancéreux dans les réseaux de soins palliatifs qui
coordonnent les professionnels de ville ; tant dans notre société le cancer est associé à la mort à
venir.
3. De plus en plus fréquemment, les traitements classiques de chimiothérapie sont associés
à des médicaments protecteurs qui permettent une meilleure tolérance. D’abord les nausées et
les vomissements ont été combattus de façon plus efficace, puis les aplasies sanguines sont pré-
venues comme les anémies ou les complications cardiaques. L’amélioration de la qualité de vie
des malades, obtenue actuellement, passe le plus souvent par cette meilleure tolérance au trai-
tement, ce qui ne laisse pas d’être paradoxal.
2
a-Marin:Mise en page 1 8/06/07 14:53 Page 2

respondait à l’ensemble de l’enveloppe dévolue aux soins palliatifs
pour toute l’Île-de-France. Or dans les stades avancés de nombreux
cancers, les traitements s’ils sont certainement efficaces (au sens sta-
tistique) n’allongent la durée de vie des malades que de deux ou trois
mois en moyenne4. Bien peu de débats publics, voire professionnels
s’organisent autour de l’opportunité de consacrer de telles sommes
aux dépens d’autres secteurs de la santé : pour peu que le traitement
soit efficace, et quel que soit le degré d’efficacité, il est adopté
comme la règle, quel que soit son coût et proposé à tout malade qui
pourra éventuellement le discuter mais sans, ou très rarement,
connaître les chiffres exacts d’amélioration prévisible5.
La généralisation des traitements préventifs, administrés après un
geste chirurgical pour éviter les récidives, pose les mêmes questions :
après une intervention sur cancer du sein, et selon des critères pro-
nostiques très rigoureux, sont préconisés des traitements complémen-
taires de chimiothérapie, radiothérapie ou hormonothérapie dès qu’ils
améliorent la survie du groupe étudié de 5 %. C’est dire que dans cer-
tains groupes, l’ensemble des femmes va recevoir une chimiothérapie
qui ne sera utile qu’à très peu : 70 à 90 % des femmes n’en auront pas
besoin parce qu’elles sont déjà guéries par le geste chirurgical et
pour 5 % la chimiothérapie n’aura servi à rien parce qu’elles seront
résistantes au traitement et rechuteront malgré tout6. Les médecins,
spécialistes ou non spécialistes, ne remettent jamais en cause ces
attitudes alors que la proposition de chimiothérapies préventives7,
entraînant les mêmes gains en survie pour d’autres types de tumeurs
leur semble illicite (comme dans le cas du poumon et du pancréas).
Ces différences d’attitudes nous indiquent bien qu’il n’est pas seule-
ment question de savoir (bénéfice scientifiquement démontré) mais
bien de représentation ; ce qui vaut pour le sein ne vaut pas pour le
poumon. L’allongement de survie démontré est valorisé par le corpus
de savoirs admis : le cancer du sein et ses métastases répondent bien
aux chimiothérapies, les différents protocoles ont amélioré tant la
survie que la qualité de vie des malades à des stades plus avancés…,
toutes affirmations qui ne sont pas encore acceptées dans les cas aux
Don et sacrifice en cancérologie
4. Les tests statistiques permettent d’affirmer que la différence entre les deux traitements
n’est pas due au hasard ; ils ne disent rien de l’importance de cette différence, et donc,
in fine
de l’intérêt du traitement.
5. Même en connaissant les chiffres, les malades et leur famille ne peuvent les croire : on ne
peut proposer un traitement qui ne fait qu’allonger la vie de quelques semaines. D’autant que,
pour préserver l’espoir essentiel à la survie psychique des malades, les médecins ont tendance
à tenir un discours toujours positif, laissant dans l’ombre les chiffres statistiques avérés et s’ap-
puyant sur des expériences individuelles exceptionnelles.
6. La présentation des chiffres contribue à obscurcir pour les malades et le public les
enjeux : un traitement qui permet une diminution de 50 % des rechutes semble incontournable,
mais si les rechutes n’arrivent que dans 10 % des cas, il n’est utile qu’à 5 % des malades et
95 % le reçoivent pour rien ce qui peut ouvrir un champ de discussion.
7. Le cancer ayant été enlevé et la chimiothérapie ayant pour objectif de diminuer le risque
de récidive ou d’allonger la durée de vie sans récidive.
3
a-Marin:Mise en page 1 8/06/07 14:53 Page 3

mêmes stades de cancer du poumon ou du pancréas. La généralisa-
tion de ces traitements entraîne un coût collectif d’autant plus impor-
tant qu’ils concernent un grand nombre de malades. Les contrôles mis
en place tentent uniquement de restreindre les traitements aux indi-
cations admises sans discuter du fonds même du problème et de l’op-
portunité d’allouer de telles sommes pour un bénéfice aussi réduit. Il
n’apparaît pas décent de discuter comme si l’enjeu était d’un tout
autre ordre.
La pratique assez généralisée de l’acharnement thérapeutique ali-
mente aussi nos interrogations. Alors même que les recommandations
officielles préconisent l’abstention pour peu que le malade soit trop
fatigué, certaines équipes entreprennent ou poursuivent des traite-
ments chez des malades amaigris, épuisés, ne quittant pas leur lit,
mourant dans les semaines qui suivent leur chimiothérapie. Les
malades et leurs familles en sont bien souvent conscients, instruits
par des exemples proches, refusant dans un premier temps un traite-
ment qui leur semble entraîner une mort certaine. Une étude améri-
caine8a pu montrer que 26 % des malades avaient reçu une chimio-
thérapie dans les trois mois précédant leur mort et 14 % dans leur
dernier mois de vie ; elle concluait sur la nécessité de limiter ces trai-
tements abusifs. Curieusement cette étude a attiré l’attention de la
presse9mais n’a eu aucune suite chez les médecins.
Autre étonnement, les malades bien souvent réclament cet achar-
nement, demandant une chimiothérapie même en toute connaissance
de cause : Mme D. porteuse de métastases cérébrales d’un mélanome
malin, tumeur méchante qui ne répond que très mal au traitement, est
suivie à la maison. Très lucide, elle désire surtout finir ses jours chez
elle, entre son mari et sa fille. Elle appelle un jour son médecin : « Il
faut me trouver une place dans une unité de soins palliatifs pour la
semaine prochaine ; je vais avoir une autre cure de chimiothérapie et
je sais que je ne vais pas m’en remettre. » Impossible de relever l’in-
cohérence du propos : pourquoi accepter un traitement que l’on sait
toxique, qui empêche même de vivre comme on le souhaitait ce qui
reste à vivre ? Toute discussion fut vaine : la malade devait se sou-
mettre à cette chimiothérapie, sans espoir d’amélioration, redoutant
les suites déjà expérimentées. Le traitement était de l’ordre de l’obli-
gation, imposé par une règle intériorisée.
La vie des services hospitaliers de cancérologie souffre de ces
paradoxes : les malades qui peuvent bénéficier de traitements lourds,
parce qu’ils peuvent les supporter sont en bonne forme générale et
Don et sacrifice en cancérologie
8. Ezekiel Emanuel
et al.
, “How Much Chemotherapy are Cancer Patients Receiving at the
End of Life?”, 37econgrès de la Société américaine d’oncologie clinique (ASCO), abs 953, 2001.
9. Paul Benkimoun, « Selon une étude américaine, certaines chimiothérapies sont données
inutilement »,
Le Monde
, 15 mai 2001.
4
a-Marin:Mise en page 1 8/06/07 14:53 Page 4

suivis en ambulatoire. Les malades hospitalisés sont évidemment mal
en point. Or, la vocation de ces services est de traiter le cancer et non
de soigner des malades en fin de vie, ce qui pousse à l’acharnement
que nous dénonçons. Tous les cancérologues se plaignent du nombre
important de décès dans leur service et se soucient de la démoralisa-
tion du personnel soignant. Beaucoup d’entre eux, nous l’avons dit,
ont réussi à transformer une grande partie de leur secteur en hôpitaux
de jour ou de semaine et n’ont gardé que quelques lits d’hospitalisa-
tion conventionnelle, alors encombrés par des malades « palliatifs ».
Ils réclament alors l’accès à des lits spécialisés de soins palliatifs,
qui permettraient de rendre moins visible l’inanité de nombre de trai-
tements sans les mettre en question.
Comment comprendre cette complexité, l’écart entre les discours et
les représentations et le silence relatif autour de ces questions : d’un
côté le discours officiel reste sinon triomphaliste – « nous allons
vaincre le cancer » – du moins très optimiste : « Le cancer est devenu
une maladie chronique, il faut apprendre à vivre avec10. » De l’autre,
les chiffres épidémiologiques sont toujours alarmants : augmentation
du nombre et de la mortalité du cancer, espérance de vie peu modi-
fiée malgré les progrès annoncés. De multiples facteurs intervien -
nent : les intérêts des uns et des autres (des laboratoires pharmaceu-
tiques, de la recherche, de l’émulation médicale), le refus de l’échec
et de l’impuissance du côté des médecins et, du côté de la société, la
cécité collective vis-à-vis de la mort et de l’incurabilité d’autant plus
exacerbée ici que le cancer est l’image même de la mort. Le montage
institutionnel permet également d’apaiser les contradictions : les chi-
miothérapies sont réalisées dans des services d’hôpitaux de jour et de
semaine qui ne peuvent pas prendre en charge les malades qui vont
mal, alors soignés dans d’autres services et par d’autres soignants ; les
cancérologues, peu nombreux, recentrent leur activité sur la prescrip-
tion des traitements dits spécifiques (chimiothérapie, radiothérapie)
et laissent souvent aux autres professionnels de santé le reste de la
prise en charge. Récemment, le concept de soins de support11 a offi-
cialisé cette partition ; ainsi division du travail et séparation des
lieux, permettent une vision parcellisée moins inquiétante. Il nous
semble que ces explications ne peuvent à elles seules être suffisantes
devant l’ampleur des enjeux économiques et institutionnels d’une
telle distorsion de la réalité. Nous voudrions ici proposer quelques
hypothèses peut être hasardeuses qui nous semblent donner un autre
Don et sacrifice en cancérologie
10. Il est assez rare en médecine de parler de maladie chronique quand la durée de vie
tourne autour de 12 à 36 mois.
11. L’organisation des soins de support regroupe l’ensemble des disciplines dont l’objectif
est d’améliorer le confort, la qualité de vie sans avoir pour visée la guérison même du cancer :
on y retrouve les traitements de la douleur, la psycho-oncologie, les soins palliatifs, la diété-
tique, la kinésithérapie, l’art-thérapie…
5
a-Marin:Mise en page 1 8/06/07 14:53 Page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%